Histoire du communisme
L'histoire du communisme recouvre l'ensemble des évolutions de ce courant d'idées et, par extension, celle des mouvances et des régimes politiques qui s'en sont réclamés. Le communisme se développe principalement au XXe siècle, dont il constitue l'une des principales forces politiques[1] : à son apogée, durant la seconde moitié du siècle, un quart de l'humanité vit sous un régime communiste[2].

Le concept d'une société égalitaire où la propriété privée serait abolie existe de très longue date dans la pensée utopiste : c'est à partir de la fin du XVIIIe siècle qu'il commence à être désigné par le mot communisme. Au début du XIXe siècle, l'idée de communisme devient une composante du socialisme : le terme est notamment revendiqué par Karl Marx et Friedrich Engels, qui publient en 1848 le Manifeste du parti communiste. Le marxisme, courant de pensée dérivé des œuvres de Marx et Engels, acquiert au cours du XIXe siècle une importance essentielle au sein de la mouvance socialiste ; quant au mot communisme, qui ne désigne pas alors un courant d'idées distinct, il continue de faire partie des vocabulaires socialiste et anarchiste, mais tombe en relative désuétude[3].
Le terme communisme revient en usage au XXe siècle, mais son emploi change alors radicalement, car en 1917, les bolcheviks, dont Lénine est le principal dirigeant et idéologue, prennent le pouvoir en Russie. L'année suivante, ils prennent le nom de Parti communiste ; l'Internationale communiste est constituée en 1919 et la mouvance socialiste se divise à l'échelle mondiale entre partisans et adversaires du nouveau régime russe[4]. Si des tendances opposées, comme la gauche communiste et plus tard le trotskisme, peuvent également se réclamer du communisme, l'Union des républiques socialistes soviétiques domine la mouvance de manière incontestée. Après la mort de Lénine, Joseph Staline s'impose comme le maître absolu de l'URSS et de l'Internationale communiste, achevant de mettre en place un régime politique particulièrement répressif et meurtrier. Le fonctionnement de l'URSS a par la suite servi de modèle aux autres régimes communistes, se caractérisant par une mainmise des partis communistes locaux sur le pouvoir politique, une économie étatisée, la présence massive de la police politique dans la société, et la surveillance des activités des citoyens[5].



.jpg.webp)
.jpg.webp)
Après la Seconde Guerre mondiale, une partie des pays européens, occupés militairement par l'URSS, deviennent des États communistes à parti unique et constituent le bloc de l'Est. En Asie, la République populaire de Chine est proclamée en 1949, après la victoire militaire du Parti communiste chinois dirigé par Mao Zedong. La guerre froide oppose durant plusieurs décennies les pays communistes — eux-mêmes progressivement divisés entre eux — au « monde libre » dont les États-Unis constituent la superpuissance dominante, rivale de l'URSS. Dans plusieurs démocraties européennes, comme la France et l'Italie, les communistes constituent une force électorale de premier plan et tiennent un rôle important dans la vie intellectuelle et culturelle. La mort de Staline et la déstalinisation qui s'ensuit à partir de 1956 amènent à révéler une partie des crimes du régime soviétique, altérant l'image de la mouvance communiste. Refusant la déstalinisation, la Chine de Mao rompt avec l'URSS, mais reste isolée. L'Union soviétique use ensuite de sa puissance militaire et politique pour empêcher toute réforme conséquente du monde communiste.

De nouveaux régimes communistes apparaissent aux Amériques (Cuba), en Asie et en Afrique. La pratique dictatoriale des États communistes — dont les exemples les plus célèbres sont, en Europe, l'écrasement de l'insurrection de Budapest, la construction du mur de Berlin, et la répression du Printemps de Prague — contribue cependant à faire perdre au modèle soviétique une large part de son attrait. La Chine maoïste subit elle aussi des désastres lors du Grand Bond en avant, puis de la Révolution culturelle. Par ailleurs, l'identité communiste continue d'être revendiquée par une partie de l'extrême gauche, qui cherche des formes alternatives au modèle soviétique. La sclérose économique et politique des pays communistes leur pose des problèmes croissants[6] : à partir de 1986, un vaste mouvement de réformes, connu sous le nom de perestroïka, tente de remédier à la situation. Cette libéralisation politique s'avère cependant insuffisante pour sauver le bloc de l'Est, et débouche au contraire sur l'effondrement des régimes communistes européens. L'URSS elle-même est dissoute à la fin de 1991. De nombreux partis communistes, ainsi que plusieurs régimes se réclamant de cette idéologie, continuent cependant d'exister. La République populaire de Chine, convertie à l'économie de marché mais toujours gouvernée par un parti communiste, tient un rôle de premier plan sur la scène politique internationale et dans l'économie mondiale.
Origines du communisme
Origines du courant d'idées

L'idée d'une société égalitaire et idéalement harmonieuse, fondée sur l'égalité absolue — ou sur certains degrés d'égalité — entre êtres humains, est très ancienne : elle est largement antérieure, aussi bien à l'apparition de la mouvance politique communiste qu'au mot « communisme » lui-même. En dehors des écoles de pensée occidentales, l'idéal d'une société fraternelle se retrouve aussi bien dans le confucianisme — tout particulièrement chez Mencius — que dans le taoïsme, le bouddhisme, ou certains courants de pensée de l'islam. Ces idéaux, qui inspirent des mouvements égalitaristes plus tardifs comme celui de la révolte des Taiping, peuvent être considérés comme constituant, en Orient, des ancêtres lointains et indirects du socialisme[7]. C'est néanmoins en Occident que se développent des précurseurs plus directs de la pensée égalitariste et de l'idée d'abolition de la propriété. Sous la Grèce antique, Sparte aurait offert un modèle de société pratiquant une forme de « communisme » : selon Plutarque, le législateur Lycurgue aurait résolu à Sparte le problème de l’inégalité foncière en amenant ses concitoyens à mettre leurs terres en commun et à en opérer la redistribution. Cette communauté intégrale des biens aurait uniquement concerné les citoyens spartiates de plein droit, c'est-à-dire l'élite de la cité : sa réalité n'est en outre pas certaine[8]. Le mythe de l'âge d'or tient ensuite un rôle important dans les constructions théoriques de l’école classique et hellénistique[9]. Platon imagine, dans La République, une cité idéale, divisée en trois classes : les travailleurs, les guerriers et les dirigeants. Parmi les dirigeants — l'élite de la cité — serait appliquée la mise en commun totale des biens, y compris celle des femmes et des enfants. On ignore cependant si Platon jugeait applicable cette idée utopique : dans Les Lois, il revient à un égalitarisme foncier rappelant davantage celui de Sparte, mais sous une forme plus souple[10].
La doctrine chrétienne met également l'accent sur le partage des biens matériels[11] : au fil des siècles, la notion d'une société égalitaire où la propriété privée — censée être la source de tous les vices — n'existerait pas, revient autant dans les travaux de penseurs chrétiens réformateurs que dans certaines hérésies, notamment sous la Renaissance dans des courants issus de l'anabaptisme. Des communautés établies en Moravie, dans la mouvance des Frères Moraves, pratiquent la fraternité communautaire et ne possèdent rien en propre[12]. Durant la guerre des Paysans allemands, le prêtre itinérant Thomas Münzer, idéologue millénariste, lève une armée de paysans et prône la constitution de « communautés de saints » où tout serait partagé. Défait militairement, il est exécuté en 1525[13]. Le millénarisme égalitaire réapparaît durant la décennie suivante, avec le mouvement anabaptiste conduit par Jan Matthijs, puis par son disciple Jean de Leyde. Inspirés par les idées de Münzer, les anabaptistes animent à Münster, de 1534 jusqu'à leur écrasement en 1536, un régime théocratique et égalitariste, fondé sur communauté universelle des biens et des personnes et comprenant la pratique de la polygamie[14].
Sur le plan des idées, le courant de pensée utopiste, qui se développe à partir de la Renaissance, exprime une critique sociale par le biais de la description de sociétés fictives, idéales et harmonieuses, où l'égalité parfaite aurait généralement été réalisée par la disparition de la notion de propriété. Le philosophe et théologien Thomas More signe en 1516 le livre Utopia, qui constitue le modèle du genre en décrivant une île où règneraient l'harmonie sociale et la communauté des biens matériels. Le moine Tommaso Campanella publie en 1602 La Cité du Soleil, ouvrage décrivant une cité idéale fondée sur l'égalité universelle, où la propriété n'existerait pas et où la famille serait remplacée par un système d'éducation communautaire. Les ouvrages de More et de Campanella, fondateurs du courant utopiste, s'inspirent nettement de La République de Platon[15],[16],[17],[11]. L'imaginaire utopique continue par la suite de nourrir une critique radicale de la propriété privée, présente à des degrés divers dans les œuvres d'auteurs des Lumières : en France, le curé Meslier, Morelly et Dom Deschamps posent une partie des principes et idéaux d'égalité et d'harmonie sociale, repris par la suite par le socialisme et par le communisme[18]. En Grande-Bretagne, William Godwin, dont les idées sont empreintes d'un ascétisme à la fois puritain et individualiste jette les bases d'une forme de « communisme anarchiste » en prônant une organisation sociale sans État ni gouvernement[19].
En France sous le Directoire, Gracchus Babeuf mène en 1796 la conjuration des Égaux : sa pensée, héritière directe de la Révolution française, est particulièrement proche du communisme au sens contemporain du terme[20]. Pour l'historien Michel Winock, « Babeuf et le babouvisme offrent le premier exemple de communisme appliqué, à la fois comme idéologie et comme action révolutionnaire ». Sur le plan idéologique, Babeuf préconise une société fondée sur l'égalité de fait, l'administration commune et l'abolition de la propriété particulière. Sur le plan organisationnel, il articule ses aspirations à une pratique révolutionnaire de type nouveau, celle de l'organisation d'un coup de force par un parti clandestin. La préparation de l'insurrection est ainsi confiée par les babouvistes à un état-major secret, la « révolution communiste » devant se faire par la dictature d'une minorité. Pour Winock, la méthode de Babeuf annonce celles de Blanqui et de Lénine ; de manière plus générale, il voit dans la Révolution française la prémisse de plusieurs éléments du socialisme et du communisme, sur le plan des idées comme à celui de la pratique : pour ce qui est de l'exercice du pouvoir, avec le gouvernement révolutionnaire et les mesures d'exception du Comité de salut public que sont la Terreur et l'instauration d'une dictature « provisoire » en raison des circonstances ; pour ce qui est de l'usage du contre-pouvoir avec la pression « populaire » exercée par les sans-culottes ; Babeuf amenant quant à lui, fût-ce au niveau théorique, une technique de la prise du pouvoir[4],[21],[22].
Philippe Buonarroti, compagnon de Babeuf, s'emploie dans les décennies suivantes à entretenir et diffuser les idées babouvistes. La doctrine et la pratique politique de Babeuf constituent une origine directe de la notion contemporaine de « communisme », l'égalitarisme, la propriété commune et la redistribution des richesses étant alliés à l'usage de tactiques militantes et révolutionnaires pour prendre le pouvoir[23].
Indépendamment du courant d'idées européen, le XIXe siècle voit se dérouler, en Chine, la révolte des Taiping, mouvement fondé sur un mélange de pensée chinoise et de christianisme hétérodoxe, qui prône l'établissement d'une société théocratique strictement égalitaire (l'égalitarisme taiping se révélant très théorique en ce qui concerne les dirigeants du mouvement). Les Taiping sont plus tard récupérés par diverses écoles de pensée chinoises, dont les communistes, qui les présentent comme des précurseurs[24].
Formation du terme
Le terme « communisme » vient du latin communis formé du préfixe com- signifiant « avec » et d'une racine dérivée du substantif munus renvoyant au « devoir », à l'« office », à l'« emploi », mais pouvant aussi signifier la « fonction » ou la « tâche ». Ce substantif est lui-même issu d'une racine indo-européenne mei signifiant « changer », « aller », « échanger » et dont les dérivés (monnaie, municipalité, immunité, etc.) se réfèrent aux échanges de biens et services dans une société selon les lois et les règles établies. À cette racine préfixée s'adjoint le suffixe « -isme » désignant une « doctrine »[25].
Le mot communiste est antérieur à celui de communisme. Il apparaît dès le XIIe siècle et désigne alors le membre d'une communauté de mainmorte, forme de propriété féodale reposant sur le servage[26]. S'il ne renvoie pas alors à la notion de communauté de biens, ce sens est pris en charge par plusieurs termes connexes. Communelli au XIIIe siècle, puis Communicantes au XVIe siècle « situent très exactement les origines théoriques des doctrines communautaires anciennes »[26]. Ils font référence aux membres de sectes chrétiennes qui mettaient en commun une partie, voire la totalité, de leurs biens. En 1569, un pamphlet polonais faisant état de luttes internes entre anabaptistes et frères moraves, utilise le terme de communista en lui donnant le sens de partisan de la communauté des biens. Cet usage est repris au début du XVIIe siècle dans plusieurs textes néerlandais, puis disparaît complètement après 1650. Ces emplois sporadiques révèlent que les dérivés de commun et de communauté impliquaient de longue date la notion moderne de communisme, sans que cette acception parvienne à s'implanter durablement avant le XIXe siècle[27].
Au cours de la seconde moitié du XVIIIe siècle, le terme communista est introduit dans deux langues vernaculaires : le français et l'italien. Un traité de Victor de Mirabeau emploie en 1766 communiste dans son sens médiéval de « membre d'une communauté de mainmorte »[28]. À la fin des années 1770, son équivalent italien, communisti, désigne l'habitant d'une commune rurale[28]. Selon l'historien Jacques Grandjonc, le terme semble avoir connu une certaine fortune dans l'aire géographique Provence-Alpes-Toscane. Tout au long du XIXe siècle, il y est mobilisé pour caractériser de nombreux statuts liés à la vie en communauté : député, copropriétaire, détenteur de biens communaux etc[28].

L'écrivain Restif de la Bretonne semble avoir joué un rôle décisif dans l'évolution sémantique du concept. En 1785, il publie la lettre d'un propriétaire terrien et philosophe provençal, Victor d'Hupay, qui se déclare « communiste »[28]. D'Hupay est l'auteur du livre Projet de communauté philosophe (1777), qui décrit un idéal de vie en collectivité[29] : il y reprend plusieurs conceptions platoniciennes et se dit favorable à une éducation « communautaire », détachée au moins partiellement du cercle familial. L'idéal philosophique de d'Hupay demeure assez imprécis, mais « la leçon de langage n'a pas été perdue pour Restif »[30]. Écrit et publié en 1795, le livre de Restif Monsieur Nicolas multiplie les occurrences de communiste et crée le terme français de communisme. Les deux mots se rapportent à une idéologie politique précise : le babouvisme, soit la pensée de Gracchus Babeuf[30].
Le terme allemand Kommunismus serait peut-être antérieur. En , le poète Friedrich Hölderlin rédige un court essai intitulé Du communisme des esprits (Communismus der Geister), à la suite d'une conversation avec le philosophe Georg Wilhelm Friedrich Hegel[31]. L'authenticité de cet essai a été discutée, même si l'orthographe employée (un C pour Communismus) plaide en faveur d'une datation antérieure au XIXe siècle[32]. La notion de communisme est employée dans un sens assez christianisant : « communauté de tous les esprits qui vivent dans une même foi, dans un même monde, parce que cette foi et ce monde expriment un même « esprit » : une communauté du divers impliquée dans l'identité du tout »[31]. Ce communisme spirituel possède sans doute certaines implications matérielles. À plusieurs reprises, Hölderlin s'est déclaré favorable à une mise en commun des biens. Dans son roman épistolaire Hyperion, il décrit le futur État libre sous le prisme de la maxime suivante : « Tout pour tous et chacun pour tous »[33],[34]. Au cours de la décennie 1790, Kommunismus semble avoir continué de circuler. Un procès-verbal autrichien rend ainsi compte des positions d'un jacobin viennois, Andreas Riedel, qui souligne que, « si le terme existait », il qualifierait sa doctrine de Kommunismus[30].
À peine formalisés, les mots communiste, communisme et Kommunismus disparaissent. Le Consulat, l'Empire et la Restauration « vont voir affleurer d'autres intérêts, d'autres vocables »[30]. En 1827, le journal britannique Co-operative Magazine qualifie le socialisme de Robert Owen de système « social, coopératif et communioniste »[35]. Les deux termes ne réapparaissent cependant vraiment qu'en 1839. Héritière du babouvisme, la Société secrète des travailleurs égalitaires rattache communiste à la notion de prolétaire révolutionnaire[30]. Le 1er juillet 1840 se tient à Belleville un « banquet communiste », animé par Richard Lahautière et qui attire environ 1200 participants, en majorité des ouvriers[36] ; l'événement contribue à la diffusion du terme dans la presse française et internationale[30]. John Goodwyn Barmby, correspondant de la revue socialiste anglaise New Moral World, forge communist et communism, rapidement repris dans la presse britannique[37]. L'Allgemeine Zeitung d'Augsburg traduit les comptes-rendus parisiens du banquet en réactualisant Kommunist. Kommunism n'est réintroduit dans un texte écrit allemand qu'en 1841, même si le terme était déjà oralement employé dans la Ligue des justes l'année précédente[37]. Dans les années 1840, le substantif communauté est en compétition dans l'usage avec le terme abstrait communisme. En revanche, l'adjectif communiste semble avoir rapidement supplanté le terme alternatif de communautaire. En 1845, Engels parle encore des communistes comme du « parti de la communauté » (Gemeinschaft Partei) ; Proudhon parle indifféremment des « communautaires », des « partisans de la communauté », des « communistes » ou du « communisme », visant généralement les partisans de Cabet mais également, à l'occasion, les « communistes allemands », c'est-à-dire ceux de Marx[38].
Naissance du socialisme


Au début du XIXe siècle, la révolution industrielle en Europe et les bouleversements qui l'accompagnent entraînent, tout d'abord en France et au Royaume-Uni, le développement des idées socialistes. Ce courant anticapitaliste, qui vise à résoudre la question sociale en améliorant la condition de la classe ouvrière, se pose progressivement en expression politique du mouvement ouvrier. Le vocable de communisme, que certains auteurs et militants préfèrent d'ailleurs à celui de « socialisme », devient partie intégrante du courant dit du « socialisme utopique » (entendu comme socialisme pré-marxiste) qui envisage une réorganisation complète de la société afin de promouvoir l'égalité entre les individus[39]. L'entrepreneur et philosophe britannique Robert Owen préconise, pour résoudre les problèmes nés de l'individualisme capitaliste, une nouvelle organisation de la société via la constitution de communautés — des « villages de coopération » de 500 à 2 000 personnes, formés de groupes égalitaires d'ouvriers et de cultivateurs organisant leur auto-suffisance sur le modèle coopératif. Dans les années 1820, Owen fonde plusieurs communautés de ce type, dont la plus célèbre est celle de New Harmony, aux États-Unis. L'échec de ces projets n'empêche pas leur instigateur de connaître une grande renommée : jusqu'aux années 1840, l'« owenisme » compte de nombreux disciples[40],[41].
Les questions du travail et de la propriété privée inspirent à de nombreux penseurs de la famille socialiste des écrits radicaux. Charles Fourier — qui ne se présente pas lui-même comme communiste[42] — préconise non pas la suppression de la propriété, mais sa réforme via l'organisation de la société en phalanstères fondés sur la libre association et l'harmonie. Pierre-Joseph Proudhon, tout en s'opposant lui aussi au courant communiste par hostilité à l'idée de communauté[43], contribue à rendre célèbre le dicton « La propriété, c'est le vol » dans son ouvrage Qu'est-ce que la propriété ? (1840)[44]. Louis Blanc n'envisage pas la disparition de la propriété privée, mais sa généralisation par la coopération et l’association : dans son ouvrage Organisation du travail (1839), il prône une réorganisation du monde du travail au sein d'« ateliers sociaux » qui annoncent, comme par ailleurs les idées de Proudhon, les principes de l'autogestion[45] ; Blanc utilise également l'adage « De chacun selon ses facultés, à chacun selon ses besoins » : cette formule également présente chez Cabet et censée représenter l'idéal d'une société socialiste ou communiste, connaît, sous diverses variantes, une grande fortune au temps du socialisme utopique ; elle sera ensuite reprise par Marx, ainsi que par des penseurs anarchistes comme Kropotkine[46].
Au sein du mouvement socialiste, le terme de communistes tend à désigner un ensemble de tendances radicales, au point qu'Engels peut écrire en 1890 que « le socialisme signifiait en 1847 un mouvement bourgeois, le communisme un mouvement ouvrier ». L'appellation communistes distingue plus particulièrement les socialistes insistant sur la réalité de la lutte des classes et ne comptant pas sur la bonne volonté des classes dominantes pour parvenir à une autre organisation de la société. On retrouve des communistes dans le courant d'idées « néo-babouviste ». Les socialistes communistes tendent, en France, à se réunir au sein de sociétés secrètes et prennent part à des insurrections : certains connaissent la prison. Malgré un radicalisme commun, le mot recouvre, dans les années 1840, des courants d'idées assez divers au sein de la famille socialiste[47]. Babeuf demeure pour cette mouvance une figure mythique, mais la référence qui est faite à son œuvre et à son action demeure souvent superficielle : les divers théoriciens et militants qui se réclament de lui avec insistance tendent souvent, dans les faits, à se démarquer de ses idées[48].
Le blanquisme
Auguste Blanqui, qui compte parmi les disciples de Babeuf, en a principalement retenu le principe de la prise du pouvoir par un coup de force[48] : il participe à de nombreuses conspirations, ses multiples séjours en prison lui valant un statut légendaire dans les milieux révolutionnaires. Son nom donne naissance au courant du blanquisme, pour lequel la révolution doit être provoquée par un petit groupe organisé de militants qui donnerait l'impulsion au peuple[49]. Homme d'action plus que théoricien, Blanqui envisage une révolution violente, qui se traduirait par une dictature du prolétariat où le peuple serait armé au sein d'une milice nationale. Le passage progressif à une société communiste se ferait en diffusant l'éducation au sein du peuple et en luttant contre les religions, perçues comme des instruments d'oppression[50].
C'est l'échec politique de Blanqui — dont la tentative d'insurrection, en 1839, vire au fiasco — qui tend à sonner le glas d'une certaine mythologie révolutionnaire. L'idée « communiste » est alors essentiellement reprise par des intellectuels, qui n'envisagent pas de la réaliser par une révolution violente ou par l'action clandestine[48].
Le socialisme utopique
Au début des années 1840, les « communistes » français visent non plus à prendre le pouvoir mais à éduquer le peuple en diffusant la doctrine par le biais de la propagande, et en proposant une étude de la société à visées « scientifiques » qui se baserait sur une « connaissance objective de la nature humaine »[48]. La tendance communiste la plus influente est alors, en France, celle de l'intellectuel chrétien Étienne Cabet, au point que la paternité du mot communisme a été attribuée à ce dernier[51],[52]. Cabet, inspiré par More, Rousseau et Owen, publie en 1840 le livre Voyage en Icarie dans lequel il décrit une société idéale dans la tradition utopique de More ou de Campanella ; la même année, il publie la brochure Comment je suis communiste. Dans ses livres et dans son journal Le Populaire, il prône le passage progressif à une société égalitaire et de propriété commune, gouvernée par le biais de la démocratie directe : pour lui, tout véritable chrétien est forcément communiste car Jésus-Christ prescrit « la communauté »[53]. Dans les années suivantes, Cabet, qui a convaincu de nombreux adeptes, se lance aux États-Unis dans l'expérience de diverses communautés sur le modèle de l'Icarie[49]. L'expédition des « icariens », victimes d'une nature hostile et de leur mauvaise organisation, tourne cependant vite au désastre, et les diverses communautés inspirées des idées de Cabet disparaissent avec le temps[54],[48]. D'autres expériences communautaires, à fondement purement religieux, existent par ailleurs à la même époque aux États-Unis, comme les colonies Amana fondées par des Allemands piétistes, ou les communautés Shakers. Ce courant de pensée et ces communautés religieuses refusant la propriété privée sont désignés sous l'expression générique de communisme chrétien[55],[56].
Un autre courant communiste que celui de Cabet, lié plus directement à la tradition révolutionnaire et à l'héritage babouviste, se retrouve en France chez des intellectuels comme Richard Lahautière, Théodore Dézamy, Jean-Jacques Pillot ou Albert Laponneraye. Les théoriciens ne se montrent pas forcément précis quant au mode de passage de la société capitaliste à la société communautaire[49]. Dézamy et Pillot, rejetant toute idée de coup d'État, s'emploient à faire connaître leurs idées via des initiatives comme le « banquet communiste » organisé à Belleville en 1840. L'éphémère journal L'Humanitaire tente également de diffuser en France les idées communistes, en prônant une « science sociale » qui serait « entièrement conforme à l'organisme humain ». Bien que leurs idées soient souvent divergentes, le point commun de la plupart de ces intellectuels communistes français est de viser la construction d'une nouvelle société, qui imiterait la solidarité naturelle du corps humain[48].
Le courant communiste ne se limite pas aux seuls socialistes français : en Allemagne, les idées socialistes pénètrent avec un certain retard et touchent d'abord principalement les milieux intellectuels, influencés par les courants français. C'est à travers un ouvrage de Lorenz von Stein, Le socialisme et le communisme dans la France contemporaine (1842) que les Allemands acquièrent une connaissance approfondie des doctrines venues de l'étranger. Entretemps, divers courants ont fait leur apparition : en 1836, à Paris, des socialistes allemands en exil fondent, à l'initiative de Wilhelm Weitling, la Ligue des justes, qui compte des membres dans plusieurs pays (Suisse, Royaume-Uni…). Weitling prône un communisme empreint d'un mysticisme chrétien comparable à celui des anabaptistes du XVIe siècle : croyant à une révolution sociale qui résulterait d'un mouvement de masse et détruirait la puissance de l'argent, il présente le prolétariat comme l'instrument désigné de l'affranchissement de l'humanité. Karl Schapper, l'un des membres de la Ligue, publie en 1838 l'ouvrage La Communauté des biens, dans lequel il décrit la fin de la propriété privée comme la condition de toute démocratie ; il anime également à Londres la Société communiste de formation ouvrière (Kommunisticher Arbeiterbildungsverein) qui constitue une foyer actif de militantisme socialiste. L'idéologie communiste ainsi diffusée demeure voisine de l'« icarisme » d'Étienne Cabet et compte sur la « raison » et la « discussion pacifique » pour faire triompher ses principes[57].
Les idées socialistes s'enracinent notamment chez les intellectuels allemands à la faveur de la radicalisation du courant des jeunes hégéliens (ou hégéliens de gauche). Ces derniers, athées et matérialistes, réfutent notamment l'idée des hégéliens conservateurs selon laquelle la société prussienne représente un aboutissement de l'Histoire : pour les jeunes hégéliens, la société est au contraire appelée à évoluer et à se réformer jusqu'à parvenir à un degré d'organisation toujours plus juste et rationnel[58]. Moses Hess, futur penseur du sionisme, vise à transformer la méthode de Hegel en philosophie de l'action : il imagine en 1837 dans son Histoire sacrée de l'humanité un régime de fraternité morale et de communauté de biens qui serait une « nouvelle Jérusalem » où l'homme retrouverait sa vraie nature sur la base de l'altruisme. Pour Hess, le communisme est « la loi vitale de l'amour, transportée dans le domaine social »[59].
Le Manifeste du parti communiste

La Ligue des justes est reprise en main en 1846 par Joseph Maximilian Moll et Karl Schapper. La section londonienne de la Ligue la détourne du communisme « philosophique et sentimental » qui avait été le sien sous l'influence de Weitling. En juin 1847, la Ligue des justes prend le nom de Ligue des communistes, sous l'impulsion de Karl Marx et Friedrich Engels. Tout d'abord liée à la Société des saisons blanquiste, elle affiche d'emblée un credo internationaliste en substituant à sa précédente devise « Tous les hommes sont frères » le nouveau mot d'ordre « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ! » ; en février 1848, Marx et Engels publient la « profession de foi » du mouvement, intitulée Manifeste du parti communiste. Si le Manifeste n'a pas dans l'immédiat une influence notable[60], sa parution a, à moyen terme, de profondes conséquences sur le mouvement socialiste et sur la notion de communisme. Marx et Engels posent les bases d'une conception à visées scientifiques du socialisme et de l'analyse sociale en général, affirmant une orientation nettement révolutionnaire. Proches dans leur jeunesse des jeunes hégéliens, ils rejettent les conceptions chrétiennes du communisme, et prônent au contraire un athéisme militant[61]. Pour Marx et Engels, le communisme doit cesser d'être une construction abstraite, pour constituer au contraire « le mouvement réel qui abolit l'état actuel »[48].
En 1848, dans le contexte du « Printemps des peuples », le mot « communisme » est devenu suffisamment connu pour que l'essayiste français Alfred Sudre publie, afin de dénoncer le courant d'idées dans son ensemble, l'ouvrage Histoire du communisme, ou réfutation historique des socialistes : y sont notamment englobés sous le vocable « communiste » Platon, Sparte, l'anabaptisme, Owen, Saint-Simon, Fourier et Proudhon. Il n'y est fait aucune mention de Marx[62]. L'année suivante, Adolphe Thiers publie la plaquette Du communisme, dans laquelle il attaque conjointement Marx et Proudhon[63].
Le communisme de Marx
Karl Marx indique dans la préface de l'Introduction à la critique de l'économie politique qu'il s'est rallié aux doctrines socialistes et communistes vers 1842-1843. Collaborateur d'une gazette libérale, la Rheinische Zeitung, il effectue à cette époque une série de reportages, sur les délits forestiers en Moselle, qui le sensibilise aux questions sociales[64]. Parallèlement, la gazette diffuse « un écho affaibli, pour ainsi dire philosophique, du socialisme et du communisme français »[65]. En 1843, sa parution est suspendue par les autorités prussiennes. À la suite de cette censure, Marx radicalise ses positions. Il estime désormais que l'action politique ne suffit pas pour changer la société : il est nécessaire d'en passer par une restructuration complète des rapports économiques[64].
Échaudé par la répression prussienne, Marx émigre en France en . Pendant son séjour parisien, il se familiarise avec les diverses idéologies et théories révolutionnaires qualifiées, parfois indistinctement, de socialiste ou de communiste. Témoignant de ces multiples influences, les Manuscrits de 1844, ou « Manuscrits de Paris », définissent le communisme comme une société de liberté complète[66]. Par contraste avec la démocratie libérale, la démocratie communiste repose sur un consensus permanent entre l'ensemble de ses membres : il n'y a ni représentants, ni élections périodiques[67]. Le pouvoir du peuple est constant. Par contraste avec l'économie capitaliste, l'économie communiste refuse la division du travail et permet à chaque individu d'exercer le métier qu'il souhaite à n'importe quel moment[67]. Ce premier communisme de Marx tranche avec le communisme plus radical des babouvistes. Il s'inscrit davantage dans un courant romantique et utopique marqué par le socialisme de Charles Fourier ou les conceptions de son ami Heinrich Heine[67].
Par-delà ces emprunts, Marx développe une synthèse originale : son communisme est un communisme historique qui trouve une place définie dans l'évolution sociale de l'humanité. Il ne vise pas à remplacer le système capitaliste, mais à lui succéder, en accord avec la logique dialectique du développement économique[68]. Cette succession ne peut pas intervenir à n'importe quel moment : la société doit avoir atteint un stade où ses contradictions internes deviennent insurmontables. Concrètement, en détruisant et en assimilant les petites structures commerciales, l'industrialisation empêche l'émergence d'un marché stable : la surproduction devient systématique ; les conditions des masses s'égalisent et se retrouvent imbriquées dans un destin commun ; le prolétariat universel est prêt à faire sa révolution[69]. Dans la mesure où l'économie de marché représente un état antérieur au communisme, ses acquis et caractéristiques fondamentaux ne disparaîtront pas, mais seront absorbés dans une organisation supérieure[69]. Les méthodes de travail rationnelles mises au point par la bourgeoisie seront ainsi reprises et systématisées par le prolétariat. Le Manifeste du parti communiste de 1848 décrit ainsi une armée industrielle qui agit en concordance avec un plan commun[69].

Ici se dessine l'une des principales contradictions du communisme de Marx, qui témoigne de la pluralité de ses influences originelles[69]. La description inactuelle de la société communiste dans les Manuscrits de 1844 décrit des rapports sociaux fondés sur des choix individuels toujours fluctuants. Inversement, le récit dynamique de la succession des infrastructures sociales établit une continuité entre les méthodes de production capitalistes et communistes, en particulier en ce qui a trait à la division du travail[70]. On voit ainsi se concilier deux ou trois approches différentes du communisme. L'historien David Priestland distingue ainsi un communisme romantique (fondé sur la cohabitation spontanée d'individus entièrement libres), un communisme radical (fondé sur la révolte du prolétariat) et un communisme moderniste (fondé sur une administration centralisée)[70]. Après l'échec des mouvements révolutionnaires de 1848, Marx et, plus particulièrement, son collaborateur Friedrich Engels tendent à privilégier l'approche moderniste. Assez marqués par la biologie darwinienne, ils cherchent à donner à leurs travaux une caution scientifique[71]. L'observation attentive des échanges économiques et sociaux et la déduction des lois de l'histoire prennent l'ascendant sur les spéculations romantiques. Le communisme conçu comme conséquence logique des déséquilibres du capitalisme est objectivé et rationalisé. Il s'agit désormais du produit d'une association entre des techniciens planificateurs et des exécutants[72]. Ce système n'est plus tant apprécié pour sa liberté que pour son efficacité, sa capacité à mettre un terme aux progrès et régressions erratiques de l'économie de marché[71]. À la fin de sa vie, Marx tente néanmoins de concilier les approches modernistes et romantiques en distinguant plusieurs stades internes au développement de la société communiste[73]. La dictature du prolétariat assure d'abord le renversement complet de la bourgeoisie et de ses institutions. S'ensuit une phase de bas-communisme (que les bolcheviques qualifieront de socialisme réel) qui correspond au communisme moderniste : des techniciens contrôlent rationnellement la production. Enfin, ce processus graduel s'achève par le haut-communisme, stade ultime où la société se perpétue sans aucune coercition ; devenu inutile, l'État se désagrège[73].
En tant qu'objet historique, le communisme pose un problème d'un autre ordre : celui de sa réalisation. Marx élabore un schéma de succession assez précis : initialement la société féodale, puis la révolution libérale, la société bourgeoise, la dictature du prolétariat et enfin la société communiste. Toutefois, il ne donne aucune temporalité précise. Si l'ordre est immuable, ses diverses phases peuvent se moduler[73]. Pendant les révolutions de 1848, Marx s'interroge ainsi sur le cas de l'Allemagne. Autant la révolution communiste lui paraît imminente en France, autant la société allemande demeure archaïque : elle n'a pas encore fait sa révolution bourgeoise et reste dominée par des structures féodales[74]. Marx incite en conséquence les communistes allemands à se placer dans une double perspective : celle, prochaine, de la révolution bourgeoise et celle, lointaine, de la révolution communiste. Concrètement, le prolétariat doit faciliter l'avènement d'une démocratie parlementaire sans perdre de vue son propre destin[74]. À côté de ces accélérations, Marx admet également des raccourcis. En 1881, il affirme à la socialiste russe Vera Zassoulitch que les communautés agraires rendent possible une révolution communiste immédiate dans l'empire tsariste[75]. Généralement réticent à spéculer sur l'avenir, il laisse ainsi subsister plusieurs ambiguïtés et incertitudes dans son schéma historique. Celles-ci vont alimenter de multiples débats idéologiques à la fin du XIXe et au début du XXe siècle[75].
Diffusion du socialisme et du marxisme
.png.webp)
De la première à la deuxième Internationale
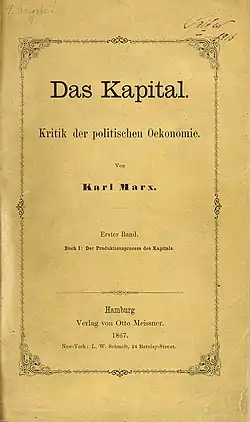
L'échec du printemps des peuples n'entrave que temporairement le développement des mouvements socialistes et ouvriers et le contexte politique plus libéral des années 1860 favorise par la suite leur officialisation. Au cours du XIXe siècle, le développement du mouvement socialiste accompagne, de manière plus ou moins étroite selon les pays, celui du syndicalisme en Europe. En 1864, plusieurs organisations socialistes européennes tentent de s'accorder au sein de l'Association internationale des travailleurs (ou Première Internationale). Ses statuts provisoires sont conçus et rédigés par Marx[76] ; ce dernier ne parvient cependant pas à empêcher l'émergence de multiples clivages. Les syndicats anglais ne rompent pas leurs liens politiques avec le Parti libéral et défendent une approche pragmatique d'amélioration graduelle de la condition ouvrière[76]. Inversement, des anarchistes comme Mikhaïl Bakounine ou Pierre-Joseph Proudhon dénoncent les tendances autoritaires et les prétentions scientifiques du marxisme ; ils privilégient une forme de socialisme décentralisé qui exclut tout recours à une élite technocratique[77]. Aucune de ces tendances ne se qualifie alors de communiste : le terme tend à perdre sa connotation idéologique pour être remplacé par de nouveaux concepts comme la social-démocratie qui devient, dans une partie des pays européens, le synonyme de socialisme au sens de mouvement politique organisé[77],[78].

Des membres de l'Internationale participent à la Commune de Paris : si la plupart d'entre eux ne sont pas des disciples de Marx, mais plutôt de Proudhon ou de Blanqui, Marx et Engels considèrent avec intérêt cette expérience de démocratie participative active. Marx parle de « gouvernement de la classe ouvrière », Engels écrivant pour sa part, en 1891, que la Commune était l'application de la dictature du prolétariat[79],[80],[81],[82]. L'expérience de la Commune de Paris représente, dans l'imaginaire socialiste et, plus tard, communiste, un puissant souvenir historique et l'image d'une véritable tentative de gouvernement révolutionnaire : de nombreuses familles politiques revendiquent ensuite sa filiation[83]. Le soutien de Marx à la Commune, par son texte La Guerre civile en France, contribue également à l'époque à populariser la figure de ce dernier auprès d'un public élargi[80] à l'époque même où l'Internationale commence à se disloquer, avec notamment la scission entre les partisans de Marx et les anarchistes conduits notamment par Mikhaïl Bakounine ; les anarchistes, opposés aux conceptions « autoritaires » de Marx (les marxistes étant considérés comme les champions d'une forme de « communisme étatique »[84]), se retrouvent par la suite chez les collectivistes libertaires (ou « anarcho-collectivistes ») disciples de Bakounine et les anarcho-communistes (ou « communistes libertaires ») inspirés par la pensée d'auteurs comme Pierre Kropotkine ou Errico Malatesta. L'anarcho-communisme, qui nie toute notion de propriété publique, déborde l'anarcho-collectivisme vers la fin des années 1870 : par la suite, après avoir parfois dégénéré dans l'exercice d'une violence gratuite via la forme terroriste de la « propagande par le fait », il évolue lui-même vers la pratique anarcho-syndicaliste. Ce n'est qu'en 1896 que les socialistes anarchistes sont définitivement exclus de l'Internationale ouvrière[85],[86]. En Amérique latine, les idées socialistes libertaires se diffusent notamment à la fin du XIXe siècle par l'intermédiaire de l'émigration européenne, surtout italienne — Malatesta, exilé en Argentine, y publie le journal bilingue La Question sociale — et des milieux anarcho-syndicalistes, en l'absence dans un premier temps d'organisations socialistes structurées. En 1878, au Mexique, un groupe d'anarcho-communistes crée un « Partido Comunista Mexicano » : un mouvement communautaire naît dans la vallée de San Martín Texmelucan, où des paysans se partagent les terres, jusqu'à ce que l'armée intervienne et écrase l'« émeute communiste »[87].
La deuxième révolution industrielle qui s'amorce à la fin des années 1870 en Europe paraît confirmer les analyses et les prédictions de Marx : les industries deviennent de plus en plus importantes ; la condition ouvrière se généralise au détriment de la paysannerie et de l'artisanat ; les conflits sociaux et les inégalités économiques s'exacerbent[88]. Dans les dernières décennies du XIXe siècle, la pensée de Marx donne naissance au marxisme, vaste courant d'idées marqué par le matérialisme (aux sens historique et dialectique du terme) et l'athéisme[89], qui s'impose progressivement comme une idéologie de référence des mouvements socialistes, au détriment de celles de Proudhon ou Bakounine. Le degré d'influence du marxisme est inégal selon les pays mais en Allemagne et en Autriche (où naît au début du XXe siècle le courant dit de l'« austromarxisme »), de même qu'en Russie, il occupe une position dominante au sein de la famille de pensée socialiste[90].
L'Allemagne récemment unifiée est le terrain privilégié de la diffusion théorique et politique du marxisme. Le Parti social-démocrate d'Allemagne (Sozialdemokratische Partei, ou SPD) naît initialement d'un compromis entre le « socialisme de la chaire », plutôt pragmatique, inspiré des conceptions de Ferdinand Lassalle et le socialisme ouvrier marxisant d'August Bebel. Ce compromis s'incarne dans le Programme de Gotha, qui est vivement critiqué par Marx et Engels. Toutefois, condamné à la clandestinité par la Loi contre les socialistes (Sozialistengesetz) de 1878, le Parti se radicalise : « l’idée de la lutte des classes gagne du terrain au détriment des conceptions lassalléennes »[91]. Cette radicalisation ne concerne pas que l’électorat. Formée en partie par Engels, la nouvelle élite intellectuelle du Parti se rallie ouvertement aux doctrines marxistes[92]. En 1891, la Loi contre les socialistes est abrogée en Allemagne. Elle n'est pas parvenue à enrayer l’essor du Parti qui représente désormais 20 % de l’électorat[91]. Afin de se restructurer, le Parti convoque un congrès à Erfurt. Le « programme d'Erfurt », qui en ressort, reprend tous les grands thèmes du Capital : l'aliénation du travail ouvrier, la lutte des classes, les contradictions insolubles du capitalisme bourgeois…[93]. Fortement liée aux syndicats qui se développent en Allemagne après la fin des lois d'exception et surtout le départ de Bismarck en 1890, la social-démocratie allemande, très puissante, constitue une véritable « contre-société ouvrière » et tend au monopole de la représentation du mouvement ouvrier en Allemagne[94].
Les mouvements socialistes ne sont à nouveau fédérés qu'en 1889, lors de la fondation de l'Internationale ouvrière (ou Deuxième Internationale). Si le marxisme y est largement représenté, les nuances idéologiques et les dissensions tactiques sont nombreuses entre les partis[95].
Querelle entre réformistes et révolutionnaires
.jpg.webp)
Progressivement, de nouveaux clivages émergent au sein même du marxisme. L'un des principaux idéologues du SPD, Eduard Bernstein, développe une approche théorique nouvelle : le réformisme. Dans son optique, le marxisme est une science et, en tant que science, il doit se conformer aux données immédiates de l'observation socio-économiques[96]. Plusieurs prédictions du Capital ne se réalisent pas : la classe moyenne, en particulier, résiste à toute absorption par le prolétariat ou la bourgeoisie[97]. Ce renversement épistémologique a d'importantes conséquences politiques : le socialisme ou le communisme désignent désormais un processus plutôt qu'un état précis. Bernstein qualifie ainsi rétrospectivement de communistes plusieurs hommes politiques anglais du XVIIe siècle[98]. Pour Bernstein, le mouvement socialiste doit renoncer à l'idée de lutte des classes, cesser de se penser comme le parti du prolétariat en devenant un vaste parti démocratique qui représenterait également les classes moyennes, et proposer non plus une révolution mais simplement des réformes visant à une plus grande justice sociale. La diffusion de ce réformisme suscite au sein du SPD l'important débat dit de la « querelle réformiste » (Reformismusstreit) et entraîne par contre-coup l'avènement d'un anti-réformisme. En 1899, un congrès est organisé à Hanovre pour statuer sur l'orientation générale du Parti : l'option réformiste est rejetée par 216 voix contre 21[99]. Ce rejet massif des thèses « révisionnistes » dissimule un important clivage interne. La direction du Parti critique les théories de Bernstein sur un plan tactique, August Bebel et Karl Kautsky se faisant les champions de l'orthodoxie marxiste
. Rosa Luxemburg, figure de la gauche du SPD, s'oppose elle aussi aux thèses de Bernstein ; elle partage cependant avec lui la critique du décalage entre discours révolutionnaire et pratique réformiste, et prône une revitalisation de la social-démocratie par l'« action de masse ». On voit ainsi émerger trois tendances qui se distinguent de plus en plus[100].
En France, le socialisme émerge dans différents groupes, cercles, syndicats et derrière certains leaders, mais souffre longtemps, contrairement au socialisme allemand, d'un manque d'unité. Les partisans de Marx se retrouvent surtout dans le Parti ouvrier français, de Jules Guesde et Paul Lafargue (lui-même gendre de Marx). Le programme rédigé par Guesde obtient d'ailleurs l'imprimatur de Marx et Engels en personne[101],[102]. La famille socialiste française ne s'unifie qu'en 1905, avec la création de la Section française de l'Internationale ouvrière (SFIO). Solidement implanté sur le plan électoral, le socialisme français est fortement attaché aux principes républicains, et faiblement marxiste. Guesde s'est fait le diffuseur en France d'un marxisme dogmatique, sans grand effort de renouvellement théorique ; Jean Jaurès, quant à lui, a intégré des éléments de marxisme dans son discours mais se fait l'avocat d'un « évolutionnisme révolutionnaire » — soit d'une progression vers le socialisme comme achèvement des principes républicains — et rejette la vision marxiste de l'État[103] ; si Jaurès se réclame du courant des « collectivistes » et des « communistes », au sens de partisans de la propriété collective des moyens de production, il fait dans ses idées une large place à l'individualisme et considère que si la nation doit être détentrice des moyens de production, elle doit déléguer ceux-ci à des coopératives et à des syndicats où l'initiative individuelle serait essentielle[104].
Dans le reste de l'Europe, le mouvement socialiste — dit également social-démocrate ou travailliste — se développe également, mais à des degrés très divers selon les pays pour ce qui est de l'importance de la pensée marxiste en son sein et du degré d'alliance entre parti et syndicats. Dans plusieurs pays, l'évolution vers le réformisme est sensible à la veille de la Première Guerre mondiale, avec l'abandon de la ligne révolutionnaire et de la remise en cause du capitalisme, dont il n'est désormais question que de socialiser les profits. C'est notamment le cas en Scandinavie, mais aussi en Allemagne où se développe néanmoins une aile d'extrême gauche incarnée par des personnalités comme Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht ou Clara Zetkin[105]. Rosa Luxemburg se distingue notamment en critiquant vivement l'évolution vers le réformisme de la social-démocratie allemande et prône un processus révolutionnaire que le prolétariat prendrait en main, partis et syndicats devant se contenter d'éclairer initialement les ouvriers sans prétendre ensuite les diriger[106].
Le contexte particulier de la Russie
L'Empire russe se distingue du reste des monarchies européennes par une économie peu industrialisée, des structures sociales encore très archaïques dont les réformes — comme l'abolition tardive du servage en 1861 — échouent à gommer les profondes inégalités et un système de monarchie absolue imperméable à la pénétration des idées démocratiques. L'exode des populations rurales pauvres vers les zones urbaines aboutit à la formation d'une classe ouvrière vivant dans des conditions souvent très difficiles et ne bénéficiant, dans la seconde moitié du XIXe siècle, d'aucune des avancées sociales des autres prolétariats européens[107]. Des mouvements socialistes apparaissent, comme les Narodniki, qui passent d'une aspiration au « retour à la terre » à de véritables actions révolutionnaires violentes[108]. Le mouvement socialiste se développe surtout chez les intellectuels, à travers les travaux d'auteurs comme Alexandre Herzen, Nikolaï Ogarev ou Nikolaï Tchernychevski dont le roman Que faire ? constitue une inspiration pour une génération de jeunes révolutionnaires. Les premières associations ouvrières, en Russie, naissent en 1875 et les aspirations du prolétariat ne rencontrent celles de l'intelligentsia socialiste que très progressivement. Dans certains milieux révolutionnaires se développe une forme de « nihilisme », dont Serge Netchaïev est l'un des représentants le plus célèbre. Des groupes passent au terrorisme, comme Narodnaïa Volia (« Volonté du Peuple ») qui assassine en 1881 le tsar Alexandre II[109],[110].
Le marxisme commence à se diffuser en Russie dans les années 1870 : en 1872 paraît la première traduction en russe du Capital, que la censure tsariste avait jugé trop difficile d'accès pour toucher un quelconque lectorat et poser le moindre problème. L'ouvrage rencontre au contraire un rapide succès dans les milieux intellectuels ; les révolutionnaires russes, dont les espoirs dans le monde paysan ont été déçus, tournent maintenant leurs regards vers la classe ouvrière. Marx lui-même suit désormais avec intérêt la progression de ses idées en Russie, pays qu'il considérait auparavant comme trop arriéré et peu industrialisé pour voir l'apparition d'une avant-garde révolutionnaire. Dans sa correspondance avec Vera Zassoulitch, il évoque le potentiel révolutionnaire des communautés agricoles russes. Gueorgui Plekhanov devient le principal diffuseur en Russie des théories inspirées de Marx : exilé à Genève, il fonde avec Pavel Axelrod et Vera Zassoulitch le groupe Libération du Travail, qui s'emploie à éditer en Russie des ouvrages marxistes. Le but de Plekhanov est alors de faire naître en Russie un mouvement marxiste comparable à celui qui existe déjà en Allemagne. À cette même époque, Vladimir Oulianov, admirateur de Tchernychevski puis de Plekhanov, commence à fréquenter les cercles révolutionnaires. Les militants marxistes en Russie font régulièrement l'objet d'arrestations, qui se traduisent souvent par des peines d'exil intérieur ; en , le Parti ouvrier social-démocrate de Russie (POSDR) est formé lors d'un congrès clandestin à Minsk : la réunion ne réunit que neuf participants, qui sont ensuite, pour la plupart, rapidement arrêtés. De nombreux révolutionnaires russes sont alors exilés à travers toute l'Europe[111],[112] ; jusqu'en 1905, le mouvement socialiste russe est réduit à la clandestinité en Russie et doit s'organiser pour l'essentiel à l'étranger[113].

En 1900, de retour d'une peine d'exil en Sibérie et installé à Munich, Vladimir Oulianov fonde le journal Iskra, imprimé à Leipzig pour être ensuite diffusé en Russie : différents intellectuels marxistes installés en Allemagne ou en Suisse (Gueorgui Plekhanov, Vera Zassoulitch, Pavel Axelrod, Julius Martov, Alexandre Potressov) collaborent à Iskra, qui fait figure de premier véritable « comité central » du Parti ouvrier social-démocrate de Russie[114],[115]. En février 1902, Vladimir Oulianov, qui a pris le pseudonyme de « Lénine », publie le traité politique Que faire ? (au titre emprunté au roman de Tchernychevski) dans lequel, polémiquant avec les tendances réformistes du marxisme, il prône la prise du pouvoir via une stratégie révolutionnaire méticuleuse, mise en œuvre par un parti clandestin, strictement hiérarchisé et discipliné. Lénine insiste tout particulièrement sur la nécessité d'une organisation centralisée, où le centre de direction dirigerait avec précision les cellules locales de l'organisation, qui elles-mêmes guideraient les classes laborieuses. Cette conception prend par la suite le nom de centralisme démocratique[116],[117],[118]. À la fin 1902, Léon Bronstein, dit « Trotsky » rend visite aux différents membres du comité éditorial d'Iskra, en Suisse puis en Angleterre, et devient un temps proche de Lénine[119].

Le POSDR gagne des militants mais il est très vite parcouru de profondes divisions. Lors du second congrès du Parti, tenu à Bruxelles à partir du mois de juillet 1903, les différentes factions s'opposent vivement. La motion de Lénine proposant une organisation stricte et centralisée du Parti est mise en minorité par celle, plus souple, de Martov. Mais le départ du congrès des délégués des courants du Bund et des « économistes » permettent ensuite à Lénine d'obtenir la majorité et d'affermir le contrôle de sa tendance sur le comité central et le journal du Parti. Cet épisode aboutit à ce que les partisans de Lénine soient désormais surnommés bolcheviks (« majoritaires ») et ceux de Martov mencheviks (« minoritaires »). Quelques mois plus tard, en vif conflit avec Martov, Lénine démissionne cependant de la rédaction du journal et de la direction du Parti ; l'Iskra repasse sous le contrôle des Mencheviks, dont Plekhanov se rapproche. Le POSDR bénéficie de relais et de militants en Russie mais la plupart de ses têtes pensantes se trouvent en exil, où le Parti, définitivement scindé, continue d'être parcouru par des conflits politiques et personnels incessants[120],[121]. Trotsky rompt ainsi avec Lénine et l'accuse en 1904 de ne pas préparer la dictature du prolétariat mais une dictature sur le prolétariat, où la volonté du Parti primerait sur celle des travailleurs[122].
Lorsque l'agitation commence en Russie après le Dimanche rouge de janvier 1905, les dirigeants bolcheviks et mencheviks se trouvent toujours à l'étranger ; Lénine saisit l'occasion pour rétablir son autorité sur les bolcheviks en convoquant des réunions et en émettant des mots d'ordre afin de participer à la révolution[123]. Au troisième congrès du Parti, qui se tient à Londres au printemps 1905, il parvient à imposer ses idées et à assurer le contrôle des bolcheviks sur le POSDR. Il est cependant surpris par le déclenchement et l'ampleur de la révolution de 1905. À partir du mois de mai, des travailleurs et des soldats russes s'organisent en conseils (en russe : Soviets)[124]. Les émigrés commencent à rentrer en Russie pour participer à cette révolution spontanée : Trotsky arrive en mars et devient en octobre le vice-président du Soviet de Saint-Pétersbourg. Lénine lui-même n'arrive qu'en novembre et prône la formation d'un gouvernement révolutionnaire provisoire des travailleurs. Cependant, après la publication par Nicolas II du Manifeste d'octobre, l'opposition se divise et la révolution s'éteint. En décembre, les membres du Soviet de Saint-Pétersbourg sont arrêtés ; les appels à l'insurrection lancés par les bolcheviks ne débouchent que sur l'écrasement du soulèvement ouvrier à Moscou[125],[126],[127].
Entre 1906 et 1917, les révolutionnaires, dont les principaux chefs sont à nouveau contraints à l'exil, tentent de se réconcilier, de tirer les leçons de l'échec de 1905 et de définir de nouvelles stratégies. Trotsky, fort de son expérience au Soviet, théorise l'alliance entre le Parti et les conseils de travailleurs, le premier devant éduquer les seconds, mais leur laisser ensuite le pouvoir. Lénine, lui, s'en tient à sa conception du rôle dirigeant du Parti et théorise, dès cette époque, l'usage de la « terreur de masse » pour combattre les contre-révolutionnaires. Les bolcheviks assurent leur financement notamment par des activités illégales sur le sol russe, dans lesquelles s'illustre entre autres un militant géorgien, Joseph Djougachvili, connu sous les pseudonymes de « Koba », puis de « Staline »[128],[129]. Les sociaux-démocrates participent cependant également à la vie politique légale, l'Empire russe tentant désormais de s'engager dans la voie du parlementarisme. Mencheviks et bolcheviks comptent des élus à la Douma d'État, ce qui entraîne de vifs débats au sein des bolcheviks[130]. Au sein de l'Internationale ouvrière, la division permanente du parti russe suscite l'inquiétude : Rosa Luxemburg et Karl Kautsky, notamment, s'opposent à la politique suivie par Lénine ; le Bureau socialiste international adopte une résolution condamnant les bolcheviks[131].
Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, les sociaux-démocrates russes sont encore divisés sur la marche à suivre ; la Deuxième internationale, quant à elle, échoue totalement à définir une ligne commune face à l'approche du conflit, puis éclate de fait. Les partis socialistes de la plupart des pays européens — à quelques exceptions notables près, comme le Parti socialiste italien — adhérent à la politique belliciste de leurs gouvernements respectifs[132]. Lénine compte pour sa part sur une défaite russe qui pourrait favoriser la révolution. Il plaide, à la conférence de Zimmerwald qui réunit en 1915 les représentants des minorités socialistes opposées à la guerre, la rupture avec les « sociaux-patriotes » et la constitution d'une troisième Internationale. D'abord isolées, ses thèses gagnent du terrain à mesure que le conflit se prolonge. Cependant, si l'opposition à la guerre progresse chez les socialistes européens, la ligne de Lénine sur la transformation de la « guerre impérialiste » en « guerre civile » révolutionnaire demeure minoritaire[133],[134]. En Russie même, les bolcheviks sont très affaiblis : responsables et militants sont régulièrement arrêtés par l'Okhrana, qui infiltre largement le mouvement. Les députés bolcheviks de la Douma et leurs assistants, parmi lesquels Lev Kamenev, sont arrêtés pour trahison et envoyés en déportation, où ils retrouvent les militants déjà arrêtés comme Staline et Ordjonikidze. L'organisation du Parti peine ensuite à se reconstituer[135],[136]. En janvier 1917, les révolutionnaires russes apparaissent encore loin du pouvoir et Lénine exprime, lors d'un discours prononcé à Zurich à l'occasion du douzième anniversaire de la révolution de 1905, ses doutes quant à la possibilité, pour sa génération, de voir la révolution de son vivant[135].
Révolution russe et naissance du mouvement communiste mondial
La chute du tsarisme
La chute de l'Empire russe en 1917 apporte aux révolutionnaires marxistes une occasion inespérée de prendre le pouvoir. Les déboires militaires de la Russie sur le Front de l'Est et l'effondrement de l'économie du pays portent le coup de grâce à un régime tsariste politiquement discrédité. Au début du mois de mars (fin février selon le calendrier julien), une révolte populaire spontanée éclate dans la capitale Petrograd (Saint-Petersbourg), déclenchant la révolution de Février, premier acte de la révolution russe. La troupe se mutine et fraternise avec les émeutiers. Des députés de la douma forment un comité destiné à assurer un gouvernement provisoire ; dans le même temps est formé le Soviet des députés ouvriers et des délégués des soldats de Petrograd, sur le modèle des conseils ayant existé durant la révolution de 1905. Nicolas II, dépassé par la situation, abdique le 15 mars (2 mars du calendrier julien). Si certains mencheviks et socialistes révolutionnaires ont participé à la révolution sans pour autant la diriger, les bolcheviks n'y ont jusqu'ici tenu aucun rôle[137]. Le gouvernement provisoire russe, issu de la chute du tsarisme et dirigé par Gueorgui Lvov puis par Alexandre Kerenski, temporise du fait de la guerre en cours : les réformes réclamées par la population, comme la redistribution des terres, sont repoussées en attendant la convocation d'une assemblée constituante. Il se trouve en outre presque immédiatement en situation de rivalité avec le Soviet de Petrograd, le pouvoir politique en Russie étant de fait en situation de dualité[138],[139].
Avec le concours matériel du haut commandement militaire allemand (ravi de faire pénétrer en Russie des fauteurs de trouble potentiels) Lénine et d'autres révolutionnaires exilés, comme Radek et Zinoviev, retournent sur le sol russe. En chemin, Lénine rédige un document connu ensuite sous le nom de Thèses d'avril, qu'il présente à son arrivée à la réunion des bolcheviks[140],[139]. Sans appeler explicitement au renversement du gouvernement provisoire, il y préconise son remplacement par un cabinet socialiste, ainsi que la redistribution des terres aux paysans, l'arrêt de la guerre, l'auto-détermination des peuples et la transformation des Soviets, conseils élus de travailleurs, en organes de gouvernement[141] ; il prône également « la création d'une Internationale révolutionnaire, d'une Internationale contre les social-chauvins et contre le "centre" ». Si Lénine préconise le transfert de tout le pouvoir aux Soviets, qu'il met en parallèle avec la Commune de Paris en tant que pouvoir venu « du bas », il conçoit le Soviet comme devant être pénétré par le Parti, qui en ferait l'expression de sa volonté. Les bolcheviks entretiennent l'agitation à renfort de slogans populistes et pacifistes comme « Pain, paix, liberté ! » ou « Tout le pouvoir aux Soviets immédiatement ! »[142] ; ils prennent progressivement le contrôle des détachements armées de travailleurs qui constituent le bras armé des Soviets et qui reçoivent bientôt le nom de gardes rouges[143]. Une première tentative d'insurrection, lors des journées de juillet, tourne à la débâcle pour les bolcheviks, qui ne semblent pas avoir eu de plan réellement défini[144] ; Lénine est contraint de se réfugier en Finlande. Les bolcheviks continuent cependant leur progression en son absence : profitant du mécontentement général face à la situation désastreuse du pays, ils gagnent des élus aux Soviets, aux comités d'usine et dans les syndicats. En août, la contre-offensive sur le front de l'Est décidée par Alexandre Kerenski tourne à la débâcle, discréditant plus avant le gouvernement provisoire[145]. Les bolcheviks poursuivent leur prise de contrôle des Soviets ; en septembre, Trotsky, désormais allié aux bolcheviks, est élu président du Soviet de Petrograd[146]. Durant son séjour en Finlande, Lénine rédige L'État et la Révolution, ouvrage dans lequel il théorise le passage du stade d'un État bourgeois à celui d'un « État prolétarien », qui, après une phrase de dictature du prolétariat provisoire, s'éteindra ensuite de lui-même pour aboutir à la phase du communisme ; il n'y aborde que furtivement la question de l'usage de la violence[147]. Lénine est hostile à la vision anarchiste de la suppression volontariste de l'État et prône au contraire un gouvernement prolétarien à l'organisation centralisée qui exercerait sa dictature à l'encontre de la bourgeoisie dans la période de lutte des classes qui précèdera l'établissement d'une société socialiste : dans son optique, la répression ne concernera qu'une minorité d'exploiteurs, dont la majorité des anciens exploités se chargera d'écraser la résistance[148]. Citant Engels qui utilisait le mot communiste pour distinguer son camp de ses adversaires « sociaux-démocrates », Lénine envisage au passage l'adoption du nom de communistes par les bolcheviks : « nous avons un parti véritable ; il se développe admirablement ; donc, ce nom absurde et barbare de "bolchevik" peut "passer", bien qu'il n'exprime absolument rien, sinon ce fait purement accidentel qu'au congrès de Bruxelles-Londres, en 1903, nous eûmes la majorité… […] peut-être hésiterais-je moi-même à proposer, comme je l'ai fait en avril, de changer la dénomination de notre Parti. Peut-être proposerais-je aux camarades un « compromis » : celui de nous appeler Parti communiste, tout en gardant, entre parenthèses, le mot « bolchéviks » »[149].
La révolution d'Octobre

Au début du mois d'octobre, Lénine revient clandestinement en Russie pour plaider auprès des bolcheviks la nécessité d'une prise du pouvoir par la force, non seulement avant l'élection de l'assemblée constituante prévue en novembre, mais aussi avant que ne se réunisse le deuxième congrès panrusse des Soviets ; subordonner la prise de pouvoir à un vote du congrès risquerait en effet d'aboutir à la formation d'un gouvernement de coalition, ruinant les chances du parti bolchevik d'exercer le monopole du pouvoir[150] ; il parvient à convaincre le comité central et l'insurrection est décidée. Trotsky suscite de son côté la création d'un Comité militaire révolutionnaire du Soviet de Petrograd, officiellement présidé par un membre des socialistes-révolutionnaires de gauche mais contrôlé par une majorité de bolcheviks[151]. Dans la nuit du 24 au 25 octobre (7 novembre du calendrier grégorien), les troupes dépendant du Soviet de Petrograd s'emparent des bâtiments stratégiques de la capitale, dont le Palais d'Hiver, siège du gouvernement : Kerenski doit prendre la fuite. Au matin du , Lénine proclame le renversement du gouvernement provisoire[152],[153]. À Moscou, des combats ont lieu durant dix jours avant que les bolcheviks ne parviennent à prendre le contrôle de la ville[144]. À Petrograd, quelques heures après la chute du Palais d'hiver, le deuxième congrès des Soviets s'ouvre. Les mencheviks, les SR et le Bund quittent la salle pour protester contre le coup de force des bolcheviks. Ils laissent ainsi les mains libres à Trotsky, qui fait adopter un texte condamnant les SR et les mencheviks. Peu après, le congrès adopte un texte rédigé par Lénine attribuant « tout le pouvoir aux Soviets » : le pouvoir est cependant détenu dans les faits par les bolcheviks, à qui le départ des autres partis du congrès permet de s'attribuer la légitimité populaire. Le lendemain, un gouvernement présidé par Lénine, le Conseil des commissaires du peuple (Sovnarkom), est proclamé, ne comptant que des bolcheviks en son sein ; les bolcheviks et leurs alliés SR de gauche sont seuls à siéger au nouveau Comité exécutif du Congrès des Soviets. Dès le lendemain de leur prise du pouvoir, les bolcheviks prennent des mesures autoritaires en interdisant des journaux d'opposition[154].
Alors qu'ils viennent de prendre le pouvoir, les bolcheviks n'ont pas encore d'idées précises sur le du régime politique et l'organisation économique qu'ils comptent mettre en place[155]. Au sein même du Parti, les méthodes léninistes ne font pas l'unanimité et une partie des « vieux bolcheviks » réclament dans un premier temps un gouvernement qui comprendrait toutes les tendances socialistes, soit également les mencheviks et les SR de droite comme de gauche : la tendance de Kamenev, Zinoviev, Rykov, Noguine, Milioutine, Chliapnikov et Lounatcharski proteste vivement contre la politique de Lénine et Trotsky qui, avec Sverdlov, Dzerjinski, Boukharine et Staline, veulent un gouvernement « purement bolcheviste ». Les opposants à la ligne léniniste de monopole du pouvoir manifestent leur désapprobation en démissionnant du Comité central et du Sovnarkom, mais Lénine obtient gain de cause[156]. Lors de l'élection de l'assemblée constituante, dont les bolcheviks avaient eux-mêmes réclamé la tenue, les socialistes-révolutionnaires remportent la majorité, devançant largement les bolcheviks[157]. L'assemblée ouvre sa session en janvier 1918, puis est déclarée dissoute dès le lendemain par le Conseil des commissaires du peuple. Les gardes rouges l'empêchent de se réunir à nouveau. Le gouvernement bolchevik restreint les prérogatives du Congrès des Soviets, pourtant censé être l'« instance suprême » ; son organe permanent de direction, le Comité exécutif des Soviets, voit ses compétences limitées et un Présidium du Comité exécutif, entièrement contrôlé par les bolcheviks, est créé. Les Soviets deviennent de simples organes d'enregistrement. Un décret sur la terre, qui légitime les confiscations des terres des grands propriétaires survenues dans les mois précédents, permet aux bolcheviks d'obtenir, au moins durant un temps, le soutien d'une grande partie de la paysannerie[154].
De Brest-Litovsk à la guerre civile


Le nouveau régime bolchevik naît dans des conditions particulièrement délicates et apparaît peu susceptible de durer. Les dirigeants bolcheviks tiennent leurs valises prêtes au cas où ils auraient besoin de prendre la fuite. Pour lutter contre les ennemis internes, le Sovnarkom crée dès une police secrète, la Tchéka (Commission extraordinaire panrusse pour la répression de la contre-révolution et du sabotage). De surcroît, la Russie est toujours en guerre contre les Empires centraux, alors même que le nouveau gouvernement est incapable de se défendre, malgré la transformation de la Garde rouge en Armée rouge des ouvriers et paysans[158].

Les bolcheviks entament à Brest-Litovsk des pourparlers avec l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie : alors que Lénine estime que la précarité du nouveau régime impose de faire des concessions aux Empires centraux, Trotsky, commissaire aux affaires étrangères, prolonge les négociations en s'en tenant à une ligne « ni paix ni guerre », ce qui implique de refuser de signer la paix. Dès lors, les Empires centraux reprennent l'offensive en février sur le sol russe : Allemands et Austro-hongrois prennent d'importants territoires aux bolcheviks qui n'ont guère les moyens de les arrêter. Lénine obtient alors, contre l'avis de Trotsky et Boukharine, la signature en mars d'une paix séparée avec les Empires centraux. Le nouveau régime perd du fait de cette paix coûteuse le contrôle de la Biélorussie, de l'Ukraine et des pays baltes, mais parvient à éviter l'anéantissement. De multiples gouvernements indépendantistes, encouragés par l'incapacité des bolcheviks à résister aux Empires centraux et soutenus par ces derniers, sont proclamés dans les mois qui suivent sur le territoire de l'ancien Empire russe. Quelques jours après l'armistice, lors du septième congrès des bolcheviks, le Parti est rebaptisé Parti communiste de Russie (bolchevik), ce nouveau nom étant destiné, comme préconisé par Lénine dans L'État et la Révolution, à souligner l'identité révolutionnaire du mouvement et à se distinguer des autres socialistes[159],[158].
Le traité de Brest-Litovsk suscite des oppositions internes au nouveau pouvoir, notamment avec le groupe des « communistes de gauche » qui, rassemblé autour de la revue Kommunist à laquelle collaborent notamment Nikolaï Boukharine, Gueorgui Piatakov et Karl Radek, prône la « guerre révolutionnaire » ; les SR de gauche, jusque-là alliés aux bolcheviks, s'opposent également au traité de paix. Les SR « de droite » forment quant à eux un gouvernement rival, le Comité des membres de l'Assemblée constituante (Komuch) mais l'Armée rouge, réorganisée par Trotsky, arrête l'avance de leurs troupes vers Moscou[160].
Le régime bolchevik doit combattre sur plusieurs fronts. En mars, les SR de gauche entrent en rébellion ; les Alliés, qui sont d'abord intervenus en Russie du fait de l'offensive des Empires centraux, apportent ensuite leur soutien aux Armées blanches contre-révolutionnaires dont les principaux commandants sont les généraux Koltchak, Dénikine, Ioudenitch et Wrangel[158].
Terreur en Russie
.svg.png.webp)
Face à cette situation, les bolcheviks doivent improviser une armée, un mode de fonctionnement économique qui reçoit le nom de « communisme de guerre », et la mise sur pied d'une dictature politique. L'économie est étatisée et mobilisée par le biais d'une vaste programme de nationalisations ; une politique de réquisitions agricoles est mise en œuvre pour assurer le ravitaillement, tandis que le régime tente de mobiliser les paysans. Ne concevant la paysannerie que constituée en classes sociales antagonistes, Lénine met en place une politique de réquisition brutale qui touche l'ensemble du monde agricole : des insurrections éclatent, que Lénine, les attribuant aux seuls paysans riches (« koulaks »), donne l'ordre de réprimer avec violence. Les institutions autonomes nées de la révolution (Soviets, comités d'usine, syndicats) sont subordonnées au parti, tandis que les partis non bolcheviks sont interdits. Le , la première constitution de la République socialiste fédérative soviétique de Russie (RSFSR) est adoptée : les Soviets y sont toujours présentés comme l'instance suprême, bien qu'étant désormais dans les faits contrôlés par les bolcheviks. La formation de partis politiques autre que le Parti communiste n'est pas explicitement interdite, mais l'article 23 de la constitution dispose que le nouveau régime « refuse aux personnes et aux groupes les droits dont ils peuvent se servir au détriment de la révolution socialiste »[158].
Les effectifs de la Tchéka, dirigée par Félix Dzerjinski, s'accroissent considérablement durant la guerre civile ; le 6 juin, un décret rétablit la peine de mort que les bolcheviks avaient abolie quelques mois plus tôt. Le massacre de la famille Romanov et la répression des SR de gauche comptent parmi les évènements marquants du début du régime de terreur. Les exécutions ne prennent cependant un caractère massif qu'après les attentats du : Moïsseï Ouritski, chef de la Tchéka de Petrograd, est tué, tandis que le même jour Lénine est blessé à Moscou par la SR Fanny Kaplan[158].
Le 5 septembre, le Conseil des commissaires du peuple publie un décret intitulé Sur la Terreur rouge et appelant à frapper l'ensemble des adversaires du nouveau régime (contre-révolutionnaires et « ennemis de classe »)[161]. La Tchéka et l'Armée rouge mènent alors une campagne de terreur d'une violence et d'un arbitraire extrêmes, qui se déroule en parallèle aux actes de la terreur blanche commis par les Blancs[162]. Une campagne de propagande anti-religieuse est mise en œuvre dans le but de répandre l'athéisme, tandis que les manifestations communistes s'emploient à imiter eux-mêmes les rituels religieux pour présenter l'idéologie officielle à la manière d'une « nouvelle religion ». À partir de 1921, le clergé est victime de massacres ; en 1922, Lénine incite à utiliser comme prétexte la famine qui règne en URSS pour lancer une campagne de confiscation des biens des églises et multiplier les exécutions des membres du « clergé réactionnaire ». Plus de 7000 membres du clergé orthodoxe sont tués durant la campagne de terreur anti-religieuse du début des années 1920[163],[164]. La population cosaque, liée à l'ancien régime, est victime d'une politique de massacres à grande échelle, baptisée « décosaquisation »[165]. Un système de camps est mis en place, où sont emprisonnés les soldats prisonniers, les déserteurs, les condamnés pour « parasitisme, proxénétisme et prostitution », ainsi que les « otages issus de la haute bourgeoisie », les « fonctionnaires de l’ancien régime » etc., ces derniers groupes étant arrêtés par la Tchéka à titre de « mesure prophylactique » et enfermés sans jugement[166].
Par ailleurs, la forte proportion de Juifs parmi les dirigeants bolcheviks et dans l'appareil de la Tchéka conduit une partie de l'opinion russe, mais également internationale, à assimiler les communistes aux Juifs, donnant naissance à la thèse antisémite du « judéo-bolchevisme ». De nombreux pogroms sont commis pendant la guerre civile russe par des adversaires des bolcheviks, notamment durant la terreur blanche[167].
Victoire des bolcheviks
Après avoir mis sur pied l'Armée rouge dans l'urgence, les bolcheviks réussissent à en faire une véritable force militaire ; Trotsky met notamment à profit les compétences professionnelles d'anciens officiers de l'Armée du Tsar, tout en faisant encadrer les troupes par un corps de Commissaires politiques responsable de l'idéologie. Le régime soviétique organise en outre un appareil de propagande très efficace tandis que les Blancs, désunis, ne proposent aucun programme politique cohérent susceptible de rallier la population, et se bornent pour l'essentiel à prôner un retour à l'ancien régime. Les Alliés, tout juste sortis de la guerre mondiale, n'apportent pas aux Blancs une aide suffisante. En outre, une partie de leurs troupes se montre peu disposée à combattre les bolcheviks. Au printemps 1919, des mutineries éclatent sur les navires français en mer Noire, entraînant l'évacuation de la flotte française qui était censée affronter les Rouges[168],[169].
En 1919-1920, les bolcheviks parviennent à triompher du gros des Armées blanches ; cependant, ils doivent également compter avec les différents mouvements indépendantistes, les anarchistes de Nestor Makhno et les « Armées vertes » de paysans révoltés. Les insurrections paysannes se poursuivent jusqu'en 1923 dans les territoires de l'ancien Empire russe. Si la Russie soviétique échoue à reprendre le contrôle des pays baltes et de la Finlande, comme de la Pologne orientale, elle récupère finalement les autres anciens territoires impériaux, qui deviennent tous des Républiques socialistes soviétiques[168],[170].
Consolidation du régime
Durant la guerre civile, le Parti communiste russe est dirigé pour l'essentiel par Lénine et Sverdlov, jusqu'à la mort de ce dernier en . Dans le courant 1919, le Comité central du Parti est réorganisé avec la création de deux organes de direction internes, le Politburo et l'Orgburo, qui disposent de pouvoirs considérables[171]. Le contrôle de tous les organes du pouvoir par les rouages du Parti communiste, via la multiplication des comités et des organes de décision, entraîne très rapidement le développement d'une bureaucratie dont l'importance ne fera ensuite que s'accentuer avec les années. Le processus de bureaucratisation se déroule à la fois « par en haut », du fait de la mainmise exercée par les bolcheviks, et « par en bas », les responsables des comités d'usine, comités de quartier et autres organes de transmission accaparant les fonctions de décision en lieu et place de la population dont ils sont censés exprimer les volontés. Se développe progressivement la catégorie dite des apparatchiks, militants dont l'activité politique, qui leur fournit une source de revenus tout en leur faisant rompre avec leur classe d'origine, se mue en statut social, la solidarité avec le Parti étant conditionnée par leur dépendance vis-à-vis des instances dirigeantes[172].
Les institutions sociales sont subordonnées au pouvoir bolchevik : en 1919, le gouvernement précise que le rôle des syndicats est d'appliquer le contrôle ouvrier sur la production, mais en même temps de « suivre plutôt que précéder celui de l'administration », ce qui revient à priver les ouvriers eux-mêmes de possibilité d'initiative. Grigori Zinoviev précise que « puisque le nouveau régime est l'expression de la classe ouvrière », les syndicats doivent être subordonnés au gouvernement. En 1919, lors de la session du Parti, un texte prévoyant de continuer à garantir le droit de grève aux ouvriers est rejeté, dans la mesure où, la République des Soviets étant un « État ouvrier », il est « absurde que les ouvriers puissent faire grève contre eux-mêmes ». Tout pluralisme syndical est éliminé, les dirigeants syndicaux gagnant une situation de monopole en échange de leur subordination[173].
Parallèlement aux mesures de collectivisation, de déchristianisation et de terreur, le pouvoir bolchevik s'emploie à bouleverser la société russe, notamment en appliquant d'emblée une politique progressiste en faveur des droits des femmes[174] : l'égalité de droit entre les sexes est proclamée. De nombreuses mesures de libéralisation sont prises sous l'égide du Jenotdel (département des femmes) cofondé par Inessa Armand et Alexandra Kollontaï (cette dernière étant la première femme ministre de l'Histoire). Une législation très libérale sur le divorce est adoptée. Si ces mesures font progresser l'égalité des sexes de manière décisive en Russie, elles ont également des conséquences non désirées, comme la précarisation de certaines femmes dont les époux profitent des nouvelles lois pour divorcer soudainement, ou les initiatives de certaines autorités locales qui, surinterprétant les consignes du Jenodtel, vont jusqu'à proclamer dans un premier temps l'abolition du mariage[175].
L'économie de la Russie soviétique est, en 1921 alors que la guerre civile se termine, dans un état catastrophique, l'application improvisée du communisme de guerre ayant eu des effets désastreux. Les appareils centralisés du Conseil suprême de l'économie nationale (VSNKh) et du Gosplan sont incapables de gérer le vaste réseau d'entreprises nationalisées dont ils ont la charge. Les insurrections paysannes, dont la révolte de Tambov est l'une des plus importantes, redoublent d'intensité. Une famine atroce sévit dans plusieurs régions. Le Parti communiste, qui a purgé ses effectifs en 1919 pour exclure environ 150 000 recrues jugées douteuses, doit faire face à plusieurs courants d'opposition internes : l'Opposition ouvrière, menée notamment par Alexandre Chliapnikov et Alexandra Kollontaï, réclame que la gestion de l'industrie soit confiée aux syndicats, une position que Lénine dénonce comme de l'« anarcho-syndicalisme »[176] ; Trotsky, au contraire, souhaite la fusion des syndicats avec l'appareil d'État et une gestion militarisée de l'économie par le Parti, qui s'appuierait sur les militants de base plus que sur la bureaucratie bolchevique[177].

En mars 1921, le gouvernement bolchevik doit affronter la révolte de Kronstadt : les marins de la base navale de Kronstadt, sur l'île de Kotline, jusque-là soutiens turbulents des bolcheviks, se soulèvent contre le régime. Trotsky charge le maréchal Toukhatchevski d'écraser l'insurrection : la répression entraine plusieurs milliers de victimes et de condamnations à la peine capitale ou à la déportation[177]. L'écrasement de Kronstadt achève de sonner le glas de l'anarchisme en Russie où les libertaires, initialement ralliés au régime bolchevik, ont été réprimés dès 1918[178]. Une fois la rébellion écrasée, le gouvernement bolchevik engage ses forces dans la chasse aux militants socialistes, la lutte contre les grèves et le « laisser-aller » ouvrier ; le combat contre les insurrections paysannes continue, de même que la répression contre l'église. Dès le , Félix Dzerjinski ordonne à toutes les Tchékas provinciales de procéder à des arrestations massives d'anarchistes, de socialistes-révolutionnaires et de menchéviks. L'opposition est décimée, réduite à la clandestinité ou à l'exil[179].
Au moment même où l'Armée rouge engage les opérations contre les insurgés à Kronstadt, se tient le Xe congrès du Parti communiste, au cours duquel sont prises deux décisions fondamentales : l'une sur l'interdiction des factions au sein du Parti, l'autre sur le remplacement des réquisitions par un impôt en nature. La première orientation influe très durablement sur la vie politique soviétique en interdisant, sous peine d'exclusion du Parti, tous les groupes constitués sur des plates-formes particulières. Les opinions de l'Opposition ouvrière, notamment sur le rôle des syndicats, sont condamnées. L'une des résolutions adoptées sous l'impulsion de Lénine affirme que « le marxisme enseigne que seul le parti politique de la classe ouvrière, c'est-à-dire le Parti communiste, est en mesure de grouper, d'éduquer et d'organiser l'avant-garde du prolétariat et de toutes les masses laborieuses » : la conception du rôle du Parti formulée par Lénine en 1902 se voit élevée au rang d'un élément de doctrine faisant partie intégrante du marxisme. La seconde orientation inaugure une nouvelle orientation économique, désignée sous le nom de Nouvelle politique économique (NEP). La multiplication des révoltes souligne l'état désastreux de l'économie russe et l'urgence de procéder à des réformes pour améliorer les conditions de vie de la population : cela permet à Lénine de faire accepter, malgré une forte opposition doctrinale au sein du Parti communiste, le principe d'un changement de cap économique. Le commerce extérieur est libéralisé et la création des petites entreprises privées est autorisée ; grâce à la NEP, les citoyens de l'État soviétique retrouvent un niveau de vie acceptable[177],[180]. Le remplacement du communisme de guerre par une forme de capitalisme d'État, en l'occurrence une certaine forme de marché régulé par l'État et progressivement socialisé via des coopératives, est pour Lénine une manière de passer à une approche gradualiste et d'assurer la transition vers le socialisme : il juge en effet l'économie de la Russie insuffisamment développée pour passer directement à ce stade, qui n'est supposé possible que dans des pays où le capitalisme s'est déjà mis en place[181].
Formation de l'URSS
.svg.png.webp)
Le XIe congrès, en 1922, poursuit la réorganisation du Parti. Joseph Staline est nommé au poste de Secrétaire général du Parti communiste, fonction d'apparence technique mais qui lui permet de contrôler les nominations de cadres et de s'assurer de solides appuis au sein de l'appareil. Le , l'Union des républiques socialistes soviétiques naît officiellement d'un traité réunissant au sein d'une fédération la République socialiste fédérative soviétique de Russie, la République socialiste soviétique d'Ukraine, la République socialiste soviétique de Biélorussie et la République socialiste fédérative soviétique de Transcaucasie (cette dernière réunissant les territoires de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan et de la Géorgie)[182].
Dès 1924, Staline s'oppose à la ligne de Trotsky, qui prône une « révolution permanente », soit l'exportation du modèle soviétique par le biais d'une révolution internationale, condition indispensable à ses yeux pour construire le socialisme. Le secrétaire général du Parti communiste impose au contraire la ligne du « socialisme dans un seul pays » : Staline ne perd pas de vue l'espoir d'une révolution mondiale mais, dans un contexte de « stabilisation partielle du capitalisme », il juge prioritaire de défendre et consolider le socialisme dans la seule URSS, ce qui implique remettre à plus tard les espérances révolutionnaires. L'État soviétique sort à la même époque de son isolement diplomatique : dès 1922, le traité de Rapallo établit des relations diplomatiques et commerciales avec l'Allemagne de Weimar. Au cours des années suivantes, l'ensemble des pays occidentaux établit progressivement des relations avec l'URSS ; les États-Unis sont, en 1933, parmi les derniers à la reconnaître[183]. L'Union soviétique demeure cependant dépourvue de régimes alliés, à l'exception de la Mongolie : en 1924, un gouvernement ami de l'URSS, dirigé par l'« évêque rouge » Fan Noli, est créé en Albanie, mais il est renversé au bout de quelques mois[184].
Guerre civile en Finlande
Durant les derniers mois de la Première Guerre mondiale, la révolution bolchevique a des répercussions en Finlande, qui vient de gagner son indépendance vis-à-vis de la Russie et dont la situation politique est encore très instable. L'affrontement qui oppose les Gardes rouges — formés par une partie de l'appareil du Parti social-démocrate de Finlande — et les Blancs — force armée du gouvernement conservateur — tourne à la guerre civile entre février et mai 1918. L'Empire allemand apporte son soutien aux Blancs, tandis que les bolcheviks, après avoir reconnu l'indépendance de la Finlande, tentent d'en regagner le contrôle en y favorisant la mise en place d'un pouvoir socialiste. Les Rouges finlandais sont vaincus, le gouvernement de Lénine n'ayant pas encore les moyens de leur apporter un soutien suffisant. La Russie soviétique doit dès lors renoncer à toute présence militaire en Finlande[185]. Ce n'est qu'une fois réfugiés en Russie que les anciens sociaux-démocrates, dirigés notamment par Otto Wille Kuusinen, se rebaptisent Parti communiste de Finlande[186].
Révolution en Allemagne et écrasement des spartakistes

Au sein des partis socialistes et sociaux-démocrates européens, la révolution d'Octobre ne fait l'objet d'aucune unanimité. En Allemagne, Karl Kautsky critique vivement la rupture avec les traditions du mouvement ouvrier européen, qui aboutit selon lui non à la dictature du prolétariat mais à celle d'une partie du prolétariat sur une autre. À l'extrême-gauche, chez les Spartakistes, Clara Zetkin et Franz Mehring approuvent l'écrasement de l'assemblée constituante, tandis que Rosa Luxemburg, si elle l'approuve également, regrette qu'il n'ait pas été suivi de nouvelles élections[187]. En novembre 1918, l'Allemagne se trouve en état d'ébullition politique : de multiples grèves éclatent à travers le pays, marquées par des élections de conseils de travailleurs et de soldats. À Munich, le 8 novembre, un conseil proclame la « République socialiste de Bavière » et porte à sa présidence l'USPD Kurt Eisner. À Berlin, le 9 novembre, les soldats fraternisent avec les ouvriers en révolte. Le ministre SPD Philipp Scheidemann proclame la République pour prendre de vitesse Karl Liebknecht, qui proclame deux heures plus tard la « République socialiste libre »[188].
Un gouvernement, le Conseil des commissaires du peuple (ou des députés du peuple) est fondé, mais son président, le SPD Friedrich Ebert, s'en tient à une démarche légaliste. Le Congrès national des Conseils d'ouvriers et de soldats refuse de se faire l'instrument d'une révolution de type bolchevique, tandis que les Spartakistes s'opposent à l'idée d'une révolution qui prendrait le chemin de la démocratie parlementaire. Fin décembre et début janvier 1919 se tient le congrès fondateur du Parti communiste d'Allemagne (KPD), dans une atmosphère radicale, et en présence de Karl Radek, venu de Russie. Le KPD refuse de participer au processus électoral et réclame l'instauration d'une « République des Conseils », soit d'un régime politique qui serait dirigé par les conseils ouvriers[189],[190] ; Rosa Luxemburg tente vainement de convaincre du danger du boycott des élections à l'assemblée nationale[191]. Le lendemain, une manifestation ouvrière d'une ampleur inattendue débouche sur un affrontement ouvert à Berlin. Karl Liebknecht, emporté par le mouvement, appelle à renverser le gouvernement. Rosa Luxemburg, initialement opposée à l'insurrection, s'engage ensuite sans réserve aux côtés des combattants[191]. Le soulèvement berlinois de janvier 1919 est bientôt écrasé par le gouvernement social-démocrate, le ministre SPD Gustav Noske s'appuyant sur les Corps francs pour réprimer les insurgés. Karl Liebknecht et Rosa Luxemburg sont capturés et assassinés par des militaires[192].
Agitations sociales en France et en Italie
En Europe de l'Ouest, la crise économique, venue s'ajouter aux souffrances endurées durant quatre années de guerre, exacerbe les mécontentements ; l'apparition d'un régime révolutionnaire en Russie pousse certains militants socialistes et syndicaux à la radicalisation : en France, d'importantes grèves éclatent en juin 1919 dans le secteur de la métallurgie ; le mouvement s'essouffle cependant rapidement[193].
La situation est bien plus tendue en Italie, où le courant « maximaliste » (mot que les Italiens tendent à confondre avec « bolchevik » à la suite d'une mauvaise traduction de celui-ci[194]), dirigé par Giacinto Menotti Serrati, Nicola Bombacci et Amadeo Bordiga, prend le contrôle du Parti socialiste italien dès ; les maximalistes publient en décembre un programme préconisant la mise en place d'une « République socialiste » et de la dictature du prolétariat, malgré l'opposition du groupe parlementaire socialiste et du syndicat ouvrier CGL. Le mot d'ordre maximaliste suscite l'enthousiasme dans l'opinion ouvrière et l'Italie est, dans le courant de l'année 1919, parcourue de nombreuses grèves, orchestrées par les socialistes mais évoluant bientôt vers des mouvements spontanés et des grèves sauvages. L'Italie entre dans la période d'agitation politique appelée le biennio rosso (« les deux années rouges ») ; des « soviets » sont constitués dans la région de Florence et des grands domaines sont occupés. Le Parti socialiste s'abstient cependant de donner une direction au mouvement ; de leur côté, les milieux nationalistes réagissent face à l'activisme des « rouges », ce qui permet au mouvement fasciste, tout juste fondé par Mussolini, de gagner en importance[195].
Naissance des premiers partis communistes hors de Russie et création du Komintern

Le , le Parti communiste d'Autriche (KPÖ) est fondé : d'envergure très modeste, il n'en est pas moins l'un des tout premiers partis communistes d'Europe occidentale[196]. Aux Pays-Bas, le Parti social-démocrate (scission du Parti social-démocrate des ouvriers apparue en 1909[197]) se rebaptise, lors du congrès des 16 et , Parti communiste de Hollande. Le mouvement communiste des Pays-Bas se trouve cependant vite divisé entre les partisans de la participation à l'activité parlementaire et syndicale, comme David Wijnkoop et les tenants du pouvoir des conseils ouvriers, comme Anton Pannekoek et Herman Gorter[198]. Les Russes en arrivent rapidement à considérer le parti néerlandais comme un groupe « sectaire » dont la formation était prématurée[199]. En Pologne, pays tout juste reformé en tant qu'État, la Social-Démocratie du Royaume de Pologne et de Lituanie et l'aile gauche du Parti socialiste polonais fusionnent pour former, en décembre 1918, sous l'influence des révolutions russe et allemande, le Parti communiste ouvrier de Pologne (rebaptisé en 1924 Parti communiste de Pologne). Le Parti ne soutient guère l'indépendance du nouvel État polonais et proclame essentiellement son adhésion à la révolution internationale. Son soutien à la Russie soviétique et son discours peu en phase avec la nouvelle unité nationale de la Pologne valent d'emblée au parti polonais d'être réprimé et réduit à la clandestinité[200].
En janvier 1919, les bolcheviks mettent en application le projet, exposé par Lénine dans ses Thèses d'avril, de formation d'une Internationale révolutionnaire destinée à supplanter la Deuxième internationale discréditée par les soutiens des partis socialistes à la guerre ; des contacts sont pris avec des groupes sympathisants en vue de la tenue d'un congrès à Moscou. Le 2 mars s'ouvre la réunion, que Lénine présente comme le congrès fondateur de l'Internationale communiste (ou Troisième internationale, ou Komintern, ou IC) : du fait des difficultés du voyage et de la faiblesse de nombreux groupes révolutionnaires, les délégués sont peu nombreux. Anciens membres de la Deuxième internationale décidés à emprunter une voie plus radicale pour agir en faveur de la classe ouvrière, ils sont venus pour certains en l'absence d'un mandat de leurs partis respectifs. Du fait notamment de la disparition de Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht, qui étaient opposés à l'idée d'une Internationale contrôlée par la Russie, Lénine domine les débats, le délégué allemand Hugo Eberlein ne parvenant pas à lui porter efficacement la contradiction. Un bureau exécutif de l'Internationale communiste, comprenant des représentants de divers pays, est fondé à Moscou sous la direction de Grigori Zinoviev, la Russie soviétique prenant, de fait, le contrôle immédiat de l'organisation. La création du Komintern, précipitée, a pour tâche de coordonner et d'impulser des mouvements révolutionnaires dont on pense alors qu'ils vont s'étendre et, par là même, défendre la Russie bolchevique[201],[202]. Écrivant dans la foulée de la création de l'IC, Boukharine trace un parallèle direct entre l'Internationale et la Ligue des communistes et juge que, « par son action, la Troisième Internationale prouve qu'elle suit les traces de Marx, c'est-à-dire la voie révolutionnaire qui mène au renversement violent du régime capitaliste »[203].
Dès le , le Parti socialiste italien envoie son adhésion à l'Internationale communiste[204]. En Bulgarie, pays sensibilisé depuis longtemps aux évolutions politiques chez le « grand frère slave » russe, le Parti ouvrier social-démocrate bulgare se rebaptise, dès mai 1919, Parti communiste bulgare ; le nouveau parti hérite d'une organisation alors en plein essor, avec 25000 adhérents[205].
Révolutions en Hongrie et en Bavière

La Hongrie, qui vient de prendre son indépendance avec l'éclatement de l'Autriche-Hongrie, est elle aussi touchée par la vague révolutionnaire. Le , Béla Kun et Tibor Szamuely, à la tête d'un groupe de Hongrois faits prisonniers en Russie durant la guerre et convertis au bolchevisme, fondent à Moscou la section hongroise du parti bolchevik. À la fin de l'année, alors que la Hongrie devient indépendante, ils reviennent dans leur pays avec un mandat informel de Lénine et y fondent officiellement, le 24 novembre, le Parti communiste de Hongrie[206]. Le les communistes, alliés aux sociaux-démocrates, prennent le pouvoir et proclament la République des conseils de Hongrie, le nom de République des conseils se traduisant également comme République soviétique[207]. Suscitant immédiatement l'hostilité des Alliés, le nouveau gouvernement hongrois, qui ne bénéficie pas d'un véritable appui dans la population, prend un ensemble de mesures sociales mais se rend vite impopulaire par des mesures de nationalisations autoritaires. Une politique répressive appelée, comme en Russie, terreur rouge, est bientôt mise en œuvre, faisant plusieurs centaines de victimes. Le régime hongrois, dans le but de récupérer les territoires perdus par le pays à la fin de la Première Guerre mondiale, entre ensuite en conflit avec la Tchécoslovaquie — une éphémère République slovaque des conseils est proclamée sur les territoires slovaques pris par les troupes hongroises — puis la Roumanie. Le conflit avec la Roumanie entraîne la chute de la République des conseils de Hongrie après trois mois d'existence : les troupes roumaines prennent Budapest en août et Béla Kun se réfugie en Autriche, puis en Russie soviétique[208]. Les communistes hongrois sont ensuite réduits à la clandestinité sous la régence de Miklós Horthy[209].
En Allemagne, la Bavière est plongée dans une grande tension politique après l'assassinat, le , de Kurt Eisner. Les évènements de Hongrie poussent à la proclamation le d'une République des conseils de Bavière. Elle est d'abord dirigée pour l'essentiel par des anarchistes mais, le , les communistes locaux prennent le pouvoir. Eugen Leviné, dirigeant de la République bavaroise, agit de son propre chef sans l'aval de la direction du KPD, mais entre bientôt en contact avec Lénine, qui lui accorde ses encouragements et l'incite à prendre des otages dans la bourgeoisie locale. Le régime ne vit que quelques semaines, appliquant dans l'intervalle une politique confuse et pratiquant des arrestations arbitraires : à l'exception de l'exécution de plusieurs otages dans ses tout derniers jours, il n'a cependant guère le temps ni les moyens de mener des actions sanglantes, mais l'annonce de la création de tribunaux révolutionnaires contribue à terrifier ses adversaires et à susciter leur réaction violente. Le 3 mai, le gouvernement communiste de Munich est écrasé par les corps francs du Wurtemberg[210],[211].
Le régime hongrois, dont une majorité des cadres est issue de la communauté juive de Hongrie, contribue à susciter des persécutions antisémites en Hongrie et plus largement à diffuser le mythe du judéo-bolchevisme, soit l'identification des communistes aux Juifs. L'épisode bavarois, auquel participent de nombreux militants juifs, suscite une flambée d'antisémitisme en Bavière et plus largement en Allemagne. Déjà très répandu en Russie, le préjugé antisémite qui identifie les révolutions communistes à un complot juif est largement diffusé, en Europe comme sur le continent américain, durant toute la période de l'entre-deux-guerres[212],[213].
Essoufflement des révolutions et défaite contre la Pologne

Le , sous l'influence des évènements de Hongrie et de Bavière, le Parti communiste d'Autriche tente de susciter une insurrection à Vienne. Mais cette tentative de soulèvement ne bénéficie pas d'un soutien suffisant de la part des ouvriers autrichiens qui restent, dans leur majorité, proches des sociaux-démocrates : elle échoue au bout de 24 heures. Des conseils ouvriers sont par ailleurs formés dans de nombreuses usines autrichiennes. À la fin du mois, les conseils se réunissent au sein d'une conférence, durant laquelle les communistes appellent à la formation d'une République soviétique : cette proposition est cependant rejetée par la majorité social-démocrate. À la suite de ces échecs, et du fait de la stabilisation politique de la République autrichienne, le PC autrichien voit ses effectifs décliner durant les années 1920[214].
En Italie, à la veille des élections de , la motion de Serrati, qui préconise la préparation de la révolution par des conseils d'ouvriers et de soldats, l'emporte. L'adhésion du Parti socialiste italien à l'Internationale communiste est ratifiée par acclamation. Le Parti arrive ensuite en tête aux élections avec 32 % des suffrages, mais refuse de participer à un ministère. À l'été 1920, le mouvement d'occupations d'usines tourne à vide faute de directives de la direction maximaliste du PSI. Les cadres socialistes, habitués à la voie légaliste, sont incapables de canaliser le mouvement populaire, tandis que la tendance d'Amadeo Bordiga prône le refuge dans l'abstention et la préparation de l'insurrection. L'échec du biennio rosso, que le PSI a laissé tourner au fiasco faute d'initiative, entraîne une crise profonde au sein des socialistes italiens. En octobre 1920, le groupe de la revue Ordine nuovo, animé par Antonio Gramsci, Angelo Tasca et Palmiro Togliatti, critique vivement la direction maximaliste du PSI et prône la constitution en parti communiste. À la même époque, Lénine s'en prend violemment aux stratégies « gauchistes » au sein du mouvement communiste, qu'il juge stériles car contraires à sa conception de l'organisation des partis : il expose ses vues sur la tendance de la « Gauche communiste » — représentée notamment par Bordiga en Italie, ou par Pannekoek aux Pays-Bas — dans l'ouvrage La Maladie infantile du communisme (le « gauchisme »), publié en [195].
Lénine s'interroge encore sur la manière d'exporter la révolution bolchevique quand la Pologne, indépendante depuis la fin de la guerre mondiale, envahit le territoire ukrainien pour l'annexer. L'Armée rouge parvient à repousser les troupes polonaises : Lénine envisage alors de passer au stade de la « guerre révolutionnaire » préconisée par les « communistes de gauche » en 1918. Le , alors que l'Armée rouge marche sur Varsovie, le second congrès de l'Internationale communiste a lieu, dans une atmosphère survoltée. Les conditions d'une révolution mondiale semblent être réunies aux congressistes, les principaux obstacles étant le manque de partis organisés dans de nombreux pays, et le courant réformiste : l'un des buts du congrès est donc de poursuivre la rupture avec la social-démocratie[215]. Lénine encourage les délégués étrangers, notamment les Italiens, à exporter la révolution dans leurs pays respectifs ; il envisage également la réorganisation des anciens territoires de l'Empire russe sous la forme d'une union fédérale, dans l'optique d'une « révolution socialiste européenne ». Mais en août, une contre-attaque des troupes de Józef Piłsudski stoppe net l'avance de l'Armée rouge : les hostilités se terminent à l'automne par une défaite de la Russie soviétique, qui doit renoncer à exporter dans l'immédiat sa révolution vers l'Ouest. La « paix de Riga », qui met officiellement fin au conflit, est signée en mars 1921[216].
L'exportation de la révolution est par ailleurs freinée par la situation géopolitique de la Russie soviétique, que Lénine souhaite faire sortir de son isolement : le Royaume-Uni laisse ainsi le régime bolchevik reconquérir le Caucause — notamment en envahissant la Géorgie — en échange de son cantonnement dans cette zone, et de la fin de ses espérances révolutionnaires en Occident. La mainmise russe sur le Caucause est également conditionnée à un accord passé avec le gouvernement turc de Mustafa Kemal, qui implique que la Russie cesse de soutenir aussi bien Enver Pacha, rival de ce dernier, que les communistes turcs[217].
Les communistes allemands subissent eux aussi des échecs, alors que leur pays est considéré comme stratégique pour l'avenir de la révolution européenne : en avril 1920, le soulèvement de la Ruhr, lancé par le KPD et les « conseillistes » du KAPD en réaction à la tentative de putsch nationaliste, est stoppé par l'intervention de l'armée allemande. En , une nouvelle tentative de soulèvement du KPD et du KAPD est menée sous l'impulsion des envoyés hongrois du Komintern, Béla Kun et Mátyás Rákosi : mal préparée, l'insurrection allemande est un échec total[218],[219].
En , l'Internationale communiste, lors de son troisième congrès, reconnaît avec prudence que la phase révolutionnaire ouverte en 1917, « caractérisée par sa violence élémentaire, par l'imprécision très significative des buts et des méthodes », est achevée[220].
Victoire des communistes en Mongolie

Repoussé militairement ou écrasé politiquement en Europe occidentale, le communisme réalise cependant une progression en Asie lorsque la guerre civile russe déborde sur la Mongolie-extérieure, pays voisin de l'ex-empire russe et indépendant de la Chine depuis quelques années : le chef de guerre russe blanc Ungern-Sternberg y prend le pouvoir en 1921 avant d'être chassé la même année par l'Armée rouge et les révolutionnaires mongols dirigés par Damdin Sükhbaatar et Horloogiyn Choybalsan. Fédérés au sein du Parti du peuple mongol, les communistes locaux prennent en le contrôle de la Mongolie : le pays reste officiellement une monarchie théocratique, mais le Khan ne conserve qu'un pouvoir symbolique. En 1924, après la mort du Khan, la monarchie est abolie et laisse la place à la République populaire mongole, État alors fermé sur l'extérieur, non reconnu internationalement et très largement dépendant de son voisin soviétique. Le Parti est rebaptisé Parti révolutionnaire du peuple mongol. Les deux seuls États alliés à l'URSS sont à l'époque la Mongolie communiste et une entité nettement plus modeste, l'ancien protectorat russe de Tannou-Touva : chacun des deux pays est à l'époque le seul à reconnaître l'autre, à l'exception de l'URSS[221],[222].
Le communisme international dans l'entre-deux-guerres
Expansion du mouvement communiste dans les années 1920-1930
Malgré l'échec des tentatives révolutionnaires européennes en dehors de la Russie, la mouvance communiste se développe rapidement en Europe, puis dans le reste du monde, dans le courant des années 1920. Entre 1919 et 1921, la plupart des partis socialistes et sociaux-démocrates européens scissionnent — certains se rebaptisant tout simplement du nom de Parti communiste — sous l'influence de la révolution bolchevique[223]. Dans certains pays, en Europe (Portugal) mais aussi en Amérique latine, les partis communistes ne se constituent pas à partir de scissions des partis socialistes mais naissent au contraire au sein des milieux anarcho-syndicalistes[224]. Attirant une clientèle électorale de salariés — d'ailleurs souvent davantage chez les travailleurs qualifiés que dans la frange la plus défavorisée du prolétariat — l'engagement communiste séduit également dans une partie de l'intelligentsia ainsi que dans une certaine frange de la bourgeoisie progressiste sensible au sort des ouvriers. L'adhésion au communisme ne se mesure par ailleurs pas uniquement sur le plan de l'adhésion à un parti communiste, l'idéologie attirant dans tous les secteurs de nombreux sympathisants — « compagnons de routes » — engagés aux côtés de la mouvance sans être pour autant des membres encartés d'un quelconque mouvement[225],[226]. L'Internationale communiste (Komintern) pilotée depuis Moscou constitue une vaste machine de formation, de financement et d'encadrement des partis communistes[223].
Dès l'annonce de la Révolution d'Octobre, le phénomène exerce un fort pouvoir d'attraction sur de nombreuses imaginations, indépendamment de la réalité du régime russe : dans la foulée du traumatisme de la Première Guerre mondiale et de l'échec des mouvements socialistes à s'y opposer, le bolchevisme semble porteur d'une immense espérance et comme un événement universel, comparé à la Révolution française et pouvant amener à la rupture avec le capitalisme[227]. La Révolution d'Octobre soulève également l'enthousiasme dans une partie des milieux anarchistes : nombre d'anarcho-syndicalistes se rallient à l'Internationale communiste, alors même que les anarchistes, initialement alliés aux bolcheviks, sont réprimés en Russie soviétique[228]. Le régime bolchevik continue de séduire les libertaires jusqu'à l'écrasement de la révolte de Kronstadt en 1921[229].
Si le communisme gagne du terrain dans certains pans des opinions publiques, il suscite à contrario, dans d'autres secteurs, de vives réactions anticommunistes, pendant et après la vague révolutionnaire de 1919-1921. En France, la peur du bolchevik « au couteau entre les dents » contribue par exemple à la victoire de la coalition de la droite et du centre lors des législatives de 1919[230]. Le mouvement communiste est fort en Allemagne, mais les soulèvements révolutionnaires de 1918-1919, très brutalement réprimés, ont également renforcé, en réaction, la droite nationaliste[231]. Les évènements de 1919-1921 contribuent à faire apparaître en Europe, dans les années 1920, des régimes autoritaires ou dictatoriaux — notamment ceux de Horthy en Hongrie et de Mussolini en Italie — dont l'anticommunisme est l'un des fondements idéologiques. Si la crainte du communisme alimente, dans l'entre-deux-guerres, des mouvements d'extrême droite comme le fascisme et plus tard le nazisme[232], certains gouvernements démocratiques vont eux aussi jusqu'à prendre des mesures répressives. Ainsi, peu après la révolution russe, les États-Unis connaissent en 1919-1920 la période dite de la « peur rouge » : à la suite de plusieurs attentats anarchistes, l'opinion américaine craint la multiplication de complots révolutionnaires (communistes, anarchistes, socialistes...). Plus de la moitié des États adoptent des lois punissant l'apologie de la révolution, voire l'usage du drapeau rouge[233],[230]. En 1937, c'est le gouvernement du Québec qui adopte une loi protégeant la province contre la propagande communiste (dite « loi du cadenas »), autorisant des mesures de censure et de perquisition pour lutter contre toute propagande communiste réelle ou supposée[234].
Développement de la Troisième Internationale
.jpg.webp)
Au deuxième congrès de l'Internationale, en , sont adoptées 21 conditions d'admission pour les partis souhaitant rejoindre le mouvement[235]. Nées d'une suggestion initiale d'Amadeo Bordiga[236], les 21 conditions ont pour but de définir les caractéristiques de l'action de chaque parti et de constituer des organisations dont l'objectif effectif est la révolution et la conquête du pouvoir. Les partis doivent s'organiser selon les principes du centralisme démocratique, combiner les actions légales et illégales en constituant des structures clandestines en plus du parti officiel, rompre avec le parlementarisme sans renoncer à participer aux élections, subordonner l'activité de leurs députés et journalistes à l'intérêt du parti et abandonner le réformisme tout en continuant de tenter de convertir les membres des partis socialistes. La nécessité de disposer d'un parti structuré et discipliné est particulièrement soulignée, cette condition étant jugée essentielle pour organiser et diriger la lutte révolutionnaire[237].

Le second congrès du Komintern est également marqué par la présence, outre celle des révolutionnaires européens, de plusieurs participants asiatiques. Lénine souligne dans son rapport, au cours de la première séance, que « l'impérialisme mondial » s'écroulera quand « l'offensive révolutionnaire des ouvriers exploités et opprimés au sein de chaque pays […] fera sa jonction avec l'offensive révolutionnaire des centaines de millions d'hommes qui, jusqu'à présente, étaient en dehors de l'histoire ». Si l'Italien Serrati juge que cette position est dangereuse pour le prolétariat occidental et que la révolution a son centre en Europe, l'Indien M. N. Roy insiste au contraire sur le fait que la révolution occidentale ne pourra se faire sans l'appui des mouvements orientaux. Lénine défend quant à lui une voie médiane, mais considère que la révolution soviétique doit trouver des alliés hors d'Europe, capables de miner les arrières des puissances coloniales qui lui sont hostiles : dans cette optique, le mouvement communiste devra prendre appui sur les mouvements indépendantistes au sein des pays colonisés. Aux yeux de Lénine, le continent asiatique est susceptible de tenir un rôle capital dans la mondialisation de la révolution, car il accueille la majorité de la population du globe ; les « pays arriérés » d'Asie pourraient en outre sauter l'étape du capitalisme, pour passer directement à un régime soviétique. Lénine estime cependant que même les communistes des pays colonisateurs ne sont pas encore prêts à le suivre dans la voie[238].
Le mois suivant se tient à Bakou le « Premier congrès des peuples d'Orient », qui réunit des délégués venus en majorité d'Asie centrale. Cette réunion accepte la légitimité des mouvements nationaux dans la mesure où ils ébranlent la domination des puissances impérialistes : au nom de l'anti-impérialisme, l'internationalisme communiste se marie dès lors avec l'anticolonialisme. L'idéologie officielle du mouvement communiste s'accommode ainsi, du moins à titre tactique et transitoire, d'un certain nationalisme[239]. Au cours du congrès de Bakou, Zinoviev incite les délégués musulmans à la « guerre sainte » contre l'impérialisme britannique : l'assistance, enthousiaste, en appelle au djihad[240],[241],[242],[243].
Dans le courant des années 1920 et 1930, des partis communistes sont créés sur tous les continents. Aux États-Unis, deux partis rivaux naissent en 1919 et tentent tous deux d'obtenir l'aval du Komintern, qui doit intervenir pour les faire fusionner au sein du Parti communiste USA (CPUSA)[244]. Le Parti communiste de Grande-Bretagne et le Parti communiste d'Australie naissent en 1920, le Parti communiste de Belgique, le Parti communiste suisse, le Parti communiste du Canada et le Parti communiste de Nouvelle-Zélande en 1921. Aux Indes orientales néerlandaises, l'Union social-démocrate des Indes, animée principalement à ses débuts par des militants néerlandais, prend en 1920 le nom d'Association communiste des Indes (PKH) et devient le premier parti asiatique à adhérer à la IIIe Internationale ; en 1924, la PKH se rebaptise Parti communiste indonésien (PKI). Engagé dans la lutte indépendantiste, le PKI est alors l'un des rares PC asiatiques qui attire des effectifs militants non négligeables[245]. Le groupe qui donnera naissance au Parti communiste d'Inde est formé en 1920 par M. N. Roy, qui se trouve alors au Turkestan à l'issue du second congrès de l'Internationale communiste : ce n'est cependant qu'en 1925 que le Parti a la possibilité d'être officiellement fondé sur le sol des Indes britanniques[246],[247].
Par ailleurs, des problèmes propres aux mouvements communistes orientaux apparaissent rapidement. Le congrès de Bakou fait d'emblée ressortir l'absence d'unité de vues entre les dirigeants occidentaux du Komintern et les communistes orientaux ; les premiers sont en effet encore réticents à reconnaître la spécificité des luttes des seconds[240],[241],[242],[243]. Les délégués musulmans sont avant tout attachés à la notion de révolution nationale qui leur paraît seule susceptible de garantir l'émancipation de l'Orient, et ne s'intéressent pas à la forme sociologique du mouvement communiste asiatique, dont M. N. Roy veut au contraire faire une question centrale. L'organisation des communistes du Turkestan souhaite par ailleurs se constituer en parti communiste turc. En 1923, Lénine, Staline et Zinoviev finissent par condamner les « déviations nationales ». Cela entraîne une rupture avec Sultan-Galiev, l'un des communistes tatars les plus en vue, qui juge au contraire que les luttes des prolétariats de l'Orient sont entièrement distinctes de celles des prolétaires occidentaux. Sultan-Galiev prône la création d'un grand État national turc, et la fusion du communisme et de l'islam via la création d'une nouvelle Internationale distincte du Komintern. Il finit par être arrêté, et la situation au Turkestan est « normalisée »[243].
En Turquie, le mouvement communiste se trouve dans une situation particulière : le Parti communiste de Turquie, dirigé par Mustafa Suphi, est créé à Bakou en septembre 1920, mais Mustafa Kemal fait fonder dès le mois suivant par ses alliés, sur le sol turc, un autre Parti communiste, qui soutient son gouvernement. Le Komintern ne reconnaît que le parti de Subhi et pas le PC pro-Kemal. En janvier 1921, alors qu'ils reviennent en Turquie, Subhi et la plupart des autres dirigeants de son parti sont assassinés en mer Noire par des nationalistes. Le gouvernement bolchevik privilégie par la suite ses bonnes relations avec le gouvernement de Mustafa Kemal par rapport au soutien aux communistes turcs. Une fois devenu président de la République, Kemal fait interdire le PC turc, dont plusieurs centaines de militants sont arrêtés[248],[249].
En outre, les dimensions des partis qui naissent dans le monde entier durant l'entre-deux-guerres sont très inégales, certains n'étant à l'origine que des groupuscules : le Parti communiste mexicain, fondé en , ne rassemble à sa création que 12 militants[250]. Le Parti communiste brésilien est fondé en 1922 par neuf délégués issus de divers mouvements anarchistes, qui rassemblent au total 75 militants dans tout le pays[251]. Le Parti communiste de Belgique compte à peine mille membres[250].
En France

En France, la révolution russe suscite de nombreux sympathisants dans les milieux de gauche (socialistes, anarchistes, syndicalistes...). Des membres de la tendance anarchiste de la CGT participent, fin mai 1919, à la création d'un premier Parti communiste français visant à créer un trait d'union entre ces courants : ils tentent également d'animer des « soviets » en France. Relevant de l'ultra-gauche (le « gauchisme » dénoncé par Lénine) et de la tendance anarchiste de la révolution russe dont il ne retient que l'aspect « soviétiste », ce parti se divise rapidement et n'a qu'une existence éphémère[252].
La tendance qui va devenir le véritable Parti communiste français se développe au sein de la SFIO, dont une partie des militants plaide pour un retrait de l'Internationale ouvrière discréditée par la guerre. L'échec des grèves de 1920 exacerbe le conflit entre les courants réformistes et révolutionnaires du socialisme français[253]. Des militants SFIO d'extrême-gauche, Fernand Loriot et Boris Souvarine, créent le Comité de la troisième Internationale et plaident pour l'adhésion du parti socialiste à l'Internationale communiste. Les réactions face à la révolution d'Octobre sont initialement très mitigées, y compris chez des futurs ralliés. Mais à l'été 1920, les dirigeants de la SFIO Ludovic-Oscar Frossard et Marcel Cachin effectuent en Russie soviétique un voyage durant lequel leurs déplacements sont dûment guidés par les bolcheviks : ils en reviennent conquis par le nouveau régime[254].
Un vaste débat s'ouvre parmi les militants et dans la presse socialiste française : Cachin et Frossard militent pour une adhésion sans réserves à l'Internationale communiste, Jean Longuet envisage une adhésion avec réserve, tandis que Léon Blum la refuse en critiquant sur le fond le régime bolchevik. Le congrès s'ouvre le à Tours, sous la présidence d'honneur de Loriot et Souvarine emprisonnés ; le 29 décembre la motion Cachin-Frossard obtient une large majorité. Socialistes et communistes français scissionnent : Longuet et Blum reconstituent aussitôt la Section française de l'Internationale ouvrière en regroupant les minoritaires. La Section française de l'Internationale communiste, qui réunit les majoritaires, prend ensuite le nom de Parti communiste français[255].
Dès l'année suivante, cependant, la SFIO reprend l'avantage : avec le reflux de la vague révolutionnaire en Europe, les effectifs du PCF s'effondrent et, lors des élections de 1924, les socialistes devancent largement les communistes[256].
En Italie

En Italie, dans le contexte de l'échec du biennio rosso, le Parti socialiste italien tient en janvier 1921 son congrès à Livourne. Une motion modérée, défendue notamment par Filippo Turati, est prête à demeurer au sein de l'Internationale communiste mais refuse les 21 conditions ; une motion dite « communiste », menée entre autres par Antonio Gramsci et Amadeo Bordiga, exige l'acceptation des 21 conditions et l'exclusion des réformistes ; enfin, une motion maximaliste défendue par Giacinto Menotti Serrati accepte les 21 conditions mais refuse d'exclure les modérés. Cette dernière motion remporte une large majorité, provoquant la scission des communistes, qui fondent le Parti communiste d'Italie. Ces divisions interviennent dans un contexte très périlleux pour la gauche italienne, le fascisme étant alors en pleine ascension[195].
Dans le reste de l'Europe
En novembre 1919 est fondé le Parti socialiste de gauche du Danemark, qui devient l'année suivante le Parti communiste du Danemark. En Suède, le Parti social-démocrate de gauche adhère en 1919 au l'Internationale communiste et se rebaptise en 1921 Parti communiste de Suède. Le Parti travailliste norvégien rejoint l'Internationale communiste en 1919 mais la quitte dès 1923 : les partisans du maintien dans l'IC se séparent alors du Parti travailliste et forment le Parti communiste norvégien. L'organisation de jeunesse du Parti socialiste ouvrier espagnol adhère directement à l'IC et fonde le Parti communiste espagnol en avril 1920 ; un autre parti, le Parti communiste ouvrier espagnol, est fondé en 1921 et le Komintern doit alors intervenir pour faire fusionner les deux organisations au sein du Parti communiste d'Espagne[257]. Le Parti communiste portugais est fondé en 1921 non par une scission d'un parti socialiste, mais par l'union de groupes syndicalistes d'extrême-gauche[258]. En Grèce, le Parti socialiste ouvrier de Grèce, fondé en novembre 1918, adhère l'année suivante au Komintern et prend en 1924 le nom de Parti communiste de Grèce (KKE)[259]. La défaite de la Grèce dans la guerre contre la Turquie provoque un afflux de réfugiés grecs d'Asie mineure. Cette « Grande Catastrophe » ayant dégradé l'économie grecque, le mouvement communiste gagne de nombreuses recrues, notamment au sein de la population réfugiée qui vit dans des conditions très difficiles[260]. Le Parti socialiste de Roumanie se rebaptise en mai 1921 Parti socialiste-communiste, puis Parti communiste de Roumanie ; il est cependant interdit en 1924[261]. Dans le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes (futur Royaume de Yougoslavie), le Parti socialiste ouvrier yougoslave naît en avril 1919 ; une fois affilié au Komintern, il devient en juin de l'année suivante le Parti communiste de Yougoslavie. Malgré un programme vague, le PCY remporte un rapide succès du fait de la misère des campagnes et de la situation chaotique du nouvel État : aux élections de l'assemblée constituante en , le Parti remporte 58 sièges sur 419[262]. Un mois plus tard, prenant prétexte de grèves, le gouvernement limite par décret les activités du PCY, tout en laissant siéger ses députés. Le parti est interdit l'année suivante après une tentative d'assassinat du régent par un militant communiste[263]. En 1921, une scission du Parti social-démocrate tchécoslovaque donne naissance au Parti communiste tchécoslovaque[264]. Le Parti communiste de Chypre est fondé en 1926[265].
En Amérique latine
En Amérique latine, le Parti communiste d'Uruguay naît en 1921 d'une scission du Parti socialiste[224] ; au Chili le Parti ouvrier socialiste se rebaptise en janvier 1922 Parti communiste du Chili ; en Argentine, le Parti socialiste internationaliste, scission en janvier 1918 du Parti socialiste argentin, adhère en mai 1919 à l'Internationale communiste et devient ensuite le Parti communiste argentin[266]. À Cuba, les différents groupes communistes se réunissent en 1925 au sein d'un premier mouvement, l'Union révolutionnaire communiste, qui s'illustre dans l'opposition au régime de Gerardo Machado. Comprenant de nombreux étrangers immigrés à Cuba, notamment des travailleurs juifs ne parlant pas espagnol, ce parti n'est admis au sein de l'Internationale communiste qu'à partir de 1927, probablement du fait de son identité nationale incertaine[267]. Le Parti communiste de l'Équateur naît en 1926 et adhère à l'IC deux ans plus tard. Le Parti communiste péruvien et le Parti communiste paraguayen apparaissent en 1928, le Parti communiste colombien et le Parti communiste salvadorien en 1930, le Parti communiste du Venezuela et le Parti communiste du Costa Rica en 1931[224].
En Chine

Si l'Indien M. N. Roy est, à l'époque de la fondation de l'Internationale communiste, le militant communiste asiatique le plus connu, c'est en Chine et non aux Indes britanniques que le communisme connaît sa progression la plus importante en Asie. La Chine, depuis le début du XIXe siècle, est très affaiblie politiquement et a connu de nombreuses humiliations internationales qui l'ont conduite à devenir la « semi-colonie » de diverses puissances étrangères[268]. Les idées socialistes venues d'Occident gagnent progressivement au début du XXe siècle les milieux intellectuels et politiques, notamment au sein du courant républicain et nationaliste, sans les dominer pour autant[269]. La chute de l'Empire Qing à la suite de la révolution de 1911 ne permet pas au pays de retrouver une autorité centrale forte et, à partir de 1916, la République de Chine connaît une nouvelle période de chaos politique durant l'ère des seigneurs de la guerre. En réaction à ce contexte, le nationalisme chinois gagne en puissance au sein de la jeunesse à partir de 1919, via le mouvement du 4-Mai : des groupes de sympathisants marxistes apparaissent dans le sillage de cette mouvance[268].
La Russie soviétique et le Kuomintang (KMT), parti nationaliste dirigé par Sun Yat-sen, nouent une politique d'alliance : le Komintern s'emploie dès lors à favoriser la naissance en Chine d'un parti communiste, destiné à s'allier au Kuomintang. Les différents groupes de sympathisants communistes, issus notamment du mouvement du 4-Mai, se rapprochent les uns des autres. Avec l'aide de Mikhaïl Borodine, envoyé du Komintern, le Parti communiste chinois (PCC) organise son congrès fondateur en juillet 1921 à Shanghai. Le premier secrétaire général du parti chinois est Chen Duxiu ; Mao Zedong assiste au congrès fondateur du Parti en tant que délégué d'un groupe du Hunan. Le PCC, qui ne compte que 200 militants en 1922, est alors une formation infiniment plus modeste que le Kuomintang : dès lors, le Komintern encourage les communistes chinois à adhérer au KMT en pratiquant la double appartenance, tout en demeurant étroitement alliés avec les nationalistes au sein d'un Front uni. Borodine obtient notamment que le militant communiste Zhou Enlai prenne la tête du département politique de l'Académie militaire de Huangpu, qui doit former l'armée du Kuomintang[270]. L'URSS, qui fonde de grands espoirs sur ses opérations en Chine, apporte une aide décisive au parti nationaliste chinois. L'université Sun Yat-sen de Moscou, spécialement dédiée à la formation des cadres politiques chinois, accueille des membres du KMT comme du PCC. Tchang Kaï-chek, chef militaire du KMT, perfectionne sa formation à Moscou et bénéficie du soutien de Borodine. Sous l'influence de ce dernier, le PCC se développe rapidement et commence à devenir un mouvement révolutionnaire solidement structuré[271].
Dans le reste de l'Asie et en Afrique
En Extrême-Orient, le Parti communiste japonais se constitue en juillet 1922 mais est aussitôt contraint à la clandestinité ; la « loi de préservation de la paix » de 1925 vise ensuite tout particulièrement les socialistes et les communistes japonais[272]. Dans la Corée colonisée par le Japon, le Parti communiste de Corée, formé en avril 1925, est lui aussi réduit à la clandestinité par les lois japonaises[273] : engagés dans le combat indépendantiste contre les Japonais, les communistes coréens mènent des actions de guérilla mais la répression contraint beaucoup d'entre eux à se réfugier en URSS au fil des années[274]. Le Parti communiste philippin, formé en 1930, est interdit deux ans plus tard par la Cour suprême du Commonwealth des Philippines, puis à nouveau autorisé en 1937[275],[276].
L'un des émissaires du Komintern en Asie, le vietnamien Nguyễn Ái Quốc (futur Hô Chi Minh), est chargé d'organiser les organisations communistes de la région, comme le Parti communiste malais (fondé en 1930 en Malaisie britannique) et les différents groupes thaïlandais (le Parti communiste thaïlandais proprement dit n'est formé qu'en 1942) tout en s'efforçant de les faire sortir des limites de la diaspora chinoise où ils comptent l'essentiel de leurs membres. En février 1930, Nguyễn Ái Quốc fonde à Hong Kong, avec d'autres exilés, le Parti communiste vietnamien : l'IC impose rapidement au PCV de se rebaptiser Parti communiste indochinois, dans l'espoir de séduire les autres peuples de l'Indochine française en affirmant une visée indépendantiste à l'échelle de toute la péninsule. Le recrutement du Parti reste cependant, dans les années suivantes, essentiellement vietnamien[277].
Au Moyen-Orient, l'Internationale communiste mise sur les luttes nationales, mais les partis communistes créés dans la région éprouvent de grandes difficultés à s'implanter durablement. Le Parti communiste palestinien, créé en Palestine mandataire, est entièrement dirigé par des Juifs de Palestine qui, ne parlant pas l'arabe, ont bien du mal à suivre les consignes d'« arabisation » de l'Internationale[278]. L'activisme communiste dans le monde arabe, qui mise sur la création de « Partis nationalistes révolutionnaires » arabes, se déroule dans des conditions aux limites de l'isolement[279]. L'Afrique est, dans l'entre-deux-guerres, un continent négligé par le Komintern. Les quelques partis qui y apparaissent sont surtout formés de militants d'origine européenne, comme le Parti communiste sud-africain dont les cadres sont blancs (il réussit cependant assez vite à attirer des militants noirs[280]). Le Parti communiste algérien est quant à lui formé à l'origine en tant que section du PCF en Algérie française : ce n'est que très progressivement qu'il acquiert une certaine autonomie et s'ouvre à des indigènes musulmans[281].
Assez vite, dans le courant des années 1920, l'Internationale communiste réduit ses activités en direction des peuples extra-européens et colonisés, dont elle juge le potentiel révolutionnaire insuffisant et l'orientation trop réactionnaire[282]. Les « déviations » comme celle de Sultan-Galiev sont réprimées. Dès 1921, la Russie signe avec le Royaume-Uni un accord commercial, qui comporte une clause par laquelle elle s'engage à s'abstenir de toute propagande qui pourrait nuire aux intérêts britanniques en Asie. Les Soviétiques s'emploient ensuite principalement, en Asie, à instrumentaliser les mouvements nationaux, ou du moins à choisir lesquels doivent être soutenus. Malgré les protestations de militants issus de pays colonisés — comme Nguyễn Ái Quốc, M.N. Roy ou le Malais Tan Malaka — le Komintern s'en tient à une position européo-centrée, en considérant que seul l'Occident est à même de mener à bien une « révolution sociale », tandis que les mouvements orientaux sont voués à ne mener que des « révolutions nationales »[243].
À partir de 1928, Staline concentre l'essentiel de son attention sur l'Europe. Ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale, et notamment à partir de la victoire des communistes chinois en 1949, que l'URSS fait le choix d'une politique ouvertement tiers-mondiste en soutenant fortement les mouvements de libération nationale dans le contexte de la décolonisation[282].
Les tendances communistes minoritaires
.JPG.webp)
Dans le même temps, des dissensions persistent dans le camp communiste face à l'autoritarisme des conceptions léninistes, tout particulièrement en ce qui concerne le rôle dirigeant du Parti et le devoir d'obéissance aux consignes du Komintern. Une partie de ces dissidences constituant la mouvance dite de la Gauche communiste : certains militants marxistes, qui se réclament du luxemburgisme — c'est-à-dire des idées de Rosa Luxemburg — prônent la prise en main du prolétariat par lui-même, via notamment des conseils ouvriers, plutôt que par des partis politiques. Le néerlandais Anton Pannekoek, qui s'affirme comme l'un des principaux théoriciens du communisme de conseils, est exclu du Komintern en 1921. Herman Gorter l'est à son tour pour avoir publié Lettre à Lénine, texte dans lequel il dénonçait l'absence de liberté au sein des partis, ainsi que la pratique de ceux-ci[283],[284]. Paul Levi occupe un temps la présidence du KPD : fidèle à l'héritage de Rosa Luxemburg dont il a été le compagnon, il se montre méfiant vis-à-vis des directives de l'Internationale ; mais, contesté en interne par un ensemble d'adversaires, il quitte la direction du Parti dès le début de 1921. Quelques mois plus tard, il est exclu du Parti pour avoir critiqué le rôle des envoyés du Komintern lors de la tentative de soulèvement de mars. Levi fonde ensuite le courant Communauté de travail communiste, qui constitue une première scission du KPD, puis finit par réintégrer le SPD[285],[219]. Toujours en Allemagne, Herman Gorter fonde le Parti communiste ouvrier d'Allemagne (KAPD), qui regroupe les « conseillistes » du KPD. Le KAPD et différents groupes dans la mouvance de la gauche communiste se fédèrent en créant en 1922 l'Internationale communiste ouvrière[286], mais celle-ci n'a qu'une existence éphémère[287]. Très critique envers le « capitalisme d'État » soviétique où les travailleurs ne contrôlent pas plus les moyens de production que sous l'ancien régime, les « conseillistes » dénient toute légitimité aux partis, considérant que les structures ne peuvent qu'être temporaires et que c'est à la classe ouvrière dans son ensemble de faire la révolution. Des groupes conseillistes apparaissent notamment en Allemagne, mais le communisme de conseils, qui n'a, par définition, pas vocation à s'incarner dans des organisations, est historiquement vaincu dès 1921[288]. Le « luxemburgisme », malgré son aura auprès de certains intellectuels et militants, n'a qu'une influence réduite et c'est plutôt le trotskisme qui incarne, par la suite, un courant communiste dissident possédant un relatif rayonnement[289].
En France, l'un des fondateurs du parti communiste, Ludovic-Oscar Frossard, le quitte au début de 1923. Lui et ses partisans rejoignent un groupe dissident, l'Union socialiste communiste ; il finit par revenir à la SFIO dès 1924[290],[291]. Devant l'évolution du régime soviétique et la « bolchévisation » des partis, des figures venues du syndicalisme révolutionnaire — comme en France Alfred Rosmer et Pierre Monatte — s'éloignent également du Komintern dans les années 1920[288]. L'italien Amadeo Bordiga adopte lui aussi des positions « de gauche », mais de l'intérieur du Komintern dont il demeure membre durant les années 1920[292].
Par ailleurs, en Allemagne, des militants comme Ernst Niekisch — qui avait participé à la République des conseils de Bavière — tentent une synthèse entre nationalisme prussien et bolchevisme : cette tendance, surnommée le « national-bolchevisme », ne donne pas naissance à un mouvement politique d'envergure notable, mais séduit certains cercles intellectuels et des associations de jeunesse, ainsi que la gauche du Parti nazi. Niekisch, devenu nationaliste par hostilité à la politique pro-occidentale du gouvernement de Weimar, considère le marxisme soviétique comme un déguisement utilisé par le nationalisme russe pour mieux affronter le capitalisme occidental et salue en Staline le seul vrai héritier de Lénine[293],[294],[295].
Réorganisation du Komintern
Au cours des années 1920, l'Internationale communiste s'emploie à homogénéiser le fonctionnement des partis communistes nationaux selon le modèle bolchevik en surveillant à la fois leur appareil et leur conformité idéologique. Si de nombreux cadres étrangers — par ailleurs souvent exilés de leurs pays — participent aux instances de l'IC, comme le Finlandais Otto Wille Kuusinen, l'Italien Palmiro Togliatti, le Hongrois Mátyás Rákosi, le Suisse Jules Humbert-Droz ou le Bulgare Georgi Dimitrov, les principaux responsables de l'organisation sont, jusqu'en 1934, des Soviétiques (Zinoviev, Boukharine, Molotov puis Manouïlski). Les cadres d'Europe occidentale sont relativement peu nombreux à gravir la hiérarchie de l'IC, le Français André Marty étant un contre-exemple[296].
Des émissaires du Komintern, comme Eugen Fried en France dans les années 1930, sont envoyés conseiller les cadres communistes des partis nationaux. En 1924, le cinquième congrès de l'Internationale ouvre la phase dite de « bolchevisation » des partis, qui vise, après l'échec des révolutions européennes, à réorganiser l'action des partis en entreprise, à structurer les cellules locales et à renforcer la discipline idéologique, afin que les partis, encore faibles pour la plupart sur les plans électoral et organisationnel, soient aptes à saisir les prochaines occasions révolutionnaires. La réalisation hâtive de la bolchevisation, en 1924-1925, cause des remous dans la plupart des partis communistes[296],[236].
L'Internationale communiste crée au fil des années un ensemble de structures destinées à devenir des organisations de masse pouvant concurrencer les mouvements de la social-démocratie. À la suite de son troisième congrès en 1921, l'IC fonde l'Internationale syndicale rouge (ISR, dite également Profintern), destinée à porter la parole communiste dans le monde du travail. La création de l'ISR se situe dans le contexte du changement de stratégie qui a suivi l'échec de la vague révolutionnaire en Europe. La rupture de plus en plus prononcée avec les libertaires, puissants dans le syndicalisme, impose de se trouver d'autres relais parmi les travailleurs. À sa création, l'ISR revendique des représentations dans 41 pays et des liens avec 17 millions de syndiqués, chiffres apparemment très exagérés ; l'organisation hésite en outre entre créer de nouvelles organisations ou travailler à l'intérieur des syndicats réformistes. Les résultats obtenus par l'Internationale syndicale rouge sont très mitigés et elle ne parvient réellement à marquer des points qu'en France, grâce à l'adhésion en 1922 de la CGTU, dont l'Internationale communiste s'assure bientôt le contrôle[297]. L'allemand Willi Münzenberg, spécialiste de l'agitprop, est l'un des principaux animateurs et concepteurs des structures annexes de l'Internationale communiste, qui comptent notamment avec les années l'Internationale des jeunes communistes, l'Internationale paysanne rouge (Krestintern), le Secours rouge international (MOPR), le Secours ouvrier international, Les Amis de l'URSS ou la Ligue contre l'impérialisme et l'oppression coloniale[298].
En Europe

Malgré l'inquiétude qu'elle suscite chez ses adversaires à travers le monde, l'Internationale communiste ne remporte que peu de succès dans le cadre de ses ambitions révolutionnaires. Au cours des années 1920 et 1930, aucune révolution communiste ne réussit et les communistes échouent par ailleurs à endiguer la montée des mouvements fascistes et assimilés[299]. Le coup de force des communistes allemands en avait déjà été un échec : en 1923, la tentative d'organiser une insurrection censée être l'« octobre allemand » tourne à la débâcle[300],[301]. Diverses autres tentatives révolutionnaires se soldent également par des fiascos. Après sa dissolution, le Parti communiste de Yougoslavie se tourne vers des actions terroristes qui n'aboutissent qu'à l'exclusion de ses députés du parlement et à son interdiction totale. Le PCY entame vingt années de clandestinité : son appareil est presque réduit à néant au début des années 1930[302]. Le Parti communiste de Finlande, dont les dirigeants sont réfugiés sur le sol soviétique, tente vainement de fomenter des révoltes armées en Finlande[186]. En septembre 1923, le chef du Parti communiste bulgare, Georgi Dimitrov, organise avec l'aide de l'émissaire du Komintern Vassil Kolarov une insurrection contre le gouvernement : le soulèvement échoue et Dimitrov et Kolarov doivent prendre la fuite, tandis que le PCB est interdit et réprimé. En avril 1925, les communistes bulgares organisent un attentat meurtrier à Sofia, qui entraîne de nombreuses arrestations dans leurs rangs[303].
Au Portugal, l'activisme du Parti communiste portugais n'aboutit qu'à son interdiction en 1926, par le régime de la Dictature nationale ; le PCP entre dans la clandestinité, situation qui se prolonge ensuite durant des décennies sous l'Estado Novo de Salazar. Le Parti communiste d'Italie est parcouru de divisions en pleine ascension du fascisme : Antonio Gramsci parvient à faire mettre en minorité la ligne d'Amadeo Bordiga qui soutient Trotsky mais, en 1926, le PC italien est interdit par le gouvernement de Benito Mussolini comme tous les autres partis d'opposition. La plupart des chefs communistes italiens, dont Gramsci lui-même, sont emprisonnés : le seul membre de la direction du Parti à échapper à l'arrestation est Palmiro Togliatti, qui se trouvait à Moscou en tant que représentant auprès du Komintern. Il devient dès lors secrétaire général du PC italien en exil[304],[305]. Durant son emprisonnement, Gramsci se consacre à l'élaboration d'une œuvre théorique hétérodoxe, s'éloignant de l'économisme traditionnel des marxistes et mettant l'accent sur le rôle de la culture et des arts : les Cahiers de prison de Gramsci, publiés après-guerre, feront ensuite de lui, post mortem, un penseur marxiste très influent[306],[307]. À Chypre, en 1931, après la rébellion contre les autorités coloniales britanniques, le Parti communiste est interdit en même temps que les autres groupes ayant participé à la révolte[265]. En 1936, le Parti communiste de Grèce profite d'importants mouvements sociaux pour préparer, en accord avec les syndicats, une grève générale. Mais, le 4 août, à la veille de la grève, le général Metaxás instaure une dictature avec le soutien du roi Georges II : des milliers de communistes grecs sont arrêtés[308].
En Asie du Sud-Est
Aux Indes orientales néerlandaises, le Parti communiste indonésien (PKI) suscite des émeutes insurrectionnelles en novembre 1926 et janvier 1927. La répression mise en œuvre par les autorités coloniales néerlandaises aboutit au démantèlement et à l'interdiction du PKI, dont les cadres dirigeants sont emprisonnés ou contraints à l'exil[309]. En Indochine française, en 1930, à la faveur d'une grave famine au nord de l'Annam, le Parti communiste indochinois mobilise les paysans, mais la Sûreté générale réprime rapidement le mouvement et multiplie les arrestations de militants communistes[310].
En Amérique latine
En 1932, au Salvador, Agustín Farabundo Martí mène, sans l'aval du Komintern, une insurrection paysanne contre le régime militaire du général Martínez : la répression de la révolte débouche sur un terrible massacre — la matanza — au cours duquel périssent environ 20 000 paysans ; les principaux dirigeants communistes salvadoriens sont exécutés[311]. En 1935, au Brésil, Luís Carlos Prestes organise un soulèvement communiste qui échoue totalement et n'aboutit qu'à la décapitation du Parti communiste brésilien[312].
Début de la guerre civile chinoise
L'un des plus graves échecs de l'Internationale communiste a lieu en Chine, où le Parti communiste chinois a suivi la consigne d'alliance avec le Kuomintang et d'infiltration de ce parti nationaliste. Alors que l'expédition du Nord est lancée par le Kuomintang pour soumettre les seigneurs de la guerre, les communistes participent à l'opération de reconquête du pays et s'attirent de nombreux sympathisants dans la population, jouant un rôle décisif dans la prise de contrôle de Shanghai. Mais en avril 1927, Tchang Kaï-chek, que les Soviétiques considéraient comme un allié, réalise un coup de force pour prendre le contrôle du KMT, purger les éléments de gauche de son parti et éliminer les communistes dont il redoute la montée en puissance : le massacre de Shanghaï, suivi d'autres actions de répression, décime les rangs communistes chinois et brise l'alliance PCC-Kuomintang. Mikhaïl Borodine et M. N. Roy, les émissaires du Komintern en Chine, doivent prendre la fuite : les ambitieuses visées soviétiques en Chine semblent alors totalement ruinées. Les communistes chinois ne désarment cependant pas et, lors du soulèvement de Nanchang, une partie des soldats et officiers communistes de l'Armée nationale révolutionnaire du Kuomintang, parmi lesquels Zhou Enlai, se rebelle et constitue l'embryon de l'Armée rouge chinoise. Mao Zedong mène quant à lui, sans succès, le soulèvement de la récolte d’automne dans le Hunan et le Jiangxi. La guerre civile chinoise, que les communistes chinois mènent par leurs propres moyens, se poursuit dans les années qui suivent[270].
Mort et succession de Lénine

Le , Lénine est victime d'une attaque. Il reprend ses fonctions à l'automne. Durant sa convalescence, le président du Conseil des commissaires du peuple s'inquiète des conceptions et de la personnalité de Staline, nommé en avril secrétaire général du Parti communiste, et dont il lui apparaît qu'il concentre désormais entre ses mains un pouvoir excessif. En , il commence à dicter un ensemble de notes, désignées par la suite sous le nom de « testament de Lénine », qu'il envisage de faire lire, ou de présenter lui-même, au congrès du Parti et dans lesquelles il préconise entre autres un remplacement de Staline au secrétariat général par une personnalité moins brutale et plus consensuelle. Mais, le , une nouvelle attaque le terrasse et le laisse paralysé et muet[313]. Le XIIe congrès du Parti s'ouvre quelques semaines plus tard et manifeste une unité de façade ; Trotsky préfère s'abstenir d'attaquer Staline de front. Mais à l'automne, la crise éclate au sein du Parti à la suite d'une proposition, faite au Plénum du Comité central et visant à renforcer la surveillance du Parti pour prévenir d'éventuelles factions. Trotsky envoie le 8 octobre une lettre au Comité central dans laquelle il fustige la « dictature de l'appareil », dénonce la bureaucratisation du Parti communiste et annonce son intention d'en appeler à l'ensemble des militants. Une semaine plus tard, ces idées sont reprises dans une lettre signée par 46 vétérans de la révolution[314]. Trotsky et ses alliés, qui se réclament de l'héritage léniniste en se baptisant « bolchevik-léninistes », sont également désignés par la suite du nom d'Opposition de gauche[315]. C'est à cette époque, en 1923-1924 que le terme « trotskystes » se banalise dans le vocabulaire politique pour désigner les partisans — réels ou supposés — de Trotsky, le mot étant tout d'abord principalement utilisé par les adversaires de ce dernier[316]. Au sein du Politburo, Staline s'appuie notamment sur Zinoviev et Kamenev, inquiets des ambitions de Trotsky : le camp de Staline n'a aucune difficulté à faire condamner par une très large majorité du Comité central la position de Trotsky — connu pour son autoritarisme et se proclamant maintenant apôtre de la démocratie au sein du Parti — et des 46 signataires. La XIIIe conférence du Parti se tient du 16 au , en l'absence de Trotsky malade, et condamne le « révisionnisme anti-bolchevique » et la « déviation anti-léniniste » de l'Opposition de gauche. Des points de règlements, prévoyant des sanctions plus graves pour les factions, sont adoptés, tandis que divers partisans de Trotsky sont envoyés en poste à l'étranger[317],[318].
Lénine meurt le . Sur ordre du Politburo, son corps est conservé dans la glace en attendant de pouvoir être embaumé, puis exposé au sein d'un Mausolée construit à cet effet. La personnalité et les écrits de Lénine sont désormais présentés dans des termes quasiment religieux, l'idéologie léniniste, codifiée par Zinoviev et Staline, étant considérée à l'égal d'un texte sacré. Le léninisme est proclamé « idéologie légale exclusive de l'État soviétique ». Pour Boris Souvarine, « désormais, le léninisme sera la rigoureuse observance rétrospective et formelle de l'œuvre léninienne imprimée, valable ou caduque, obscure ou contradictoire. Bible nouvelle découpée en versets comme s'il s'y trouvait autant de réponses définitives à toutes les questions posées par l'histoire ». Staline s'institue « premier auteur classique » de l'idéologie léniniste en publiant Fondements du léninisme, recueil de conférences dans lesquelles il expose un condensé de son cru de la pensée de Lénine. Le terme marxisme-léninisme apparaît avec les années pour désigner la lecture léniniste du marxisme, mise en orthodoxie par Staline[319],[320],[321]. L'interprétation stalinienne de la théorie marxiste aboutit à une « pétrification » de celle-ci, où la succession nécessaire des cinq grands « modes de production » aboutit de manière inéluctable à la victoire du socialisme, puis au « communisme », le Parti communiste jouant le rôle de l'avant-garde[322] ; le matérialisme dialectique, désormais considéré comme une doctrine à laquelle les sciences elles-mêmes doivent être subordonnées, est décrété philosophie obligatoire de tout communiste[323].
Victoire de Staline sur ses rivaux
Après la défaite de l'Opposition de gauche et le départ de Trotsky du Conseil des commissaires du peuple en 1925, la « troïka » formée contre Trotsky par Staline, Kamenev et Zinoviev commence à se fissurer. Zinoviev, responsable du Parti à Leningrad, critique notamment la conception de la NEP par Staline et Boukharine. Au XIVe congrès du Parti, en , Kamenev dénonce la « gestion dictatoriale » de Staline ; ce dernier fait cependant approuver son rapport d'activité par le congrès. Une commission, présidée par Molotov, se charge ensuite de réorganiser le Parti à Leningrad : Zinoviev est démis de son poste et remplacé par Kirov. Un front hétéroclite des adversaires de Staline, désigné sous le nom d'Opposition unifiée, se forme alors : il regroupe entre autres Zinoviev, Kamenev, Trotsky, Radek, Antonov-Ovseïenko et différents représentants de l'Opposition ouvrière. Les opposants, dont l'unité est fragile, s'emploient à diffuser leur propagande au sein du Parti mais Staline parvient à réorganiser le Politburo à son avantage : l'activité de l'opposition est surveillée de près par le Guépéou, la police secrète qui a remplacé la Tchéka en 1922. L'Opposition unifiée perd bientôt sa cohésion et en octobre 1926, six de ses dirigeants, dont Trotsky, Zinoviev et Kamenev, publient une déclaration désavouant leurs propres « activités fractionnelles ». Le plenum du Comité central, quelques jours plus tard, sanctionne les opposants désormais discrédités : Trotsky et Kamenev sont exclus du Politburo. Quant à Zinoviev, ses jours à la tête de l'Internationale communiste sont comptés et il est remplacé par Boukharine en décembre. Trotsky tente à nouveau de réorganiser l'opposition l'année suivante mais, le , lui et Zinoviev sont exclus du Parti communiste ; Kamenev est quant à lui exclu du Comité central. Certains opposants, comme Kamenev et Zinoviev, font leur autocritique, Trotsky et la plupart des autres s'y refusant. En janvier 1928, Trotsky est exilé à Alma-Ata avec 30 autres oppositionnels[324].
.jpg.webp)
À l'hiver 1927-1928, le gouvernement soviétique est confronté à la « crise des collectes », une chute catastrophique des livraisons de produits agricoles. Staline a recours à des mesures d'urgences pour remédier à la situation ; il décide alors d'abandonner la coopération avec la paysannerie, qu'il juge responsable de la crise, en mettant fin à la NEP et collectivisant le monde rural, qui devra être réorganisé sous la forme d'exploitations collectives qui constitueraient des « forteresses du socialisme », les kolkhozes (coopératives agricoles) et les sovkhozes (fermes d'État). Le retour à une politique de réquisitions, c'est-à-dire à des pratiques de la guerre civile, crée des résistances au sein du CC : Nikolaï Boukharine conteste notamment les conclusions de Staline en matière économique. En , Staline fait condamner par un vote unanime du Politburo et du CC la « déviation droitière », sans encore attaquer ses adversaires de front. Peu après, en janvier 1929, saissant l'occasion de la publication par Trotsky d'un appel à la « lutte des communistes du monde entier » contre le projet stalinien, il fait expulser son rival d'URSS pour activités « anti-soviétiques »[325],[326],[327].
En avril 1929, le Plénum du CC consacre la défaite de l'« opposition de droite » de Boukharine, Rykov et Tomski. Staline fustige publiquement dans un discours le « soutien aux koulaks » de Boukharine. Le plan quinquennal prévoyant la collectivisation de 20 % des foyers paysans et une industrialisation accrue, est adopté ; la NEP appartient définitivement au passé. Boukharine est démis de ses fonctions au Komintern et de la direction du quotidien officiel la Pravda, Tomski de la direction des syndicats et Rykov démissionne de la présidence du Sovnarkom. Boukharine — bientôt également démis du Politburo — et ses partisans sont soumis à une campagne de presse d'une rare violence qui fustige leur collusion avec les « éléments capitalistes » et les « trotskystes ». À l'occasion de la défaite de l'opposition, Staline peut entamer sa politique de « Grand Tournant » sous les apparences de l'unanimité au sein du Parti communiste. Un culte de la personnalité se développe autour de lui : en décembre 1929, à l'occasion de son 50e anniversaire, il est salué comme « le théoricien le plus éminent du léninisme », « le Lénine d'aujourd'hui » et un « génie dont les immenses qualités sont indispensables à la classe ouvrière ». Toute forme d'opposition est désormais bannie du Parti communiste et les « déviationnistes » sont assimilés à des traîtres ; Rykov et Tomski sont contraints à des autocritiques humiliantes[328].
Disposant désormais d'un pouvoir sans limite sur les nominations et révocations des membres de l'appareil soviétique, Staline opère de multiples réorganisations, limogeages et changements d'affectation qui l'assurent de la présence de ses fidèles aux postes-clé[329].
Renforcement du contrôle sur les partis communistes
Le contrôle sur l'Internationale communiste est également renforcé. Bien que le gouvernement soviétique assure officiellement que le Komintern n'est qu'une organisation « de caractère privé » sur laquelle il n'a aucune prise[330], les activités des partis communistes nationaux sont, dans les faits, soumis à une stricte surveillance de la part des envoyés de Moscou[331]. En 1928, au VIe congrès du Komintern, Staline déclare ouvertement que les intérêts de chaque parti communiste sont subordonnés à ceux de l'URSS : « Est authentiquement révolutionnaire celui qui est prêt à défendre l'Union soviétique sans réserve, ouvertement, inconditionnellement ». En 1929-1930, l'Internationale est fermement reprise en main par des fidèles de Staline comme Dmitri Manouïlski et Viatcheslav Molotov[332]. L'École internationale Lénine, fondée en 1926 à Moscou, assure dans l'entre-deux-guerres la formation de milliers de cadres de l'IC et la diffusion du modèle politique soviétique[333].
La « bolchevisation » des partis communistes nationaux, entamée dès 1924, entraîne de nombreux conflits à l'intérieur de ceux-ci, avec, au cours des années 1920 et 1930, des évolutions incessantes des structures de direction. Un nombre considérable d'adhérents et de cadres sont mis à l'écart dans tous les partis communistes, par un processus de sélection et de formation au sein des élites dirigeantes[334]. Les personnalités jugées trop indépendantes qui ne suivent pas d'assez près la ligne dominante sont évincées : Boris Souvarine est exclu par le Komintern dès 1924 pour avoir pris la défense de Trotsky ; il adopte par la suite une démarche d'historien très critique du mouvement communiste[335]. Le théoricien conseilliste allemand Karl Korsch tente, en 1926, de s'allier à l'italien Amadeo Bordiga, principale figure de la Gauche communiste à faire encore partie du Komintern, pour fédérer les communistes de gauche — soit aussi bien l'aile gauche de partis comme le KPD que les partis sortis du Komintern comme le KAPD — au sein d'une « fraction internationale » qui soutiendrait l'opposition interne en URSS. Sa proposition se heurte à la fois à l'attitude réservée de Bordiga et à l'hostilité des groupes d'ultragauche allemands. L'échec du projet de Korsch, et l'arrestation de Bordiga par le régime fasciste italien — qui prive la gauche du Komintern de sa principale figure — mettent fin à la dernière tentative de constituer une opposition « gauchiste » au sein de la IIIe Internationale[336]. La gauche du KPD est définitivement vaincue en 1927 ; Ruth Fischer et Arkadi Maslow, cadres dirigeants du Parti communiste d'Allemagne, sont exclus en tant que partisans de Zinoviev. Amadeo Bordiga, libéré mais toujours sous surveillance policière, est finalement exclu en 1930 du PC italien en exil, pour « gauchisme ». Bien que se voulant fidèle à une ligne léniniste, il se pose désormais en opposant à l'URSS, qu'il considère comme un « État capitaliste » ; l'ensemble des différents courants se réclamant de sa pensée est par la suite désigné sous le nom de bordiguisme[283]. Au sein du Parti communiste français — affaibli par la baisse de ses effectifs et isolé face à la SFIO — l'interdiction de tout droit de critique entraîne des protestations. En 1926, le Komintern réorganise la direction du parti, tout d'abord au profit de Pierre Semard. Le PCF connaît cependant bientôt de nouveaux remous : Henri Barbé et Pierre Célor, membres du Bureau politique, sont exclus pour activités « fractionnelles » en 1931. Un nouveau secrétariat du PC français, composé de Maurice Thorez, Jacques Duclos et Benoît Frachon, est ensuite formé[337]. La ligne du Komintern, donc de l'URSS et plus précisément de Staline, prime largement sur les intérêts des partis nationaux : quand Ernst Thälmann, dirigeant du Parti communiste d'Allemagne, est destitué par une vote du comité central de son parti pour avoir couvert une affaire de détournement de fonds, l'Internationale communiste impose qu'il soit maintenu à son poste. Ce sont au contraire les adversaires de Thälmann au sein de la direction du KPD qui sont ensuite privés de leurs fonctions[338].
La domination stalinienne sur le mouvement communiste continue d'entraîner des résistances et des scissions au sein des partis nationaux. En 1928, des dissidents du Parti communiste d'Allemagne — dont ses anciens dirigeants exclus, Heinrich Brandler et August Thalheimer — forment le Parti communiste d'Allemagne - opposition ; en 1929, la majorité des cadres du Parti communiste de Suède rompt avec le Komintern et fait sécession en fondant un nouveau Parti socialiste, tandis que les partisans de Moscou restent au PC ; en Espagne apparaissent la Gauche communiste d'Espagne et le Bloc ouvrier et paysan, deux partis opposés au Parti communiste d'Espagne, qui fusionnent en 1935 pour former le Parti ouvrier d'unification marxiste (POUM). Une partie des communistes opposés à la stalinisation du Komintern — dont Brandler et ses partisans, ainsi que le POUM — se regroupent au sein de l'Opposition communiste internationale, basée à Paris. Celle-ci se désagrège cependant au cours des années 1930, pour s'unir en 1938 avec le Centre marxiste révolutionnaire international (ou « Bureau de Londres ») et disparaître au début de la Seconde Guerre mondiale[339],[340].
Malgré leurs efforts, les contestataires demeurent une minorité. Dans la plupart de cas, le contrôle exercé par l'URSS, via le Komintern, sur les PC nationaux ne se dément pas durant tout l'entre-deux-guerres[341] ; le communisme apparaît, sous sa forme dominante, comme un « système international centralisé à l'intérieur duquel le Parti russe joue un rôle dirigeant »[342].
De la persécution des koulaks aux grandes famines
Joseph Staline, ayant désormais les mains libres après l'élimination politique de ses adversaires, se lance dans une politique de collectivisation accrue. Le Plan quinquennal est soumis à une série de révisions à la hausse. Les mauvais résultats agricoles de 1928-1929, qui entraînent des situations de pénurie, et l'échec de la campagne de collectes suivante, sont attribuées par Staline à l'action des « koulaks ». À l'été 1929, la collectivisation est intensifiée pour lutter contre les « capitalistes ruraux ». Staline, dans le cadre de sa politique de « grand tournant », fait adopter un plan irréaliste de croissance industrielle et de collectivisation accélérée[343].
L'une des rares innovations théoriques de Staline, avec le socialisme dans un seul pays[321], est l'idée que la lutte des classes est destinée à s'accroître après la « prise du pouvoir par le prolétariat ». Cette conception l'amène à gouverner l'URSS selon une logique de « guerre totale » permanente[344]. Face aux résistances paysannes à la collectivisation, le dirigeant soviétique décide la « liquidation des koulaks en tant que classe »[345]. Des classifications abusives et incohérentes de diverses catégories de « koulaks » ou supposés tels sont établies, ouvrant la voie à de multiples abus. Des dizaines de milliers de paysans moyens sont « dékoulakisés », c'est-à-dire arrêtés par le Guépéou et déportés. Entre la fin de 1929 et le début de 1932, près de deux millions de paysans sont déportés, le pic se situant en 1930-1931 avec 1 800 000 personnes envoyées dans des régions inhospitalières (Oural, Sibérie, Kazakhstan…) ou sur des grands chantiers[346],[347]. Les déportations continuent dans les années suivantes. En certaines occasions, comme lors de l'« affaire de Nazino », les transferts de populations sont organisés de telle manière que les déportés, une fois arrivés à destination, sont abandonnés à une mort certaine[348].
À la même époque, le système concentrationnaire soviétique est réorganisé et prend le nom de Goulag, d'après l'acronyme russe signifiant Direction principale des camps qui désigne son administration centrale. De nombreux camps se trouvent dans les régions les plus reculées du pays, notamment en Sibérie et plus particulièrement dans la Kolyma. Initialement créé comme un service rattaché au Guépéou, le Goulag devient un véritable « État dans l'État » à mesure que l'appareil concentrationnaire change d'échelle avec la collectivisation et la dékoulakisation[349].
À l'été 1931, la campagne de collectes enregistre de mauvais résultats, ce qui provoque des réquisitions massives et autoritaires, tandis que les paysans tentent de conserver une partie de leur récolte. Le pouvoir stalinien réprime massivement les récalcitrants : les groupes ethniques et sociaux censés menacer la stabilité du régime sont quant à eux ciblés de manière préventive et collective. La politique suivie par le gouvernement soviétique a des conséquences catastrophiques : une terrible famine ravage plusieurs régions du pays et fait, principalement en Ukraine — république très touchée par les réquisitions — dans le Nord du Caucase et au Kazakhstan, environ 6 millions de victimes[350],[351]. En Ukraine, cette période, désignée du nom d'Holodomor, joue par la suite un rôle fondamental dans la mémoire historique du pays, au point que la thèse d'une famine délibérément provoquée par Staline pour soumettre définitivement une région jugée insoumise est largement répandue. Environ 30 % du groupe ethnique ukrainien disparaît. Si la famine, qui touche plusieurs autres régions soviétiques, ne paraît pas avoir été sciemment provoquée en Ukraine par Staline, le dirigeant soviétique l'a par contre utilisée pour briser la résistance de la paysannerie ukrainienne et le « nationalisme » séparatiste des Ukrainiens. L'appareil du Parti ukrainien est purgé et près d'un million d'Ukrainiens sont déportés[352].
Le Ier Plan quinquennal, dont la variante révisée à la hausse est adoptée en 1929, entraîne une industrialisation intensive en URSS, donnant la priorité à l'industrie lourde. Au cours du Ier Plan, le nombre d'ouvriers en URSS passe de 3,7 à 8,5 millions, beaucoup étant des paysans fuyant la collectivisation. Un vaste prolétariat urbain, souvent déraciné, se forme. Dans le même temps, les autorités favorisent la promotion à grande échelle d'ouvriers à des postes de responsabilité, formant une « intelligentsia technique » tandis qu'est mise en avant la lutte contre les spécialistes « bourgeois » et les « saboteurs ». L'industrie lourde connaît une forte croissance, mais l'industrie légère et la production des biens de consommation sont négligées. L'industrialisation se fait en outre sans tenir compte des coûts et entraîne une forte inflation[353].
Autres transformations de la société soviétique sous Staline

Photo Ivan Shagin
Si les objectifs économiques sont loin d'être tous atteints, le pouvoir communiste parvient cependant à transformer en profondeur la société soviétique, en favorisant la mobilité sociale, ce qui lui permet de gagner l'allégeance des citoyens qui en bénéficient : de nombreux paysans rejoignent la classe ouvrière tandis que de nombreux ouvriers accèdent à des postes à responsabilité, offrant à leurs familles des possibilités de progression sociale. Un effort important est fourni pour développer l'éducation et l'alphabétisation : la proportion d'adultes sachant lire et écrire passe de moins de 40 % avant la révolution à 95 % pour les hommes et 79 % pour les femmes, bien que les chiffres officiels soient peut-être exagérés. Les groupes ethniques de l'URSS continuent cependant d'avoir un accès inégal à l'éducation, les Russes étant bien plus avancés dans ce domaine que les Ouzbeks, les Tchétchènes ou les Kirghizes[174].
Les droits des femmes sont l'une des principales conquêtes de la révolution : les femmes ont notamment obtenu le droit à exercer un travail salarié. Ces droits connaissent cependant, comme la représentation des femmes dans la propagande officielle, des variations au gré des impératifs politiques : l'avortement, autorisé après la révolution, est à nouveau interdit en juin 1936 dans le cadre d'une politique nataliste souhaitée par Staline[354]. La place de la femme dans la société et la propagande soviétiques oscille entre d'une part la valorisation de la militante et de la « travailleuse de choc » et d'autre part celle de la maternité, sans évacuer la hiérarchie entre le féminin et le masculin. La société soviétique tend cependant à voir se généraliser le cumul entre maternité et travail salarié, anticipant sur ce point la tendance dans les pays occidentaux[355].
La persécution des religions - notamment, mais pas uniquement, l'église orthodoxe russe - atteint des sommets sous Staline. Outre la propagande antireligieuse que le Parti communiste et ses organisations affiliées - notamment la Ligue des militants athées - se chargent de diffuser, un ensemble de mesures contre la religion est pris : les publications religieuses sont interdites, de même que de multiples célébrations. De nombreux membres du clergé sont soumis à des mesures vexatoires, voire purement et simplement arrêtés et envoyés en camp de travail. Au moment de la grande terreur des années 1930, des dizaines de milliers de prêtres et de fidèles sont exécutés. La pratique religieuse demeure en théorie autorisée, mais la grande majorité des lieux de culte sont fermés de manière arbitraire[356].
Des premières purges staliniennes à la grande terreur

Au milieu des années 1930, Staline, autour duquel se développe un culte de la personnalité de plus en plus marqué[357], affermit encore son contrôle sur le Parti. Le XVIIe congrès du PC, en 1934, dresse un bilan victorieux du « Grand Tournant » : durant ce « congrès des vainqueurs », Staline est qualifié de « chef des classes ouvrières du monde entier », d'« incomparable génie de notre époque », voire de « plus grand homme de tous les temps et de tous les peuples ». Il obtient néanmoins, à bulletins secrets, moins de voix au Comité central que certains de ses collègues, comme Sergueï Kirov. L'année 1934 alterne de manière contradictoire des périodes de répression et de détente[358]. Une loi sur la trahison de la patrie, adoptée en juin, prévoit une échelle de sanctions incluant la déportation et la peine de mort, sans définir clairement en quoi consiste la « trahison de la patrie » ; elle étend en outre la responsabilité aux familles des condamnés. Le 1er décembre 1934, Kirov est assassiné, ce qui marque le début de l'une des périodes les plus répressives de l'histoire de l'URSS[359]. Le dirigeant soviétique vise à épurer la société de ses éléments présumés hostiles au régime, considérés comme des obstacles sur la voie de la construction socialiste ; dans le même temps, il entreprend de débarrasser l'appareil de l'État et du Parti de ses cadres insuffisamment dociles, éliminant ses vieux rivaux et toute personne pouvant potentiellement lui faire obstacle pour ne conserver que des fidèles et des militants qui lui doivent toute leur carrière. Les appareils du Parti sont purgés à Moscou et Léningrad : Zinoviev et Kamenev sont arrêtés pour « complicité idéologique » avec les assassins de Kirov. La responsabilité de Staline lui-même dans le meurtre de ce dernier est couramment postulée, mais n'a jamais pu être prouvée. Cette affaire donne en tout cas au dirigeant soviétique un prétexte pour lancer une nouvelle campagne de terreur[360]. L'assassinat de Kirov est suivie d'une vague d'arrestations exercées par le NKVD, police politique qui a pris la succession du Guépéou. Le Parti est une nouvelle fois purgé de ses éléments « trotskystes » et « zinoviévistes » réels ou supposés et des dizaines de milliers de personnes « peu sûres » ou présumées « antisoviétiques » sont déportées, notamment sur des critères ethniques (Finlandais, Polonais, Allemands d'Ukraine…)[361].
Les persécutions anti-religieuses sont intensifiées : de plus en plus de lieux de culte sont fermés (la proportion atteindra 95 % en 1940). En 1935-1936, Staline achève de renforcer sa position, en nommant à des postes clés des fidèles comme Anastase Mikoïan, Andreï Jdanov, Nikita Khrouchtchev ou Nikolaï Iejov. Dans le même temps, il s'emploie à réécrire et faire réécrire l'histoire du bolchevisme à sa propre gloire : une filiation directe Marx-Engels-Lénine-Staline est établie, l'histoire du Parti étant désormais présentée comme une longue lutte contre les déviations, au profit de la vraie ligne léniniste incarnée par Staline. L'exploit en 1935 du mineur Alekseï Stakhanov permet par ailleurs de lancer une nouvelle campagne de propagande : 1936 est décrétée « année stakhanoviste »[360].
La propagande s'exerce également sur les terrains culturel et scientifique. Un courant artistique visant à « rééduquer les travailleurs dans l'esprit du socialisme », le « réalisme socialiste », est élaboré par Maxime Gorki, Alexeï Tolstoï et Alexandre Fadeïev : en 1934, Gorki et Jdanov, secrétaire à l'idéologie du Parti communiste, présentent le réalisme socialiste comme le seul courant politiquement acceptable[362]. Sur le plan scientifique, Staline permet au charlatan Trofim Lyssenko de régner en maître dans le domaine de la génétique ; les champs des autres sciences « dures » sont également touchées par la propagande. Le terme de « lyssenkisme » passe ensuite à la postérité en tant que synonyme de pseudo-science soumise aux impératifs idéologiques[363].
Entre 1936 et 1938, la terreur stalinienne atteint son apogée. En août s'ouvre le premier procès de la série dite des « procès de Moscou », parodie judiciaire à grand spectacle au cours de laquelle seize vétérans bolcheviks, dont Kamenev, Zinoviev et Tomski, sont mis en accusation par le procureur Andreï Vychinski. Les accusés sont contraints de se livrer à des « aveux » dégradants[364],[365], reconnaissant avoir comploté contre Staline en liaison avec Trotsky et participé à l'assassinat de Kirov ; ils sont tous condamnés à mort, tandis que le procès est l'occasion d'une campagne de propagande à la gloire de Staline et contre la « vermine trotskyste ». En septembre 1936, Iejov est nommé à la tête du NKVD avec pour mission d'achever de démasquer le « bloc trotskyste-zinoviéviste ». En janvier, un second procès de Moscou aboutit à la condamnation de 17 accusés, dont Piatakov et Radek, pour participation à un « centre trotskyste antisoviétique » en liaison avec l'Allemagne nazie et l'Empire du Japon. Entre février-mars 1937 et mars 1938, la purge de l'appareil soviétique atteint son apogée : des dizaines, voire des centaines de milliers de cadres de l'économie et du Parti sont destitués ou arrêtés, aussitôt remplacés par une nouvelle génération de promus (celle de cadres comme Brejnev, Kossyguine ou Gromyko). L'état-major de l'Armée rouge est décimé[366].
Le NKVD, sous la direction de Iejov - lui-même minutieusement supervisé par Staline - se livre à une campagne de terreur, d'arrestations et de déportations sans précédent, visant un ensemble très hétérogène d'« ennemis » au sein de la population soviétique, dans le but de mettre en place une bureaucratie civile et militaire entièrement aux ordres et de parachever radicalement l'élimination de tous les éléments « socialement dangereux ». Toute personne suspectée de « mauvaises » origines sociales est une cible potentielle, les fonctionnaires de la police politique travaillant selon un système de quotas à atteindre. Certaines régions, comme l'Ukraine, sont particulièrement touchées. Des émissaires du centre, accompagnés de cadres du NKVD, sont envoyés superviser la purge des appareils communistes de Républiques ou de villes données : Beria en Géorgie, Kaganovitch à Smolensk et Ivanovo, Malenkov en Biélorussie et en Arménie, Molotov, Iejov et Khrouchtchev en Ukraine. Outre les militaires, les milieux scientifiques, l'intelligentsia dans son ensemble, le clergé, les « koulaks » ou supposés tels, diverses minorités ethniques, sont ciblés à une grande échelle, les familles des « ennemis du peuple » étant également visées. Sur les seules années 1937 et 1938, le NKVD procède à 1575000 arrestations, aboutissant à 1345000 condamnations à mort et 681692 exécutions, sachant que ces chiffres officiels ne prennent en compte que les morts dûment répertoriés par les autorités locales du NKVD et indiqués ensuite à l'administration centrale[367]. Les « Grandes Purges » de Staline, également appelées « Grande Terreur », sont par la suite passées sous silence durant des décennies, l'opinion internationale n'ayant eu connaissance que des procès à grand spectacle[368].
Lors du troisième procès de Moscou, 21 personnalités d'envergures diverses, parmi lesquelles Boukharine, Rykov, mais également Iagoda qui dirigeait le NKVD au moment du premier procès, sont condamnées pour un ensemble de complots. Un grand nombre de dirigeants communistes étrangers présents en URSS, et de cadres du Komintern, sont arrêtés et exécutés, à l'image de Béla Kun. Les purges staliniennes déciment notamment les cadres, réfugiés sur le sol soviétique, du Parti communiste de Hongrie, du Parti communiste d'Allemagne, du Parti communiste de Finlande et du Parti communiste de Pologne[367],[369],[370],[371],[372].
Durant la même période, la République populaire mongole, État satellite de l'URSS, se livre à une émulation des politiques staliniennes : le Parti, dont Horloogiyn Choybalsan représente la ligne dure, mène durant la période 1937-1939 des purges politiques de grande ampleur - auxquelles s'ajoutent une campagne de persécutions contre le clergé bouddhiste - causant la mort d'environ 100 000 personnes sur une population de 700 000[373],[374].
L'élimination d'un trop grand nombre de cadres qualifiés finit cependant par porter préjudice au bon fonctionnement du régime. Aussi, pour éviter un chaos total, les autorités centrales de l'URSS décident-elles début 1938 de « rectifier le tir » : Staline met fin à la terreur vers la fin de l'année. Nikolaï Iejov, blâmé pour les « excès » commis durant les purges, est remplacé par Lavrenti Beria à la tête du NKVD ; il est lui-même, par la suite, arrêté, jugé et exécuté[367],[375].
L'ouverture des archives soviétiques permet par la suite aux historiens d'établir des bilans des victimes de la période stalinienne. Robert Conquest, en cumulant les victimes d'exécutions avec les personnes mortes en prison ou dans des camps, évalue le bilan humain de la période des années 1930 à environ 20 millions de morts, directement causées par la répression politique[376]. Nicolas Werth arrive quant à lui à une estimation d'environ 16 millions 800 000 victimes entre 1929 et 1953, dont 750 000 personnes exécutées sur la seule période 1937-1938[377].
De la ligne « classe contre classe » aux fronts populaires
Dans les pays occidentaux, la dimension électorale des partis communistes est très inégale au tournant de la décennie 1930. Le Parti communiste d'Allemagne, qui a recruté massivement à partir de 1923 à la faveur de la grave crise économique de la République de Weimar, bénéficie d'une audience importante et apparaît comme le plus puissant d'Europe occidentale[378]. Le Parti communiste français, bien qu'isolé politiquement et minoritaire à gauche face à la SFIO, dispose de bastions électoraux et d'une réelle implantation en milieu ouvrier grâce à son contrôle de la CGTU ; ses effectifs, ses résultats aux élections et son influence tendent néanmoins à décliner fortement au début des années 1930[379]. Le Parti communiste tchécoslovaque, bien que relégué dans l'opposition, obtient des scores électoraux satisfaisants. A contrario, le Parti communiste de Grande-Bretagne et le Parti communiste USA ont un électorat réduit et exercent surtout leur influence sur le terrain syndical[380],[381] ; le Parti communiste du Canada n'a qu'une audience très limitée dans le monde du travail[382]. Indépendamment de leur poids électoral, les partis tendent à fonctionner comme des « contre-cultures », ou le cas échéant, de « contre-sociétés », marquées par l'intensité de la dévotion militante. Bien que le communisme soit la plupart du temps associé à l'athéisme, l'engagement en son sein est fréquemment comparé, y compris dans de nombreux témoignages de communistes, à une expérience « religieuse »[383].
En juillet 1929, le 10e Plénum de l'Internationale communiste approuve la ligne stalinienne, qui reprend les idées de l'ancienne opposition en pronostiquant une vague révolutionnaire imminente. Manouïlski, Kuusinen et Molotov analysent la dégradation du capitalisme et prévoient une radicalisation des masses ouvrières. Dans cette optique, que la Grande Dépression paraît dans un premier temps confirmer mais qui méconnaît profondément les rapports de force politiques en Occident, les partis communistes sont tenus d'adopter une ligne dite « classe contre classe » et de s'opposer fermement aux partis de gauche modérés pour se distinguer d'eux : le terme de « social-fascisme » est désormais employé pour désigner les forces socialistes et social-démocrates[378],[384]. Au début des années 1930, la social-démocratie fait, dans la propagande communiste, l'objet d'une véritable haine qui conduit notamment à mettre au second plan le péril nazi[385]. Cette stratégie contribue à priver le mouvement communiste du profit qu'il aurait pu espérer retirer de la crise du système capitaliste dans l'entre-deux-guerres[386]. Les directions des partis communistes occidentaux suivent les directives du Komintern jusqu'à un aveuglement qui débouche, en Allemagne, sur un résultat catastrophique : alors qu'Adolf Hitler arrive au pouvoir en janvier 1933, l'Internationale communiste continue en février d'affirmer que la victoire des nazis est passagère et que la révolution prolétarienne triomphera bientôt. En France, le PCF continue de prendre les socialistes pour cible principale. Bientôt, le Parti communiste d'Allemagne est interdit, sa direction arrêtée ou en fuite : le parti communiste le plus puissant d'Europe occidentale est détruit en quelques semaines, sans résistance, dans le pays qui devait être le fer de lance de la révolution communiste. De nombreux communistes allemands sont déportés dans les premiers camps de concentration nazis et des milliers d'entre eux sont tués entre 1933 et 1939. Ernst Thälmann, chef du KPD, sera lui-même tué à Buchenwald en 1944[378],[387],[388],[389].
.svg.png.webp)
En 1934, Dimitrov, convaincu — notamment par son observation des réalités françaises — des avantages d'une alliance des forces antifascistes, entreprend, avec l'aide d'autres cadres du Komintern comme Togliatti, de persuader Staline d'adopter une nouvelle ligne. La nouvelle politique internationale de l'URSS, qui envisage désormais une alliance avec la France et le Royaume-Uni contre l'Allemagne nazie, influe également sur le changement de stratégie du Komintern. En 1935, la consigne de formation de « fronts populaires » contre le danger « fasciste » est officiellement adoptée par l'Internationale communiste, dont Dimitrov prend alors la tête[390]. L'année suivante, l'Allemagne nazie conclut avec l'Empire du Japon une alliance anticommuniste, le Pacte anti-Komintern — auquel adhèrent ensuite l'Italie, la Hongrie, puis en 1939 l'Espagne franquiste — donnant un aspect concret à l'opposition entre l'Internationale communiste et les puissances englobées sous le vocable de « fascisme ». L'antifascisme est à nouveau mis au premier plan du discours militant communiste et devient un puissant argument pour attirer des sympathisants. Il ne se limite cependant pas à l'union des forces « démocratiques », et continue de se situer dans la perspective d'une stratégie révolutionnaire : le « fascisme » — pris au sens large du mot — est vu comme une forme politique tardive du capitalisme, son extirpation supposant que soit mis un terme à la domination du capital. Le thème de l'union des « démocrates » contre le « fascisme » — la signification de ces termes connaissant de nombreuses nuances et variations — demeure après 1945 un élément clé de la propagande communiste et se retrouve dans le discours officiel des pays du Bloc de l'Est[391].
L'adoption de la ligne antifasciste permet aux partis communistes, désormais alliés aux sociaux-démocrates, aux libéraux et même à certains milieux religieux, de gagner de nombreux sympathisants[392]. Alors que les PC n'avaient que moyennement profité de la crise du capitalisme durant la Grande Dépression, qui coïncidait avec la période sectaire « classe contre classe », ils bénéficient au contraire pleinement des tensions internationales. Le danger nazi attire de nombreux électeurs vers les partis qui s'affichent à la pointe de l'antifascisme. Parallèlement, en l'absence de connaissance des réalités soviétiques, l'économie planifiée de l'URSS apparait à beaucoup comme une alternative séduisante aux incertitudes de l'économie de marché, dont le monde a souffert durant la première partie de la décennie à la suite du krach de 1929[393]. Le communisme, qui avait déjà exercé une séduction au lendemain de la révolution d'Octobre, attire dans les années 1930 un nombre jusque-là inégalé de sympathisants dans les milieux artistiques et intellectuels. Le français Louis Aragon, seul parmi les surréalistes français à être demeuré communiste après 1932, est l'un des rares intellectuels à être admis au sein du groupe dirigeant du PCF[394]. L'allemand Bertolt Brecht applaudit aux purges staliniennes[395]. George Bernard Shaw, membre de la Fabian Society, groupe de pensée socialiste proche du Parti travailliste, soutient le régime soviétique dont la dictature lui apparaît justifiée par la nécessité de mettre fin à l'anarchie du profit. Il contribue à convaincre Sidney et Beatrice Webb, également membres de la Fabian Society, qui effectuent en URSS un voyage soigneusement encadré par les autorités soviétiques et publient à leur retour le livre Soviet Communism: A new civilization ? (titre français : Voici l'URSS : Une Nouvelle Civilisation), dans lequel ils font l'apologie du régime stalinien. Deux ans plus tard, lors de la seconde édition anglaise de leur livre, le point d'interrogation est retiré du titre. François Furet juge que l'ouvrage des Webb, « à force de gentillesse d'âme et de crédulité, est l'un des plus extravagants jamais écrits sur le sujet, riche pourtant dans ce registre »[396],[397]. André Gide, initialement séduit par le communisme, fait partie de la minorité d'intellectuels à ne pas se laisser abuser par les autorités soviétiques lors sa visite en URSS : il exprime son désenchantement en 1936 dans son livre Retour de l'U.R.S.S.[398].

Le Parti communiste français, dirigé par Maurice Thorez, adopte la stratégie du front populaire avec détermination[399] : dès juillet 1934, le PCF et la SFIO manifestent ensemble pour la première fois depuis la scission du congrès de Tours. Un Front populaire est officiellement formé avec les anciens ennemis socialistes et radicaux. Le PCF engrange de rapides progrès électoraux et consolide de manière spectaculaire son implantation en milieu syndical quand la CGT et la CGTU se réunifient en mars 1936. Le Parti se présente en ordre de bataille aux législatives de mai 1936, remportées par le Front populaire, et par lesquelles les communistes deviennent le deuxième parti de France derrière la SFIO : de « secte stalinienne » aux dimensions nationales, le PCF devient un véritable parti de masse, consolidant son influence sur une classe ouvrière française en pleine mutation. Les adhésions syndicales se multiplient, permettant au PCF de se présenter désormais comme le « grand parti de la classe ouvrière ». Le PCF soutient le gouvernement de Léon Blum sans y participer, ce qui lui permet de s'associer aux acquis du Front populaire (accords de Matignon, congés payés) sans avoir à affronter les critiques que risquent d'entraîner des mesures moins populaires[400].
Le Parti communiste d'Espagne (PCE), dont l'influence a augmenté de manière considérable depuis ses modestes débuts, forme en janvier 1936 un Front populaire avec le Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE). Le climat politique est particulièrement tendu, la gauche espagnole étant divisée entre modérés et radicaux : alors que Manuel Azaña, parmi les socialistes, souhaite un vaste rassemblement de centre-gauche, Francisco Largo Caballero, autre dirigeant du PSOE, entretient des contacts avec l'envoyé du Komintern Jacques Duclos et se livre à des surenchères révolutionnaires qui lui valent le surnom de « Lénine espagnol », allant jusqu'à gêner la stratégie unitaire prônée par Dimitrov[401]. Le Front populaire rassemble, outre le PCE et le PSOE, divers partis de gauche comme le Parti ouvrier d'unification marxiste (POUM, parti communiste anti-stalinien) ou la Gauche républicaine : il bénéficie également du soutien des nationalistes galiciens et catalans comme de la CNT anarchiste. La coalition de la gauche espagnole remporte les élections générales de février 1936. En juillet, un soulèvement, mené par des militaires nationalistes contre le gouvernement du Front populaire, marque le début de la guerre d'Espagne[402].
Un troisième front, en-dehors de l'Europe, remporte une victoire électorale : au Chili, le Front populaire, qui réunit entre autres partis le Parti communiste du Chili, le Parti socialiste du Chili et le Parti radical, accède au pouvoir en 1938 lors de l'élection à la présidence du radical Pedro Aguirre Cerda, ce qui constitue la première participation d'un parti communiste à un gouvernement en Amérique latine[403]. L'entente entre socialistes et communistes chiliens ne résiste cependant pas au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale et à la polémique sur la politique suivie par l'URSS[404]. Toujours en Amérique latine, le parti communiste de Cuba (qui prend début 1944 le nom de Parti socialiste populaire) est allié avec Fulgencio Batista, dirigeant officieux du pays puis président de la république en titre de 1940 à 1944 : en 1942, Juan Marinello, chef du PC cubain, devient ministre sans portefeuille[405].
La stratégie des front populaires est également appliquée en Asie : c'est le cas en Chine où le PCC est poussé à s'allier à nouveau avec le Kuomintang ; mais également aux Indes où le Parti communiste d'Inde, qui avait jusqu'ici surtout milité pour une révolution de type soviétique et la conquête immédiate de l'indépendance, est repris en main par le Komintern qui lui enjoint de faire cause commune avec les nationalistes du Congrès[247].
L'opposition trotskyste

Exilé d'URSS — il est privé en 1932 de sa nationalité soviétique — établi successivement en Turquie, en France, en Norvège puis, à partir de janvier 1937, au Mexique, Léon Trotsky tente de définir une stratégie contre la politique stalinienne, dont il conteste d'ailleurs souvent moins les principes que la pratique[406]. L'ancien dirigeant bolchevik correspond avec un réseau de sympathisants, qui créent dans divers pays des organisations aux effectifs modestes : en France, où se trouve l'un des foyers les plus actifs de militants trotskystes, la Ligue communiste est animée entre autres par Pierre Naville, Pierre Frank, Raymond Molinier, Yvan Craipeau ou Alfred Rosmer[407]. Des groupes trotskystes apparaissent également très tôt en Amérique latine, le premier étant constitué au Brésil à la fin des années 1920[408]. Tout d'abord réticent à créer une nouvelle internationale rivale de l'Internationale communiste, Trotsky prend acte en 1930 de l'absence de réel sursaut anti-stalinien dans la IIIe Internationale. En 1933 sont publiés les « Onze points de l'opposition de gauche », qui comprennent la défense de l'indépendance des « partis prolétariens », la théorie de la « révolution permanente » et le caractère international de la révolution en opposition à la ligne du « socialisme dans un seul pays », le classement de l'URSS comme « État ouvrier bureaucratiquement dégénéré », la nécessité de militer dans des organisations de masse, la condamnation de la ligne « classe contre classe » et enfin le besoin de création d'une nouvelle Internationale. À partir de 1934, Trotsky estime que les forces, modestes, de l'opposition de gauche doivent prendre leur place dans le front antifasciste en entrant dans les partis sociaux-démocrates : cette nouvelle orientation pose les bases de l'« entrisme », associé depuis à la stratégie des organisations trotskystes[409].
Un réseau de groupes trotskystes, revendiquant l'héritage de la révolution bolchevik mais opposés à la politique stalinienne, s'organise à travers le monde : une première réunion destinée à préparer la création d'une Quatrième Internationale se tient en février 1934 à Bruxelles, en présence de quatorze délégués[410]. Trotsky poursuit entretemps un travail de réflexion sur l'histoire de la révolution et la nature du pouvoir en URSS : naguère partisan de la terreur rouge et de l'écrasement des partis opposés au pouvoir bolchevik[411], il estime désormais, dans son ouvrage La Révolution trahie (1936), que la démocratisation des soviets est « inconcevable sans le droit au pluripartisme »[412]. Le trotskysme se positionne dès lors comme un « autre communisme », s'opposant à la version en cours en Union soviétique tout en revendiquant l'héritage léniniste, dont il reprend la tradition des « révolutionnaires professionnels » ; la tendance trotskyste apparaît à ses partisans comme un retour aux sources de la tradition révolutionnaire, tout en ayant la capacité d'attraction des avant-gardes politiques[413].
La formation de l'internationale trotskyste, lente et laborieuse, se heurte à de nombreuses difficultés, notamment les désaccords au sein des groupes et entre ceux-ci : les membres des sections française et américaine se divisent ainsi sur la question de l'entrisme[414]. Une nouvelle conférence pour la formation de la Quatrième internationale rassemble, en juillet 1936, des délégués de neuf pays : les effectifs des groupes trotskystes sont très inégaux selon les pays (2500 aux Pays-Bas, 1000 aux États-Unis, à peine 150 membres clandestins en Allemagne)[415]. Au Brésil, les groupes trotskystes sont très actifs et parviennent, notamment après la révolution de 1930, à exercer une influence non négligeable sur le mouvement ouvrier brésilien. Après le soulèvement de 1935, cependant, le gouvernement brésilien réprime l'ensemble des groupes communistes : les trotskystes, comme les autres, sont alors réduits à la clandestinité[416]. Le groupe trotskyste le plus important demeure la section française, qui souffre cependant de divisions incessantes. Le parti trotskyste français « officiel » est alors le Parti ouvrier internationaliste, fondé après l'exclusion des trotskystes de la SFIO : face à lui existe un mouvement rival qui porte le même nom, animé par Raymond Molinier. Certains trotskystes chassés de la SFIO participent au Parti socialiste ouvrier et paysan dirigé par Marceau Pivert. Staline, pour sa part, surestime - ou affecte de surestimer - la puissance des organisations trotskystes, et dénonce Trotsky comme le maître d'un complot occulte ourdi contre l'URSS[415].
Au cours des années 1930, le parcours politique de Trotsky s'accompagne de tragédies personnelles : les membres de sa famille demeurés en URSS sont décimés ; son fils et principal collaborateur Lev Sedov, qui contribue à coordonner les groupes trotskystes à travers le monde, meurt à Paris en février 1938 dans des circonstances obscures, à la suite d'une opération[417]. Trotsky est persuadé que son fils a été en réalité assassiné par les services secrets staliniens[418]. La Quatrième Internationale est finalement fondée en septembre 1938 lors d'une conférence à Périgny, en région parisienne : 21 délégués, venus de 11 pays, adoptent comme document fondateur le « Programme de transition » rédigé par Trotsky. Un agent infiltré du NKVD, Mark Zborowski alias « Étienne », est élu au secrétariat international de l'organisation[415]. L'Internationale trotskyste demeure parcourue d'intrigues et de divisions, ce qui provoque le départ rapide de certains militants comme Victor Serge[419] ; elle est en outre confrontée, à l'approche du second conflit mondial, à la question de savoir s'il convient de prendre ou non la défense de l'URSS[420]. Le , Léon Trotsky est assassiné à son domicile mexicain par un agent du NKVD, Ramón Mercader[421].
La guerre d'Espagne


La guerre civile espagnole, précédant la Seconde Guerre mondiale, voit l'alliance antifasciste préconisée par l'Internationale communiste affronter de manière directe les « fascistes » et assimilés. Les premiers mois du conflit voient plusieurs régions espagnoles connaitre de véritables bouleversement sociaux : alors que le soulèvement de juillet semble initialement avoir échoué, l'enthousiasme révolutionnaire amène les milices « prolétariennes », anarchistes, socialistes, communistes ou plus rarement « poumistes », à prendre le contrôle de nombreuses localités, notamment en Catalogne et en Aragon. Dans un climat de « révolution sociale », les exploitations agricoles sont expropriées et l'économie « socialisée » de manière spontanée, plus ou moins contre le gré des directions des organisations ouvrières. La collectivisation des terres confisquées est décrétée par le gouvernement en octobre 1936 : en Catalogne, elle se fait dans la pratique sous l'égide des libertaires ou des militants du POUM. En Aragon, les anarcho-syndicalistes instaurent un régime de « communisme libertaire » dans la plupart des villages. Cette période d'« utopie au pouvoir » s'accompagne de nombreux cas de désordres et d'abus, voire de tyrannies exercées par les milices sur les populations locales[422].
Parallèlement à cette période d'euphorie révolutionnaire se déroule, dans les zones républicaines, une campagne de « terreur rouge », commise à la fois par les communistes et les anarchistes contre toutes les catégories sociales suspectées de « fascisme », ce qui inclut les ennemis politiques réels ou supposés du Front populaire, ainsi que le clergé espagnol, les monarchistes, et plus largement les personnalités « de droite ». Dans certaines villes dominées par les forces de gauche, des « commissions d'enquêtes », généralement connues sous le nom de checas (en référence à la Tchéka), animent des « tribunaux révolutionnaires » qui prononcent les condamnations à mort des partisans de l'insurrection nationaliste. Le gouvernement républicain apparaît initialement dépassé face aux abus de toutes sortes et ce n'est que progressivement que Francisco Largo Caballero, arrivé au pouvoir en , parvient à rétablir un ordre relatif. La terreur rouge espagnole - qui se déroule par ailleurs en parallèle à la terreur nationaliste exercée dans les zones tenues par les troupes de Franco - choque l'opinion publique internationale et contribue à amener les gouvernements français et britannique à choisir la non-intervention. Après la fin 1936, les violences en zone républicaine tendent à diminuer et s'apparentent davantage à une répression politique de type stalinien, exercée par les communistes, non seulement contre des hommes de droite, mais aussi contre les factions minoritaires de l'extrême-gauche espagnole[423],[424] ; le bilan de la terreur rouge se monte à plusieurs dizaines de milliers de victimes, bien qu'aucun consensus n'existe quant aux chiffres exacts[425],[426].
Staline, pour sa part, souhaite s'en tenir à une non-intervention officielle tout en contribuant à empêcher la victoire du camp « fasciste » en Espagne, les nationalistes étant de leur côté soutenus par Hitler et Mussolini : l'URSS envoie en renfort du camp républicain des pilotes de guerre - présentés non comme des troupes officielles mais comme des « volontaires » - de l'armement ainsi que des agents du NKVD et du GRU. Maurice Thorez obtient de son côté l'aval du Komintern pour lancer la formation de groupes de volontaires, qui deviennent les Brigades internationales. Celles-ci attirent des communistes de nombreux pays, mais également des sympathisants non-communistes de la République espagnole. Le principal centre de recrutement des Brigades se trouve à Paris, où les volontaires sont encadrés pour l'essentiel par des dirigeants des PC français et italien, dont André Marty (membre du comité exécutif du Komintern) Luigi Longo et Giuseppe Di Vittorio. Le yougoslave Josip Broz, agent du Komintern connu sous le surnom de Tito, s'occupe surtout, pour sa part, des volontaires originaires des Balkans[427],[428].
Les Brigades internationales, si elles s'hispanisent au cours du conflit, fonctionnent dans les premiers temps de la guerre comme une force armée semi-autonome dépendant en grande partie du Komintern. Juan Negrín, qui succède à Largo Caballero en mai 1937, poursuit le rétablissement de l'ordre sur le plan intérieur et adopte une politique moins marquée à gauche, revenant notamment sur le décret de collectivisation des terres confisquées. Les communistes soutiennent ce retour à l'ordre qui leur paraît indispensable pour assurer la victoire du camp républicain et en profitent pour régler leurs comptes avec leurs adversaires d'extrême-gauche : les unités sous commandement communiste participent au démantèlement des fermes collectives et à la mise au pas des anarchistes et du POUM. Le conflit espagnol est ainsi marqué par une « guerre civile dans la guerre civile », interne au camp républicain. Les communistes réalisent des purges sanglantes contre les anarchistes et le POUM, notamment en Catalogne où de véritables batailles rangées ont lieu en avril-mai 1937 : anarchistes et poumistes sont défaits et le chef du POUM, Andreu Nin, est emprisonné avant d'être tué par une équipe de membres des Brigades internationales, dirigée par un agent soviétique. La Guerre d'Espagne s'achève en 1939 par la victoire des nationalistes et la mise en place du régime franquiste. Les communistes espagnols entament une longue période de clandestinité ou d'exil[429],[428],[430]. Les autres PC occidentaux retirent cependant une certaine aura morale de l'imaginaire héroïque de la guerre d'Espagne et de l'aventure des Brigades internationales[431].
La Longue marche


En Chine, où se déroule depuis 1927 une guerre civile entre communistes et nationalistes, le Parti communiste chinois dispose d'un ensemble de bases territoriales, dénommées « soviets », dont la plus importante se trouve dans le Jiangxi. Des purges et des campagnes de terreur contre les paysans rétifs à la politique communiste sont exercées dans les zones tenues par le PCC, plusieurs années avant la grande terreur stalinienne en URSS : environ 186 000 personnes auraient été tuées hors combats dans le Jiangxi, entre 1927 et 1931[432]. Le , le Parti communiste chinois proclame l'union des territoires discontinus qui se trouvent sous son contrôle, au sein de la République soviétique chinoise dont la présidence est confiée à Mao Zedong. Ce dernier développe à l'époque sa notion de « guerre populaire » via la mobilisation et la militarisation du peuple ; la base du Jiangxi est conçue comme la matrice d'un futur État communiste chinois. Dès 1930, Tchang Kaï-chek lance des campagnes d'extermination contre les « bandits communistes » et tente, d'abord sans succès jusqu'en 1933, d'anéantir leurs bases[433].
Le Komintern, considérant Mao comme trop indépendant, entreprend de le marginaliser au profit du groupe dit des « 28 bolcheviks », des militants communistes chinois formés à l'université Sun Yat-sen de Moscou[434]. Mais la donne est bouleversée quand les troupes de Tchang Kaï-chek parviennent à détruire le Soviet du Jiangxi : Mao Zedong, l'Armée rouge chinoise et plusieurs dizaines de milliers de communistes chinois, doivent entamer en octobre 1934 la Longue Marche. Ce périple les mène un an plus tard dans la base du Shaanxi, où Mao établit son nouveau quartier général à Yan'an. Sur 80 000 communistes chinois ayant pris part à la Longue Marche, 8 000 seulement arrivent à destination. Si son contrôle sur le Parti communiste chinois n'est pas encore total, Mao resserre le noyau dirigeant autour de lui, au détriment des cadres soutenus par l'URSS. Il retire un grand prestige personnel de l'épisode de la Longue Marche, qui est utilisé par la suite pour bâtir un mythe politique autour de sa personne, et du communisme chinois en général[435],[436].
Guerre contre le Japon et ascension de Mao

Parallèlement, l'Empire du Japon poursuit ses visées expansionnistes en Chine, envahit la Mandchourie en 1931 et déclenche un conflit à Shanghai en 1932. Tchang Kaï-chek privilégiant la lutte contre les communistes à celle contre les Japonais, l'un de ses généraux, Zhang Xueliang, le prend en otage pour l'obliger à négocier avec les communistes et former avec ceux-ci une alliance contre le Japon. Malgré les réticences de Mao, et sur l'insistance du Komintern qui applique également en Asie sa stratégie des fronts populaires, l'accord de Xi'an aboutit à la formation d'un deuxième front uni entre le Kuomintang et le Parti communiste chinois[437].
Bénéficiant de cette trêve avec les nationalistes, Mao en profite pour développer à Yan'an sa version personnelle du marxisme, dont il a eu le temps, en 1936, d'achever de lire les ouvrages classiques. Il entreprend de concevoir une forme « sinisée » de la pensée marxiste, dont il mêle les concepts à des notions issues de la philosophie chinoise et à des idées tactiques adaptées aux réalités locales. Mao bâtit progressivement sa propre doctrine, connue en Occident sous le nom de maoïsme et en Chine sous le nom de « pensée Mao Zedong ». Sur la base des réalités chinoises, il détermine le rôle essentiel du monde rural et du sentiment nationaliste dans la révolution chinoise ; il énonce également le concept de « Nouvelle démocratie », doctrine prônant un front uni qui engloberait tous les Chinois qui se rallieraient à la cause du PCC, ce qui permet de justifier sur le plan théorique l'alliance avec le Kuomintang, mais induit également l'idée que le PCC pourra ensuite gouverner seul sans le KMT[438]. Mao applique dans les territoires tenus par le PCC une politique officiellement fondée sur des principes égalitaires. Sur le plan de l'organisation du Parti, il entreprend de lutter contre le « subjectivisme », le « sectarisme » et le « formalisme de parti », soit l'excès de dogmatisme coupé des réalités et les factions nuisant à l'unité du mouvement[439]. Pour la conquête du pouvoir, Mao vise la mobilisation permanente de la population et à l'emploi des tactiques de guérilla ; son contrôle de la paysannerie de la Chine du Nord lui fournit dans la pratique un atout essentiel[440],[438].
En 1937, l'Empire du Japon passe à la guerre ouverte contre la République de Chine, déclenchant la seconde guerre sino-japonaise. Les troupes communistes, dirigées notamment par Peng Dehuai et Zhu De, participent aux combats contre les Japonais aux côtés des nationalistes, mais ces derniers supportent l'essentiel de l'effort de guerre, tandis que les communistes se livrent surtout à des actions de guérilla et ne perdent pas de vue la consolidation de leurs propres forces, afin de pouvoir vaincre plus tard leurs alliés du moment[441]. La participation à la guerre contre les Japonais permet aux communistes chinois de mobiliser les masses populaires dans les campagnes et d'affermir leur pouvoir, non dans les villes mais dans les villages, où vit la majorité de la population chinoise[442]. En 1937, l'Internationale communiste envoie à Yan'an Wang Ming, protégé de Dimitrov et chef de file des communistes chinois formés à Moscou. Mao laisse dans les premiers temps une prééminence de façade à Wang Ming, qui tente de renforcer la politique de front uni avec les nationalistes. Il impose cependant très vite son autorité aux dépens de Wang Ming, en gagnant à sa cause Kang Sheng, chef de la police politique, et Liu Shaoqi, chef du bureau de la Chine du Nord qui couvre les principales bases communistes. Dès 1938, Staline reconnaît Mao comme principal interlocuteur parmi les communistes chinois. En 1942, Mao et Liu Shaoqi éliminent la plupart de leurs adversaires au sein du Parti communiste chinois en lançant une « campagne de rectification ». L'année suivante, Mao est élu au poste de Président du PCC, créé pour l'occasion. En avril-, le septième congrès du PCC exalte la « pensée Mao Zedong » et affirme la primauté absolue de son auteur[443],[444].
Le communisme dans la Seconde Guerre mondiale
1939–1941 : pacte avec l'Allemagne nazie

Alors que Hitler concrétise ses projets expansionnistes en Europe, Allemands, Français et Britanniques perçoivent que l'URSS, en pleine période de purges, n'a pas la possibilité de jouer immédiatement un rôle décisif dans les relations internationales. Les Soviétiques, de leur côté, perdent leurs dernières illusions sur la politique de sécurité collective à la suite des accords de Munich. Préoccupée par la signature du Pacte anti-Komintern entre l'Allemagne, l'Italie et le Japon, l'URSS cherche à éviter d'être prise en tenaille et multiplie les ouvertures envers l'Allemagne tout en poursuivant des négociations avec les démocraties occidentales. En 1938 et 1939, l'Armée impériale japonaise réalise des incursions via le Mandchoukouo sur les territoires de l'URSS et de la Mongolie : elle affronte l'Armée rouge dans de violents combats, la bataille du lac Khassan de juillet à , puis la bataille de Khalkhin Gol à partir de . Si les incidents frontaliers tournent à l'avantage des Soviétiques et débouchent sur une trêve avec le Japon le , ils achèvent de convaincre le gouvernement de l'URSS de la nécessité d'éviter l'encerclement du pays. Les perspectives d'une alliance avec le Royaume-Uni et la France s'étant éloignées, Staline prend la décision, en consultation avec Molotov et sans prévenir le Commissariat aux affaires étrangères, de conclure un traité de non-agression avec l'Allemagne nazie. Le , le pacte est signé avec le ministre des affaires étrangères allemand Joachim von Ribbentrop et rendu public le lendemain, créant la stupeur dans le monde entier. Une clause secrète du traité délimite les zones d'influence allemandes et soviétiques en Europe de l'Est et prévoit notamment un partage de la Pologne, à qui l'URSS souhaite reprendre les portions d'anciens territoires ukrainiens et biélorusses[445]. Durant la période 1939–1941, l'URSS et le Reich multiplient les échanges commerciaux et les gestes d'amitié[446]. Plusieurs centaines de communistes allemands réfugiés en URSS sont livrés aux nazis[447],[392].
Staline transmet à Dimitrov des instructions destinées aux partis de l'Internationale communiste, leur intimant l'ordre de dénoncer un conflit en Europe de l'Ouest comme une guerre « impérialiste » et de refuser de prendre parti. Le pacte germano-soviétique provoque une onde de choc au sein du mouvement communiste mondial, qui suivait jusque-là scrupuleusement les consignes anti-hitlériennes du Komintern. Les directions de certains partis, comme le Parti communiste de Grande-Bretagne, connaissent une période de tourmente interne ; d'autres, comme celle du Parti communiste français, font le choix de l'obéissance. La soumission des dirigeants communistes français aux ordres de l'URSS n'empêche pas une grande partie des élus et militants du PCF de quitter le Parti ; la CGT décrète l'exclusion de tous ses militants qui ne désavoueraient pas le pacte germano-soviétique. Le 26 septembre, le gouvernement d'Édouard Daladier dissout le PCF et toutes les organisations liées au Komintern sur le sol français[448],[449]. L'année suivante, en août 1940, le gouvernement suisse interdit aussi bien le Parti communiste suisse que le Mouvement national suisse (parti pro-nazi), afin de préserver sa neutralité[450].
Le 1er septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne, déclenchant la Seconde Guerre mondiale. Le 17, face à l'effondrement de la résistance polonaise, l'Armée rouge passe à son tour à l'attaque et envahit l'Est de la Pologne. Plus de 30000 prisonniers Polonais, en majorité des officiers, fonctionnaires et policiers, sont exécutés au printemps 1940, dans divers sites en Pologne ou en URSS, conformément à une directive secrète de Beria approuvée par Staline. Le massacre de Katyń, au cours duquel périssent plus de 20 000 officiers de l'armée polonaise, restera par la suite emblématique de cette vague d'assassinats[451],[452].
En application du protocole secret, l'URSS impose, peu après l'invasion de la Pologne, des « traités d'assistance mutuelle » à l'Estonie, la Lituanie et la Lettonie. La Finlande repousse par contre les exigences territoriales soviétiques : le 29 novembre, au prétexte d'un incident de frontière, l'URSS dénonce son pacte de non-agression avec la Finlande et déclenche les hostilités. Un « gouvernement populaire de la République démocratique finlandaise », dirigé par Otto Kuusinen et quelques communistes finlandais exilés depuis longtemps en URSS, est proclamé à Terijoki, sur les territoires pris par les Soviétiques : il entreprend de lever une « armée populaire », dont les effectifs n'excèdent cependant pas les 10000 hommes. L'URSS est exclue de la SDN. La « Guerre d'Hiver » contre la Finlande s'avère cependant très coûteuse en hommes pour l'Armée rouge : les troupes finlandaises, pourtant très inférieures en nombre, résistent bien mieux que prévu. La paix est conclue en mars 1940 par le traité de Moscou : la Finlande cède à l'URSS la région de Vyborg et l'essentiel de la Carélie, tout en évitant l'invasion totale. Bien que victorieux pour l'Union soviétique, le conflit a révélé l'état d'impréparation de l'Armée rouge. Les territoires conquis par l'URSS sont incorporés à la République socialiste soviétique carélo-finnoise. À l'été 1940, l'URSS envahit l'Estonie, la Lituanie et la Lettonie, accusées d'avoir violé les pactes d'assistances mutuelles : des « gouvernements populaires » sont imposés dans les trois pays baltes, qui sont ensuite incorporés dès le mois d'août à l'Union soviétique[451],[453],[454].
Attaque allemande et guerre totale en URSS

Dès l'été 1940, les relations germano-soviétiques connaissent une première dégradation, alors que l'URSS observe avec inquiétude les victoires militaires allemandes sur le front de l'Ouest. L'URSS joue l'apaisement en proposant en vain d'adhérer au pacte tripartite. En avril 1941, les Soviétiques remportent un important succès diplomatique en signant avec le Japon un pacte de neutralité, destiné à prémunir l'URSS d'une attaque sur le flanc asiatique. Alors que Hitler étudie depuis un plan d'invasion de l'URSS, Staline choisit de continuer de traiter l'Allemagne nazie en puissance amie. Si le dirigeant soviétique croit la guerre avec l'Allemagne inévitable à terme, il tente d'éviter un conflit le plus longtemps possible et se méprend totalement sur la volonté d'Hitler d'attaquer dès 1941 ; dès lors, il ignore les messages qui le préviennent de l'imminence d'une offensive allemande et refuse que ses généraux préparent un plan de défense du pays. Le , les autorités soviétiques sont prises de court par l'invasion du territoire soviétique[455],[456],[457].
L'Armée rouge, mal préparée et dont la hiérarchie a été décimée par les purges staliniennes, subit durant les premiers mois du conflit des pertes effroyables. Les Soviétiques sont forcés d'abandonner des pans entiers de leur territoire devant l'attaque allemande ; dans les régions concernées, le NKVD massacre avant l'évacuation des dizaines de milliers de prisonniers politiques. Cependant, malgré ses succès militaires initiaux, Hitler a mal calculé en misant sur l'isolement de l'URSS. En effet, le jour même de l'invasion allemande, Winston Churchill annonce que le Royaume-Uni soutiendra l'État soviétique dans son combat contre l'Allemagne et ses alliés de l'Axe (outre l'Allemagne, l'URSS est attaquée par l'Italie, la Hongrie, la Roumanie, la Slovaquie, la Croatie, mais aussi la Finlande qui mène une « guerre de continuation » pour récupérer les territoires perdus en 1940). Une alliance soviéto-britannique est signée dès l'été. Les États-Unis soutiennent quant à eux l'URSS dans le cadre du programme Lend-Lease. La résistance soviétique parvient à ralentir l'avance allemande ; dès le mois d'août, Staline décrète que toute personne se rendant à l'ennemi sera punie de mort. Dans les territoires de l'URSS envahies lors de l'attaque allemande, les occupants sont tout d'abord accueillis de manière relativement favorable en Ukraine ou en Biélorussie, voire parfois comme des libérateurs dans les pays baltes. Hitler, qui considère les Slaves comme des « sous-hommes », n'envisage cependant que le « colonialisme intégral » pour les territoires soviétiques : les méthodes d'occupation particulièrement barbares des troupes nazies retournent bientôt les populations contre les Allemands. Dès 1942, les envahisseurs ont perdu tout crédit auprès des citoyens soviétiques. Menée de manière impitoyable par des généraux efficaces mais très dispendieux en vies humaines comme Gueorgui Joukov, l'Armée rouge paie un très lourd tribut au conflit. Les pertes militaires de l'URSS se chiffrent à environ neuf millions. Entre quinze et dix-huit millions de civils soviétiques meurent durant la guerre[458],[452].
Face à la menace, Staline fait appel à une propagande non plus uniquement communiste, mais au contraire d'essence très largement patriotique. Dans son premier discours radiodiffusé durant la guerre, le , il s'adresse à la nation en appelant les citoyens soviétiques non plus uniquement « camarades », mais également « citoyens » et « frères et sœurs ». Les valeurs russes, nationales et patriotiques, déjà remises à l'honneur dans la seconde moitié des années 1930, sont pleinement utilisées dans le discours officiel, qui appelle la nation à une « Grande Guerre patriotique » contre l'envahisseur. Le pouvoir s'emploie à susciter un consensus social en relâchant certains contrôles politiques et se rapprochant de l'église orthodoxe, faisant également des gestes envers les musulmans. Dans les kolkhozes, les paysans bénéficient de plus de liberté pour monnayer leur production personnelle. Dans l'armée, le corps des commissaires politiques est supprimé. Parallèlement au développement d'une idéologie de plus en plus centrée sur le patriotisme et le nationalisme, le pouvoir suprême est de plus en plus personnalisé en URSS, Staline cumulant la direction du Parti, celle du gouvernement et celle des forces armées. À la suite des victoires militaires et du fait de l'aura croissante qu'il acquiert à l'échelle internationale, Staline parvient, malgré sa responsabilité dans les désastres initiaux, à susciter une véritable foi populaire autour de sa personne. Cependant, en dépit de ses appels à l'unité nationale, il continue durant la guerre de persécuter des pans entiers de la population soviétique, cette fois en faisant massivement déporter des nationalités vues comme potentiellement déloyales en temps de guerre (Allemands de la Volga, Tchétchènes, Ingouches, Tatars de Crimée...)[459],[452].
L'URSS contribue plus que tout autre pays allié à la défaite allemande en Europe. La bataille de Stalingrad et celle de Koursk marquent des tournants sur le front de l'Est[452]. Staline et l'URSS sont fêtés par la propagande alliée : la révélation par les Allemands du charnier de Katyń vient cependant, en avril 1943, perturber les relations entre Soviétiques et Britanniques, en même temps qu'elle provoque la rupture des relations entre l'URSS et le gouvernement polonais en exil. L'URSS nie farouchement sa responsabilité dans le massacre, qu'elle attribue aux Allemands ; les services secrets britanniques, au courant de la vérité, s'abstiennent quant à eux de la révéler, afin de ménager les Soviétiques. La rupture avec le gouvernement polonais de Londres facilite en outre la tâche à Staline pour préparer une reprise en main de la Pologne : il concentre son aide sur les communistes polonais, qui forment l'embryon de ce qui sera le pouvoir d'après-guerre. Un corps d'armée polonais loyal aux communistes est formé, tandis que davantage de maquisards soviétiques sont infiltrés en Pologne occupée[452],[460].
Pour améliorer l'image de l'URSS à l'étranger, Staline entreprend de la dissocier de l'idée de révolution mondiale. Cela lui permet non seulement de rassurer Américains et Britanniques, mais également de rendre les partis communistes plus attractifs en faisant disparaître leur lien de subordination évident avec Moscou : en mai 1943, Staline informe Dimitrov de son intention de dissoudre l'Internationale communiste. Ce dernier réunit rapidement le bureau exécutif du Komintern, qui convient que l'organisation a « achevé sa mission » et procède à sa dissolution. Dans les faits, les fonctions du Komintern sont transférées au Département international du Comité central du Parti communiste, département dont Dimitrov prend la tête[461]. Lors de la conférence de Téhéran qui le met, en octobre 1943, en présence de Churchill et Roosevelt, Staline obtient satisfaction sur plusieurs points, notamment sur le déplacement des frontières de la Pologne vers l'Ouest et sur l'annexion des pays baltes[462].
Le poids décisif de l'URSS, « patrie du socialisme », dans le conflit mondial, ainsi que la part prise par les communistes aux mouvements de résistance nationaux, entraînent dans l'opinion occidentale une vague de sympathie sans précédent pour le régime soviétique, et redonnent vigueur aux partis communistes dans le monde entier. Les PC se conforment aux instructions de l'URSS, qui leur demande de soutenir les efforts de guerre de leurs pays respectifs. Des partis comme le Parti communiste britannique et le Parti communiste américain, dont l'image avait souffert du pacte germano-soviétique, reviennent sur le devant de la scène. Le Parti communiste du Canada avait ainsi été interdit au début du conflit, et une partie de ses dirigeants arrêtée ; en 1943, à nouveau autorisé, il obtient un élu au parlement fédéral. En Amérique latine, le nombre de militants communistes passe d'environ 100 000 en 1939 à environ 500 000 en 1947[463],[464]. Aux Indes, le Parti communiste d'Inde soutient l'effort de guerre des Britanniques et, dans le même temps, profite de sa stratégie d'« entrisme » au sein du Congrès pour prendre le contrôle du All-India Trade Union Congress, le syndicat lié à ce parti[247].
L'URSS victorieuse
En 1944, les Soviétiques, ayant désormais repris l'avantage sur le plan militaire, mettent fin au siège de Leningrad ; à l'été, ils lancent une grande offensive vers l'Ouest. L'Armée rouge franchit la frontière finlandaise, libère l'Ukraine et atteint la Pologne. Les communistes polonais réfugiés en URSS au début de la guerre, et renvoyés dans leur pays pour mener la résistance anti-allemande forment, à Lublin, un Comité polonais de libération nationale (dit « Comité de Lublin »). Le Comité, officiellement une alliance « antifasciste », est largement contrôlé par les communistes du Parti ouvrier polonais — parti créé en Pologne occupée pour remplacer le Parti communiste de Pologne anéanti par les purges staliniennes[465]. Lors du soulèvement de Varsovie mené pour l'essentiel par la résistance polonaise non communiste, l'Armée rouge, qui approche de la capitale polonaise, arrête son avance. les troupes soviétiques demeurent ensuite l'arme au pied et s'abstiennent d'apporter une aide substantielle aux insurgés polonais, laissant l'Armia Krajowa, favorable au gouvernement polonais de Londres, se faire écraser par les Allemands[466],[465]. Par la suite, les troupes soviétiques multiplient les arrestations parmi les résistants non communistes. Les cadres communistes polonais, bien que sans réelle implantation populaire, bénéficient du fait d'avoir été les premiers sur place à la suite de l'Armée rouge, et se réservent la direction de la police et de l'armée dans le gouvernement provisoire. C'est un communiste, Władysław Gomułka, qui prend en charge l'administration des territoires polonais ex-allemands, d'où la population allemande doit être expulsée[467].
En août, l'Armée rouge envahit la Roumanie, puis le mois suivant la Bulgarie et la Hongrie, autres pays alliés de l'Allemagne. Le Front patriotique prend le pouvoir en Bulgarie et Kimon Georgiev, chef du Zveno allié aux communistes, devient premier ministre ; en Roumanie, le gouvernement provisoire formé après la chute d'Ion Antonescu est remanié, accueillant un ministre communiste ; dans la Hongrie ravagée par les combats, le gouvernement favorable aux Soviétiques formé en à Debrecen n'a de réelle autorité sur le pays qu'à partir de février 1945[465],[468]. Un traité de paix est conclu avec la Finlande, entérinant les conquêtes territoriales soviétiques : l'URSS ne tente cependant pas d'envahir la Finlande, ni par la suite d'y imposer un régime communiste, à la fois pour complaire aux États-Unis, garantir de bonnes relations avec les pays scandinaves voisins, mais sans doute également du fait du mauvais souvenir laissé par le conflit de 1940, qui aurait par conséquent poussé Staline à éviter une nouvelle guerre avec les Finlandais[469],[470],[471]. Les pays baltes sont reconquis par l'Armée rouge : Lituanie, Estonie et Lettonie redeviennent des républiques soviétiques[472].
En octobre 1944 et alors qu'une grande partie de l'Europe orientale est déjà tombée sous influence soviétique, Churchill propose à Staline lors de la conférence Tolstoï un plan chiffré de partage des zones d'influence en Europe de l'Est : la Roumanie serait à 90 % sous influence soviétique et 10 % sous influence britannique, la Grèce à 90 % sous influence britannique, la Bulgarie à 75 % réservée aux Soviétiques, la Hongrie et la Yougoslavie (la question du régime de ce dernier pays demeurant en suspens) étant partagées à 50 / 50 %[465],[473]. Du 4 au se tient la conférence de Yalta qui règle plusieurs points fondamentaux à l'avantage des Soviétiques, dont le tracé des frontières polonaises, la reconnaissance du Comité de Lublin comme gouvernement légitime de la Pologne et l'occupation militaire de l'Allemagne. En échange d'une déclaration de guerre de l'URSS contre l'Empire du Japon, l'État soviétique obtient notamment de pouvoir annexer la moitié sud de Sakhaline et les îles Kouriles. En avril et mai, les Soviétiques entrent dans Berlin, puis dans Prague. L'Est de l'Allemagne et une grande partie de l'Europe orientale sont occupés par l'Armée rouge[474].
Après la fin de la guerre en Europe, l'URSS s'engage à nouveau, lors de la conférence de Potsdam, à déclarer la guerre au Japon : le , entre les deux bombardements atomiques américains sur le Japon, l'Armée rouge envahit la Mandchourie, les îles Kouriles, la Mongolie-Intérieure, Sakhaline et la Corée, accélérant la reddition japonaise et la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les Soviétiques pillent les infrastructures de l'ex-Mandchoukouo, au grand dam des communistes chinois. Ces derniers gagnent cependant de précieuses bases d'opération dans le Nord-est de la Mandchourie et s'emparent des armes des Japonais grâce à la bienveillance des Soviétiques. Pour faire obstacle au Parti communiste chinois, Tchang Kaï-chek demande aux Soviétiques de rester plus longtemps sur place, ce qui lui permet de se réimplanter dans le Sud de la Mandchourie[475],[476]. Le Nord de la Corée est occupé par les Soviétiques, tandis que les Américains occupent le Sud[477].
En Europe
Dans les différents pays européens occupés par l'Allemagne et ses alliés, les communistes locaux prennent une part active à la résistance[478] : durant la seconde moitié de 1941, alors que les relations germano-soviétiques se tendent, le Komintern appelle à la création d'alliances politiques regroupant tous les « patriotes » de bonne volonté, dans un objectif de libération nationale. En Europe occupée, des « fronts nationaux » se forment dans la clandestinité, sous le patronage des communistes locaux. À partir de l'invasion de l'URSS en juin 1941, les communistes entrent pleinement dans la résistance et y prennent dans certains pays une part prépondérante : la libération du pays occupé est présentée comme liée au sort de l'URSS, qui fait elle-même figure de « glorieuse avant-garde » dans la lutte contre le fascisme. Dans l'ensemble des pays occupés par l'Allemagne, les communistes sont à partir de 1941 une cible privilégiée de la répression et de la déportation mise en œuvre par les autorités nazies[479]. A contrario, les militants communistes bénéficient, dans le cadre de leurs activités de résistance, de leur culture de « révolutionnaires professionnels » et de leur expérience de la clandestinité[480].
France

En France, plusieurs cadres du PCF (dont la direction a été dispersée par l'invasion allemande — Thorez et Marty, notamment, se trouvent à Moscou) parmi lesquels Jacques Duclos et Maurice Tréand, tentent durant les premières semaines de l'occupation d'obtenir une légalisation du parti et de faire reparaître légalement l'Humanité, avant que l'Internationale communiste n'y coupe court. La direction clandestine du PCF entreprend ensuite de reconstituer ses réseaux, sans se livrer à des actes de résistance, renvoyant au contraire dos à dos les partisans de la reprise du conflit, que ce soit pour ou contre l'Allemagne. En avril 1941, le Komintern envoie au PCF une directive demandant la création d'un « Front national large de lutte pour l'indépendance », dans le cadre d'une « lutte pour la libération nationale ». En mai, le PCF crée le Front national dans le cadre de la nouvelle orientation « patriotique ». Des grèves sont organisées par les communistes dans le bassin minier du Nord de la France. Après l'invasion de l'URSS en juin, le PCF s'engage dans des actions violentes de résistance, menées tout d'abord par l'Organisation spéciale (OS), constituée par des militants aguerris, dont des anciens de la Guerre d'Espagne ; en avril 1942, l'OS est remplacée par les Francs-Tireurs et Partisans (FTP). En 1942, les mesures des Allemands et l'amplification de la politique collaborationniste de Vichy provoquent un afflux de volontaires dans les rangs des FTP. Les résistants communistes français sortent ensuite de leur isolement et se rapprochent des autres éléments de la résistance intérieure française comme de la France libre : à la mi-1943, le Front national participe au Conseil national de la Résistance (CNR). L'organisation clandestine du PCF, dirigée par Auguste Lecœur, gagne en puissance jusqu'à prendre largement le contrôle du CNR puis du commandement national des Forces françaises de l'intérieur — le communiste Henri Rol-Tanguy, notamment, dirige les FFI en région parisienne — tout en conservant les FTP en tant que force autonome. Lors de la libération de la France, le pays ne connaît cependant aucune vacance du pouvoir, ce qui permet au GPRF de s'installer aux commandes[481].
Grèce
Dans les Balkans occupés, la résistance prend également l'aspect d'une guerre civile entre les factions communistes et non communistes[478]. Le Parti communiste de Grèce, clandestin sous le régime du 4-Août de Metaxás, forme un Front de libération nationale (EAM) qui parvient en deux ans à devenir un véritable mouvement de masse, attirant de nombreux sympathisants non communistes : l'Armée populaire de libération nationale grecque (ELAS), dirigée par Áris Velouchiótis, forme la branche armée de l'EAM qui mène la guérilla contre les occupants allemands, italiens et bulgares tout en entrant également en conflit avec les organisations de résistance non communistes comme l'EDES. L'EAM-ELAS domine très largement les autres mouvements de la résistance grecque : à la fin du conflit mondial, elle étend son influence sur une grande partie du territoire grec[482].
En octobre 1944, les Allemands se retirent de Grèce tandis que les Britanniques, qui souhaitent prévenir une prise de contrôle par les communistes, débarquent en ramenant le premier ministre du gouvernement en exil Geórgios Papandréou. La situation est extrêmement tendue, alors que le pays est en pleine incertitude sur son avenir politique et que les communistes semblent en position de force. En décembre, les ministres de l'EAM démissionnent du gouvernement d'union nationale de Papandréou, puis des affrontements éclatent entre l'ELAS et l'armée britannique ; il s'agit du seul cas où les troupes alliées ont dû combattre la résistance locale durant la Seconde Guerre mondiale. Le comportement des soldats de l'ELAS, notamment les assassinats d'otages « bourgeois », contribuent à détruire une large part du prestige acquis durant la guerre par les communistes grecs. En janvier 1945, après plusieurs semaines de combats, l'ELAS dépose les armes et est dissoute ; l'influence de l'EAM sort très affaiblie des événements de décembre. Au sortir de la guerre, alors que les Grecs doivent encore décider du maintien ou non de la monarchie et de l'éventuel retour de Georges II, la situation demeure explosive[482].
Yougoslavie
.svg.png.webp)
Dans la Yougoslavie occupée et démembrée par les forces de l'Axe, Tito, secrétaire général du Parti communiste de Yougoslavie clandestin, constitue des forces de résistance connus bientôt sous le nom de Partisans et entame le combat contre les occupants, dans l'espoir d'une arrivée prochaine de l'Armée rouge[483]. Les communistes yougoslaves se trouvent bientôt en conflit avec les Tchetniks, résistants nationalistes serbes commandés par Draža Mihailović : la guerre de résistance en Yougoslavie se double dès lors d'une véritable guerre civile. Si le Royaume-Uni soutient initialement les Tchetniks, ceux-ci s'avèrent être un mouvement moins organisé et moins efficace que les Partisans ; divers chefs Tchetniks s'allient par ailleurs aux Italiens, puis plus tard aux Allemands, pour combattre les communistes. Outre leur expérience de l'action clandestine et de la guérilla - une partie de leurs dirigeants sont d'anciens membres des Brigades internationales - les Partisans ont pour avantage de constituer la seule force de résistance authentiquement « yougoslave » : ils parviennent en effet à attirer des membres issus de différentes nationalités yougoslaves (bien que Serbes et Monténégrins soient, surtout au début, majoritaires parmi eux) et envisagent pour l'après-guerre une organisation fédérale du pays. A contrario, les Tchetniks sont pour l'essentiel des nationalistes serbes et se livrent volontiers à des exactions contre les Croates et les Musulmans[478].
En novembre 1942, les Partisans, maîtres d'une partie du territoire yougoslave, créent le Conseil antifasciste de libération nationale de Yougoslavie (AVNOJ), un « parlement » qui leur permet d'attirer des sympathisants sous la bannière de l'antifascisme. La domination des Partisans sur le terrain et la collaboration d'une partie des troupes Tchetniks avec les occupants finissent par décider Churchill à retirer son appui à Mihailović et à soutenir exclusivement Tito, ce dont il fait part à un Staline surpris lors de la conférence de Téhéran[484]. Le , pendant la conférence de Téhéran, l'AVNOJ proclame le Comité national de libération de la Yougoslavie, un gouvernement qui se présente comme l'autorité légitime du pays, en concurrence avec le gouvernement royal en exil. Sur l'insistance de Churchill, le roi Pierre II reconnaît Tito comme le chef de la résistance yougoslave. En octobre 1944, l'Armée rouge réalise une incursion en Yougoslavie et permet aux Partisans de Tito de prendre Belgrade. Les troupes soviétiques se retirent ensuite et les communistes yougoslaves achèvent par leurs propres moyens de remporter la victoire dans le reste du pays. Tito accepte en mars 1945, à la demande des Britanniques, de reconnaître l'existence d'un conseil de régence : dans les faits, il détient la totalité du pouvoir à la fin du conflit mondial[478],[485],[486].
Roumanie
En Roumanie, le sentiment anti-allemand es resté très vif, tant chez les civils que les militaires, à la suite de la dureté de l'occupation allemande pendant la Première Guerre mondiale, et du fait que depuis son arrivée en Roumanie en , la Wehrmacht s'y comporte en pays conquis, multipliant les réquisitions, bien que le régime d'Ion Antonescu soit l'allié du Reich. Dans ce contexte, les divisions « Vladimirescu » et « Horia-Cloșca-Crișan » sont des équivalents roumains de la division française Leclerc et combattent en URSS contre les nazis. Les communistes roumains, très minoritaires dans la Résistance parviennent, grâce à l'appui soviétique, à pendre le contrôle de ces divisions. Elles grossissent pendant la campagne de l'armée roumaine contre l'URSS (-) d'un grand nombre de déserteurs et de prisonniers roumains faits par l'Armée rouge[487]. La division « Vladimirescu » est commandée par les généraux Nicolae Cambrea et Iacob Teclu. La division « Horia-Cloșca-Crișan » est commandée par le général Mihail Lascăr, qui s'était rendu et joint aux soviétiques à Stalingrad. Après avoir reculé vers l'est devant les forces de l'Axe jusque dans le Caucase, elles avancent vers l'ouest jusqu'à la fin de la guerre, atteignant Bratislava en Slovaquie le [488] et Humpolec en Bohême le [489]. La division « Vladimirescu » (6 000 hommes à sa constitution, 19 000 à la fin de la guerre, surtout des ruraux) est placée en face de divisions nazies ou hongroises et utilisée au combat direct. La division « Horia-Cloșca-Crișan » (5 000 hommes à la fin de la guerre, surtout des citadins) est plutôt utilisée face aux unités de l'armée roumaine sous les ordres du régime Antonescu, en infiltration et propagande pour tenter (surtout pendant et après Stalingrad) de rallier les soldats à la cause Alliée. Quant aux soldats roumains capturés par les Soviétiques, ils préfèrent souvent s'engager dans l'une de ces deux divisions plutôt que d'être envoyés en Sibérie ; ils sont ensuite endoctrinés par des commissaires politiques membres du PCR : le colonel Mircea Haupt (frère de l'historien communiste devenu français, Georges Haupt) pour la division « Vladimirescu » et le colonel Walter Roman (ancien des brigades internationales en Espagne et père du premier ministre roumain Petre Roman) pour la division « Horia-Cloșca-Crișan ». Après la guerre, le , 58 officiers de ces deux divisions reçoivent l'ordre soviétique de la Victoire[490].
Albanie et autres pays
Dans l'Albanie annexée par l'Italie, les Partisans yougoslaves aident les communistes locaux à s'organiser et à créer leur propre parti : c'est avec leur soutien que Enver Hoxha devient, en novembre 1941, le chef du nouveau Parti communiste d'Albanie[491],[492]. Le Mouvement de libération nationale dirigé par les communistes albanais, et dont le principal chef militaire est Mehmet Shehu, vétéran des Brigades internationales, mène ensuite la résistance contre les Italiens ; après le retrait de ces derniers, les communistes affrontent à la fois les Allemands et les nationalistes du Balli Kombëtar. En octobre 1944, à la faveur du retrait allemand, le comité anti-fasciste de libération nationale des communistes albanais devient le gouvernement provisoire du pays, sans que les Soviétiques soient intervenus[493]. En Roumanie, les communistes participent au Conseil national de la résistance contre le régime pro-allemand de Ion Antonescu. En Bulgarie, pays non occupé allié avec le Reich, le Parti communiste bulgare clandestin forme avec d'autres groupes politiques, aux idéologies très diverses, un Front patriotique destiné à combattre la politique pro-allemande de la monarchie[494].
Italie
Des groupes antifascistes italiens clandestins réfugiés en France fondent en , à Toulouse, un comité unitaire pour la lutte en Italie, qui inclut les communistes. Néanmoins, la résistance italienne se développe réellement après la chute de Mussolini et l'invasion du pays par l'Allemagne en septembre 1943 pour stopper l'avance des Alliés. La chute de Mussolini et l'amnistie prononcée par le nouveau gouvernement italien permettent la libération de nombreux détenus politiques, parmi lesquels des milliers de cadres communistes, prêts pour beaucoup à reprendre la lutte. À travers l'ensemble du pays, des groupes de partisans se forment plus ou moins spontanément pour mener la résistance contre les Allemands et le régime de la République sociale italienne. Un Comité de libération nationale, incluant l'ensemble des partis antifascistes, est fondé dès pour tenter de coordonner la résistance ; les communistes tiennent un rôle de premier plan dans la lutte armée contre l'occupant allemand et ses alliés fascistes, sans en avoir non plus l'exclusivité. À l'été 1944, cependant, plus de la moitié des groupes partisans sont sous l'autorité des communistes : certains croient venue l'heure de la « révolution prolétarienne » mais Palmiro Togliatti, revenu en Italie en , coupe court à leurs espoirs en décrétant que la révolution n'est pas à l'ordre du jour et que l'objectif de la lutte antifasciste est de construire un État démocratique en Italie. Togliatti parle au nom de Staline, qui souhaite préserver l'influence des communistes en Europe de l'Ouest : en s'abstenant de se lancer dans une entreprise révolutionnaire dangereuse qui risquerait d'entraîner leur élimination de la vie politique italienne, les communistes italiens se garantissent une place de premier plan après-guerre grâce à leur forte implication dans la lutte antifasciste. Le Parti communiste italien participe aux gouvernements provisoires successifs, présidés à la fin de la guerre par Badoglio, puis Bonomi[495],[431].
Autres pays européens
En Belgique, le Parti communiste anime le Front de l'Indépendance, qui participe à la résistance avec d'autres organisations non communistes : les Pays-Bas connaissent une situation comparable, de même que la Scandinavie occupée, où les PC locaux contribuent à la résistance aussi bien au Danemark qu'en Norvège. En Tchécoslovaquie occupée, le Parti communiste tchécoslovaque se livre, en Bohême-Moravie comme en Slovaquie, à des actions contre les Allemands : il en retire un réel prestige au sein de la population[496].
En Pologne occupée, le Parti ouvrier polonais lève une force armée, l'Armia Ludowa (Armée du Peuple), mais n'a nullement l'exclusivité de la lutte contre l'occupant et se trouve en conflit avec les autres branches de la résistance : l'AL, beaucoup moins importante que l'Armia Krajowa, ne parvient à s'assurer la prééminence au moment de la défaite allemande que grâce à la présence des troupes soviétiques et du fait de l'écrasement des résistants non communistes lors du soulèvement de Varsovie[497].
En Extrême-Orient
En Asie, outre la participation du Parti communiste chinois à la guerre en Chine, des mouvements de résistance communistes participent, dans certains pays occupés, à la lutte contre l'envahisseur japonais. Aux Philippines, le Parti communiste philippin crée l'organisation des Hukbalahap, soit Armée populaire anti-japonaise. En Malaisie, le Parti communiste malais, qui compte surtout dans ses rangs des membres de la minorité chinoise, forme l'Armée anti-japonaise des peuples de Malaisie[498].
En Indochine française où les troupes japonaises stationnent à leur guise depuis 1940, Nguyễn Ái Quốc, chef du Parti communiste indochinois, revient au pays après trente ans d'absence et de missions au service du Komintern : il crée en mai 1941 le Việt Minh (« Ligue pour l'Indépendance du Viêt Nam ») qui se veut un vaste « front national » rassemblant toutes les classes sociales sous un programme nationaliste. Des maquis naissent à la frontière chinoise, mais la surveillance des autorités coloniales françaises oblige les dirigeants nationalistes vietnamiens à se réfugier dans le Sud de la Chine. En août 1942, Nguyễn Ái Quốc est arrêté par le gouvernement chinois du Kuomintang ; en son absence, le Việt Minh étend ses réseaux en Indochine et prend progressivement le contrôle d'une série de villages. Le chef du Việt Minh est ensuite libéré par les Chinois, peut-être à l'instigation des États-Unis qui ignorent à la fois son identité réelle et son affiliation communiste et voient en lui un allié potentiel. L'activisme Việt Minh, qui entretient des contacts avec les services secrets américains, redouble en 1943, ce qui amène les Français à renforcer leur surveillance. En mars 1945, les Japonais prennent le contrôle de l'Indochine et anéantissent l'administration coloniale française. Alors que le territoire vietnamien est en plein chaos et souffre, durant l'année 1945, d'une terrible famine, le Việt Minh étend son contrôle sur les campagnes, ne rencontrant que peu d'opposition de la part des Japonais qui tiennent surtout les grandes villes. En août 1945, après le bombardement atomique de Nagasaki, Nguyễn Ái Quốc, qui se fait désormais appeler Hô Chi Minh, décrète un « soulèvement général » contre les Japonais. Durant l'épisode dit de la révolution d'Août, le Việt Minh prend le contrôle du pays de manière inégale, sans partage au Nord et de façon moins assurée au Sud. Les Japonais résistent peu et présentent finalement leur reddition au Việt Minh plutôt qu'aux Alliés, laissant délibérément l'Indochine dans une situation impossible pour les Français. Le 2 septembre, Hô Chi Minh proclame l'indépendance de la « République démocratique du Viêt Nam » et prend la tête d'un gouvernement provisoire à Hanoï[499],[500],[501],[502].
L'essor du communisme après 1945 et le début de la guerre froide

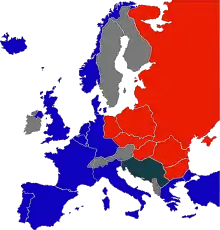
Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'URSS, dont les troupes occupent la majeure partie de l'Europe de l'Est, étend son influence de manière spectaculaire : Winston Churchill déclare en mars 1946 « De Stettin sur la Baltique à Trieste sur l'Adriatique, un rideau de fer s'est abattu à travers le continent »[503]. Dès 1946, les relations entre l'URSS et ses anciens alliés, le Royaume-Uni et les États-Unis, se dégradent. L'URSS et les États-Unis, tous deux membres fondateurs de l'ONU, apparaissent comme les deux superpuissances majeures de l'après-guerre et entreprennent d'étendre et de consolider leurs influences respectives dans le monde d'après-guerre. Les États-Unis proposent en 1947 un vaste plan d'aide pour la reconstruction de l'Europe, le plan Marshall, qui contribue à convaincre Staline que la division du monde en deux blocs rivaux est inévitable. Le président américain Harry Truman est de son côté convaincu de la nécessité de mettre en place une politique de « containment » (endiguement) de l'expansion communiste : sa position prend le nom de doctrine Truman[504],[505]. Quelques mois après le lancement du plan Marshall — refusé par les pays d'Europe de l'Est sous influence soviétique — l'URSS met en place un nouvel organisme assurant la liaison entre les PC européens, le Kominform (abréviation en russe de Bureau d'information des partis communistes et ouvriers) : lors de sa première réunion, le délégué soviétique Andreï Jdanov présente le monde comme divisé entre un camp « anti-démocratique et impérialiste » et un autre « anti-impérialiste et démocratique ». Cette conception prend le nom de doctrine Jdanov[506].
Entre 1945 et 1949, des régimes communistes sont mis en place dans l'ensemble des pays d'Europe de l'Est et d'Europe centrale, constituant l'ensemble politique connu sous le nom de bloc de l'Est. Inspiré par l'expression de « démocratie populaire » utilisée par la propagande des Partisans yougoslaves, Joseph Staline adopte le terme et en fait le nouveau mot d'ordre des mouvements communistes européens, en le définissant comme une voie vers le socialisme alternative à la dictature du prolétariat. L'ensemble des régimes communistes — ou « pays frères » — mis en place en Europe se présentent ensuite comme des « démocraties populaires », concept que Dimitrov présente d'abord comme un « pouvoir démocratique, reposant sur la coopération des pouvoirs politiques antifascistes avec un rôle essentiel des communistes et des forces de la gauche », avant de la définir comme une nouvelle forme de la dictature du prolétariat[507],[508]. Dans la majorité des pays, la période de prise de pouvoir par les communistes se fait sous l'égide de gouvernements de coalition (« fronts ») dont l'orientation officielle est celle de l'antifascisme. Les communistes usent d'un mélange de manipulations et d'actions légales pour s'assurer le contrôle de tous les leviers du pouvoir, usant de manœuvres de terreur. Ils réussissent cependant à susciter, au moins dans les premiers temps, l'adhésion d'une partie de la population à qui est promise, après des années de guerre, d'occupation et de dictature, la construction d'un « système démocratique original adapté à chaque pays ». Ce soutien populaire, qui n'est pas absolu, est aussi très inégal selon les pays. Il n'en est pas moins réel dans l'immédiat après-guerre, et les communistes en bénéficient notamment en Yougoslavie, en Bulgarie et en Tchécoslovaquie[509],[510]. Dans l'ensemble des pays communistes, l'opposition politique est progressivement éliminée et la société civile neutralisée[510] ; les partis socialistes d'Europe de l'Est sont liquidés, avec la complicité d'une partie de leurs cadres qui, ralliés aux communistes, poussent à la fusion avec les PC[511].
Dans plusieurs pays occidentaux, les communistes deviennent au sortir de la guerre, grâce à leur implication dans la résistance, des acteurs essentiels de la vie politique : tout en demeurant des alliés de l'URSS, les partis communistes demeurent des partis de premier plan dans des pays comme la France et l'Italie. En Asie, le pays le plus peuplé du monde devient communiste en 1949 avec la proclamation de la République populaire de Chine. La « guerre froide » qui oppose désormais les pays communistes au « monde libre » donne lieu à des conflits ouverts comme la guerre civile grecque en Europe et, en Asie, la guerre d'Indochine et surtout la guerre de Corée[512]. L'extension du communisme en Extrême-Orient donne naissance à l'expression « rideau de bambou », pour désigner un équivalent asiatique du rideau de fer. La période 1949-1950 marque une phase culminante de la guerre froide, avec le blocus de Berlin, la création de deux États allemands distincts, la formation de l'OTAN que l'URSS interprète comme une menace directe, l'explosion de la première bombe A soviétique qui signe l'entrée de l'URSS dans la catégorie des puissances nucléaires et le déclenchement de la guerre de Corée[513].
Yougoslavie
.svg.png.webp)
En Yougoslavie, la victoire militaire des Partisans permet au Parti communiste de Yougoslavie dirigé par Tito de s'assurer dès 1945 le monopole du pouvoir. La force des communistes tient dans leur capacité à transcender les barrières ethniques et à proposer un projet national authentiquement yougoslave : les trois quart des communistes yougoslaves sont morts pendant la guerre mais une campagne massive de recrutement permet d'attirer environ 140 000 membres en 1945, puis 300 000 militants durant les quatre années qui suivent le conflit. Durant ses premiers mois au pouvoir, Tito écrase ce qui reste des troupes des Oustachis et des Tchetniks et purge à la fois les opposants et les collaborateurs, lors d'épisodes comme le massacre de Bleiburg : au cours des deux premières années de l'après-guerre, plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers de personnes périssent en Yougoslavie[514],[515],[516]. Dès , une grave crise éclate entre la Yougoslavie et l'Italie lorsque Tito occupe la Vénétie julienne et l'Istrie, régions annexées par l'Italie après la Première Guerre mondiale et dont il souhaite s'emparer. La population italienne de ces territoires, assimilée aux fascistes, fait l'objet d'un nettoyage ethnique : plusieurs milliers d'Italiens sont tués, notamment durant les massacres des foibe. Sous la pression des Soviétiques qui souhaitent éviter des tensions avec les Alliés, Tito doit finalement se résoudre à partager avec les Britanniques l'occupation de ces zones, qui deviennent provisoirement le Territoire libre de Trieste[517].
Le gouvernement de Tito, formé en , compte plusieurs royalistes afin de complaire aux Alliés, mais les communistes écartent bientôt leurs partenaires, Tito usant de tactiques staliniennes impitoyables. Des opposants sont condamnés pour « collaboration », aux côtés d'authentiques pro-nazis serbes et croates. Des élections législatives sont organisées en novembre 1945 mais les manœuvres d'intimidation sont telles que les partis non communistes se retirent du scrutin : le Front populaire des communistes constitue alors la liste unique lors du scrutin. La monarchie yougoslave est officiellement abolie immédiatement après le scrutin, laissant place à la République fédérative populaire de Yougoslavie. Plus aucune activité politique n'est autorisée en dehors du Front populaire, le PCY devenant parti unique. Les organisations religieuses, dont certaines ont collaboré durant la guerre, sont persécutées. Le pays s'emploie à tenter de résoudre ses fractures ethniques en adoptant une forme fédérale : la Serbie, la Slovénie, le Monténégro, la Macédoine, la Croatie et la Bosnie-Herzégovine composent désormais, de manière théoriquement égalitaire, les Républiques de la nouvelle Yougoslavie, où toutes les nationalités voient leur spécificité reconnue[514],[515],[516].
Albanie
.svg.png.webp)
L'Albanie voisine, dont les communistes ont été largement soutenus par les Partisans de Tito pendant le conflit, apparaît au sortir de la Seconde Guerre mondiale comme une « annexe » politique de la Yougoslavie, dont elle est alors très dépendante. Les communistes s'arrogent tous les pouvoirs dès l'automne 1944, éliminant leurs rivaux du Balli Kombëtar : un « gouvernement démocratique » est proclamé en octobre. Le Front démocratique du Parti communiste d'Albanie, réplique du Front populaire yougoslave, organise en l'élection d'une assemblée constituante, et remporte officiellement 93 % des suffrages. Le Parti communiste d'Albanie — rebaptisé en 1952 Parti du travail d'Albanie — devient parti unique. La République populaire d'Albanie est officiellement proclamée en janvier 1946, avec Enver Hoxha comme chef du gouvernement[514],[515],[516].
Pologne
En Pologne, Stanisław Mikołajczyk, chef du Parti paysan et ancien premier ministre du gouvernement polonais en exil, accepte en juin 1945 - à la demande des Anglo-Américains qui souhaitent mettre en œuvre la transition démocratique prévue par les accords de Yalta - de participer au gouvernement de coalition avec les communistes. Ces derniers jouent habilement des dissensions au sein des autres partis et proposent un programme séduisant, dont les grandes lignes sont empruntées à leurs adversaires politiques. Alors que les élections sont repoussées, les communistes organisent un plébiscite portant sur la réforme agraire et les nationalisations, la suppression du Sénat et la reconnaissance des frontières du pays. L'absence de ligne cohérente des opposants permet au Parti ouvrier de faire approuver le plébiscite par 63 % des suffrages. Contrôlant les médias, les communistes s'arrogent le mérite de la réforme agraire au détriment du Parti paysan. Grâce au soutien de cadres socialistes polonais convertis à leur cause comme Józef Cyrankiewicz, il s'assurent l'alliance du Parti socialiste polonais. En janvier 1947, des élections législatives en grande partie truquées accordent à la coalition dirigée par le Parti ouvrier polonais plus de 80 % des suffrages. Bolesław Bierut devient président de la République et Cyrankiewicz premier ministre. Dans le courant de l'année, la répression s'accroit en Pologne et Mikołajczy doit fuir pour éviter d'être arrêté. Les socialistes sont absorbés par les communistes au sein du Parti ouvrier unifié polonais (POUP, ou PZPR), dirigé par Władysław Gomułka. Un Parti paysan unifié est créé pour servir, avec le Parti démocratique, de parti satellite au POUP[518],[519].
Roumanie

En Roumanie, l'émissaire soviétique Andreï Vychinski menace le roi Michel Ier de faire tirer sur ses partisans si le monarque ne se plie pas aux exigences soviétiques. Le , Nicolae Rădescu est remplacé à la tête du gouvernement par Petru Groza, chef du « Front des laboureurs » inféodé aux communistes. Ceux-ci détiennent désormais plusieurs ministères, le chef du Parti, Gheorghe Gheorghiu-Dej, étant ministre de l'économie. Les communistes roumains sont dans les premiers temps particulièrement tributaires de la présence des troupes soviétiques : leur campagne de terreur menée lors de la prise du pouvoir en mars- et l'instauration de « tribunaux populaires » aux pouvoirs discrétionnaires permettent de neutraliser la classe politique et les syndicats non-communistes. L'administration est épurée pour laisser la place à des cadres proches du Front National Démocratique, la coalition procommuniste au pouvoir. Malgré la violence des « milices populaires » communistes, les élections organisées à la demande des Occidentaux sont, le , gagnées par le Parti paysan et le Parti libéral mais, sur pression de Joseph Staline, le Parti des travailleurs roumains — nom alors utilisé par le Parti communiste roumain — est déclaré majoritaire. Le code pénal roumain est révisé pour assurer aux communistes un arsenal répressif et les arrestations se multiplient dans les rangs de l'opposition. Une police politique aux pouvoirs très étendus, la Securitate, est mise en place. Le roi est contraint à l'abdication en décembre 1947, puis expulsé du pays, et la République populaire roumaine est proclamée. Petru Groza demeure chef du gouvernement et Gheorghe Gheorghiu-Dej devient chef de l'État[520],[521].
Bulgarie
.svg.png.webp)
En Bulgarie, les communistes ne représentent qu'un des éléments du Front patriotique mais ils parviennent, en usant des diverses manœuvres, à diviser les agrariens et les sociaux-démocrates. Une campagne de terreur menée lors de la prise du pouvoir en et l'instauration de « tribunaux populaires » permettent de neutraliser la classe politique bulgare demeurée à l'écart du Front patriotique : entre 1944 et 1949, 86 lieux de détention administrative existent en Bulgarie. Georgi Dimitrov, revenu en Bulgarie, reprend la direction du Parti. En septembre 1946, un plébiscite est organisé pour abolir la monarchie ; le mois suivant, des élections, marquées comme en Roumanie par des incidents sanglants, donnent la victoire au Front patriotique avec des chiffres officiels de 78 %. Dimitrov succède à son allié Kimon Georgiev comme chef du gouvernement de la République populaire de Bulgarie ; la nouvelle constitution, rédigée en URSS, est adoptée en décembre 1947. Le , Nikola Petkov, dirigeant de l'Union nationale agraire et obstacle à l'hégémonie des communistes, est arrêté en pleine séance du parlement, sous l'accusation de tentative de coup d'État et de menées terroristes. Il est condamné à mort et pendu le . Les communistes bulgares s'assurent le monopole du pouvoir et l'Union nationale agraire est réduite au rang de parti-satellite au sein du Front patriotique. Le dernier député d'opposition est arrêté en [522],[523],[524].
Tchécoslovaquie

En Tchécoslovaquie — l'un des rares pays d'Europe de l'Est à ne pas être occupé par les troupes soviétiques, qui ne sont pas demeurées sur place après leur offensive sur Prague en 1945 — le Parti communiste tchécoslovaque arrive au pouvoir par ses propres moyens. En 1945, le PCT fait partie du gouvernement de coalition mis en place par le président Edvard Beneš. Grâce à leur opposition avant-guerre aux accords de Munich et à leur participation à la résistance durant l'occupation, les communistes, dirigés par Klement Gottwald, Antonín Zápotocký et Rudolf Slánský, bénéficient d'un réel soutien populaire et obtiennent 37,9 % des suffrages lors des élections législatives de 1946[509].
La Tchécoslovaquie accepte d'abord le Plan Marshall, puis le refuse sur injonction de Staline. Le Parti communiste prend ensuite la décision de réaliser un coup de force pour achever de faire passer le pays dans l'orbite soviétique : grâce notamment à la complicité du ministre de la défense, alors non communiste, Ludvík Svoboda, ils prennent progressivement le contrôle des forces de sécurité, profitant également de la maladie d'Edvard Beneš pour étendre leur influence. En février 1948, lors de l'épisode dit du coup de Prague, les communistes s'emparent du pouvoir : alors que les ministres non communistes commettent l'erreur de remettre leur démission du gouvernement pour protester contre les manœuvres communistes, des milices ouvrières, hâtivement armées, sont formées dans tout le pays par les communistes pour intimider l'opposition et soutenir la « révolution ». Le président de la république, très affaibli, accepte le départ de ses ministres et la constitution d'un nouveau gouvernement composé pour moitié de communistes. Ces derniers ont alors le champ libre pour imposer leurs mesures, notamment celle d'une liste unique aux élections législatives. Le pouvoir passe aux mains du Front national dirigé par le Parti communiste, qui épure les partis politiques et renforce l'alliance avec l'URSS. L'administration est rapidement purgée. Les comités d'action révolutionnaires désignent de nouvelles municipalités. En mai, des élections sont organisées et le Front national remporte 90 % des suffrages. Gottwald devient président de la république pour remplacer Beneš démissionnaire et une nouvelle constitution est adoptée, achevant d'instaurer le régime communiste en Tchécoslovaquie[525],[526].
Hongrie
.svg.png.webp)
En Hongrie, le Parti communiste hongrois, dirigé par Mátyás Rákosi — membre en 1919 du gouvernement de la République des conseils — Ernő Gerő et Imre Nagy, participe au gouvernement de coalition mais ne bénéficie pas au sortir de la guerre d'une réelle assise populaire. En novembre 1945, les élections législatives, organisées honnêtement, sont remportées par le Parti des petits propriétaires. Rákosi emploie alors une stratégie graduelle, désignée du nom de tactique du salami, pour s'emparer des leviers du pouvoir et éliminer les opposants en conduisant les partis non communistes, dûment infiltrés, à se scinder ou à fusionner avec les communistes. Ceux-ci s'arrogent les ministères clés : László Rajk, ministre de l'intérieur, met sur pied une police secrète, l'AVH, et entreprend de susciter un régime de terreur en liquidant peu à peu l'opposition. En 1947, lors de nouvelles élections, les communistes obtiennent un peu moins de 23 % des voix grâce à des fraudes : la coalition de gauche qu'ils dirigent, le Front démocratique, obtient 45,3 % des suffrages. Le Parti entreprend un recrutement massif, atteignant les 650 000 membres en . Fusionnant avec le Parti social-démocrate de Hongrie, le Parti communiste devient le Parti des travailleurs hongrois. Avant même la mise en place définitive du régime communiste, Rákosi entreprend de purger le Parti, éliminant une partie des cadres qui étaient restés en Hongrie durant l'entre-deux-guerres, comme János Kádár et László Rajk. Kádár est emprisonné et Rajk condamné à mort et exécuté. En , de nouvelles élections sont convoquées, le Front démocratique présentant cette fois une liste unique, qui remporte 95,6 % des suffrages. Une nouvelle constitution est adoptée, la Hongrie devenant la République populaire de Hongrie, et le Parti des travailleurs devient parti unique[527],[528].
Allemagne de l'Est

.svg.png.webp)
Dans la zone d'occupation soviétique en Allemagne, qui correspond à l'Est du pays, le Parti communiste d'Allemagne est, le , le premier parti allemand à se reconstituer après la défaite du régime nazi. Les cadres du KPD, revenus au pays avec le « groupe Ulbricht » ramené par les Soviétiques ou sortis de la clandestinité, entreprennent de prendre le contrôle des administrations, nommant dans les villes des maires non communistes flanqués de cadres communistes. Après sa reformation, le KPD publie un manifeste modéré, qui ne réclame ni une économie socialiste ni un système de parti unique. Soutenus par l'occupant soviétique, les communistes entreprennent de se rallier l'ensemble du personnel politique, qui obtempère sous la pression ou par opportunisme. Les partis autorisés dans la zone soviétique sont tous réunis au sein de la coalition du « Bloc antifasciste ». En avril 1946, les parties des appareils du KPD et du Parti social-démocrate d'Allemagne présentes dans la zone soviétique fusionnent pour donner naissance au Parti socialiste unifié d'Allemagne (SED). Malgré cette stratégie unitaire, le nouveau parti ne parvient à obtenir la majorité dans aucune province lors des élections organisées en 1946, les communistes allemands étant associés par la population à l'occupation soviétique. Le , les trois zones d'occupation de Berlin-Ouest par la France, le Royaume-Uni et les États-Unis adoptent une nouvelle monnaie en remplacement de la monnaie d’occupation, sans consulter l'URSS, qui occupe la quatrième zone de Berlin. Les Occidentaux veulent ainsi détacher économiquement la Trizone de la zone soviétique : Staline proteste contre ce qu’il considère être une violation des accords de Potsdam, en vertu desquels les quatre puissances occupantes exercent une souveraineté collective sur l’Allemagne. En réaction, les Soviétiques organisent le blocus des zones occidentales de la ville ; l'URSS barre les voies terrestres d'accès à Berlin-Ouest pour y prévenir l'implantation de la nouvelle monnaie. Alors que la tension en Allemagne entre Est et Ouest atteint son comble, l'aviation occidentale met en place un pont aérien de marchandises vers Berlin-Ouest afin d'en ravitailler la population. Staline lève finalement le blocus en mai 1949. Le , à l'Ouest, l'Allemagne renaît en tant qu'entité politique indépendante avec la proclamation du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne (RFA, dite Allemagne de l'Ouest). À l'Est, le camp communiste réagit en proclamant le 7 octobre la République démocratique allemande (RDA, dite Allemagne de l'Est) : Wilhelm Pieck, militant communiste depuis l'époque du spartakisme, devient président de la république et l'ancien social-démocrate Otto Grotewohl chef du gouvernement : Walter Ulbricht, autre vétéran du KPD et secrétaire général du SED à partir de 1950, est dans les faits le principal dirigeant du régime. La coalition du Bloc antifasciste, dominée par le SED et réunissant les autres partis autorisés en RDA, est rebaptisée Front national de l'Allemagne démocratique[529],[530],[531].
Fonctionnement des régimes communistes est-européens


Les effectifs des partis communistes d'Europe de l'Est, qui s'organisent et recrutent dès 1945-1946, augmentent massivement dans tous les pays[532]. Alors qu'aucun n'était puissant avant-guerre à l'exception des PC soviétique et tchécoslovaque, tous deviennent progressivement des partis de masse, du fait notamment de leur monopole ou quasi-monopole de la vie publique et des avantages procurés à leurs adhérents[533]. Les cadres des PC au pouvoir deviennent, sur le modèle soviétique, des élites sociales bénéficiant de multiples privilèges, la possession de la carte du Parti devenant un atout sur les plans social et professionnel. Cette nouvelle élite est désignée avec le temps, en URSS comme ailleurs, du nom de nomenklatura[534]. Les dirigeants du Parti communiste local, de l'armée, des diverses bureaucraties et des organisations sociales jouissent de nombreux avantages (attributions de logements, magasins spéciaux, facilités de voyages, et, grâce à des salaires plus élevés, de niveaux de vie supérieurs au reste de la société)[535]. Le Yougoslave Milovan Djilas, ancien proche de Tito passé à l'opposition, emploie en 1957 l'expression « nouvelle classe » pour désigner la catégorie de cadres issus de l'appareil des partis de type bolchevik[536],[537].
Dans les pays d'Europe de l'Est, des maquis de résistance anticommuniste existent durant les premières années de la Guerre froide et mènent une lutte armée contre les nouveaux régimes : c'est notamment le cas en Pologne[538], en Bulgarie[539] et en Roumanie[540], mais aussi dans certains territoires réannexés par l'URSS comme les pays baltes - où la guérilla antisoviétique reçoit le nom de « frères de la forêt » - ainsi qu'à l'Ouest de la Biélorussie et de l'Ukraine[541].
Dans les faits, les dirigeants des régimes communistes européens sont dans leur majorité directement subordonnés à Staline, qui va jusqu'à leur imposer ses propres horaires de travail très particuliers, les appelant en plein milieu de la nuit pour des entretiens téléphoniques. Des milliers de conseillers militaires et économiques soviétiques sont envoyés en Europe de l'Est. Des émissaires de l'URSS sont en contact régulier avec les dirigeants est-européens, l'URSS disposant de ses réseaux d'informateurs au sein de partis communistes locaux : seuls les Yougoslaves font preuve de suffisamment d'indépendance pour congédier les informateurs à la solde des Soviétiques. En est créé le Conseil d'assistance économique mutuelle (CAEM, également désigné par l'acronyme anglais COMECON), structure économique qui lie l'URSS et les différents pays communistes européens[542]. Très dépendants politiquement et économiquement de l'URSS, les régimes communistes est-européens s'inspirent étroitement, dans un premier temps, du modèle soviétique. L'armée et la police constituent d'importants groupes de pression, concentrant en leur sein une grande partie des pouvoirs. Des polices politiques, comme l'ÁVH hongroise, l'UDBA yougoslave, la Securitate roumaine ou la Stasi est-allemande, sont créées dans tous les pays communistes : elles bénéficient de pouvoirs exorbitants, qui leur permettent de faire régner un climat de terreur. Des systèmes d'économie planifiée sont mis en place, l'agriculture est collectivisée au sein de coopératives agricoles, avec des succès inégaux selon les pays, du fait notamment de la mauvaise volonté du monde paysan. En 1955, seule la République populaire de Bulgarie affiche un pourcentage très élevé (61 %) de terres agricoles intégrées dans les coopératives, tandis que la République populaire roumaine et la République populaire de Pologne dépassent à peine les 10 %. Au contraire, les nationalisations des banques, du commerce extérieur, des sources d'énergie, des transports et de l'industrie progressent assez rapidement, facilitées notamment par la confiscation de l'économie de la plupart de ces pays par les Allemands durant la guerre. Des politiques d'industrialisation massive sont mises en œuvre en appliquant un credo productiviste[543],[544].
Les églises sont contrôlées, marginalisées et mises au pas[545]. Un effort colossal de propagande est fourni pour diffuser l'idéologie marxiste-léniniste et embrigader la société au sein d'organisations de masse (syndicats inféodés au Parti, organisations de femmes, organisations de jeunesse…)[546]. Dans certains pays du bloc, plusieurs partis sont autorisés à exister tout en demeurant subordonnés au PC local, à l'image du Parti paysan unifié polonais ou des chrétiens-démocrates est-allemands. L'existence d'un multipartisme de façade constitue un alibi libéral à usage externe, tout en maintenant l'image d'une coalition des forces « antifascistes ». Ces partis ont également pour fonction d'aider à diffuser l'idéologie officielle auprès des catégories sociales qui forment leur électorat traditionnel[547].
Si les régimes communistes ne garantissent pas dans les faits l'égalité totale entre les citoyens, du fait notamment des privilèges accordés à la nomenklatura, ils mettent en œuvre des mesures destinées à favoriser le progrès social : le droit à l'éducation gratuite pour tous est instauré, de même que l'accès à la culture, les écarts de salaires sont réduits et toutes les personnes bénéficiant d'un emploi se voient garantir le droit au logement, au remboursement des frais médicaux et à la retraite[548].
Rupture avec la Yougoslavie

Alors même que tous les régimes communistes est-européens n'ont pas encore achevé de se mettre en place, le bloc de l'Est subit un remous important en 1948 au moment de la rupture entre l'URSS et la Yougoslavie (dite également « schisme yougoslave »). Tito apparaît dans les premières années de l'après-guerre comme un stalinien loyal. Staline s'agace néanmoins de l'activisme des Yougoslaves, que ce soit dans le contexte de la guerre civile grecque où leur interventionnisme est jugé dangereux par les Soviétiques, ou dans le projet d'une Fédération balkanique entre la République fédérative populaire de Yougoslavie et la République populaire de Bulgarie : le dirigeant bulgare Georgi Dimitrov se déclare initialement favorable à ce dernier projet mais se rétracte au début de 1948 après une réprimande de la Pravda. L'URSS voit d'un mauvais œil les ambitions de la Yougoslavie de constituer une puissance majeure dans les Balkans[549],[515].
En , l'URSS rappelle ses conseillers et instructeurs militaires de Yougoslavie en se plaignant de l'attitude des autorités yougoslaves. Soviétiques et Yougoslaves entament alors un échange de messages qui vire au dialogue de sourds, chacun protestant contre l'attitude de l'autre. L'URSS vise à ébranler le pouvoir de Tito et à provoquer son renversement par la faction pro-soviétique du Parti communiste de Yougoslavie ; le PCY refuse un arbitrage du Kominform. À la seconde conférence du Kominform, en juin 1948, le parti yougoslave est violemment attaqué par le Français Jacques Duclos et l'Italien Palmiro Togliatti ; le Kominform publie ensuite une résolution condamnant la politique suivie par le parti yougoslave, qui est exclu de l'organisation. Une violente campagne de propagande contre Tito, accusé de tous les maux idéologiques, est menée par tous les partis communistes fidèles à Staline sur le continent européen. Tito, cependant, tient bon et consolide sa position au sein du PCY[550],[551], qu'il purge au contraire de ses éléments favorables à Staline, dont beaucoup sont envoyés dans la prison de l'île de Goli Otok[552].
Purges politiques au sein du Bloc de l'Est
L'accusation de « titisme » devient, dès la rupture soviéto-yougoslave, un prétexte pour purger les appareils des partis communistes est-européens, qui subit une nouvelle forme de « bolchévisation », soit de reprise en main après la crise de 1948. En 1948-1949, de nombreux dirigeants et cadres communistes considérés comme trop nationalistes ou simplement trop indépendants sont déchus de leurs fonctions sous diverses accusations dont, notamment, celle de collusion avec Tito. Beaucoup sont condamnés à des peines de prison, voire à mort. Dans de nombreux cas, les communistes restés sur le sol national dans l'entre-deux-guerres et durant la guerre sont éliminés au profit de ceux ayant passé des années en URSS : mais l'inverse est également fréquent[553].
L'épuration des PC peut se diviser en deux phases : la première vise des dirigeants politiques « nationaux » au profit de « moscovites », soit de cadres plus proches de l'URSS ; la seconde vise, sous l'accusation fréquente de « cosmopolitisme », des cadres, souvent d'origine juive, dont le principal crime est d'avoir été, en tant que membres des Brigades internationales ou du Komintern, les témoins des méthodes d'épuration staliniennes. La dénonciation, sur un ton « hystérique », du « titisme hitléro-fasciste » et la chasse aux « déviationnistes » visent à éliminer toute dissidence potentielle au sein du camp communiste[553].
En Pologne, Władysław Gomułka, l'un des dirigeants communistes les plus indépendants, qui n'hésite pas à critiquer publiquement les pillages commis par l'Armée rouge[554], est démis de son poste de secrétaire général du Parti au profit de son rival Bolesław Bierut. En Bulgarie, le vice-premier ministre Traïcho Kostov est arrêté et condamné à mort au cours d'un procès grossièrement mis en scène ; ceci permet à Valko Tchervenkov, qui le remplace, d'écarter un rival pour la succession de Georgi Dimitrov alors très malade. C'est ce même contexte qui voit en Hongrie l'élimination de László Rajk par Mátyás Rákosi. En Albanie, Enver Hoxha se défait de son rival le ministre de la défense Koçi Xoxe, qu'il fait condamner à mort. En Tchécoslovaquie, le secrétaire général du Parti Rudolf Slánský est relevé de ses fonctions en 1951 et remplacé par Antonín Novotný ; Mátyás Rákosi se charge de fournir au président tchécoslovaque Klement Gottwald des « noms suspects » issus de la procédure du procès de László Rajk, qui permettent de dresser une liste des personnalités à éliminer. Des cadres dirigeants du Parti communiste tchécoslovaque, dont Slánský, sont ensuite arrêtés et inculpés pour trahison et espionnage. S'ensuit en novembre 1952 une mascarade judiciaire, connue sous le nom de procès de Prague : elle se déroule dans le cadre d'une campagne de propagande aux nets accents antisémites, onze accusés sur quatorze étant juifs et dénoncés par conséquent comme des « sionistes » forcément portés à trahir. Slánský et dix des autres inculpés sont condamnés à mort et exécutés. En Roumanie, Gheorghe Gheorghiu-Dej parvient dans le courant de 1952 à faire démettre et emprisonner plusieurs hauts dirigeants du régime qui rivalisaient avec lui en influence, dont la ministre des affaires étrangères Ana Pauker[555],[556].
Le communisme yougoslave après 1948

Après sa rupture avec l'URSS, la Yougoslavie se trouve dans un premier temps isolée en Europe, la République populaire d'Albanie, jusque-là son alliée proche, choisissant le camp soviétique[557]. Mais, dès 1949, les États-Unis commencent à apporter leur aide au régime de Tito. Ce dernier est alors amené à adopter une nouvelle voie économique, du fait notamment de la nécessité de rembourser les prêts américains. L'économie yougoslave, jusque-là « militarisée », est rationalisée dans une recherche de l'équilibre budgétaire. Tito décide de confier la gestion des entreprises à des conseils ouvriers, pour aller à l'encontre du « capitalisme d'État » soviétique. Si, dans les faits, l'autogestion yougoslave demeure limitée, les conseils ouvriers étant supervisés par l'État et devant respecter les objectifs officiels, cette évolution est présentée comme un retour aux sources du marxisme. Le type de gouvernement communiste pratiqué par Tito est désigné du nom de « titisme »[558] (initialement un terme péjoratif employé par les staliniens), Tito lui-même utilisant l'expression « yougoslavisme » pour qualifier sa recherche du consensus social et de la performance économique. La Yougoslavie demeure, sur le plan politique, un État à parti unique, mais Tito, qui n'a pour sa part aucune prétention à être un théoricien politique original, encourage le débat en son sein et la réflexion autour de la doctrine marxiste. Le Parti est rebaptisé en 1952 Ligue des communistes de Yougoslavie afin de se différencier des autres partis communistes. Tandis que l'État yougoslave s'engage vers une décentralisation croissante des institutions, la Yougoslavie devient le plus ouvert et le plus prospère des pays communistes européens, connaissant un fort taux de croissance dans les années 1950 et s'ouvrant largement au tourisme venu de l'Ouest. Les Yougoslaves voyagent eux aussi avec une liberté accrue, ramenant des influences occidentales. Tito gouverne quant à lui dans un style « monarchique », possède de nombreuses et luxueuses résidences en Yougoslavie et s'entoure d'un culte de la personnalité. S'il se réconcilie en 1955 avec les Soviétiques à l'initiative de ces derniers, le dirigeant yougoslave continue ensuite de cultiver son indépendance et entretient de bonnes relations avec les pays occidentaux, s'en tenant à une politique de neutralité sur le plan international. En 1955, la Yougoslavie participe à la conférence de Bandung, qui donne quelques années plus tard naissance au Mouvement des non-alignés dont elle est l'un des membres fondateurs[558],[559],[560].
En Europe
Dans la majorité des pays d'Europe de l'Ouest et d'Europe du Nord (France, Italie, Finlande, Belgique, Autriche, Norvège, Grèce, Saint-Marin...) les partis communistes locaux participent aux gouvernements provisoires issus du conflit mondial. Au début de la guerre froide, et au moment de la formation du bloc de l'Est, les partis communistes quittent les gouvernements et, pour la plupart, déclinent rapidement. La Grèce, qui sombre dans la violence puis dans une véritable guerre civile, représente un cas particulier en Europe. Dans les autres pays, les PC locaux sont simplement marginalisés au sein du jeu démocratique, victimes de leur proximité avec l'URSS[561],[562] : certains, comme le Parti communiste des Pays-Bas, ont perdu près de la moitié de leurs adhérents dès le début des années 1950[563]. En 1948, s'exprimant à la tribune de l'ONU, le ministre belge des affaires étrangères Paul-Henri Spaak va jusqu'à qualifier les PC européens de « cinquième colonne » de l'URSS[564]. Si l'on excepte le cas du petit État de Saint-Marin, les PC ne demeurent des forces électorales de premier plan que dans trois pays : la France, l'Italie et la Finlande[561],[562].
La guerre civile grecque

En Grèce, les communistes quittent le gouvernement au moment des évènements de . La tension politique demeure extrême, et débouche en 1946 sur une guerre civile, qui dure jusqu'en 1949. Márkos Vafiádis dirige l'Armée démocratique de Grèce, la nouvelle force armée mise sur pied par le Parti communiste de Grèce, ainsi que le gouvernement provisoire mis en place par les communistes dans les zones sous leur contrôle. Staline, qui juge que l'insurrection en Grèce n'a aucune chance de réussir et souhaite éviter un conflit direct avec les pays occidentaux, s'en tient aux accords conclus en 1944 avec Churchill et n'accorde pas d'aide aux insurgés grecs, s'irritant même du soutien logistique que leur apporte la Yougoslavie jusqu'à la rupture de 1948[565],[566].
Les communistes grecs, qui réalisent en leur propre sein des épurations sanglantes durant le conflit, sont finalement défaits par les troupes gouvernementales : entre 80 000 et 100 000 d'entre eux se réfugient dans les pays du bloc de l'Est, où certains sont par la suite victimes des diverses purges mises en œuvre soit par les pays qui les accueillent, soit par la direction du Parti communiste de Grèce exilé[567]. Une autre partie de l'appareil du KKE demeure sur le sol grec : bien que leur parti soit officiellement interdit, les communistes grecs « de l'intérieur » continuent de participer aux élections par l'entremise d'une coalition formée avec d'autres groupes, la Gauche démocratique unie (EDA)[568]. L'EDA obtient d'ailleurs de très bons résultats, et remporte 25 % des suffrages lors des législatives de 1958[562].
En France

En France, le Parti communiste français réalise une percée historique aux élections de 1945 et atteint son apogée à celles de novembre 1946, où il remporte 28,3 % des suffrages. Les effectifs du parti, devenu en nombre de voix le premier de France, sont en pleine explosion au début de la Quatrième République : le PCF s'implante très fortement dans le monde ouvrier, dans le monde rural et dans le monde intellectuel. Ses bastions d'avant-guerre se renforcent : le Parti est particulièrement présent dans le Nord, la région parisienne - où les mairies communistes constituent une « ceinture rouge » autour de la capitale - le Centre et le Sud-Est. Si la revendication du PCF d'être devenu le « parti de l'intelligence » est exagérée, il n'en exerce pas moins un magistère considérable dans les milieux intellectuels, s'implantant notamment dans les écoles normales supérieures. Les communistes acquièrent de nombreux « compagnons de route », ou simplement de sympathisants, en la personne d'intellectuels prestigieux, dont l'existentialiste Jean-Paul Sartre[569]. Le poids des communistes français dans la vie intellectuelle est particulièrement fort et lorsque le livre du dissident soviétique Victor Kravtchenko, J'ai choisi la liberté, paraît en France, il fait l'objet d'une violente campagne de dénigrement : Kravtchenko finit par attaquer en diffamation le journal communiste Les Lettres françaises et gagne son procès en 1949[561].
Le PCF participe au gouvernement de coalition d'après-guerre mais la situation intérieure se tend bientôt, notamment du fait du contexte international, dont la guerre d'Indochine. L'expérience gouvernementale du PCF prend fin en octobre 1947 quand ils sont exclus du deuxième gouvernement Paul Ramadier. Les espoirs du PCF de revenir au pouvoir sont bientôt déçus et le Parti est renvoyé dans l'opposition pour des décennies, tout en restant très bien implanté sur le plan électoral. En 1947, la CGT participe à une série de grèves insurrectionnelles, lancées à l'origine à la régie Renault par des trotskystes ; de nombreuses autres actions de grève ont lieu l'année suivante. À partir de 1947, le Parti entreprend de resserrer son organisation pour gagner en efficacité : les effectifs militants diminuent ensuite nettement. Les communistes français usent par ailleurs de l'argument pacifiste en lançant en 1950 le Mouvement de la paix : avec l'« appel de Stockholm », pétition lancée par le Conseil mondial de la paix pour réclamer l'interdiction de l'arme atomique, les communistes s'approprient en partie, en France et ailleurs, la thématique pacifiste[570].
Au sein du PCF le culte de la personnalité de Maurice Thorez atteint son apogée à la fin des années 1940. Dans le même temps, l'appareil fait l'objet de purges : en 1950, 14 membres titulaires du comité central sont écartés. Des compagnons de route comme Vercors ou des intellectuels membres du parti comme Edgar Morin ou Marguerite Duras s'en éloignent, du fait de son raidissement stalinien et de la répression au sein du Bloc de l'Est. En 1952, alors que Maurice Thorez, malade, est soigné à Moscou, son entourage élimine ses rivaux André Marty et Charles Tillon. Ces derniers, soumis à des attaques politiques d'une rare violence, sont évincés de la direction, Marty finissant par être exclu du parti[571],[561].
En Italie

En Italie, le Parti communiste italien, dirigé par Palmiro Togliatti, retire une aura très importante de sa participation à la résistance contre l'occupant allemand et les fascistes en 1943-45. En 1946, le nombre de ses adhérents dépasse deux millions, en comptant les Jeunesses communistes. Le PCI participe jusqu'en mai 1947 au gouvernement de coalition issu de la guerre, mais en est ensuite évincé sous la pression des États-Unis[572].
Dépassé lors des élections générales de 1946 par le Parti socialiste italien, il s'allie ensuite à celui-ci au sein du Front démocratique populaire, sous les couleurs desquelles il affronte la Démocratie chrétienne d'Alcide De Gasperi lors des élections générales de 1948. Le Front démocratique populaire dépasse 30 % des suffrages mais est largement battu par la DC, qui devient le parti hégémonique de gouvernement en Italie. Rejeté dans l'opposition au niveau national, le PCI est néanmoins devenu largement dominant au sein de la gauche italienne. Tout en conservant sa rhétorique révolutionnaire, il joue le jeu des institutions démocratiques et évite les débordements : lorsque Togliatti est blessé dans un attentat en , l'Italie connaît des grèves massives et des émeutes quasi insurrectionnelles. Les dirigeants des syndicats communistes et du PCI, ainsi que Togliatti lui-même depuis son lit d'hôpital, lancent cependant des appels à l'apaisement et mettent un terme au mouvement. Des bordiguistes animent un Parti communiste internationaliste, mais les disciples italiens de Bordiga ne sont pas en mesure de rivaliser avec le PCI et demeurent insignifiants sur le plan électoral. Togliatti, ayant totalement rompu avec la notion de parti d'avant-garde des premières années du communisme italien, conçoit désormais le PCI comme un parti de masse, cette condition étant obligatoire pour rivaliser avec la DC : le Parti acquiert également un fort rayonnement dans les milieux culturels italiens, touchant notamment les écrivains et les cinéastes. La Confédération générale italienne du travail, la plus importante centrale syndicale italienne, est majoritairement communiste. Le PCI demeure, pour le reste de son histoire, le deuxième parti italien après la DC : implanté dans tout le pays, il dispose notamment de bastions en Émilie-Romagne, en Toscane et en Ombrie, où il exerce une véritable hégémonie politique[573],[574].
En Finlande
Au sortir de la guerre, l'URSS n'a pas tenté de faire de la Finlande un pays communiste, et s'est contentée de s'en assurer la neutralité. Les Soviétiques ont néanmoins obtenu la légalisation du Parti communiste de Finlande. Le PC finlandais participe au gouvernement jusqu'en 1948, année où il se présente aux élections législatives sous les couleurs de la Ligue démocratique du peuple finlandais, une coalition regroupant les forces situées à gauche du Parti social-démocrate. Relégué dans l'opposition après sa défaite, le Parti communiste de Finlande continue de développer une culture politique ouvriériste qui lui permet de conserver de solides positions électorales : en 1958, la Ligue démocratique remporte 23,3 % des suffrages, ce qui lui permet de constituer le groupe parlementaire le plus important à la Diète nationale[561].
Si Juho Kusti Paasikivi (Parti de la Coalition nationale), président de la Finlande de 1946 à 1956, se conforme au principe de neutralité, son successeur, Urho Kekkonen (Parti du centre), chef du gouvernement à partir de 1950 puis président de la République de 1956 à 1982, fait le choix d'une politique d'amitié de plus en plus marquée avec l'URSS. Cette ligne donne naissance, dans les années 1970, à l'expression « finlandisation », qui désigne le fait, pour un pays, de se soumettre peu ou prou aux intérêts d'un voisin plus puissant[575].
En RFA
En Allemagne de l'Ouest, le Parti communiste d'Allemagne (KPD) continue d'exister indépendamment du SED est-allemand, avec qui il se dit lié au sein d'une « communauté de travail socialiste »[576]. Ses effectifs et ses résultats électoraux déclinent rapidement au début de la guerre froide : s'il attire encore 5,7 % des voix en 1949, il tombe à 2,2 % en 1953 et perd sa représentation parlementaire. En 1956, il est interdit par le Tribunal constitutionnel fédéral, qui juge que ses buts sont incompatibles avec le maintien d'une constitution démocratique. Une partie de ses dirigeants passe à l'Est ; des militants — environ 7 000 aux alentours de 1960 — continuent d'animer à l'Ouest un KPD clandestin[562],[577]. Ce n'est qu'en 1968 qu'un nouveau parti, le Parti communiste allemand (DKP) réapparaît en Allemagne de l'Ouest, les autorités s'abstenant cette fois de le dissoudre dans le contexte de la détente[578] : malgré le soutien de la RDA qui lui permet d'avoir une visibilité certaine, ce nouveau parti demeure au stade du groupuscule[579].
En Autriche
Du fait notamment de la présence des Soviétiques parmi les forces d'occupation, le Parti communiste d'Autriche (KPÖ) participe au gouvernement de coalition de l'immédiat après-guerre. Mais, aux élections de , les communistes ne remportent que 5 % des voix. Ils quittent le gouvernement deux ans plus tard. En 1950, une tentative de grève générale, qui fait alors craindre un coup d'État communiste, renforce l'anticommunisme en Autriche et contribue à réduire l'influence du PC local. Le retrait des troupes d'occupation soviétiques en 1955, puis l'insurrection de Budapest l'année suivante, affaiblissent encore le KPÖ, qui perd en 1959 ses derniers élus au parlement[580].
En Belgique
Le Parti communiste de Belgique est, comme la plupart des PC ouest-européens, très affaibli par le début de la guerre froide, la rupture de son alliance avec le Parti socialiste contribuant encore à son isolement. Il perd une partie de ses militants et la plupart de ses élus au parlement fédéral. En 1950, son président, Julien Lahaut, est assassiné par des inconnus. Des conflits internes au parti entraînent ensuite, en 1954, la destitution de l'ensemble du bureau politique. La nouvelle direction, moins radicale que la précédente, est favorable à un retour à l'alliance avec les socialistes, mais l'influence du PCB n'en continue pas moins à décliner : le parti passe de 12,7 % des suffrages en 1946 à 3,6 % en 1954. Il ne compte alors plus que deux députés fédéraux[581],[562].
Au Royaume-Uni
Le Parti communiste de Grande-Bretagne (CPGB), dirigé par Harry Pollitt, est dans une situation particulière du fait de ses relations avec les travaillistes et avec les syndicats : lors des élections de 1945, privilégiant toujours la bonne entente avec le Labour, il ne présente qu'un nombre réduit de candidats pour ne pas gêner celui-ci. Lors du scrutin de 1950, qui a lieu après la création du Kominform, les communistes s'opposent au contraire frontalement aux travaillistes : ils présentent cinq fois plus de candidats, mais attirent cinq fois moins d'électeurs qu'en 1945. Cette stratégie ayant mis les syndicalistes communistes en porte-à-faux vis-à-vis de leurs alliés travaillistes et le début de la guerre froide lui ayant fait perdre de nombreux militants, le CPGB décide de changer à nouveau d'orientation : avec l'accord des Soviétiques, il abandonne les revendications révolutionnaires pour se concentrer sur le combat syndical et prôner une « voie britannique vers le socialisme ». Il présente peu de candidats lors du scrutin anticipé de 1951, sans pouvoir cependant empêcher la défaite du Labour[582],[583].
En Suisse
Les communistes suisses, pour remplacer leur ancien parti interdit en 1940, fondent en 1944 le Parti suisse du Travail. En 1945, l'interdiction des organisations communistes est levée, ce qui permet au nouveau parti de se présenter ouvertement comme le successeur du Parti communiste suisse. Le Parti du Travail connaît initialement, comme son prédécesseur, un certain succès auprès de l'électorat ouvrier : il remporte son score le plus élevé en 1947, avec 5,1 % des suffrages. Dès le début de la guerre froide, cependant, il perd plus de la moitié de ses électeurs. La direction du Parti connaît en outre des remous : son secrétaire général Karl Hofmaier en 1947, puis son président Léon Nicole en 1952, sont évincés et remplacés par des dirigeants jugés plus soumis aux consignes de l'URSS[584].
À Saint-Marin
À Saint-Marin, micro-État enclavé dans le territoire de l'Italie — et par conséquent très influencé par le contexte politique italien — le Parti communiste saint-marinais gouverne avec le parti socialiste local, après que leur coalition a remporté les élections de . Le pays connait alors des tensions avec le gouvernement démocrate-chrétien italien. En 1957, l'entrée en dissidence de plusieurs élus socialistes au Grand Conseil général met la coalition au pouvoir en minorité. Communistes et socialistes présentent alors en bloc la démission de leurs conseillers - parmi lesquels les dissidents, sans l'accord de ces derniers - dans le but de provoquer de nouvelles élections : une crise éclate entre l'opposition, qui dénonce une partie des démissions comme illégitimes et proclame un gouvernement provisoire, et les Capitaines-régents, qui refusent de reconnaître ce gouvernement. L'intervention des carabiniers italiens permet de ramener le calme à Saint-Marin et les Capitaines-régents reconnaissent finalement le gouvernement non communiste. La nouvelle majorité est ensuite confirmée lors des élections de 1959[585].
Aux États-Unis

Aux États-Unis, le secrétaire du Parti communiste USA, Earl Browder, se permet de manifester son indépendance en prônant une voie réformiste et la coexistence pacifique du capitalisme et du socialisme : le Français Jacques Duclos est chargé en 1945 de condamner la ligne de Browder, qui est ensuite exclu de son propre parti. Dans les années suivantes, alors que les États-Unis connaissent un renouveau de la « peur rouge », le CPUSA est quasiment réduit à néant par le climat de guerre froide : il ne compte plus que trois mille membres en 1957. Les dirigeants du parti communiste américain sont arrêtés en 1948 et condamnés à des peines de prison pour incitation au renversement du gouvernement et « conspiration » en ce sens. Le McCarran Internal Security Act sur les « activités subversives », adopté en 1950, permet ensuite de poursuivre le PC américain en tant qu'« instrument de l'étranger »[586],[587].
Joseph McCarthy, sénateur du Wisconsin, mène une violente campagne dénonçant les infiltrations communistes au sein du gouvernement, des médias et des milieux culturels. Ses accusations, souvent excessives et abusives, contribuent à susciter aux États-Unis un climat de très vif anticommunisme : de nombreuses personnalités sont amenées à être interrogées par le Comité des activités anti-américaines de la Chambre des représentants. La période dite du maccarthysme s'accompagne de certaines affaires retentissantes comme celle de la condamnation à mort des époux Rosenberg pour espionnage au profit de l'URSS. McCarthy lui-même est finalement discrédité après avoir été condamné par le Sénat pour abus de pouvoir ; néanmoins, les idées communistes sont totalement marginalisées aux États-Unis. Les notions mêmes de socialisme, voire de libéralisme politique, deviennent suspectes aux yeux d'une part importante de l'opinion américaine. Même après la fin du maccarthysme, le CPUSA reste confiné dans la marginalité, son soutien inconditionnel à la politique soviétique achevant de le discréditer au cours des décennies suivantes[586],[587].
En Amérique latine

En Amérique latine, les partis communistes ont acquis au fil des années dans plusieurs pays, comme le Chili, Cuba, le Brésil, l'Uruguay, le Venezuela et le Guatemala, une véritable base ouvrière et populaire, qui leur confère une influence syndicale et électorale. Les PC existent dans un contexte politique fortement empreint de nationalisme et de populisme qui leur impose diverses adaptations et constitue parfois un obstacle à leur développement, notamment au Mexique où le PC ne parvient pas à se développer. Les États-Unis, très influents dans cette région du monde, pèsent également sur la politique répressive des gouvernements locaux à l'encontre des communistes[588].
Si la ligne stalinienne domine largement et est suivie par les PC latino-américains sans originalité particulière, des organisations trotskystes existent également, dont certains acquièrent une vraie influence comme le Parti ouvrier révolutionnaire en Bolivie[589]. En Argentine, le Parti communiste peut, après la chute de Juan Perón, bénéficier de son opposition à ce dernier pour gagner en audience dans les milieux universitaires et syndicaux. Cependant, ses structures militantes restent ensuite languissantes, le péronisme demeurant le principal vecteur de contestation. Le Parti communiste brésilien est légalisé en 1945 : en s'opposant au pouvoir des grands propriétaires fonciers et des hommes d'affaires et en suivant la ligne de Luís Carlos Prestes, il parvient à augmenter rapidement le nombre de ses adhérents, qui passe de 4000 à 200 000 entre 1945 et . En , le gouvernement réagit et le PCB est interdit. Il continue ensuite d'exister clandestinement durant la décennie suivante en misant sur la démocratisation de la société brésilienne, mais le coup d'État de 1964, qui met en place la dictature militaire, vient ruiner ses plans. L'échec de la stratégie de Prestes entraîne la scission du parti en de multiples tendances[588]. Le Parti communiste du Chili est interdit en 1948[403] ; à nouveau légalisé dix ans plus tard, reprend une politique d'alliance avec le Parti socialiste du Chili au sein du Front d'Action Populaire (FRAP). Le socialiste Salvador Allende est le candidat malheureux de l'alliance PS-PC à l'élection présidentielle de 1958[590]. Le Parti communiste du Venezuela rejoint en 1958 la coalition de Rómulo Betancourt, lors du retour de ce dernier au pouvoir[591].
Globalement, l'URSS se montre très prudente dans son implication en Amérique latine, jugeant que la pénétration des préceptes marxistes, malgré l'influence des PC et de certains groupes chrétiens progressistes, y est encore trop faible pour susciter des mouvements de masse. C'est contre l'avis des Soviétiques, qui jugent la coalition trop fragile, que le Parti guatémaltèque du travail s'allie au gouvernement de Jacobo Arbenz ; Arbenz est d'ailleurs renversé en 1954 lors d'un coup d'État, que la CIA organise pour s'opposer à la diffusion du communisme en Amérique centrale[592].
À Cuba, où Fulgencio Batista est revenu au pouvoir en 1952 via un coup d'État, le Parti socialiste populaire, le PC cubain, se trouve désormais dans l'opposition. Le , des insurgés, conduits notamment par Fidel Castro et son frère Raúl, attaquent la caserne de Moncada. Si Raúl Castro est membre de l'organisation de jeunesse du PSP, Fidel Castro n'a alors guère de liens avec les communistes. L'attaque échoue totalement et débouche sur la mort d'une grande partie des assaillants ; Fidel et Raúl Castro sont emprisonnés. L'attitude de Fidel Castro durant son procès le rend ensuite célèbre dans tout le pays. Batista profite de cet épisode pour faire dissoudre le Parti socialiste populaire, qui n'était pour rien dans l'affaire. En 1955, le président cubain commet l'erreur de promulguer une amnistie : les frères Castro, libérés, se rendent au Mexique où ils entreprennent de réorganiser leur groupe, désormais baptisé Mouvement du 26-Juillet, pour reprendre la lutte armée. Fidel Castro ne semble pas avoir eu à l'époque d'idéologie clairement définie ; il fait cependant différentes rencontres dans les rangs communistes. Dont celle, importante pour la suite, d'un militant communiste argentin, Ernesto « Che » Guevara, qui rejoint aussitôt le combat des révolutionnaires cubains[593],[594]. À l'époque, Fidel Castro lui-même, interrogé par la presse mexicaine, nie vivement être communiste[595].
Victoire des communistes en Chine

La Chine est, au sortir de la guerre mondiale, dans une situation économique et politique critique. La tension entre nationalistes et communistes étant à nouveau à son maximum, les États-Unis tentent une médiation et organisent à partir d' des pourparlers à Chongqing, réunissant Tchang Kaï-chek et Mao Zedong : les deux dirigeants chinois annoncent les principes d'une coopération. Le général George Marshall, nommé ambassadeur des États-Unis en Chine, fait son possible pour obtenir la formation d'un gouvernement de coalition. Le gouvernement nationaliste de Tchang Kaï-chek gère l'économie du pays, ruinée par le conflit, de manière désastreuse : le retour des troupes nationalistes dans les villes libérées des Japonais s'accompagne de réquisitions et d'impôts qui aggravent la situation des populations, dans un contexte de chômage massif en milieu urbain et de famines dans certaines régions. Entretemps, les communistes mobilisent à leur profit la paysannerie de la Chine du Nord, via des promesses de réforme agraire. Dès la fin des pourparlers de paix, la lutte pour le contrôle territorial de la Chine reprend de plus belle, et débouche en 1946 sur une reprise ouverte de la guerre civile chinoise. Tchang, qui bénéficie d'un soutien financier massif de la part des Américains, commet l'erreur de concentrer l'essentiel de ses forces dans les grandes villes, ce qui l'oblige à étirer démesurément ses troupes pour affronter les communistes ; ces derniers mènent essentiellement des actions de guérilla et n'attaquent ouvertement les unités du Kuomintang que quand ils sont sûrs de pouvoir les écraser. Les nationalistes prennent la place-forte communiste de Yan'an mais dans le courant de 1947, les communistes réalisent une contre-attaque. Dans le Nord-est, le général communiste Lin Biao mène une guerre de mouvement qui aboutit à isoler les nationalistes dans les villes qu'ils tiennent. Dans le Nord et le Nord-est, les communistes remportent la victoire en s'appuyant notamment sur la mobilisation des campagnes, via l'endoctrinement de la population et les avantages apportés par la réforme agraire. Le dispositif nationaliste s'effondre également en Chine centrale. À mesure que les combats progressent, les communistes parviennent de plus en plus souvent à mettre la main sur le matériel militaire américain et à enrôler dans leur Armée populaire de libération de nombreux militaires nationalistes. Marshall, nommé Secrétaire d'État, dissuade les États-Unis d'intervenir. En janvier 1949, Pékin est encerclée et le gouverneur nationaliste se rend avec toutes ses troupes. Le gouvernement nationaliste se réfugie sur l'île de Taïwan, où se maintient l'État de la République de Chine, qui conserve le siège de la Chine à l'ONU[596]. Le 1er octobre 1949, Mao Zedong proclame la République populaire de Chine. Mao devient chef de l'État et Zhou Enlai premier ministre ; le nouveau régime contrôle toute la Chine à l'exception temporaire du Yunnan et du Xinjiang, ainsi que du Tibet qui échappe au contrôle chinois depuis 1912[597].
Les Soviétiques font initialement preuve de peu d'enthousiasme face aux succès des communistes chinois, dont ils ne saluent la victoire qu'une fois les combats définitivement achevés. Ce n'est qu'après deux mois de longues et laborieuses négociations que l'URSS et la République populaire de Chine signent, le , un traité d'amitié, d'alliance et d'assistance mutuelle valable pour trente ans. L'URSS se montre circonspecte envers son nouvel allié, le traité semblant surtout motivé par l'hostilité commune envers les États-Unis[598]. Mao retire une très mauvaise impression du voyage qu'il effectue en URSS pour les besoins de la signature du pacte et apprécie peu l'attitude condescendante des Soviétiques à son égard ; l'appui de l'Union soviétique lui est néanmoins encore indispensable pour rebâtir la Chine[599]. L'alliance n'en produit pas moins une grande impression en Occident, où l'on parle à l'époque de « bloc sino-soviétique »[600]. En outre, la naissance du régime communiste chinois bouleverse les équilibres géopolitiques de la région et influe de manière décisive sur les conflits en Corée et en Indochine française[599].
Premières années du régime maoïste


En République populaire de Chine, des campagnes contre la corruption et les « ennemis de l'État » sont menées : le nouveau régime met en œuvre une vaste épuration des cadres et partisans du Kuomintang, tandis que la réforme agraire détruit les élites villageoises. Des millions d'« ennemis du peuple » sont envoyés dans des camps. En 1951, l'épuration devient plus vigoureuse encore ; la campagne des « Trois Anti » pourchasse la corruption, le gaspillage et le « bureaucratisme » et purge les cadres hérités de l'ancien régime. En réussissant à restaurer l'ordre, le régime communiste parvient à rendre à l'économie chinoise un cours normal, pour la première fois depuis très longtemps. La politique menée par Mao Zedong s'inspire de celle de l'URSS jusqu'au milieu des années 1950 : un plan quinquennal vise le doublement de la production industrielle et l'augmentation de 25 % de la production agricole. Entre 1953 et 1955, le gouvernement chinois suit trois axes destinés à parfaire la « soviétisation » de la Chine : le renforcement du pouvoir du Parti, la collectivisation de l'agriculture, et l'industrialisation[601]. À la fin de 1956, la totalité des 120 millions de familles rurales chinoises est insérée dans le réseau des coopératives agricoles[602]. L'éducation est développée : le nombre d'enfants inscrits à l'école primaire passe de 24 millions en 1949 à 64 millions en 1957, et le nombre de Chinois suivant des études supérieures est multiplié par deux, sans que les grandes différences entre le milieu urbain et le monde rural soient pour autant résorbées[603].
En février-, alors que la guerre civile chinoise n'est pas encore terminée, des délégués chinois assistent à Calcutta à une conférence des « jeunes étudiants d'Asie du Sud-Est combattant pour la liberté et l'indépendance », puis au congrès du Parti communiste d'Inde, où ils lient la « campagne de libération des Chinois » au « mouvement de libération des peuples d'Asie du Sud-Est ». Sur le plan international, la Chine intervient ensuite directement pour défendre la « révolution », dans le cadre de la guerre de Corée et de la guerre d'Indochine ; elle tente d'exporter plus avant le communisme en Asie en soutenant les rébellions en Malaisie, aux Philippines et en Birmanie, influençant également les partis communistes indien et indonésien. Les efforts de la République populaire de Chine pour exporter son modèle n'obtiennent cependant guère de résultats positifs : en Thaïlande, les Chinois incitent le Parti communiste thaïlandais à prendre les armes, mais la tentative d'insurrection échoue totalement et n'aboutit qu'à l'interdiction du parti thaïlandais. Le régime maoïste sous-estime globalement la résistance des dirigeants nationalistes asiatiques, qui ont obtenu l'indépendance de leurs pays en dehors de toute révolution communiste. La Chine renonce par ailleurs définitivement à annexer la Mongolie-extérieure, la République populaire mongole étant soutenue par l'URSS[604].
La République populaire de Chine, qui continue à ne pas être représentée à l'ONU, réussit ensuite, dans les années 1950, une percée diplomatique en participant à la conférence de Bandung et en nouant des contacts diplomatiques avec divers pays asiatiques, dont notamment l'Inde, puis avec des pays africains, à commencer par l'Égypte de Nasser. Un traité commercial est conclu avec le Japon, qui ne reconnaît pas pour autant le gouvernement de Mao[605].
La République populaire de Chine parvient par ailleurs à reprendre le contrôle du Tibet dès : le territoire tibétain est envahi par 84 000 soldats chinois et, en mai 1951, les représentants du 14e dalaï-lama à Pékin doivent signer l'accord en 17 points sur la libération pacifique du Tibet, qui reconnaît le bien-fondé de l'intervention chinoise et la souveraineté de la Chine sur le Tibet. En 1959, le soulèvement tibétain est écrasé par une répression qui fait entre 2 000 et 20 000 morts ; le dalaï-lama se réfugie en Inde pour y animer un gouvernement en exil. En 1965, l'administration du Tibet est réorganisée, pour former la région autonome du Tibet[606].
La guerre de Corée

.jpg.webp)
Dans le Nord de la Corée libérée des Japonais, les occupants soviétiques soutiennent en février 1946 la formation d'un gouvernement provisoire, sous les auspices d'un front uni dominé par les communistes coréens. Kim Il-sung, un militant tout juste revenu de plusieurs années d'exil en URSS, en prend la tête. Un nouveau parti communiste, le Parti du travail de Corée, est créé. Si Kim Il-sung est entièrement redevable aux Soviétiques de son accession au pouvoir, il parvient ensuite à manœuvrer efficacement pour imposer son autorité, face aux autres factions communistes qui comprennent les Coréens demeurés au pays durant l'occupation japonaise et le « groupe de Yenan » proche des Chinois. Les Soviétiques laissent de surcroît aux Coréens une large autonomie dans la gestion de leurs affaires intérieures[607]. En 1948, deux semaines après la proclamation officielle au Sud de la République de Corée, les communistes proclament la République populaire démocratique de Corée (dite plus couramment Corée du Nord) qui dispute aussitôt la souveraineté à l'autre État coréen. Kim Il-sung parvient à convaincre Staline de l'opportunité d'une incursion militaire au Sud, afin de réunifier toute la Corée sous la bannière communiste[608]. Staline ne croit initialement pas à l'intervention des États-Unis après leur « lâchage » de Tchang Kaï-chek et désire concurrencer Mao en Asie[513] : en juin 1950, la Corée du Nord attaque la Corée du Sud, déclenchant la guerre de Corée. Profitant de l'absence temporaire de l'URSS des instances de l'ONU — l'État soviétique s'est en effet retiré pour protester contre la non-reconnaissance de la République populaire de Chine — les Nations Unies autorisent l'intervention d'une force militaire, largement dominée par les États-Unis, pour défendre le Sud[513].
L'avancée des troupes nord-coréennes, qui avaient pris Séoul, est stoppée net par la force d'intervention des Nations unies commandée par le général Douglas MacArthur, qui les repousse vers le Nord, reprend Séoul et s'empare de Pyongyang. Staline convainc alors Mao d'intervenir dans le conflit coréen. Trois millions de soldats chinois, commandés par Peng Dehuai et présentés officiellement comme une « Armée de volontaires », franchissent la frontière nord-coréenne pour venir au secours de Kim Il-sung. L'URSS n'intervient pas officiellement, mais équipe les troupes chinoises et nord-coréennes[608]. Chinois et Nord-Coréens repoussent les forces de l'ONU vers le Sud et prennent une nouvelle fois temporairement Séoul. La guerre de Corée menace le monde du déclenchement d'une Troisième Guerre mondiale, mais le président américain Harry Truman repousse la requête de MacArthur, qui souhaitait l'emploi de l'arme atomique[609]. La Chine paie un lourd tribut au conflit — plus de 800 000 soldats tués, dont le fils de Mao Zedong — mais elle y gagne la modernisation de son armée et le renforcement de la cohésion du Parti communiste dans la lutte contre l'« ennemi numéro un du peuple chinois », ainsi que le maintien d'un régime ami à sa frontière. Après une contre-attaque des Nations unies en 1951, les troupes communistes sont à nouveau repoussées au Nord. La ligne des combats se stabilise et l'URSS contribue rapidement à des ouvertures diplomatiques pour régler le conflit. L'armistice de Panmunjeom, en juillet 1953, met un terme à la guerre et scelle la division de la Corée, dont le Nord et le Sud sont désormais séparés par la zone coréenne démilitarisée[610]. La guerre de Corée marque un tournant dans la guerre froide, de par le refus des Américains de recourir à l'arme nucléaire, dont l'emploi est considéré comme trop risqué ; elle entraîne également un renforcement de la cohésion du monde occidental et de l'atlantisme, ce que Staline n'avait pas prévu[611].
De la guerre d'Indochine à la guerre du Viêt Nam
.svg.png.webp)
En Indochine française, le Corps expéditionnaire français en Extrême-Orient commandé par le général Leclerc débarque en octobre 1945, plusieurs semaines après les Britanniques et les Chinois, et reprend progressivement le contrôle de la colonie. Au Nord, le gouvernement indépendantiste, où le Việt Minh est allié au VNQDD et à d'autres forces non communistes, tente péniblement de nourrir la population et de gérer les affaires courantes, mais annonce une série de mesures sociales, dont une réforme agraire. En novembre, le Parti communiste indochinois proclame, afin de rassurer les partenaires du Việt Minh, son autodissolution : dans les faits, les responsables du Parti officiellement disparu continuent de contrôler la ligue Việt Minh. En mars 1946, les accords Hô-Sainteny conclus par Hô Chi Minh avec le commissaire du GPRF Jean Sainteny, prévoient la reconnaissance par la France d'un État vietnamien au sein de l'Union française. Le 18 mars, Leclerc peut rentrer dans Hanoï[612]. Mais la conférence de Fontainebleau, prévue par les accords et qui se tient à l'été 1946, tourne ensuite à vide. Un modus vivendi franco-vietnamien prévoit de reprendre les pourparlers au plus tard en janvier 1947, après l'entrée en vigueur de la constitution de la Quatrième République. En novembre 1946, l'armée française bombarde le port de Haiphong. Si Hô Chi Minh continue ensuite de se montrer officiellement conciliant, Võ Nguyên Giáp, chef militaire du Việt Minh, prépare l'Armée populaire vietnamienne au combat. Le 19 décembre, le Việt Minh tente un coup de force dans l'ensemble du territoire vietnamien, échouant malgré des combats très âpres à Hanoï, mais détruisant une partie de l'administration française, ainsi qu'une partie des infrastructures et certaines petites villes coloniales. Le gouvernement indépendantiste prend le maquis, déclenchant la guerre d'Indochine[613].

L'insurrection communiste est, dans le contexte vietnamien, totalement identifiée à une lutte nationaliste et indépendantiste, ce qui permet à Hô Chi Minh d'apparaître par la suite, dans le contexte de la décolonisation, comme un symbole du tiers-monde émergent[614]. La France accorde un statut de semi-autonomie au Laos et au Cambodge et suscite la création d'une entité politique vietnamienne unifiée, l'État du Viêt Nam, dirigé par l'ex-empereur Bảo Đại. La guerre d'Indochine est, initialement, surtout une guerre vietnamienne : des mouvements indépendantistes laotiens et cambodgiens existent, mais demeurent très faibles par rapport au Việt Minh[615]. Avec la proclamation du régime communiste chinois, le Việt Minh gagne une importante base arrière[616]. La guerre d'Indochine s'affirme comme un front de la Guerre froide, alors qu'en France métropolitaine le PCF mène campagne contre le conflit, avec l'appui de ses nombreux compagnons de route. Le Việt Minh reçoit l'aide logistique de la République populaire de Chine qui lui fournit d'importants stocks d'armes, tandis que les Français, qui s'efforcent de « vietnamiser » le conflit en mettant sur pied l'Armée nationale vietnamienne, reçoivent celle des États-Unis. Le Việt Minh réorganise et contrôle la guérilla laotienne du Pathet Lao et celle, cambodgienne, des Khmers issarak : le chef du Pathet Lao, le prince Souphanouvong (membre de la famille princière de Vientiane) a passé une partie de sa vie en territoire vietnamien et a avec le Việt Minh des liens de longue date ; Son Ngoc Minh, dirigeant politique des Khmers issarak, est un métis khmero-vietnamien, recruté par le Việt Minh et dont une partie des troupes est issue de la population viêt du Cambodge ou de Vietnamiens expatriés[617]. Le Việt Minh décide de créer pour chaque territoire de l'Indochine française un parti communiste chargé de structurer politiquement la lutte indépendantiste, tout en exprimant une identité nationale spécifique[618]. En février 1951, un congrès redonne officiellement naissance à l'ancien Parti communiste indochinois, sous le nom de Parti des travailleurs du Viêt Nam : les insurgés vietnamiens affichent désormais ouvertement leurs couleurs communistes. Lê Duẩn, un communiste orthodoxe, devient le bras droit de Hô Chi Minh au sein de la nouvelle formation. La création des « partis frères » laotien et cambodgien est annoncée[619]. Un PC cambodgien, le Parti révolutionnaire du peuple khmer, est créé en août 1951 ; le manque de cadres communistes laotiens qualifiés est par contre si criant que le Parti du peuple lao n'est officiellement créé qu'en 1955, après la fin de la guerre d'Indochine[618]. En avril 1953, l'Armée populaire vietnamienne, avec le concours du Pathet lao, réalise une percée en territoire laotien, entraînant pleinement le Laos dans la guerre ; les communistes laotiens prennent le contrôle d'une zone étendue[620]. Au Cambodge, dans une moindre mesure, les Khmers issarak gagnent également du terrain avec le soutien des communistes vietnamiens[621]. La situation s'avère de plus en plus insoluble sur les plans militaire et politique et, dès 1953, la France envisage une « sortie honorable » d'Indochine[622].
En février 1954, un cadre est fixé pour des discussions diplomatiques, qui doivent se tenir à Genève ; Võ Nguyên Giáp, qui a reçu une aide accrue de la Chine, décide alors de prendre coûte que coûte la base de Ðiện Biên Phủ pour être en position de force au moment des négociations. La bataille de Diên Biên Phu, qui dure près de deux mois, s'achève par la victoire de l'Armée populaire vietnamienne la veille de la date où la conférence de Genève doit commencer à aborder la question indochinoise, ce qui constitue pour la France un désastre à la fois militaire et politique. Pierre Mendès France, nommé chef du gouvernement français durant la tenue de la conférence, obtient la signature des accords de Genève, qui permettent à la France de sortir du conflit tout en mettant un terme à l'Indochine française. Le Viêt Nam est provisoirement coupé en deux, en attendant des élections qui doivent théoriquement conduire à la réunification du pays : le Nord est dévolu à la République démocratique du Viêt Nam (ou Nord Viêt Nam), dont Hô Chi Minh est le président et Phạm Văn Đồng le premier ministre ; le Sud du pays revient à l'État du Viêt Nam dirigé par Bảo Đại. Le Royaume du Laos doit, en vertu des accords, entamer des pourparlers avec le Pathet lao. Le Royaume du Cambodge, où le roi Norodom Sihanouk a obtenu l'indépendance dès la fin 1953, évite quant à lui d'avoir à faire des concessions aux Khmers issarak, qui doivent déposer les armes ou quitter le pays. L'organisation communiste clandestine continue cependant d'exister au Cambodge. Les Vietnamiens ayant 300 jours pour opter entre les deux zones, plusieurs centaines de milliers de réfugiés affluent du Nord vers le Sud. Les États-Unis, désireux de contenir l'avancée du communisme dans la région, intensifient leur présence en Asie du Sud-Est et remplacent rapidement les derniers conseillers français au Sud Viêt Nam. Avec la division du Viêt Nam et l'arrivée des Américains, le contexte de la guerre du Viêt Nam se met en place[623].
Au Nord Viêt Nam, la réforme agraire est mise en place dès la victoire militaire de 1954. Les élites traditionnelles des campagnes, qui avaient pourtant soutenu assez massivement le Việt Minh, sont soumises à une purge à grande échelle, avec des méthodes délibérément meurtrières : la réforme agraire donne lieu à environ 15000 exécutions et 20 000 arrestations. Le Parti des travailleurs du Viêt Nam fait l'objet d'une épuration massive, qui se déroule de manière à peu près simultanée à la « rectification » du monde rural. La politique menée par le régime entraîne en 1956 une insurrection, que Hô Chi Minh fait réprimer par la troupe. La commission internationale chargée de veiller à l'application des accords de Genève, qui comprend des délégués indiens et polonais sympathisants communistes, ne s'intéresse guère à l'épisode. Le gouvernement nord-vietnamien doit finalement désavouer en partie sa propre politique ; Hô Chi Minh reconnaît les erreurs commises durant la réforme agraire, présente ses excuses au pays et fait sanctionner les responsables des « excès » : Trường Chinh, secrétaire général du Parti, est ainsi démis de ses fonctions. Le pays entreprend une industrialisation rapide, grâce à l'aide de l'URSS et de la Chine. La liberté d'expression y est sévèrement limitée et la démocratie inexistante : aucune élection n'a lieu avant 1960 et, quand le scrutin est convoqué, seuls des candidats approuvés par le Parti sont autorisés à se présenter. Parallèlement, au Sud, Ngô Đình Diệm évince Bảo Đại et fait proclamer la République du Viêt Nam, dont il devient le président. Refusant d'organiser les élections et le processus de réunification prévus par les accords, Diệm fait pourchasser et arrêter les communistes réels ou supposés[624],[625],[626].
Asie de l'Est et du Sud-Est

Dans l'immédiat après-guerre, d'autres insurrections communistes ont lieu dans plusieurs pays d'Extrême-Orient tout juste décolonisés : le Parti communiste de Birmanie lance un soulèvement contre le gouvernement birman, peu après l'indépendance du pays. Le Parti communiste indonésien (PKI), reformé par ses chefs revenus d'exil, participe à la révolution nationale indonésienne pour empêcher le retour des colonisateurs néerlandais. Il échoue cependant en 1948 en voulant lancer une insurrection à Java contre le leader nationaliste Soekarno : les communistes sont écrasés lors de l'« affaire de Madiun ». Aux Philippines, les Hukbalahap refusent de rendre leurs armes après la défaite des Japonais et lancent un soulèvement en 1946 : sur les conseils des Américains, le gouvernement philippin parvient à vaincre la rébellion, en alternant des mesures répressives avec une réforme agraire qui ôte aux communistes leurs arguments auprès de la population[627].

En Malaisie britannique, le Parti communiste malais reconstitue sa force armée du temps de la guerre, sous le nom d'armée de libération des peuples de Malaisie[498] et déclenche une insurrection en 1948. La guérilla communiste, combattue efficacement par les Britanniques, et dont le recrutement se limite pour l'essentiel aux Chinois de Malaisie, ne parvient cependant pas à déstabiliser sérieusement le pays. Le Royaume-Uni accorde en 1957 son indépendance à la Fédération de Malaisie, et le gouvernement malais triomphe ensuite de l'insurrection. Malgré les fortunes très diverses des insurrections nationales, les communistes sont parvenus à s'implanter durablement en Asie de l'Est et du Sud-Est[627].
La collectivisation agricole, progresse rapidement dans les pays communistes asiatiques, contrairement aux lenteurs en Europe de l'Est : outre les réformes agraires réalisées en Chine et au Nord Viêt Nam, la socialisation de l'agriculture est totalement achevée en Corée du Nord entre 1953 et 1958[602].
Dans divers pays d'Asie, les partis communistes parviennent à s'implanter par la voie des urnes. Le Parti communiste d'Inde (PCI) bénéficie de sa participation à la lutte pour l'indépendance, mais ne parvient pas à rivaliser au niveau national avec le Congrès national indien. En 1947, le PCI apporte son soutien à une insurrection paysanne dans les campagnes du Télangana (alors sur le territoire de l'Hyderabad) : le soulèvement est sévèrement réprimé en 1951 par le gouvernement indien, et le parti communiste est interdit en Hyderabad. Les communistes abandonnent alors leur stratégie de confrontation avec le gouvernement de Nehru et à la demande de l'URSS, se résolvent à jouer le jeu électoral. Bien que faible à l'échelle nationale, le PCI parvient à remporter des succès électoraux à l'échelle locale et régionale. En 1957, les communistes remportent les élections dans l'État du Kerala : le Parti communiste d'Inde est ainsi l'un des tout premiers au monde - le premier si l'on excepte le cas particulier de Saint-Marin - à accéder au pouvoir à l'issue d'un scrutin régulier[628],[247],[629]. Avec l'accord de l'URSS, les communistes indiens poursuivent une politique réformiste et modérée, leur programme de réforme agraire ressemblant beaucoup à celui de Nehru. Mais des tensions entre conservateurs et communistes font craindre des violences dans le Kerala : en 1959, Nehru en profite pour dissoudre le gouvernement[628]. Le Kerala demeure cependant, comme le Bengale, un bastion communiste[247]. Le PC indien entretient également l'agitation sociale dans le district de Thanjavur (Tamil Nadu), où il soutient les revendications des paysans intouchables[629].
Au Népal, un parti communiste clandestin est fondé en 1949. Autorisé en même temps que les autres partis politiques après la révolte de 1950, il est à nouveau interdit en 1952 après avoir tenté de renverser le gouvernement du Congrès. Il redevient légal quatre ans plus tard[630].
Le Parti communiste japonais obtient, lors des élections législatives de 1949, 10 % des suffrages et trente-cinq élus à la Diète, mais ses résultats électoraux déclinent ensuite rapidement[628],[631].
En Indonésie, le PKI, après l'échec de sa tentative d'insurrection contre Soekarno, rentre dans le jeu politique dans les années 1950. Il parvient à attirer un électorat croissant et un grand nombre de militants en adoptant une ligne moins révolutionnaire, et en se faisant le porte-parole des revendications des paysans pauvres. Les communistes aident Soekarno à déjouer un putsch de droite en 1958 et le président indonésien fait ensuite rentrer au gouvernement les leaders du Parti, Dipa Nusantara Aidit et Njoto. Les communistes s'emploient ensuite à influencer le président, notamment pour le pousser à appliquer la réforme agraire prévue par les lois de 1959-60. Au début des années 1960, le PKI, qui revendique plus de trois millions de membres, est le troisième parti communiste au monde, et le plus important de tous les pays non communistes[632].
Proche et Moyen-Orient
En Palestine mandataire, durant la Seconde Guerre mondiale, le Parti communiste palestinien se divise entre Juifs et Arabes, ces derniers formant la Ligue de libération nationale en Palestine. Les deux factions se réunissent à nouveau après la déclaration d'indépendance israélienne, et l'ancien PCP se rebaptise du nom de Maki[633]. L'URSS est, en 1948, le premier pays à reconnaître Israël, Staline jugeant à l'époque que le nouvel État juif pourrait devenir une tête de pont soviétique au Proche-Orient. Mais ces espoirs sont rapidement déçus du fait de l'alliance entre Israël et les États-Unis ; le camp communiste se convertit dès lors à l'antisionisme[634]. La détérioration des relations entre Israël et l'URSS contribue à affaiblir le Maki, qui attire dès lors davantage de Palestiniens que de Juifs. Le parti communiste s'oppose résolument à la politique intérieure et extérieure du gouvernement israélien, réclame le retour des réfugiés, s'emploie à défendre les droits de la population arabe et soutient la reconnaissance d'un État palestinien[633].

Dans le reste de l'Asie de l'Ouest, la progression du communisme est nettement plus inégale, et parfois très difficile. En 1946, lors de la fin du régime de parti unique en Turquie, le Parti communiste de Turquie, interdit depuis les années 1920, tente de revenir sur la scène publique sous le couvert d'une organisation légale, le Parti socialiste ouvrier et paysan de Turquie (Türkiye Sosyalist Emekçi Köylü Partisi). Celui-ci est cependant interdit en décembre de la même année[635]. À la fin des années 1940, le Parti communiste libanais est si affaibli par le soutien que l'URSS apporte alors aux sionistes qu'il s'autodissout en : il ne renaîtra qu'en 1971. Le Parti communiste syrien, séparé du parti libanais en 1944 lors de l'indépendance des deux pays, subit également des défections à la même époque, mais survit à la crise. Il est ensuite généreusement financé par l'URSS, ce qui lui permet de développer ses activités ; en 1954, Khalid Bakdash, chef du parti, devient le premier parlementaire ouvertement communiste du monde arabe. Le Parti communiste irakien est, lui, lourdement réprimé par le gouvernement dès les premières années de l'après-guerre : ses principaux dirigeants sont exécutés en 1949. La société irakienne étant fortement marquée par la fracture confessionnelle et par la domination de la minorité sunnite sur la majorité chiite, le communisme continue cependant d'attirer de nombreux sympathisants au sein des classes défavorisées chiites. Le Parti communiste jordanien, rapidement interdit, parvient cependant à présenter des candidats via un groupe-paravent : il obtient par ce biais deux élus au parlement en 1951. Des mesures anticommunistes (interdictions de journaux, arrestations de militants...) continuent cependant d'être prises au début du règne du roi Hussein. En octobre 1956, le Front national, groupe formé par les communistes avec divers alliés, obtient trois élus au parlement. Le Parti communiste jordanien est autorisé et le roi nomme Suleiman al-Nabulsi, membre du Front national, au poste de premier ministre. Mais quelques mois plus tard, en avril 1957, Hussein et l'armée contraignent Nabulsi à la démission ; le roi déclare la loi martiale et interdit tous les partis politiques[636].
En Iran, le Tudeh, le parti communiste iranien créé en 1941 à la suite de l'invasion anglo-soviétique, obtient huit élus au parlement en 1944. Le premier ministre iranien, Ghavam os-Saltaneh, fait entrer en 1946 dans son gouvernement des ministres issus du Tudeh. La même année, l'Iran, toujours occupé dans l'immédiat après-guerre par les troupes britanniques et soviétiques, est le théâtre de la crise irano-soviétique, l'un des premiers épisodes de la guerre froide. Staline tente en effet, pour obtenir une concession sur le pétrole iranien, de faire pression sur Ghavam en soutenant la création de deux gouvernements séparatistes pro-soviétiques, le Gouvernement populaire d'Azerbaïdjan et la République du Kurdistan. Mais l'influence occidentale contribue à ce que Ghavam se sépare de ses ministres communistes. Les deux régimes séparatistes sont ensuite écrasés sans que les Soviétiques réagissent autrement que par des menaces ; le parlement iranien élu en 1947 refuse de ratifier l'accord pétrolier passé avec l'URSS. En février 1949, le Tudeh est interdit à la suite d'un attentat contre le Chah. En 1953, pour soutenir le Chah dont le pouvoir est alors menacé par le premier ministre nationaliste Mossadegh, les États-Unis organisent l'opération Ajax, qui permet d'écarter ce dernier. La monarchie iranienne saisit cette occasion pour mettre un terme à l'existence du Tudeh ; les dirigeants communistes iraniens, qui avaient apporté un soutien intermittent à Mossadegh mais n'étaient nullement à l'origine de sa politique de nationalisations, sont arrêtés, et le parti à nouveau réduit à la clandestinité[637],[636].
Divisions du trotskysme après 1945

Décimés durant la guerre, privés de leur chef assassiné en 1940, les trotskystes sont, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, moins que jamais en mesure de rivaliser avec les staliniens[638]. Durant les décennies qui suivent le conflit mondial, les différents partis trotskystes sont parcourus de nombreuses divisions : les schismes en France ont des répercussions profondes à l'échelle internationale. Parmi les nombreux groupes trotskystes, beaucoup cultivent une image idéalisée de Léon Trotsky. Leur entrisme au sein de nombreuses organisations politiques, la culture du secret de certains de leurs partis (avec l'emploi de pseudonymes pour garantir l'anonymat de leurs cadres) et le passage de diverses personnalités en leur sein leur garantit une relative aura, parfois mythique : le trotskysme demeure cependant un courant profondément divisé, sans perspective d'accès au pouvoir[639],[640]. Au Brésil, les groupes trotskystes, puissants avant-guerre, peuvent sortir de la clandestinité après la fin du régime de l'Estado Novo en 1945 : ils ne parviennent cependant plus à exercer de réelle influence, du moins avant le début des années 1960, la gauche brésilienne et le milieu syndical étant déjà dominés par le Parti communiste et le Parti travailliste[416].
Après 1945, le militant d'origine grecque Michel Raptis, dit « Pablo » devient l'une des personnalités les plus importantes du trotskysme international. Coopté durant la guerre au secrétariat européen de la Quatrième Internationale, il entreprend de rassembler les trotskystes français ; s'il échoue dans ses contacts avec David Korner, alias « Barta », il réunit la plupart des autres groupes dans le Parti communiste internationaliste (PCI)[641]. En France, les trotskistes se réunissent désormais pour l'essentiel au sein du PCI, à l'exception notable du « groupe Barta » (dit officiellement Union communiste), qui ne reconnaît pas la Quatrième Internationale comme la structure qu'avait voulu bâtir Trotsky. Barta préconise la grève générale et tient un rôle dans le déclenchement des grèves de 1947, mais son groupe s'étiole par la suite[642],[643].
En 1946, une conférence internationale se tient à Paris pour reconstituer la Quatrième Internationale dispersée. Les trotskystes tentent ensuite d'analyser la situation née du début de la guerre froide, de le rupture avec la Yougoslavie et de la révolution en Chine. Le Belge Ernest Mandel se rallie en 1950 à la classification de la Yougoslavie comme « État ouvrier », mais voit le reste des régimes communistes comme des « États bourgeois dégénérés » et la révolution chinoise comme un « mouvement paysan dirigé par des staliniens ». Mandel et Pablo, animateurs de la majorité internationale, tirent argument du « développement des forces productives » en URSS pour en conclure à la supériorité d'une « socialisation, même imparfaite, des moyens de production ». L'Internationale trotskyste enregistre divers départs, au fil des désillusions. L'Américain Max Shachtman, cofondateur du Parti socialiste des travailleurs puis du Workers' Party, s'éloigne du trotskysme pour se rapprocher ensuite du Parti démocrate. Tony Cliff, dirigeant du Socialist Review Group britannique, s'éloigne pour cause de désaccords théoriques profonds avec Mandel et Pablo sur la bureaucratie soviétique. Le philosophe Cornelius Castoriadis se montre particulièrement critique envers le système soviétique - qu'il qualifie non pas d'« État ouvrier dégénéré » ni même de « capitalisme d'État », mais de « capitalisme bureaucratique » - et cherche des alternatives dans les pratiques conseillistes et autogestionnaires[644]. Castoriadis finit par quitter en 1949 le PCI avec Claude Lefort : les deux philosophes continuent d'animer leur tendance, Socialisme ou barbarie, et publient une revue du même nom. Leurs écrits contribuent à alimenter en France une réflexion critique, libérée des dogmes trotskystes, sur le marxisme et sur les phénomènes bureaucratique et totalitaire, influençant de nombreux intellectuels[645].
Le PCI pratique l'entrisme à la SFIO, mais ses militants en sont exclus en 1947 alors que le parti socialiste se recentre. Des divisions se font jour au sein du parti trotskyste, entre la tendance d'Yvan Craipeau, partisan du maintien d'une union avec l'aile gauche de la SFIO, et les adversaires de cette option, qui se rassemblent autour de Michel Pablo, Pierre Frank et Pierre Boussel, alias « Lambert ». La tendance de Craipeau quitte le PCI en 1948 : Craipeau lui-même intègre plus tard le PSU ; David Rousset anime brièvement le Rassemblement démocratique révolutionnaire avec Jean-Paul Sartre avant de s'orienter vers le gaullisme de gauche[646]. Le groupe Barta, quant à lui, disparaît lors de la rupture de Korner avec le syndicaliste Pierre Bois et le jeune Robert Barcia, dit « Hardy »[647],[648].
En 1951, Michel Pablo publie un document préparatoire au congrès mondial de la Quatrième Internationale, dans lequel il préconise l'abandon de l'« antistalinisme sectaire et mécanique » et le retour à la ligne de l'Opposition de gauche en accordant aux partis communistes un « soutien critique », le développement des régimes communistes ne pouvant, comme le montre la crise yougoslave, que mettre en lumière les contradictions du stalinisme. Pour Pablo, les trotskystes doivent défendre l'URSS et tâcher, en infiltrant les PC dominants, de les faire évoluer. Son autre grande orientation stratégique est l'alliance, dans le cadre de la décolonisation, avec les mouvements indépendantistes, afin de donner une orientation révolutionnaire et socialiste aux mouvements nationalistes extra-européens[649],[650]. Une vive polémique éclate alors avec Marcel Bleibtreu, qui conteste la ligne de Pablo. Le « pablisme » demeure majoritaire au sein du PCI, qui s'oriente vers l'entrisme au sein du PCF et de la CGT. Mais Lambert rejoint alors l'opposition aux côtés de Bleibtreu et de Michel Lequenne. En 1952, un congrès extraordinaire de la Quatrième Internationale signe la rupture de la famille trotskyste : l'Internationale se scinde entre les courants lambertiste et pabliste. Les sections britanniques et américaines, les plus importantes de l'Internationale, soutiennent Lambert. Les Allemands scissionnent ; les Italiens, les Srilankais, et une partie des Latino-Américains se rangent aux côtés de Pablo. Les lambertistes animent en France leur propre parti qui, ne parvenant pas à conserver le nom de PCI, prendra en 1965 celui d'Organisation communiste internationaliste (OCI)[649]. En Amérique latine, les trotskystes adhèrent dans leur majorité à la ligne pabliste et favorisent l'entrisme au sein des partis — socialistes ou populistes — susceptibles d'être influencés sur leur gauche. A contrario, en Bolivie, le Parti ouvrier révolutionnaire rompt avec la IVe Internationale[651],[652].
De l'apogée du stalinisme à la mort de Staline
En URSS, la période post-1945 correspond à un renforcement, le plus souvent brutal, des structures autoritaires du pouvoir. La manière dont sont traités les prisonniers de guerre soviétiques témoigne du durcissement du régime, qui ne souhaite pas que les rapatriés puissent témoigner de leurs expériences des réalités occidentales : 58 % seulement des rapatriés de guerre sont autorisés à rentrer chez eux, 33,5 % sont envoyés à l'armée ou dans des « bataillons de reconstruction » et 8,5 %, soit 360 000 personnes environ, sont envoyés au goulag. Dans les territoires acquis en 1939-1940 puis réintégrés à l'URSS à la fin de la guerre — soit l'Ukraine occidentale, les pays baltes et la Moldavie — des résistances à l'annexion et à la collectivisation sont écrasées. Des centaines de milliers de récalcitrants, de collaborateurs réels ou supposés, et plus généralement d'éléments de « classes hostiles » sont déportés, notamment dans les pays baltes, suivant une politique de mise au pas des nationalités[653]. Les organes de répression policière se développent et le système concentrationnaire atteint son apogée[654].
Parallèlement, le régime stalinien entreprend à partir de 1946 de reprendre le contrôle de la vie intellectuelle, qui s'était quelque peu relâché durant la guerre. Andreï Jdanov mène personnellement une vaste offensive contre toute création de l'esprit qui dérogerait à la ligne du Parti et dénoterait les influences de l'étranger et du « décadentisme occidental ». Jdanov lui-même meurt en août 1948, mais la campagne se poursuit jusqu'en 1953. La littérature, le théâtre, la musique sont touchés et de multiples artistes voient leurs œuvres publiquement dénoncées. À partir de la fin de 1948, la dénonciation des tendances « formalistes » dans le domaine artistique vise plus spécifiquement le « cosmopolitisme ». La poursuite de cette nouvelle déviation prend un tour de plus en plus antisémite[655], ce qui coïncide avec l'adoption par Staline, du fait de l'alliance d'Israël avec les États-Unis, d'une ligne antisioniste sur le plan international[634]. Le Parti communiste légifère dans tous les domaines de l'esprit, en histoire, en philosophie et en sciences. Dans le domaine de la biologie, l'influence du pseudo-scientifique Lyssenko atteint son apogée et aboutit à une mise au ban de la génétique mendélienne : plusieurs centaines de chercheurs sont chassés de leurs facultés[655].
Le culte de la personnalité du « petit père des peuples » Joseph Staline atteint après-guerre un niveau encore inégalé : chaque bourgade édifie sa statue de Staline et, en décembre 1949, le 70e anniversaire du dirigeant soviétique donne lieu à des célébrations grandioses. Tout en s'appuyant sur une idéologie ultranationaliste, Staline ignore les règles traditionnelles de fonctionnement du Parti : aucun plénum du Comité central ne se réunit entre 1947 et 1952 et le Politburo ne siège presque jamais au complet, Staline préférant recevoir ses membres par petits groupes[656]. Au 19e congrès du Parti communiste, en — le premier depuis 1939 — Staline réorganise le Parti et fait notamment supprimer le poste de Secrétaire général du Comité central, tout en demeurant dans les faits aux commandes du PCUS et en restant chef du gouvernement[657]. Au début des années 1950, Staline envisage une nouvelle purge du Parti et de la société soviétique, afin de renouveler les cadres politiques, économiques, administratifs et intellectuels de la nation. À la fin de 1952, plusieurs médecins, dont une majorité de Juifs, sont arrêtés sous l'accusation de complot : ils sont torturés et contraints d'« avouer » leurs crimes, parmi lesquels le fait d'avoir provoqué la mort de Jdanov. La propagande stalinienne adopte à l'époque de nets accents antisémites, qui rejaillit sur les procès de Prague en Tchécoslovaquie et l'élimination d'Ana Pauker en Roumanie : les cadres communistes sont désormais purgés sous l'accusation de « sionisme » et de « cosmopolitisme ». En janvier 1953, la Pravda annonce la découverte du « complot terroriste des médecins », lançant l'affaire connue sous le nom de complot des blouses blanches[658]. Les autorités soviétiques, afin de préparer la nouvelle purge envisagée par Staline, lancent une campagne de propagande dénonçant les « nationalistes juifs » liés aux États-Unis et aux organisations juives internationales. Mais, le 1er mars 1953, Staline est victime d'une attaque ; il meurt le 5 mars. Gueorgui Malenkov est aussitôt désigné pour lui succéder à la tête du Conseil des ministres[659].
Divisions et mutations du camp communiste après l'époque stalinienne
Ascension de Khrouchtchev
La mort de Staline survient à un moment de grandes difficultés en URSS, dues au blocage du système économique et politique. Une « troïka » de dirigeants, composée de Gueorgui Malenkov, Nikita Khrouchtchev et Lavrenti Beria, est mise en place dans les premiers mois, qui se signalent par une certaine détente sur le plan intérieur : le 27 mars, le Soviet suprême décrète une amnistie pour tous les détenus dont la peine ne dépasse pas cinq ans, et qui concerne notamment les cadres du Parti concernés par les purges de 1951-1952. Les « médecins assassins » dénoncés dans le cadre du complot des blouses blanches sont réhabilités début avril. En juillet, Beria, qui montait en puissance et tentait de se poser en successeur, est arrêté ; il est par la suite exécuté. Son élimination entraîne une redistribution des influences au sein de l'appareil soviétique ; les services de sécurité, que Beria avait centralisés sous son autorité en cumulant de vastes pouvoirs répressifs, perdent en influence au profit de l'Armée rouge. En 1954, l'appareil policier est réorganisé, la police politique prenant le nom de KGB[660],[661].
Dans les mois qui suivent la chute de Beria, une lutte d'influence met aux prises Malenkov et Khrouchtchev, tournant rapidement à l'avantage de ce dernier : en septembre, le poste de secrétaire général — rebaptisé premier secrétaire — du Parti communiste de l'Union soviétique (PCUS) est recréé au profit de Khrouchtchev[662]. Ce dernier tente de résoudre les problèmes économiques et sociaux de l'URSS tout en menant une politique populiste d'appel aux « petites gens ». Le Code du travail est révisé, favorisant la mobilité des salariés : la loi de 1940 qui rattachait les salariés à leur entreprise est abolie. Entre 1953 et 1958, la situation matérielle des salariés urbains s'améliore considérablement grâce à une politique économique jouant sur la production et la consommation, ce qui augmente les biens disponibles sur le marché ; le salaire minimum des employés d'État est augmenté et désormais exempt d'impôt, le taux des pensions est presque doublé. Khrouchtchev, associé à ces bons résultats économiques et au relâchement des pratiques coercitives, voit son ascension favorisée au détriment de Malenkov : en février 1955, ce dernier remet sa démission et est remplacé par Nikolaï Boulganine. Khrouchtchev se retourne ensuite contre les conservateurs, tels Kaganovitch et Molotov, qui l'avaient aidé à écarter Malenkov, et obtient leur mise à l'écart[663].
Réorganisation du bloc de l'Est et dénonciation du stalinisme
Le , un décret qui préconise l'augmentation des normes du travail industriel d'au moins 10 % provoque une insurrection populaire en République démocratique allemande : une grève générale éclate dans plusieurs villes et les ouvriers mettent à sac des bâtiments officiels. L'insurrection est finalement écrasée par l'intervention des troupes soviétiques. Walter Ulbricht réussit à faire rejeter la responsabilité des événements sur ses adversaires au sein du Parti et obtient une aide économique accrue de la part de l'URSS pour améliorer le niveau de vie de la population est-allemande[664]. Les événements de 1953 cristallisent la division de l'Allemagne et montrent le peu de légitimité populaire du gouvernement de la RDA[665]. Des émeutes ouvrières contre les communistes, cette fois sans effusion de sang, ont également lieu à Plzeň en Tchécoslovaquie[666].
Sur le plan extérieur, la politique de l'URSS après la mort de Staline se déroule au rythme d'une première phase de détente : face à l'enlisement de la guerre de Corée et aux risques d'intensification des opérations américaines, les Soviétiques favorisent la signature de l'armistice en juillet 1953. Entre 1954 et 1955, l'URSS adopte une stratégie d'immobilisme dans les conférences internationales et tente en vain de s'opposer au réarmement de l'Allemagne de l'Ouest, obtenant cependant un succès avec le rejet de la Communauté européenne de défense[667].
À partir de 1955, l'URSS revient à une politique de mouvement en Europe : le est institué le Pacte de Varsovie, une alliance militaire entre l'Union soviétique et les pays du bloc de l'Est[668]. Les Sovietiques entreprennent également de remettre de l'ordre dans les régimes du bloc de l'Est dont la politique ne donne pas satisfaction : plusieurs dirigeants se voient ainsi contraints de séparer les charges de chef du gouvernement et de chef du Parti, qu'ils cumulaient jusque-là. En République populaire de Hongrie, Mátyás Rákosi, dont la politique économique est blâmée par les Soviétiques, se voit imposer en 1953 Imre Nagy comme chef du gouvernement. Partisan d'une forme de « communisme éclairé », Nagy annonce une série de mesures destinées à corriger les erreurs du gouvernement et à améliorer la vie des travailleurs, tout en libéralisant la vie intellectuelle et en supprimant les camps d'internement. Ces mesures effraient cependant l'appareil du Parti ; Rákosi parvient à obtenir le départ de Nagy en 1955[669]. En République populaire de Bulgarie, Valko Tchervenkov, qui a succédé à Dimitrov mort en 1949, garde la présidence du conseil des ministres mais cède la direction du Parti communiste bulgare à Todor Jivkov ; ce dernier évince ensuite tout à fait Tchervenkov du pouvoir[670]. En mai 1955, Nikita Khrouchtchev se rend à Belgrade et annonce la réconciliation de l'URSS avec la Yougoslavie, Tito étant entièrement réhabilité[671].
En février 1956, lors du XXe congrès du Parti communiste de l'Union soviétique, Khrouchtchev lit son « rapport secret » révélant une partie des crimes de Staline. S'il s'abstient de condamner l'ensemble de la politique suivie par Staline et ne révèle qu'une petite partie des exactions staliniennes, le numéro un soviétique déclare ouvertement que Staline a envoyé des « milliers » d'innocents à la mort, évoquant essentiellement le cas des cadres communistes injustement condamnés. Le testament de Lénine est rendu public. Le texte est très sélectif quant aux méfaits de Staline et ne remet en cause aucune des grandes orientations depuis 1917, mais Khrouchtchev prend un risque politique considérable, une grande partie de son auditoire ayant fait carrière à l'époque concernée. L'existence du rapport Khrouchtchev, que l'URSS refuse dans un premier temps de confirmer, est rapidement connue à l'étranger. Le document sème la stupeur dans le monde entier, y compris dans les rangs des partis communistes occidentaux, dont certains en nient dans un premier temps l'existence, et qui perdent bientôt de très nombreux adhérents et sympathisants[672],[673]. Durant le XXe congrès, Krouchtchev place son discours sous le signe du réalisme, en affirmant la possibilité pour chaque pays de réaliser un passage pacifique au socialisme selon ses propres conditions — ce qui met un terme à la politique d'opposition systématique envers les partis socialistes ouest-européens définie par la doctrine Jdanov — et en exposant le principe de coexistence pacifique entre systèmes politiques différents[674].
Signe de la nouvelle orientation soviétique, le Kominform est dissous, en vue de ne plus faire apparaître de lien de subordination entre les partis communistes et le régime soviétique[675]. Le mouvement communiste international est par la suite incarné pour l'essentiel par les relations bilatérales des partis communistes : celles-ci donnent lieu, entre 1957 et 1969, à cinq conférences mondiales des Partis communistes, qui mettent cependant en relief les divisions grandissantes du camp communiste[676].
Bouleversements en Pologne et en Hongrie

Les évènements de Pologne
Les répercussions de la déstalinisation lancée par Nikita Khrouchtchev se font sentir dans l'ensemble du bloc de l'Est, mais prennent un tour particulièrement dramatique en République populaire de Pologne et en République populaire de Hongrie. Après avoir entendu le rapport Khrouchtchev, le dirigeant polonais Bolesław Bierut tombe malade, apparemment victime d'un infarctus, et meurt à Moscou[677]. Edward Ochab lui succède et semble vouloir s'engager dans une politique de libéralisation contrôlée[678]. Plusieurs dizaines de milliers de prisonniers politiques sont libérés ; Władysław Gomułka et ses amis politiques sont eux aussi libérés et réhabilités. En juin, une manifestation ouvrière à Poznań, déclenchée initialement pour demander des augmentations de salaires, dégénère en véritable soulèvement dans la ville mais l'intervention rapide des troupes polonaises évite une extension de la révolte et rend inutile une intervention soviétique ; le Parti ouvrier unifié polonais et les Soviétiques sont néanmoins très préoccupés par la situation. L'agitation populaire croît en Pologne et gagne les centres industriels ; des cadres de l'appareil du Parti réclament bientôt le retour au pouvoir de Gomułka. Avec l'appui des Soviétiques qui, effrayés par la situation en Hongrie, souhaitent éviter une crise comparable en Pologne, les conservateurs du Parti acceptent finalement en octobre de céder la place à Władysław Gomułka, qui prend la tête du Parti ouvrier unifié polonais en bénéficiant d'un réel soutien au sein de la population. Gomułka annonce un programme de libéralisations politiques, mais rassure dans le même temps les Soviétiques en leur garantissant qu'il ne touchera pas à leurs intérêts en Pologne : le pays ne s'engage que sur la voie d'une démocratisation limitée[679],[677].
L'insurrection de Budapest
En Hongrie, la situation évolue de manière beaucoup plus tragique : en juillet 1956, Mátyás Rákosi doit, sous la pression des Soviétiques, céder à Ernő Gerő la tête du Parti des travailleurs hongrois. À l'intérieur du PC hongrois, des voix s'élèvent bientôt pour demander des réformes et demander le retour d'Imre Nagy. László Rajk est réhabilité au mois d'octobre, sept ans après son exécution. Le 22 octobre, une manifestation étudiante débouche sur la publication d'un manifeste révolutionnaire qui réclame la destitution des staliniens et un nouveau gouvernement dirigé par Imre Nagy. Le lendemain, la statue de Staline au centre de Budapest est abattue. Imre Nagy est renommé chef du gouvernement le soir même. L'agitation s'étend et Nagy, réticent au départ devant l'ampleur du mouvement, évolue bientôt vers un soutien aux contestataires contre les Soviétiques. Fin octobre, il forme un gouvernement de coalition avec des membres de partis d'opposition, tandis que l'insurrection s'étend. Le 31 octobre, Nagy annonce le départ de la Hongrie du Pacte de Varsovie et proclame la neutralité du pays. L'URSS décide de mettre un terme à l'insurrection de Budapest par la force. János Kádár, qui avait dans un premier temps rejoint le gouvernement d'Imre Nagy, parlemente avec les Soviétiques et obtient de former un nouveau gouvernement qui, tout en demeurant favorable à l'URSS, disposera d'une certaine latitude politique sur le plan intérieur[679],[677].
L'insurrection est écrasée et Imre Nagy, qui s'était réfugié dans l'ambassade yougoslave, est capturé par traîtrise ; il est par la suite détenu en Roumanie, jugé au cours d'un procès secret, puis pendu en 1958. Les événements de Hongrie ont un effet désastreux sur l'image de l'URSS, qui se trouve encore dégradée dans le monde entier, quelques mois après la révélation des crimes de Staline. Ils ont néanmoins pour conséquence de renforcer, par intimidation, l'obéissance de la plupart des dirigeants du bloc de l'Est. En Hongrie, l'appareil du Parti — rebaptisé Parti socialiste ouvrier hongrois — doit être entièrement rebâti après avoir été purgé des contestataires[679],[677].
L'URSS sous Krouchtchev

Sur le plan intérieur, l'autorité de Khrouchtchev est un temps affaiblie par la révolte hongroise : il est notamment confronté à l'opposition des conservateurs comme Kaganovitch et Molotov et des technocrates comme Malenkov qui lui reprochent sa gestion des crises en Europe de l'Est et le fait d'avoir sapé la crédibilité du mouvement communiste. Pour rallier la population, le no 1 soviétique accentue alors la détente en accordant de nouvelles amnisties partielles ; la majorité des Soviétiques qui avaient été déportés sur des critères de nationalité sont autorisés à rentrer chez eux. En , Khrouchtchev doit faire face, lors du plénum du Comité central, à une attaque conjointe de Kaganovitch, Molotov et Malenkov mais le chef du PCUS sort victorieux de l'épreuve et fait exclure ses adversaires du comité central. L'affaire est par la suite décrite comme résultant des menées d'un « groupe anti-parti ». Khrouchtchev fait ensuite écarter le maréchal Gueorgui Joukov, qui l'avait soutenu contre les conservateurs mais qui s'opposait à la mainmise du Parti sur l'Armée rouge et avait critiqué son rôle durant les purges staliniennes[680],[681].
Sorti très renforcé de sa victoire sur ses opposants, Khrouchtchev consolide ses positions et, en 1958, cumule son poste de premier secrétaire du Parti avec celui de président du conseil des ministres. De nouvelles mesures de détente sont prises, notamment en modifiant le code pénal dont les notions d'« ennemi du peuple » et de « crime contre-révolutionnaire » sont supprimées. Sur le plan culturel, le numéro un soviétique encourage une relative libéralisation, bien que le « réalisme socialiste soviétique » demeure la forme d'art officiel. Sur le plan social, Khrouchtchev s'efforce d'améliorer les conditions de vie des citoyens soviétiques en poussant à la création de logements. Un effort particulier est fourni pour améliorer l'éducation, poursuivant des mesures déjà initiées sous Staline. Pour ce qui est de la quantité de biens de consommation produits, la croissance de l'URSS est impressionnante durant les années 1950-1960, bien que la qualité des biens produits ne soit pas toujours au rendez-vous. Les efforts imposés aux campagnes pour rattraper le niveau de production des États-Unis pèsent également durement sur la paysannerie. La libéralisation amenée par Khrouchtchev ne s'étend, cependant, pas au domaine religieux : les trois quarts des lieux de culte sont fermés durant sa période au pouvoir. La recherche spatiale fait l'objet d'une attention particulière de la part des autorités soviétiques et, en 1961, Youri Gagarine devient le premier homme à voyager dans l'espace, ce qui constitue pour l'URSS un grand succès sur le plan de la propagande et du prestige. Politiquement, Khrouchtchev s'en tient à un strict respect du dogme marxiste-léniniste, considérant avoir réalisé un retour aux sources de la pensée de Lénine en ayant dénoncé les erreurs, les crimes et le culte de la personnalité de Staline. La principale innovation théorique de l'époque est portée par Kuusinen, qui considère que la dictature du prolétariat a vocation à devenir un « État de tout le peuple » : cette conception revient à éliminer les bases théoriques des répressions de masse. Khrouchtchev conserve néanmoins une vision idéaliste de la réalisation du « socialisme » en URSS : en 1961, le programme officiel du PCUS prévoit pour 1980 le passage au stade du communisme. Il s'agit là du dernier document officiel soviétique à prévoir officiellement la réalisation du communisme, dans son sens théorique de société sans classes[680],[681].
Sur le plan international, Khrouchtchev adopte une posture délibérément agressive, donnant la priorité à l'armement nucléaire et considérant la dissuasion, dans le cadre d'une menace de guerre atomique, comme le meilleur moyen de prévenir un conflit avec l'Occident. Le dirigeant soviétique souhaite négocier avec les Occidentaux, mais sans renoncer à ses arrière-pensées expansionnistes et à partir d'une position de force. Ses initiatives souvent audacieuses, voire risquées, lui valent cependant, au sein du Præsidium du Comité central (nom porté à l'époque par le Politburo), des opposants qui désapprouvent son « aventurisme ». Khrouchtchev innove par ailleurs par rapport à Staline en jouant la carte du tiers-monde : vis-à-vis des pays non alignés, il entreprend de se rapprocher des pays décolonisés « progressistes », même non communistes, afin d'affaiblir l'Occident et de faire progresser la cause communiste. Le PCUS affirme désormais l'existence de plusieurs voies pouvant mener au socialisme, le nationalisme pouvant constituer une phase « progressiste » intermédiaire entre la période coloniale et le socialisme. L'URSS, dans les années 1950-1960, ne dispose cependant pas encore des moyens de mener une politique conséquente au Moyen-Orient et en Afrique[682].
Rupture sino-soviétique

La déstalinisation contribue par ailleurs à provoquer la rupture entre l'URSS et la République populaire de Chine. Mao Zedong désapprouve la condamnation de Staline par Khrouchtchev et l'élimination des vétérans du PCUS lors de l'affaire du groupe anti-parti ; il tente néanmoins de lancer en Chine une opération de libéralisation, la campagne des cent fleurs, qui tourne à la débâcle et l'amène à faire de la lutte contre le « révisionnisme » l'une de ses priorités idéologiques. Le dirigeant chinois se montre en outre particulièrement hostile à un rapprochement avec les États-Unis, condamnant toute forme de coexistence pacifique : en novembre 1957, lors d'une visite à Moscou, il choque son auditoire en évoquant ouvertement l'opportunité d'une guerre nucléaire et en considérant que les centaines de millions de morts seraient un prix à payer pour la victoire du socialisme. En 1958, l'URSS montre de nets signes d'irritation face à la politique chinoise, qui provoque la deuxième crise du détroit de Taïwan : Mao tente de « tester » l'URSS en provoquant des tensions internationales qui l'amèneraient à s'opposer à nouveau frontalement à l'Occident. En 1959-1960, Khrouchtchev se rend en visite aux États-Unis. Son voyage à Pékin, le mois suivant, se passe très mal ; le dirigeant soviétique tente d'encourager l'opposition à Mao au sein du PC chinois, notamment celle du président de la République Liu Shaoqi. En avril 1960, la presse chinoise condamne avec virulence le « révisionnisme » idéologique de l'URSS et la coexistence pacifique ; l'« anti-révisionnisme » est alors l'un des principaux mots d'ordre de Mao. En juin de la même année, le congrès des partis communistes, à Bucarest, se traduit par des disputes violentes entre Soviétiques et Chinois : ces derniers se séparent sur un compromis mais leurs rapports demeurent franchement mauvais. Les coopérants soviétiques de l'industrie chinoise sont rappelés. Khrouchtchev réaffirme entretemps la politique de déstalinisation, en dressant un réquisitoire contre la période stalinienne lors du XXIIe congrès du PCUS en 1961. Les Soviétiques tentent de convoquer une conférence pour faire condamner le PC chinois, mais les réticences des partis européens et le refus des partis asiatiques ne permettent pas à ce projet d'aboutir. La rupture sino-soviétique ne devient réellement publique qu'en 1963. Si cette crise montre le sérieux des orientations de Khrouchtchev en matière de détente, elle porte également un coup à la crédibilité de l'URSS en tant que pays leader du mouvement communiste mondial[683],[684],[685].
La rupture avec la Chine est également accompagnée, en Europe, de celle de l'URSS avec l'Albanie : le leader albanais, Enver Hoxha, qui ne souhaite pas se soumettre aux desiderata de Khrouchtchev et refuse la déstalinisation, s'en prend violemment à la politique soviétique au congrès de Bucarest, qu'il quitte ensuite avec fracas. En 1961, l'URSS suspend son aide économique à l'Albanie, qui choisit de s'aligner sur la Chine et se tient à l'écart du bloc de l'Est. La Chine, qui participe au Mouvement des non-alignés, ambitionne désormais de constituer un pôle communiste concurrent à celui de l'URSS : différents partis communistes à travers le monde connaissent des scissions pro-chinoises, ou comportent des fractions maoïstes. Le premier PC européen concerné est le Parti communiste de Belgique : un tiers des adhérents de la fédération bruxelloise scissionne et fonde un parti concurrent du même nom, qui ne parvient cependant pas à s'imposer auprès des électeurs[685]. La Corée du Nord et le Nord Viêt Nam se rapprochent de la République populaire de Chine (sans rompre pour autant avec l'URSS) de même que différents partis comme le Parti communiste japonais ou le Parti communiste indonésien[686],[687]. Les partis communistes prochinois qui apparaissent à l'époque sont de dimensions inégales, et souvent très modestes. Ils se distinguent généralement des partis rivaux par des nuances d'appellation : le Parti communiste du Brésil est ainsi la scission prochinoise du Parti communiste brésilien prosoviétique[688]. Le petit Parti communiste de Nouvelle-Zélande représente - si l'on excepte le Parti du travail d'Albanie - le seul cas du principal PC d'un pays à être passé dans le camp maoïste plutôt que de connaître une scission pro-chinoise[689].
De Krouchtchev à Brejnev
En URSS, la déstalinisation, si elle apporte un réel relâchement politique, demeure d'une ampleur limitée. Si les abus les plus criants du système stalinien sont supprimés du code pénal, celui-ci conserve des articles permettant de punir toute forme de déviance politique ou idéologique. La libéralisation de la vie intellectuelle n'empêche pas le maintien de la censure : l'attitude des autorités soviétiques face au prix nobel de littérature accordé à Boris Pasternak a de surcroît des effets désastreux sur le plan de l'image[690]. La censure permet cependant la publication de livres dont la sortie en URSS aurait été impensable quelques années plus tôt, comme Une journée d'Ivan Denissovitch d'Alexandre Soljenitsyne[691]. La politique économique de Khrouchtchev marque le pas à la fin des années 1950 et le taux de croissance de l'agriculture baisse. Au XXIIe congrès du PCUS en 1961, où le Parti adopte de nouveaux statuts et un nouveau programme, la dénonciation de la période stalinienne est poursuivie, s'étendant non plus au seul Staline mais à un groupe — restreint — de staliniens ; cependant, les résistances à la déstalinisation demeurent fortes. La résolution du Parti ne parle pas de l'étendue des crimes de Staline ni des répressions de masse, mais de « fautes » et de « déviations », fermant en outre la voie à une étude plus approfondie de la période stalinienne. Khrouchtchev poursuit sa politique volontariste sur le plan international, au prix cependant de graves tensions avec l'Occident, lors de la crise berlinoise de 1961 et de la construction du mur de Berlin, ou de l'affaire des missiles cubains. Les résultats de la politique vers le tiers-monde sont en outre décevants : l'URSS adopte une démarche plus gradualiste dans sa recherche d'alliés et élabore un nouveau concept, celui d'« État de démocratie nationale » dont l'indépendance et la politique « progressiste » leur permettent de jouer un rôle déterminant dans la crise du capitalisme mais, au début des années 1960, seuls Cuba, la Guinée, le Ghana, le Mali et l'Indonésie répondent aux critères soviétiques. La République démocratique du Congo, en faveur duquel l'URSS s'était engagée sous le gouvernement de Patrice Lumumba, la République arabe unie (union de l'Égypte et de la Syrie) et l'Irak ne rejoignent pas le camp des « démocraties nationales ». Le prestige du premier secrétaire du Parti souffre en outre beaucoup de la crise des missiles cubains. L'opposition à la succession de réformes économiques de Khrouchtchev et à son style de gouvernance font augmenter la fronde au sein du PCUS en 1961-1962. Le , Nikita Khrouchtchev est démis de toutes ses fonctions, officiellement pour raisons de santé, par un vote du Præsidium du Comité central (nom porté à l'époque par le Politburo). Léonid Brejnev, jusque-là président du Præsidium du Soviet suprême, le remplace à la tête du Parti[690],[692].
L'éviction de Khrouchtchev n'entraîne pas de vague importante de limogeages au sein de l'appareil. Brejnev et son équipe mènent une politique mêlant conservatisme politique et poursuite des réformes économiques. L'URSS est gouvernée, au fil des années, selon une logique de consensus au sein du Parti et de maintien au pouvoir d'une élite immuable. Le pouvoir demeure très personnalisé, Brejnev cumulant une liste impressionnante de titres et d'honneurs, mais son style de gouvernement ne signifie pas un retour à la dictature stalinienne : le dirigeant du PCUS, qui s'appuie sur un système de clientélisme, bénéficie du soutien d'un groupe dirigeant désirant avant tout se maintenir à la tête de l'État en entourant une figure conservatrice et consensuelle. Le conservatisme du no 1 soviétique, de plus en plus marqué avec le temps est notamment affirmé lors du congrès du PCUS de 1971, durant lequel Brejnev évoque la notion de « socialisme développé », qui n'aurait pas besoin de réforme précisément parce qu'il est développé. Les réformes économiques poursuivies par Brejnev marquent progressivement le pas et, dans les années 1970, l'industrie soviétique cesse d'être motrice en matière d'emplois tandis que l'agriculture, secteur le plus fragile de l'économie de l'URSS, connaît des difficultés croissantes. Sur le plan international, l'URSS poursuit la politique de détente avec l'Occident et tente une réconciliation avec la République populaire de Chine tout en s'efforçant de consolider ses positions dans le tiers-monde : un soutien est apporté au Nord Viêt Nam dans le cadre de la guerre du Viêt Nam, ainsi qu'à Cuba qui encourage les foyers de lutte armée en Amérique latine. Mais, au sein du camp communiste, des problèmes subsistent avec les Chinois, les Cubains et bientôt les Tchécoslovaques. Des négociations sur la limitation des armements stratégiques sont poursuivies avec le gouvernement américain, l'accord SALT-1 de 1972 consacrant la reconnaissance de l'URSS comme grande puissance sur un pied d'égalité avec les États-Unis. Si l'ère Brejnev engrange divers succès diplomatiques, l'économie soviétique demeure handicapée par sa dépendance envers la vente de ressources naturelles. Le système souffre également du faible taux de renouvellement de l'élite dirigeante, de plus en plus vieillissante avec les années, et de sa lourdeur bureaucratique. Des dissidences se développent en URSS, à des degrés très divers : l'historien Roy Medvedev se livre à une vive critique de la période stalinienne tout en conservant une vision idéalisée de Lénine. Alexandre Soljenitsyne, par contre, attaque de manière bien plus radicale le système communiste : la publication en Occident, en 1973, de son ouvrage L'Archipel du Goulag, décide le pouvoir à agir contre l'écrivain, qui est arrêté puis expulsé du pays et déchu de sa nationalité. Au sein même du PCUS et de l'appareil soviétique, de nombreux cadres entretiennent, sans les exprimer ouvertement, des idées réformatrices face à la sclérose politique et économique du système[693],[694],[695].
Si la répression de l'opposition est nettement moins violente en URSS qu'à l'époque stalinienne, la censure demeure pesante. En Union soviétique comme dans les autres pays communistes européens, les dissidents doivent avoir recours, pour faire circuler des textes critiques, à un système de publications clandestines appelées samizdat. Les personnes se risquant à critiquer trop ouvertement le système risquent l'exclusion du Parti pour ceux qui en sont membres, la perte de leur emploi, voire l'incarcération. La répression des dissidents soviétiques aboutit parfois à ce que des opposants entièrement sains d'esprit soient déclarés fous et internés d'office dans des hôpitaux psychiatriques[696].
Hongrie : libéralisation relative
En Europe, les pays du bloc de l'Est connaissent des évolutions contrastées. En République populaire de Hongrie, János Kádár obtient, dans les années qui suivent l'écrasement de l'insurrection de Budapest, les coudées franches pour entreprendre, surtout à partir des années 1960, une libéralisation politique modérée et mener de véritables réformes économiques : la Hongrie communiste connaît alors une période de relative prospérité. La politique suivie par Kádár, qui conduit à une nette amélioration des conditions de vie de la population, est désignée sous le nom de « socialisme du goulash » (d'après une expression employée par Nikita Khrouchtchev)[697],[677].
RDA : de la construction du mur de Berlin à la détente avec l'Ouest


À la fin des années 1950, le régime de la République démocratique allemande se consolide. À défaut de l'accepter totalement, une partie de la population est-allemande s'en accommode, certaines réformes des communistes, telles les possibilités accrues d'ascension professionnelle dans des domaines divers, et les constructions de polycliniques ou de centres culturels, apparaissant comme des acquis sociaux. Le système éducatif est développé, s'accompagnant cependant d'un endoctrinement dès le jardin d'enfants[698]. Mais la présence de l'enclave de Berlin-Ouest est un facteur d'affaiblissement pour la RDA, car cette vitrine du monde occidental, aisément visible par les Est-Allemands, leur permet une facile comparaison avec leurs propres conditions de vie. Un nombre important d'habitants de la RDA quittent régulièrement l'Est pour s'installer en Allemagne de l'Ouest via Berlin-Ouest. En 1958-1961, une crise importante oppose l'URSS et la RDA à l'Ouest, Khrouchtchev multipliant les menaces et ambitionnant de chasser les Occidentaux de Berlin. Walter Ulbricht envisage l'épreuve de force mais Khrouchtchev le persuade d'adopter une démarche plus graduée. Dans la nuit du , la construction d'un mur séparant Berlin-Ouest de Berlin-Est est lancée : le mur de Berlin, présenté comme un « mur de protection antifasciste » par la propagande est-allemande, est désormais le symbole le plus visible du rideau de fer séparant l'Europe. Sa construction exacerbe durant un temps la crise de Berlin, mais l'arrêt de l'exode des Est-allemands met un terme à l'une des raisons de la tension diplomatique, qui prend fin à l'hiver 1961. Sur le long terme, cependant, le mur de Berlin constitue un désastre sur le plan de l'image pour le camp communiste, en même temps qu'un aveu d'échec sur les mérites de son système par rapport à celui de l'Ouest[699],[700].
Durant les années qui suivent, Walter Ulbricht s'efforce d'améliorer les performances économiques de la RDA et introduit en 1963 une réforme accordant aux entreprises davantage de marge de manœuvre par rapport à la planification : la productivité est-allemande augmente, mais sans pouvoir rivaliser avec celle de l'Ouest. Ulbricht, quant à lui, demeure particulièrement impopulaire au sein de sa population, qui l'associe à la division de l'Allemagne. En 1971, il est évincé de la tête du Parti socialiste unifié d'Allemagne et remplacé par Erich Honecker. Les méthodes de surveillance de la population demeurent cependant les mêmes, la RDA continuant de fonctionner comme un État policier[701]. L'Allemagne de l'Est sort par ailleurs de son isolement international quand, dans le cadre de son Ostpolitik de détente envers les pays de l'Est, le chancelier ouest-allemand Willy Brandt signe avec Erich Honecker le traité fondamental, par lequel les deux Allemagnes établissent des relations régulières sans pour autant se reconnaître sur le plan diplomatique[702],[703].
Roumanie : de l'« autonomie » au régime de Ceaușescu

En République populaire roumaine, Gheorghe Gheorghiu-Dej, inquiet d'un surcroît d'autoritarisme soviétique après la rupture avec la Chine, parvient à donner à la politique de son pays un cours plus indépendant et une tonalité plus nationaliste. Le dirigeant roumain adopte une position conciliatrice vis-à-vis de la République populaire de Chine, renoue des relations diplomatiques avec la République populaire d'Albanie, introduit une relative libéralisation culturelle et proclame en 1964 l'« autonomie » de son pays au sein du bloc de l'Est. L'URSS, après avoir tenté de susciter une opposition à Gheorghiu-Dej au sein du PC roumain, finit par s'accommoder de la situation. La Roumanie noue des relations cordiales avec l'Occident ; Gheorghiu-Dej meurt en , mais sa politique est poursuivie par son successeur Nicolae Ceaușescu[704].
Ceaușescu entreprend de personnaliser davantage le pouvoir en modifiant la constitution et en prenant le poste, créé à son attention, de président de la république. Le pays est rebaptisé République socialiste de Roumanie. Bénéficiant tout d'abord d'une image libérale en Occident, Ceaușescu dérive rapidement vers l'autoritarisme : après des visites en République populaire de Chine et en Corée du Nord en 1971, le président roumain revient convaincu par la nécessité de renforcer le contrôle idéologique de la population. La République socialiste de Roumanie s'oriente vers un style de gouvernement de plus en plus autocratique, le « conducator » Ceaușescu faisant l'objet d'un culte de la personnalité outrancier et pratiquant le népotisme familial à un degré extrême. À partir des années 1970, une politique dite de « systématisation », qui vise à remodeler totalement l'habitat des Roumains, aboutit à ravager le patrimoine rural et urbain du pays[705].
Le Printemps de Prague

En République socialiste tchécoslovaque, la déstalinisation a conduit à un certain relâchement dans le contrôle de la vie intellectuelle. Des économistes ont la liberté de discuter des défauts du système « socialiste » et plaident pour une introduction partielle des règles du marché : si ces propositions sont trop radicales pour la direction du Parti communiste tchécoslovaque, et notamment pour son chef Antonín Novotný, de modestes réformes économiques sont mises en place en 1965. Au sein du PCT, les réformes gagnent en audace, notamment au sein de la branche slovaque du Parti : Alexander Dubček, devenu chef du comité central slovaque en 1963 contre l'avis de Novotný, plaide pour des réformes du système et tout particulièrement pour une reconnaissance de l'identité slovaque. Au plénum du comité central d', Dubček s'oppose ouvertement à Novotný[706]. Léonid Brejnev, appelé à l'aide par Novotný, ne montre aucun empressement à soutenir ce dernier, qui était proche de Khrouchtchev[707].
En , Dubček remplace Novotný au poste de secrétaire général du Parti communiste tchécoslovaque ; Novotný cède quelques mois plus tard son poste de président de la république à Ludvík Svoboda. Le climat politique en Tchécoslovaquie, dans la période dite du printemps de Prague qui s'ouvre alors, change radicalement : la censure se relâchant et les critiques du système s'exprimant plus ouvertement dans les médias. En avril, le PCT publie un « programme d'action » qui, s'il ne renonce pas au « rôle dirigeant » du Parti, prévoit de poser des limites à son pouvoir. Les intellectuels réformateurs publient en mai un manifeste réclamant, de manière bien plus radicale, une démocratisation du système. Dubček, qui n'envisage au départ qu'un relâchement du système, se trouve bientôt pris entre deux feux et, d'une manière comparable à celle d'Imre Nagy en 1956, soutient de plus en plus les réformateurs les plus audacieux. L'expérience du « socialisme à visage humain » tchécoslovaque inquiète rapidement les autres pays du bloc de l'Est, suscitant notamment l'hostilité de la République populaire de Pologne et de la République démocratique allemande[707],[706],[708].
En , lors d'une réunion du Pacte de Varsovie, est formulée la « doctrine Brejnev », qui limite explicitement la possibilité, pour les partis communistes, de s'écarter des « principes du marxisme-léninisme et du socialisme », et par conséquent la souveraineté des pays du bloc de l'Est. Les armées du Pacte de Varsovie, à l'exception de la Roumanie qui a refusé de participer, envahissent la Tchécoslovaquie, mettant un terme au Printemps de Prague. Dubček, forcé de se soumettre, est maintenu un temps au pouvoir avant d'être définitivement écarté, au profit de Gustáv Husák. La République socialiste tchécoslovaque est soumise à une politique de reprise en main, appelée « normalisation ». L'opposition continue néanmoins de s'exprimer malgré la censure et les pressions policières, notamment au travers du mouvement dit de la Charte 77 animé entre autres par l'écrivain Václav Havel[707],[706],[708].
Contestations en Pologne : des émeutes de la Baltique à la répression de Solidarność
.jpeg.webp)
En République populaire de Pologne, les milieux intellectuels et étudiants, encouragés en 1968 par les évènements de Tchécoslovaquie, expriment leur opposition de manière de plus en plus ouverte. Le Parti ouvrier unifié polonais réagit par une campagne, aux forts accents antisémites, contre les « sionistes » et les « révisionnistes ». En décembre 1970, le mécontentement général dans la population débouche sur un important mouvement de grève dans les ports de la mer Baltique. Władysław Gomułka réagit en employant la force et seize ouvriers sont tués dans la répression, augmentant encore la colère populaire. À la fin du mois, Gomułka doit quitter le pouvoir : il est remplacé à la tête du Parti par Edward Gierek, qui entreprend de se concilier les ouvriers en améliorant leurs conditions de vie. Les réformes de Gierek n'amènent cependant pas de changements structurels[709].
À partir de 1976, la brusque hausse du prix des denrées et la dégradation générale de l'économie polonaise suscitent une nouvelle vague de protestations. Les contestataires, dans leur majorité catholiques, sont galvanisés en 1978 par l'élection du pape polonais Jean-Paul II. En juillet 1980, à la suite d'une nouvelle augmentation du prix des denrées, une grève éclate aux chantiers navals de Gdańsk : le 31 août, le gouvernement cède aux demandes des grévistes : l'accord de Gdańsk autorise notamment l'existence de syndicats indépendants du Parti communiste. Solidarność est constitué peu après, sous la direction du leader gréviste Lech Wałęsa. Très rapidement, Solidarność, premier syndicat libre du monde communiste, se mue en mouvement de masse : plus de 700 000 travailleurs polonais se mettent en grève. Edward Gierek doit quitter le pouvoir et laisse la tête du Parti à Stanisław Kania, qui ne parvient pas davantage à ramener le calme. Les dirigeants du bloc de l'Est sont particulièrement alarmés par la situation, et évoquent la possibilité d'une intervention des troupes du Pacte de Varsovie. En février 1981, le général Wojciech Jaruzelski, jusque-là ministre de la défense, est nommé premier ministre ; il remplace Kania en octobre à la tête du Parti ouvrier unifié polonais, puis décrète en décembre un état de siège en Pologne. Lech Wałęsa est arrêté et Solidarność interdit. Jaruzelski, qui apparaît comme l'homme de la manière forte, a néanmoins souhaité éviter une intervention soviétique et il s'emploie dans les années qui suivent à la fois à satisfaire les desiderata des Soviétiques et à répondre aux attentes de la population, ne réussissant dans aucun des cas. La loi martiale est levée en juillet 1983. La même année, Lech Wałęsa reçoit le Prix Nobel de la paix, au grand déplaisir des autorités polonaises. La pression politique se relâche dans les années qui suivent : le gouvernement communiste polonais doit cependant continuer à compter avec une opposition réprimée, mais toujours présente[710].
Les accords d'Helsinki

En juillet 1973 s'ouvre à Helsinki la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE), pour lancer un dialogue multilatéral est-ouest en matière de coopération et de sécurité européennes. Les négociations s'organisent autour de trois « corbeilles », à savoir les questions politiques, les questions économiques et enfin la libre circulation des idées et des personnes, à savoir les droits de l'homme. Durant les travaux de la conférence, les Occidentaux font aux Soviétiques une concession essentielle sur la « première corbeille » en acceptant de reconnaître de jure les frontières européennes établies en 1945. Surtout attachés à garantir la pérennité du bloc de l'Est, les Soviétiques accordent moins d'importance à la « troisième corbeille », sur laquelle le président américain Gerald Ford insiste pour compenser les concessions faites dans la première. Les accords d'Helsinki sont finalement signés le 1er août 1975 ; dans un contexte international où les États-Unis sont affaiblis politiquement par la guerre du Viêt Nam et l'affaire du Watergate et alors que le nombre de régimes communistes dans le monde est à son apogée, les accords apparaissent alors comme un grand succès diplomatique pour l'URSS et ses alliés est-européens : les frontières européennes issues de la Seconde Guerre mondiale sont définitivement reconnues, les signataires s'engageant à ne pas les modifier par la force. Ce traité contribue à diffuser, dans une partie de l'opinion publique de l'époque, le sentiment que les régimes communistes sont peu ou prou immuables. L'URSS échoue cependant à doter la CSCE d'un organe permanent, qui lui aurait permis d'être associée de manière structurelle à la gestion de la sécurité européenne, ce qui aurait affaibli le rôle de l'OTAN. Enfin, et surtout, les termes des accords contiennent cependant en germe des problèmes potentiels pour le bloc de l'Est, et certains éléments de sa future dissolution : les textes affirment en effet les principes des droits de l'homme et du droit à la libre information et précisent que les frontières, loin d'être immuables comme les Soviétiques souhaitaient le voir précisé, peuvent être modifiées par des voies pacifiques en accord avec la loi internationale. Si l'URSS apparaît dans un premier temps comme la grande gagnante de la conférence, l'Acte final d'Helsinki devient progressivement, de manière totalement inattendue pour les Soviétiques, un manifeste du mouvement dissident et libéral[711],[712].
Les cas de la Yougoslavie et de l'Albanie

Deux pays communistes est-européens, la Yougoslavie et l'Albanie, se situent en dehors du bloc de l'Est et suivent des voies radicalement inverses, l'un poursuivant sa relative libéralisation - tout en demeurant un régime à parti unique - et cultivant sa politique de non-alignement et ses bons rapports avec l'Occident, l'autre conservant un style de gouvernement stalinien et se fermant de plus en plus au monde extérieur. Après la rupture soviéto-yougoslave et le choix par la Yougoslavie d'une organisation économique « autogestionnaire », l'expérience du régime titiste ne laisse pas indifférents les partis socialistes européens, dont plusieurs, comme le Parti travailliste britannique ou le Parti travailliste norvégien, font part de leur intérêt, voire de leur sympathie, pour ce régime communiste antistalinien[713]. Les progrès économiques de la Yougoslavie, dus notamment au soutien financier occidental, sont réels ; ils sont cependant moins bons que prévu et, surtout, inégaux entre les différents États de la fédération[560]. Tout en demeurant un régime autoritaire, la Yougoslavie de Tito — qui modifie plusieurs fois sa constitution et prend en 1963 le nouveau nom de République fédérative socialiste de Yougoslavie — connaît diverses évolutions politiques au gré de ses problèmes de nationalités et, notamment après le mouvement de contestation du printemps croate de 1971, décentralise de manière croissante ses organes de pouvoir. La personne du maréchal Tito - nommé Président à vie en 1974 - constitue le principal ciment politique du pays[714].
En 1979, la situation économique de la Yougoslavie se dégrade fortement à la suite du deuxième choc pétrolier ; la dette extérieure du pays, dont le taux de croissance était jusque-là enviable, devient écrasante et le niveau de vie baisse brutalement[715].

Après la mort de Tito en 1980, la Yougoslavie, dont les organes de gouvernement fonctionnaient de manière de plus en plus collégiale, adopte un système de présidence fédérale tournante ; le pays ne parvient pas pour autant à résoudre ses problèmes de stabilité politique et d'équilibre entre nationalités. Les revendications nationales se font de plus en plus entendre durant les années 1980, tandis que de nouveaux leaders, comme le communiste serbe Slobodan Milošević ou l'opposant croate Franjo Tuđman, se font les porte-paroles des aspirations identitaires d'une partie de la population[716].
La République populaire d'Albanie, au contraire de la Yougoslavie, refuse toute forme de libéralisation. Lors de la dégradation de ses relations avec l'URSS, l'Albanie s'aligne d'abord sur la République populaire de Chine, dont elle partage les positions « anti-révisionnistes » ; le faible intérêt géostratégique de l'Albanie, pays au poids économique et politique négligeable, conduit les Soviétiques à tolérer sa position dissidente. Le régime d'Enver Hoxha conserve des méthodes de gouvernement staliniennes et professe un marxisme-léninisme dogmatique, parfois baptisé « hoxhaïsme », qui mêle des influences à la fois staliniennes et maoïstes ; en 1967, Hoxha, qui cherche à rivaliser avec le radicalisme de la Révolution culturelle chinoise, proclame l'Albanie « premier État athée du monde » : toute pratique religieuse est interdite. Enver Hoxha fait également couvrir le territoire albanais de milliers de bunkers, censés protéger le pays des ennemis extérieurs. En 1968, le pays se retire officiellement du Pacte de Varsovie et du CAEM. À la fin des années 1970, l'évolution de la Chine vers le réformisme conduit l'Albanie à rompre avec son alliée asiatique. L'Albanie communiste fait le choix d'un isolement autarcique et, tout en maintenant des relations diplomatiques avec l'Occident, devient le pays le plus fermé d'Europe. En 1981, Hoxha réalise une purge interne : Mehmet Shehu, premier ministre depuis 1954, est exécuté et dénoncé comme « agent des services secrets américains, soviétiques, yougoslaves, anglais et italiens ». Ramiz Alia, qui succède en 1985 à Hoxha à la mort de ce dernier, poursuit la politique isolationniste de son prédécesseur[717],[718],[719].
Prise du pouvoir par Castro

À Cuba, la lutte contre le régime de Fulgencio Batista connaît un tournant à la fin 1956 quand le Mouvement du 26-Juillet, dirigé par Fidel Castro, débarque sur l'île à bord du yacht Granma. Prévu pour le 30 novembre et censé être couvert par une insurrection sur place, le débarquement n'a lieu que le 2 décembre et la tentative de soulèvement tourne vite à la catastrophe. Les révolutionnaires sont forcés de prendre le maquis et se regroupent dans la Sierra Maestra, où ils bénéficient à la fois des conditions géographiques et du soutien de la population locale. Le groupe de guérilleros (dits « barbudos »), aux effectifs initialement très réduits, forme progressivement une petite armée rebelle, qui grossit au fil des mois. L'insurrection « non communiste » de Castro bénéficie initialement d'une bonne image aux États-Unis, lassés par la politique de Batista ; ce n'est qu'à l'automne 1958 que les Américains commencent à réviser leur opinion sur Fidel Castro, mais trop tard pour changer la donne. Le Parti socialiste populaire, le PC cubain dirigé par Blas Roca, révise son jugement critique sur la guérilla et envoie un émissaire, l'écrivain Carlos Rafael Rodríguez, dans la Sierra Maestra[720]. L'URSS est peu enthousiaste devant ce rapprochement, jugeant alors l'insurrection de Castro sans espoir[592]. La situation militaire bascule en , quand Castro lance une contre-offensive face aux attaques des troupes de Batista : Che Guevara et Camilo Cienfuegos font mouvement vers l'Ouest du pays et réalisent une jonction avec les guérilleros de l'Escambray. En octobre, toutes les villes sont isolées. Dans les derniers jours de décembre, l'armée gouvernementale se débande et Batista s'enfuit durant la nuit du nouvel an. Le , Fidel Castro fait une entrée triomphale à La Havane[720].
Castro continue d'affirmer qu'il n'est pas communiste mais les tensions avec les États-Unis sont presque immédiates : dès , les Américains dénoncent la violente répression exercée contre les partisans de Batista. Castro réalise un voyage aux États-Unis, où il tente vainement une opération de charme, le gouvernement américain demeurant méfiant. La CIA soupçonne un « péril communiste » et envisage rapidement une intervention militaire contre l'île. En , une réforme agraire touche la plupart des domaines sucriers possédés par des intérêts américains : les rapports entre Cuba et les États-Unis se dégradent au fil des mois et débouchent sur une série de sanctions économiques et militaires. Cuba se rapproche bientôt de l'URSS, qui ne connaissait guère jusque-là le mouvement castriste : en , Anastase Mikoïan visite La Havane et de nombreux accords économiques soviéto-cubains sont conclus. Entre août et , Cuba exproprie 192 sociétés nord-américaines, et les États-Unis répliquent en décrétant un embargo quasi total sur les exportations à destination de Cuba. Che Guevara, sans formation d'économiste, devient ministre de l'industrie et responsable de la banque centrale cubaine. Le « vieux » parti communiste cubain, le PSP, est intégré au gouvernement et, au début de 1960, Castro et les communistes commencent à réfléchir à une organisation unifiée[721],[722].
Affaire de la baie des Cochons et crise des missiles
Fidel Castro revient de son second voyage aux États-Unis convaincu que son pays risque une invasion imminente : il annonce la création de Comités de défense de la révolution, destinés à devenir l'« œil » de la révolution à tous les niveaux et à encadrer la population. Devenu président des États-Unis en janvier 1961, John Fitzgerald Kennedy trouve des plans d'invasion de Cuba préparés sous l'administration Eisenhower et déjà très avancés, la CIA ayant recruté 5000 Cubains au sein des associations d'exilés en les préparant à débarquer sur l'île. En avril, le débarquement a lieu dans la Baie des Cochons, mais se solde rapidement par un désastre : l'effet de surprise est nul et plusieurs milliers de sympathisants potentiels des anti-castristes sont arrêtés de manière préventive avant même l'opération. L'invasion est très mal préparée, les paysans de la région où elle se déroule ayant été bien traités par le gouvernement révolutionnaire et n'ayant aucune raison de soutenir les opposants : les 1500 Cubains anti-castristes débarqués sont accueillis par des miliciens en surnombre et rapidement mis en déroute. L'hostilité des États-Unis précipite le rapprochement de Castro avec l'URSS : le dirigeant cubain appelle la population à défendre la « révolution socialiste ». Dans le courant de 1961, il proclame Cuba « État socialiste », déclare le 1er décembre sa foi dans le marxisme-léninisme, déclare que plus aucune élection n'aura lieu car le pouvoir populaire s'exprime désormais quotidiennement, et annonce la formation d'un parti unique unifiant les organisations révolutionnaires cubaines. Le PSP et le mouvement du 26‑Juillet fusionnent au sein d'un Parti unifié de la révolution socialiste, qui prend en 1965 le nom de Parti communiste de Cuba. Les écoles sont nationalisées et de nombreux opposants réels ou potentiels demeurent incarcérés[723],[721],[722],[724].
Le régime castriste met rapidement en œuvre une série de mesures « révolutionnaires », notamment, en 1959, une première réforme agraire et une campagne d'alphabétisation, et entreprend de s'appuyer sur une mobilisation permanente de la population. Che Guevara mène, sur le plan économique, un programme ambitieux d'industrialisation mais la planification mal maîtrisée, le manque d'expertise et les sanctions américaines entraînent rapidement une dégradation de l'économie cubaine[721]. Cuba vit durant plusieurs années sans institutions véritablement organisées et n'adopte pas de constitution avant 1976[725].
L'URSS entame rapidement des échanges secrets avec Cuba sur le moyen de prévenir une autre invasion et Khrouchtchev propose à Castro d'installer des missiles à Cuba, dans un but de manœuvre d'intimidation à l'égard des États-Unis. En septembre 1962, des batteries de missiles soviétiques sont installées : mais, dès le mois suivant, les missiles sont découverts par un avion espion et Kennedy exige leur démantèlement. La crise des missiles cause dans les relations internationales une tension extrême et fait craindre une guerre nucléaire. Castro va jusqu'à proposer à Khrouchtchev d'utiliser l'arme nucléaire contre les États-Unis en cas d'attaque sur Cuba. Des négociations américano-soviétiques, dont Castro est tenu à l'écart à son grand dépit, aboutissent finalement au démantèlement des missiles en échange de la promesse, de la part des États-Unis, de ne plus essayer d'envahir Cuba[721],[722]. La CIA tente ensuite à plusieurs reprises de faire assassiner Fidel Castro ; ce dernier affirme plus tard avoir échappé, au fil des ans, à 600 complots contre sa personne[726].
Politiques intérieure et extérieure du régime castriste
Le gouvernement cubain accélère la collectivisation de l'économie, lançant une série de nationalisations et une seconde réforme agraire en 1963. Mais le développement industriel et agricole à marche forcée débouche bientôt sur des résultats catastrophiques, la situation économique de l'île étant aggravée par l'embargo américain sans que celui-ci soit l'unique facteur. En 1963, sur les conseils de l'URSS, Cuba réoriente son économie vers la production de sucre. Che Guevara se trouve bientôt supplanté par des technocrates soutenus par l'Union soviétique. Abandonnant ses responsabilités gouvernementales, il décide de consacrer son énergie à l'exportation du modèle révolutionnaire, entamant une évolution intellectuelle qui l'amène à s'éloigner du stalinisme[721],[727].
Sur le plan international, le régime castriste se distingue par une politique étrangère « surdimensionnée » par rapport aux dimensions de son pays, prônant l'exportation de la révolution selon une ligne fortement tiers-mondiste. Cuba exprime sa « solidarité prolétarienne » avec les luttes indépendantistes dans le tiers-monde et soutient les mouvements de guérilla latino-américains. En janvier 1966, la Conférence tricontinentale organisée à La Havane est le point de départ d'une action idéologique et militaire qui fait de Cuba le « centre mondial de l'anti-impérialisme », lui conférant un grand rayonnement en Amérique latine. En juillet 1967, le pays accueille la conférence de l'Organisation Latino-Américaine de Solidarité, qui tente de fédérer les implantations de focos révolutionnaires théorisés par Guevara. Ce dernier est cependant tué trois mois plus tard, ce qui marque la fin d'une époque. À partir de 1968, Castro adopte une politique étrangère moins aventuriste, suivant en cela les conseils de l'URSS : la construction d'une « économie socialiste » est désormais présentée par le régime cubain comme la principale priorité. La même année, Cuba approuve l'écrasement du printemps de Prague, soulignant son alignement sur l'« orthodoxie » soviétique. Le pays joue un jeu de balancier entre son alliance étroite avec le bloc de l'Est et son appartenance au Mouvement des non-alignés, et en tire un profit politique sur les deux tableaux[728],[729].
Cuba demeure très dépendante sur le plan économique. Sa politique dans ce domaine doit emprunter une série de virages, notamment après l'échec de la récolte de canne à sucre de 1970, dont Fidel Castro espérait des records et qui souligne au contraire l'incapacité du pays à sortir de la sujétion économique soviétique. En 1972, le pays intègre le Conseil d'assistance économique mutuelle, devenant le fournisseur officiel en sucre du bloc de l'Est. Massivement aidée par l'URSS, Cuba accumule progressivement une très forte dette extérieure[730]. Sur le plan social, le gouvernement cubain amène de réelles avancées, développant notamment un système de santé très performant, qui aboutit à réduire considérablement la mortalité infantile et à augmenter l'espérance de vie : le système de santé, qui constitue l'une des priorités du régime, a pour vocation d'être accessible à toute la population mais pèse dès lors lourdement sur le budget limité du pays. Avant la révolution, Cuba possédait déjà un taux d'alphabétisation très satisfaisant selon les critères latino-américains, mais les efforts du gouvernement castriste en matière d'éducation permettent d'importants progrès, réduisant notamment les inégalités dans ce domaine entre les villes et les zones rurales. Globalement, le régime castriste réduit les inégalités de niveau de vie au sein de la population cubaine : les problèmes économiques de l'île aboutissent néanmoins à des conditions de vie relativement médiocres pour l'ensemble des citoyens[731].

Cuba met progressivement en place ses institutions : la loi fondamentale de 1976 définit le pays comme un « État socialiste d'ouvriers et de paysans » dont « la force dirigeante supérieure » est le Parti communiste de Cuba dirigé par Fidel et Raúl Castro, respectivement premier et second secrétaires. L'encadrement est complété par les organes de la « démocratie prolétarienne », soit un ensemble d'organisations professionnelles et sociales, de syndicats et d'organisations de masse, dont les Comités de défense de la révolution qui surveillent la population. L'armée, fortement développée, est organisée à la mode soviétique, la milice venant s'ajouter au dispositif de défense. Les libertés fondamentales, affirmées par le régime, sont fortement limitées par un ensemble de lois répressives, dont en 1978 une loi dite de « dangerosité » ou de « prédélinquance » qui aboutit à la répression des « asociaux » comme les homosexuels ou les « hippies ». Les compagnons de route de Fidel Castro rétifs au virage marxiste tombent en disgrâce et sont souvent emprisonnés. La constitution de 1976 introduit un modèle électoral grâce auquel, selon le système du « pouvoir populaire », la population choisit ses représentants municipaux, lesquels élisent ensuite les délégués aux échelons supérieurs. Les candidatures sont néanmoins sévèrement encadrées, les candidats étant proposés « sur la base de leurs qualités et de leurs mérites » : le Parti communiste, qui n'a officiellement pas le droit de présenter lui-même de candidats, domine de manière écrasante toutes les instances[725]. Le refus du pluralisme par les frères Castro et leur entourage, ainsi que les pratiques policières de surveillance de la population, débouchent sur une absence de libertés politiques et intellectuelles à Cuba[731].
Dans les années 1970, Castro envoie de nombreux coopérants civils et militaires dans divers pays d'Afrique. Sa politique africaine prend un tour spectaculaire lorsque Cuba prend part militairement à la guerre civile angolaise en soutenant le MPLA et la République populaire d'Angola contre l'UNITA, elle-même soutenue par l'Afrique du Sud[728],[732]. Fidel Castro atteint en septembre 1979 le sommet de son rayonnement international lors de son élection à la présidence du Mouvement des non-alignés. Le dirigeant cubain ambitionne de donner à ce poste une nouvelle dimension, en se faisant le porte-voix des aspirations du tiers-monde et en transformant cette organisation internationale en un nouvel axe anti-américain et pro-soviétique. Mais, quelques mois après son élection, la position de Castro est considérablement affaiblie par l'invasion soviétique de l'Afghanistan : forcé de prendre position alors que l'URSS attaque un pays non-aligné, Castro choisit finalement de soutenir les Soviétiques, ce qui lui ôte une large parte de son crédit auprès des non-alignés et de l'opinion internationale. Durant ses trois ans de mandat à la tête du Mouvement des non-alignés, Castro est dès lors dans l'incapacité de concrétiser ses ambitions diplomatiques[733].
Les « Cent fleurs »

Sur le plan intérieur, au moment de la déstalinisation, le Parti communiste chinois adopte en 1956 un mode de fonctionnement plus collégial : le rôle personnel de Mao est moins souligné par la propagande et la pensée Mao Zedong disparaît temporairement des statuts officiels. La direction du PCC est maintenue pour l'essentiel, mais Deng Xiaoping est promu au rang de secrétaire général du Parti, Mao en demeurant le président[603]. Le contrôle policier de la population demeure rigide et le laogai, un système de camps de détention comparable au goulag soviétique, est créé : selon des estimations très approximatives, plusieurs dizaines de millions de prisonniers y auraient transité au fil des décennies[734]. Le PCC renforce son contrôle sur l'économie du pays en accélérant la collectivisation agricole, puis la socialisation de l'économie urbaine. Mais la consigne de « libération des forces productives », qui pousse les travailleurs chinois à une logique productiviste intensive, aboutit à un échec économique. Le malaise social et politique s'accroît face aux consignes du Parti[735].
Au VIIIe congrès du PCC en , Mao prend acte des difficultés au sein du Parti, dont les effectifs ont explosé depuis plusieurs années. En , il décrète, pour « combler le fossé » qui sépare le parti des masses, une « campagne de rectification » et encourage dans ce but la critique sur l'action du Parti ; cette campagne, symbolisée par la déclaration de Mao « Que cent fleurs s'épanouissent, que cent écoles rivalisent ! », débouche, après une période de réticences, sur un flot de critiques, notamment dans les milieux intellectuels et étudiants urbains, contre les politiques suivies par le Parti communiste chinois. Le PCC se sent finalement obligé de réprimer les contestations et déclenche à l'été 1957 une « campagne anti-droitiste » pour purger les libéraux. Après l'échec de cette tentative de « libéralisation contrôlée », la lutte contre les « droitistes » devient l'une des priorités de Mao, qui place désormais son discours sous le signe de l'« anti-révisionnisme »[736],[603].
Le Grand Bond en avant
À compter de 1958, la politique chinoise tout entière est rythmée par les élans et les échecs du maoïsme. Après sa « victoire » de 1957 sur les « droitistes » et la reprise en main des villes frondeuses, Mao souhaite promouvoir la « voie chinoise au socialisme », ce qui implique de développer, en recherchant l'autosuffisance du pays, un modèle spécifiquement chinois différent du modèle soviétique jugé trop rigide. Suivant le mot d'ordre « compter sur ses propres forces », la Chine doit, dans l'optique de Mao, rattraper son retard économique à marche forcée en mobilisant toute la population dans le cadre d'un effort productiviste et d'une collectivisation accrue. Dans un contexte de propagande intense et de grande ferveur idéologique, des objectifs irréalistes sont fixés. 740000 coopératives agricoles fusionnent en 24000 communes populaires et, à la fin de l'année, regroupent l'ensemble des paysans chinois. La socialisation de toutes les activités — les paysans mangent tous dans des cantines collectives — est menée dans une atmosphère de campagne militaire : le « Grand Bond en avant » souhaité par Mao est censé « faire jaillir les énergies populaires ». Des petits hauts fourneaux ruraux sont notamment construits, censés incarner l'industrialisation des campagnes ; les objectifs imposés aux villes et à l'industrie urbaine, tout aussi irréalistes, imposent une concentration des ressources. Le Grand Bond en avant, projet ultra-volontariste, est en grande partie improvisé sans que l'appareil technique et de planification puisse suivre. Dès la fin 1958, la situation économique et alimentaire dans les campagnes, où l'agriculture est désorganisée, est devenue préoccupante : Mao choisit alors une attitude de retraite, nouvelle pour lui, afin d'éviter de donner prise à ses ennemis au sein du Parti. En avril 1959, il laisse à Liu Shaoqi le poste de président de la République afin de se retirer, selon ses termes, en « seconde ligne ». Liu, considéré comme un homme pondéré et rigoureux, souhaite la modération du Grand Bond en avant et non son arrêt total ; Mao, quant à lui, conserve le poste de président du Parti communiste chinois. En juillet 1959, le maréchal Peng Dehuai, qui a pris conscience de la situation des campagnes lors d'un voyage dans son Hunan natal, critique vivement le Grand Bond en avant. Indirectement visé, Mao réagit avec violence : il parvient à rallier les autres dirigeants à sa cause et à faire destituer Peng Dehuai et ses proches, puis relance le Grand Bond, transformant une politique dangereuse en véritable catastrophe. Les transports ruraux sont désorganisés et l'équipement agricole négligé. Sécheresses et inondations aggravent encore, en 1959-1960, la situation de l'agriculture chinoise, dans un contexte de désorganisation totale et de chiffres officiels aussi triomphalistes que fantaisistes : une terrible famine sévit en Chine et l'appareil industriel du pays se délite. Le gouvernement chinois doit, à l'automne 1960, opérer dans l'urgence un revirement complet de sa politique. Alors qu'un rationnement sévère est imposé dans les villes, la Chine connaît, dans ses zones rurales, l'une des pires famines de son histoire. Les morts se comptent par millions, les estimations allant de 14 à 43 millions de victimes[737],[603],[738],[739].
La Révolution culturelle

Dans les années 1960, la Chine est plus isolée que jamais sur le plan international après la rupture sino-soviétique : si les partis nord-coréens et nord-vietnamiens s'efforcent de maintenir de bonnes relations avec l'URSS et la Chine, le seul véritable soutien étatique du régime de Mao est la République populaire d'Albanie, pays éloigné et de dimensions modestes. Un conflit avec l'Inde à propos de territoires frontaliers entraîne une brève guerre entre les deux pays, privant la Chine de son principal allié en Asie. Si la République populaire de Chine influence divers groupes maoïstes en Asie, en Afrique, en Amérique latine et dans une moindre mesure en Europe, aucun effort n'est fait pour créer une internationale maoïste[740]. Zhou Enlai entretient des contacts diplomatiques en Asie et en Afrique — notamment avec le Mali, la Guinée et le Ghana — ainsi qu'avec les pays asiatiques où les partis communistes participent au gouvernement (Indonésie) ou le monopolisent (Nord Viêt Nam, Corée du Nord) : se posant en champion des peuples opprimés du tiers-monde, la Chine tente de disputer la place à l'URSS mais, si elle remporte des succès diplomatiques entre 1963 et 1965, ne parvient pas à susciter autour d'elle de « front uni » cohérent[741].
Après le désastre du Grand Bond en avant — dont l'étendue demeure cachée durant des décennies — la Chine suit sur le plan intérieur une politique de « réajustement économique ». Liu Shaoqi, Deng Xiaoping et l'économiste Chen Yun mettent en œuvre à partir de 1961-1962 une politique plus modérée : l'essentiel de l'activité est ramené vers les coopératives d'avant 1958 et les lopins de terre familiaux reprennent de l'importance. Le niveau de production de 1957 est retrouvé en 1965. Les intellectuels bénéficient de plus de liberté et le contrôle de la population s'assouplit. Des intellectuels se permettent de publier des satires déguisées du régime, avec le soutien de certains cadres du Parti comme le maire de Pékin Peng Zhen. Mao Zedong, relativement mis à l'écart, décide bientôt de repartir à l'offensive, sa cible étant désormais le Parti communiste chinois lui-même, son appareil et surtout ses cadres qui s'opposent à ses orientations sans le faire ouvertement[740]. À l'automne 1962, Mao pose le principe que les classes et la lutte des classes subsistent à l'intérieur du socialisme, et désigne comme ennemi le « révisionnisme chinois ». Le Parti adopte le principe d'un « mouvement d'éducation socialiste » dans les campagnes et d'élimination des « pratiques capitalistes » réapparues depuis 1960 ; une proportion de cadres du Parti à punir (environ 3 %) est fixée. Le mouvement est d'abord modéré mais, en 1964, Mao en appelle à une « guerre d'extermination » contre les « bourgeois » au sein de la bureaucratie du Parti. Des « meetings de lutte » sont organisés dans les campagnes, où des cadres du Parti sont publiquement humiliés et contraints de faire leur autocritique. Dans le même temps, la Chine continue de mener une politique économique et sociale modérée. Mao est pour sa part préoccupé par la mobilisation insuffisante de la population : le dirigeant chinois considère que son pays évolue vers le « révisionnisme » et qu'il convient de corriger cette tendance[742].
La « Grande Révolution Culturelle Prolétarienne », lancée par Mao à partir de 1966, résulte de la rencontre des ambitions du dirigeant chinois avec les conséquences de la crise sociale en milieu urbain. L'encadrement étroit des populations et la lourdeur bureaucratique de la gestion du pays freinent le processus d'ascension sociale en Chine, tandis que l'élite du PCC tend désormais à se reproduire elle-même. La jeunesse, notamment étudiante et ouvrière, est particulièrement insatisfaite de cette situation : Mao trouve dans ces frustrations l'outil de son action contre le Parti. Le dirigeant chinois prend soin entretemps d'entretenir sa propagande en faisant publier le « Petit Livre rouge », un recueil de ses citations bientôt diffusé à des centaines de millions d'exemplaires[743].

S'étant assuré de l'appui du chef de l'armée Lin Biao, ainsi que des chefs de l'appareil de sécurité comme Kang Sheng, Mao passe à l'offensive. Entre la fin 1965 et le début 1966, des violentes attaques sont lancées contre des intellectuels, afin d'atteindre leur protecteur, Peng Zhen : ce dernier est démis de ses fonctions au printemps 1966. Les partisans de Mao s'en prennent à la « ligne noire anti-Parti et antisocialiste ». En août, Mao fait adopter par le Comité central la décision sur le déclenchement de la révolution culturelle, qui vise à « combattre et écraser ceux qui détiennent des postes de direction mais qui se sont engagés dans la voie capitaliste » ; il entreprend ensuite d'évincer Liu Shaoqi et Deng Xiaoping. Des milliers de jeunes Chinois sont embrigadés pour constituer les gardes rouges, que l'armée soutient et encadre : au cours des manifestations des gardes rouges, des « intellectuels droitiers » sont publiquement humiliés, ainsi que des responsables locaux du Parti. L'agitation des gardes rouges semble avoir dépassé les attentes de Mao, qui poursuit quant à lui son entreprise de démantèlement des appareils du Parti, la révolution culturelle étant pour lui une méthode d'épuration du régime. Mais, face au désordre croissant qui finit par menacer la survie du régime lui-même, Mao décide de mettre le mouvement sous tutelle militaire, l'aile la plus radicale étant contrainte de se soumettre à l'Armée populaire de libération. Jiang Qing, l'épouse de Mao, régente la culture chinoise durant la période, tandis que Lin Biao fait figure de grand bénéficiaire politique de la révolution culturelle ; dans ce contexte de désordre, Zhou Enlai doit assumer la charge globale de toutes les affaires de l'État. Les groupes de gardes rouges, devenus de plus en plus indépendants, sont démantelés et les « jeunes éduqués » sont massivement envoyés dans les régions rurales. La révolution culturelle constitue, par sa violence et son fanatisme, un traumatisme durable pour la société chinoise. En 1969, au IXe congrès du PCC, le « Grand Timonier » Mao Zedong triomphe et voit sa pensée réintroduite dans les statuts du Parti. Destitué, Liu Shaoqi meurt en prison ; Peng Dehuai est également incarcéré. Lin Biao apparaît comme le successeur potentiel de Mao mais semble avoir fait preuve de trop d'impatience, suscitant l'irritation de ce dernier : dès 1970, il tombe en disgrâce et, l'année suivante, meurt dans un accident d'avion, dans des circonstances obscures. La fin de Lin Biao et de la tutelle militaire met un terme définitif à la révolution culturelle, déjà officiellement terminée depuis 1969, et fait revenir sur le devant de la scène l'appareil du Parti communiste chinois, dont le rôle dirigeant est à nouveau mis en avant[740],[744],[603].
De la fin de la période maoïste à l'ère Deng Xiaoping
Vieillissant et de moins en moins actif, Mao se contente de tenir l'équilibre entre ses partisans, regroupés autour de son épouse Jiang Qing, et les cadres plus modérés dirigés par Zhou Enlai et Deng Xiaoping, ce dernier revenant sur le devant de la scène en 1973. Peu à peu, la balance penche en faveur des partisans de la reconstruction de l'appareil sous sa forme classique. Sur le plan international, la révolution culturelle a isolé la République populaire de Chine comme jamais auparavant ; les relations avec l'URSS demeurent très mauvaises et dégénèrent même en affrontements frontaliers en 1969. Zhou Enlai mène alors — via un processus connu sous le nom de « diplomatie du ping-pong » — une politique d'ouverture en direction des États-Unis, qui se saisissent de l'occasion : la République populaire de Chine sort de son isolement diplomatique et, en 1971, récupère le siège de la Chine à l'ONU au détriment de Taïwan. En 1972, la visite du président américain Richard Nixon scelle de manière spectaculaire le rapprochement sino-américain[740]. La ligne de Lin Biao est officiellement condamnée après 1973, le Parti communiste chinois étant à partir de 1974-1975 le théâtre d'une lutte d'influence entre les radicaux et les modérés, conduits par Deng Xiaoping. La Chine se remet lentement de la révolution culturelle, le climat politique et social suscitant mécontentements et dissidences[745].

L'affaiblissement physique de Mao Zedong et de Zhou Enlai, tous deux malades, renforce les antagonismes au sein du Parti. Zhou Enlai meurt en janvier 1976 : les hommages qui lui sont rendus sont l'occasion de troubles, notamment à Pékin, la population laissant éclater son mécontentement. Hua Guofeng lui succède, sa nomination semblant marquer une victoire des radicaux face à la ligne modérée de Deng Xiaoping ; les radicaux sont en fait très affaiblis, les évènements de Pékin ayant montré leur impopularité. Mao meurt le 9 septembre de la même année ; Hua Guofeng, qui lui succède à la présidence du Parti, se range aux côtés des centristes pour éviter d'être évincé : il fait arrêter en octobre la « Bande des Quatre » qui dirigeait les radicaux (la veuve de Mao Jiang Qing, Zhang Chunqiao, Yao Wenyuan et Wang Hongwen) ainsi que leurs principaux partisans. La liberté d'expression reçoit de relatifs encouragements : un « mur de la démocratie » est installé fin 1978 au centre de Pékin pour que la population puisse y afficher ses doléances sous forme de dazibaos (affichettes manuscrites) ; il est finalement retiré au bout d'un an. Deng Xiaoping, qui occupe le poste de vice-premier ministre, s'affirme après la chute de la Bande des Quatre comme le leader des réformateurs du PCC ; sa mouvance « modérée » s'emploie à maintenir le régime en dissociant de la dernière période maoïste l'ensemble des réalisations de la République populaire, évacuant au passage des épisodes gênants comme le Grand Bond en avant[746].
Deng Xiaoping évince progressivement Hua Guofeng de tous ses postes officiels, le remplaçant en 1981 à la tête de la Commission militaire centrale ; il impose sa ligne au début des années 1980, s'employant à proposer une synthèse idéologique qui élimine les éléments les plus radicaux de la pensée maoïste. Une nouvelle constitution est adoptée en 1982. Deng s'emploie à stabiliser l'économie chinoise et à accentuer la politique d'alliance avec l'Occident, plaidant pour une introduction de mécanismes de marché dans l'économie chinoise, afin de passer à une « économie socialiste de marché »[747].
Tout en continuant à se référer officiellement au marxisme-léninisme et à la pensée Mao Zedong[748], le communisme chinois est progressivement vidé de sa substance idéologique, subsistant essentiellement sous la forme d'une pratique politique autoritaire[749].
Conflits au Viêt Nam et au Laos


En Asie du Sud-Est, les États-Unis poursuivent une politique d'endiguement du communisme, afin d'éviter un basculement de l'ensemble de la région suivant la logique de la théorie des dominos. Dans la péninsule indochinoise, la guerre d'Indochine a laissé, dans les années 1950, l'ancienne Indochine française dans un état propice aux tensions politiques. Deux États autoritaires, la République démocratique du Viêt Nam (Nord Viêt Nam) communiste et le République du Viêt Nam (Sud Viêt Nam), se partagent le territoire vietnamien. Le Royaume du Laos connaît une situation politique complexe : le Pathet Lao de Souphanouvong et Kaysone Phomvihane, dirigé secrètement par le Parti du peuple lao communiste, cohabite difficilement avec la droite pro-américaine et les neutralistes de Souvanna Phouma (demi-frère de Souphanouvong). Norodom Sihanouk s'efforce de préserver la neutralité du royaume du Cambodge mais sa volonté d'échapper à l'influence américaine le conduit à se rapprocher des pays communistes, nouant des relations amicales avec la République populaire de Chine. Pactiser avec les communistes à l'extérieur permet à Sihanouk de se préserver sur le plan intérieur des communistes cambodgiens — surnommés Khmers rouges — qu'il peut réprimer à son aise. Irrités de l'attitude des Nord-vietnamiens à leur égard, les communistes cambodgiens se rapprochent politiquement de la Chine : leur chef, Saloth Sâr, réorganise le Parti clandestin, qu'il rebaptise secrètement Parti communiste du Kampuchéa (dit également Angkar, soit organisation). Les États-Unis apportent un soutien financier massif au régime de Ngô Đình Diệm au Sud Viêt Nam mais tentent en vain de lui faire amender ses pratiques autoritaires. Le régime sudiste réprime lourdement les partisans du Nord Viêt Nam qui entretiennent des foyers de guérilla sur son sol. Malgré le maintien au Sud d'une petite force communiste clandestine, en violation des accords de Genève, le Nord Viêt Nam privilégie jusqu'en 1961 l'action politique et non militaire et crée un « Front de la patrie » destiné à œuvrer à la réunification, jouant habilement de l'impopularité croissante de Diệm. Face à l'intensification de la répression au Sud, le Front national de libération du Sud Viêt Nam (FNL, surnommé par ses adversaires Việt Cộng, soit communistes vietnamiens), est fondé en décembre 1960, et appelle à la lutte contre le régime de Diệm et contre l'impérialisme américain. L'organisation, qui se veut avant tout un mouvement patriotique et anti-impérialiste, est entièrement dirigée par des natifs du Sud, dont aucun n'est ouvertement communiste : cependant, le Parti des travailleurs du Viêt Nam nord-vietnamien en inspire directement la politique[750].
Au Laos, la situation politique est également explosive et dégénère en conflit ouvert entre la droite, les neutralistes et le Pathet Lao. Préoccupés par l'évolution du contexte en Asie du Sud-Est, les États-Unis décident de s'impliquer davantage. Le nouveau président Kennedy augmente en 1961 le nombre de conseillers militaires américains pour aider à la contre-insurrection. Le peu de résultats obtenus et la crise politique au Sud Viêt Nam font craindre un passage de Diệm au neutralisme : des généraux sud-vietnamiens organisent alors, avec la bénédiction de la CIA, un putsch contre le président, qui est tué le 1er novembre 1963. Au Cambodge, Norodom Sihanouk rompt avec les États-Unis, se rapproche davantage des pays communistes et lance un programme de nationalisations qu'il baptise du nom de « socialisme royal ». Le nouveau président américain, Lyndon B. Johnson, qui succède à Kennedy, intensifie la présence militaire américaine dans la péninsule indochinoise, élargissant le théâtre de guerre au Laos. La piste Hô Chi Minh, voie de communication passant le territoire laotien avec l'aide du Pathet Lao et par le territoire cambodgien avec l'autorisation de Sihanouk qui espère préserver sa neutralité dans le conflit, permet au Nord Viêt Nam de ravitailler le Viêt Cong. En janvier 1964, la guerre du Viêt Nam est réellement lancée avec l'implication accrue des Américains : les États-Unis souhaitent faire de l'endiguement du communisme au Viêt Nam un exemple pour la région, alors que le rapprochement entre l'Indonésie et la République populaire de Chine contribue à leur faire craindre un basculement de l'Asie du Sud-Est dans le camp communiste. L'incident du golfe du Tonkin, accrochage mineur auquel les États-Unis prêtent une importance exagérée, donne à Johnson l'occasion de faire adopter, en , une résolution qui lui permet d'augmenter massivement l'engagement militaire de son pays en Asie du Sud-Est[751].
Massacre des communistes en Indonésie

En Indonésie, dans les années 1960, le Parti communiste indonésien (PKI), allié au président Soekarno et proche de la Chine de Mao, étend son influence dans les milieux politiques et militaires. En 1961, Soekarno théorise une ligne politique fondée sur l'alliance du nationalisme, de la religion et du communisme, et baptisée Nasakom. Trois cadres du PKI sont nommés ministres. En 1964-1965, le président indonésien, dont la ligne « anti-impérialiste » est de plus en plus marquée, s'emploie à déstabiliser la Malaisie voisine, soutenue par les Occidentaux : début 1965, il quitte l'ONU pour protester contre l'entrée de la Malaisie au Conseil de sécurité, puis annonce la création d'une organisation des « Nouvelles forces montantes », qui réunirait l'Indonésie, la Chine, le Nord Viêt Nam, la Corée du Nord et le Cambodge. La politique de Soekarno, dans le contexte de la guerre du Viêt Nam, inquiète fortement les Américains. En outre, dans la perspective de la succession de Soekarno, dont la santé est déclinante, le PKI apparaît susceptible de s'emparer du pouvoir, ce qui entraîne des tensions croissantes avec la droite indonésienne, puissante au sein de l'armée de terre. Les communistes s'efforcent d'accroître leur influence au sein des forces armées et font pression pour obtenir l'application de la loi de réforme agraire et la redistribution des terres ; ils multiplient les démonstrations de force, notamment les manifestations antireligieuses, ce qui entraine de graves heurts avec les organisations musulmanes[752],[753].
Craignant un coup d'État de droite, des militaires proches du PKI tentent de réaliser, le , leur propre coup d'État préventif, qui échoue très rapidement. Les chefs de l'armée et de la droite indonésiennes décident alors de saisir l'occasion pour en finir avec les communistes, sans leur laisser de possibilité de renaître de leurs cendres comme cela avait été le cas après l'affaire de Madiun. Le général Soeharto prend la tête de la contre-insurrection, avec l'aide des groupes musulmans conservateurs et l'approbation, voire le soutien actif, de la CIA. Alors que Soekarno est réduit à un rôle de façade, Soeharto obtient les pleins pouvoirs et une répression anticommuniste particulièrement sanglante se déroule dans tout le pays : environ 700 000 personnes sont incarcérées et plusieurs centaines de milliers de communistes ou supposés tels sont massacrés en quelques mois, certaines estimations, sans doute exagérées, allant jusqu'à un million de victimes. Le Parti communiste indonésien est totalement anéanti ; ses principaux dirigeants sont tués et ses cadres emprisonnés sont exécutés les uns après les autres[632],[754],[752],[753],[755]. Le risque de voir se constituer un « axe » entre l'Indonésie et la Chine est écarté, réduisant l'intérêt géostratégique du conflit vietnamien au moment même où la politique américaine au Viêt Nam entre dans une phase d'escalade[756]. L'éradication du communisme indonésien a notamment comme conséquence de pousser la Chine et l'URSS à se désengager temporairement du tiers-monde. La Chine entre à l'époque dans la période de la Révolution culturelle qui l'occupe trop sur le plan intérieur ; l'URSS, quant à elle, est poussée par cet échec à repenser la stratégie, jusque-là favorisée par Khrouchtchev, qui consistait à soutenir des fronts communs entre les partis communistes du tiers-monde et les forces progressistes locales[23].
Victoires communistes dans la péninsule indochinoise

Surclassés sur le strict plan militaire — bien que par ailleurs sous-estimés par les Américains — le Front national de libération du Sud Viêt Nam et l'Armée populaire vietnamienne misent sur une guerre d'usure. Les bombardements intensifs sur le Nord Viêt Nam et le déploiement des troupes américaines au sol ne parviennent pas à éviter l'enlisement du conflit. Au cours des années 1960, la guerre du Viêt Nam, qui ravage le pays, suscite une contestation grandissante dans le monde et dans l'opinion américaine elle-même. Les communistes vietnamiens apparaissent, aux yeux d'une partie de l'opinion mondiale, comme les héros d'une lutte contre l'impérialisme américain ; cela contribue, comme la figure « romantique » de Che Guevara à la même époque, à conférer à l'idéologie communiste, associée au tiers-mondisme, une nouvelle capacité de séduction. Le conflit vietnamien inspire en outre d'autres guérillas d'origine rurale, comme les naxalites en Inde[757]. En Asie du Sud-Est même, le conflit vietnamien déborde de plus en plus sur les pays voisins. En 1967, au Cambodge, les Khmers rouges lancent une insurrection, d'ampleur encore limitée, contre Sihanouk ; au Laos, le Pathet lao, soutenu par le Nord Viêt Nam, poursuit son combat contre la monarchie[758],[759]. En Thaïlande, le Parti communiste thaïlandais, soutenu par la Chine, mène par ailleurs à partir de 1965 sa propre guérilla en s'appuyant sur les revendications des minorités ethniques ; il reçoit l'appui de communistes malaisiens réfugiés sur le territoire thaïlandais après la défaite de leur soulèvement. Les actions menées par les communistes, notamment à la frontière entre la Malaisie et la Thaïlande, poussent le gouvernement thaïlandais à décréter la loi martiale en 1971 ; contrairement à ce qui se passe au Sud Viêt Nam, au Laos et au Cambodge, l'insurrection thaïlandaise ne parvient cependant pas à menacer durablement le pouvoir en place[760].
En 1968, l'offensive du Tết au Sud Viêt Nam surprend les Américains, dont le commandement militaire apparaît dépassé : si le FNL n'obtient, tout bien considéré, que des résultats mitigés et voit ses effectifs militaires décimés, l'ampleur de l'attaque contribue à susciter l'inquiétude des États-Unis quant à la possibilité de terminer rapidement la guerre. Très affaibli par les pertes subies lors de l'offensive, le FNL est désormais davantage subordonné à l'Armée populaire vietnamienne. Au Nord Viêt Nam, Hô Chi Minh, âgé et malade, est progressivement marginalisé par l'appareil politique, le nouvel homme fort du régime étant le secrétaire général du Parti Lê Duẩn ; le fondateur de la République démocratique du Viêt Nam et du Parti communiste vietnamien meurt en 1969 avant la fin du conflit. La dégradation de la situation au Viêt Nam contribue à la décision de Lyndon B. Johnson de ne pas se représenter à la présidence des États-Unis ; son successeur, Richard Nixon, souhaite mettre un terme au conflit indochinois mais veut avoir un avantage militaire dans la perspective d'éventuelles négociations de paix. Les territoires laotien, puis cambodgien, sont massivement bombardés par les Américains pour tenter de couper la piste Hô Chi Minh et détruire les bases communistes. Norodom Sihanouk voit ses efforts pour préserver la neutralité du Cambodge réduits à néant : du fait notamment de l'extension de l'insurrection, il est renversé par un coup d'État du général Lon Nol, avec l'approbation des États-Unis. Les troupes américaines réalisent ensuite une intervention au Cambodge pour soutenir le régime instable de Lon Nol. Au Laos, où les Américains ne peuvent intervenir au sol, c'est l'armée sud-vietnamienne qui est dépêchée ; elle est cependant mise en déroute par les communistes. Loin de ramener le calme, le renversement de Sihanouk contribue à intensifier la rébellion et à faire plonger le Cambodge dans le chaos : les bombardements américains, très meurtriers, poussent eux aussi de nombreux Cambodgiens à rejoindre les Khmers rouges. Sihanouk, exilé à Pékin, forme sur le conseil des Chinois un front uni avec les Khmers rouges, sans avoir de réelle connaissance des événements sur le terrain ni de ses nouveaux alliés[761],[762].
Des négociations laborieuses, menées par l'Américain Henry Kissinger, aboutissent finalement en janvier 1973 à la signature des accords de paix de Paris, qui prévoient le retrait des troupes américaines du Viêt Nam. Au Cambodge, les Khmers rouges, soutenus par la Chine, mènent une « guerre populaire » sur le modèle chinois : ils refusent de participer aux pourparlers de paix, suscitant l'irritation des Nord-Vietnamiens qui cessent de les soutenir, mais perdent par là-même leurs moyens de pression sur eux. Au Laos, le Pathet Lao bénéficie de la situation : un cessez-le-feu est conclu, mettant un terme à la guerre civile laotienne, et un cabinet d'union nationale est formé en [763],[758].
La fin de l'engagement direct des Américains au Viêt Nam est suivi d'un basculement politique dans la péninsule indochinoise : au printemps 1975, Viêt Nam, Cambodge et Laos deviennent des régimes communistes. Les Khmers rouges prennent la capitale cambodgienne Phnom Penh en avril, réussissant à battre de vitesse les Nord-Vietnamiens qui, de leur côté, repassent à l'offensive contre le Sud Viêt Nam et prennent Saïgon. En 1976, le Gouvernement révolutionnaire provisoire du FNL et le Nord Viêt Nam fusionnent : le Viêt Nam est réunifié sous le nom de République socialiste du Viêt Nam tandis que le Parti des travailleurs du Viêt Nam, rebaptisé Parti communiste vietnamien, reste parti unique. Au Laos, le Pathet Lao, mettant notamment à profit la maladie du premier ministre neutraliste Souvanna Phouma, réalise un putsch : le Parti révolutionnaire du peuple lao, qui apparaît désormais au grand jour, prend le pouvoir et la monarchie est abolie. Souphanouvong devient président et Kaysone Phomvihane chef du gouvernement[763],[758].
Dans les années qui suivent, plusieurs centaines de milliers de boat-people fuient le Viêt Nam par voie maritime[764]. Au Laos, devenu République démocratique populaire lao, la proportion de réfugiés est plus importante du fait d'une plus grande facilité à gagner le territoire thaïlandais. La prise de pouvoir par les communistes provoque la fuite à l'étranger, en quelques années, d'environ 400 000 Laotiens, soit 10 % de la population[765],[766]. Le Laos devient un satellite politique du Viêt Nam, les deux pays s'alignant sur l'URSS[767] ; le Viêt Nam rejoint le CAEM (COMECON) en 1978[768].
Massacres au Cambodge et nouveaux conflits en Asie du Sud-Est


La situation est nettement plus dramatique au Cambodge, rebaptisé Kampuchéa démocratique en . Dès leur victoire en , les Khmers rouges mettent en place un régime particulièrement extrémiste et imposent immédiatement l'évacuation des villes. Toutes les agglomérations du pays sont vidées, dans des conditions désastreuses, au nom d'une idéologie ultra-rigoriste visant à punir les populations urbaines jugées décadentes. Les Khmers rouges gouvernent selon une logique de secret, l'identité des véritables dirigeants du pays étant inconnue : Norodom Sihanouk, revenu au pays au bout de plusieurs mois, réalise tardivement la situation mais est réduit à l'impuissance et mis en résidence surveillée. Le secrétaire de l'Angkar, Saloth Sâr alias « Pol Pot », véritable maître du pays depuis , devient premier ministre en [762],[758],[769].
De manière très inhabituelle pour un régime communiste, le Parti au pouvoir n'a aucune activité publique et ne révèle même pas son existence : ce n'est qu'en 1977 que Pol Pot déclare publiquement, lors d'un voyage à Pékin, que l'Angkar, organe de direction des Khmers rouges, est le Parti communiste du Kampuchéa[770]. La population, mise au travail forcée aux champs, est soumise à un arbitraire total, où tout peut devenir prétexte à exécution. Le Kampuchéa démocratique constitue une tentative, à l'échelle du pays, de passer directement au stade du communisme intégral : les Cambodgiens n'ont plus aucun droit à la propriété privée, ni même à la vie privée. Le régime met en œuvre des persécutions ethniques et religieuses, l'incompétence de l'administration khmère rouge contribuant à provoquer une terrible famine. Alors même que des dizaines de milliers de personnes meurent de faim, la cueillette de fruits est punie de mort en tant qu'atteinte à la propriété collective[762],[758],[771].
Au sein même de l'appareil du Kampuchéa démocratique, des purges sanglantes sont mises en œuvre par Pol Pot et son entourage, pour éliminer les Khmers rouges plus modérés, puis pour s'en prendre à tout cadre du régime qui serait devenu suspect pour une raison ou une autre. Entre 10 et 40 % de la population du Cambodge — aucun consensus n'existant sur les chiffres exacts — périt entre 1975 et 1979. La chute des Khmers rouges est finalement provoquée par leurs relations exécrables avec le Viêt Nam, qui tournent bientôt au conflit ouvert. Souhaitant annexer une partie du territoire vietnamien, considéré comme berceau du peuple khmer, Pol Pot ordonne des incursions au Viêt Nam, ce qui provoque la réaction du gouvernement de Hanoï : le , l'Armée populaire vietnamienne envahit le territoire cambodgien ; les Khmers rouges sont chassés du pouvoir en moins de deux semaines[762],[758],[769].
Le Cambodge devient dès lors un théâtre de la rivalité sino-soviétique en Asie du Sud-Est. En , un mois après la chute des Khmers rouges, la Chine attaque le Viêt Nam dans le but avoué de le « punir » de son attaque contre le Cambodge. Le conflit s'arrête au bout d'un mois après de lourdes pertes de part et d'autre et s'achève par le retrait des troupes chinoises. Un régime cambodgien pro-vietnamien, la République populaire du Kampuchéa, est mis sur pied, de même qu'un nouveau parti communiste, le Parti révolutionnaire du peuple du Kampuchéa : une grande partie des cadres du nouveau régime cambodgien sont d'anciens Khmers rouges qui avaient fait défection et choisi le camp vietnamien avant l'invasion. Les Khmers rouges ne désarment cependant pas et, depuis leurs bases situées à la frontière thaïlandaise, continuent de mener des attaques : la République populaire du Kampuchéa n'est pas reconnue par l'ONU, où le régime khmer rouge continue de représenter le Cambodge. Le Viêt Nam, soutenu par l'URSS, s'efforce de soutenir le régime cambodgien ami et de réduire la guérilla des Khmers rouges. Ces derniers sont eux-mêmes alliés à la Chine et aux sihanoukistes ; ils reçoivent également le soutien de la Thaïlande qui souhaite contenir l'expansionnisme vietnamien dans la région et, sur le plan diplomatique, celui des États-Unis qui suivent les mêmes objectifs. Un conflit prolongé se déroule au Cambodge : si les Khmers rouges ne sont pas en situation de vaincre militairement les Vietnamiens, la poursuite de la guérilla prend, pour le Viêt Nam, l'allure d'un bourbier[772].
L'arrivée au pouvoir de Mikhaïl Gorbatchev en URSS change la donne dans les années 1980 : le nouveau secrétaire général du PCUS souhaite se rapprocher de la Chine et, pour ce faire, annonce aux Vietnamiens l'arrêt du soutien soviétique et leur demande de régler leurs différends avec Pékin. Des négociations, laborieuses, sont alors lancées pour parvenir à un accord de paix entre toutes les parties en présence dans le conflit au Cambodge[772].
Mongolie
.svg.png.webp)
En Asie de l'Est, la République populaire mongole connaît en 1952 une transition politique après la mort de Horloogiyn Choybalsan. Yumjagiyn Tsedenbal, déjà secrétaire général du Parti révolutionnaire du peuple mongol, lui succède à la tête du gouvernement. L'industrialisation de l'économie est poursuivie et les institutions du pays sont normalisées, avec, entre les années 1960 et 1970, l'adoption d'un code civil, d'un code pénal, et l'organisation de tribunaux civils et militaires, de collèges d'avocats et des Hourals (parlements) locaux. Le gouvernement s'emploie à réformer la société mongole en luttant contre le nomadisme et en favorisant l'urbanisation[373].
La Mongolie communiste, sortant de son isolement diplomatique, est admise en 1961 à l'ONU et noue des relations diplomatiques avec la plupart des pays du monde. Toujours très étroitement alliée avec l'URSS, la Mongolie intègre en 1962 le Conseil d'assistance économique mutuelle. Tsedenbal réalise des purges régulières dans les appareils de l'État et du Parti mais, contrairement à Choybalsan, s'abstient de faire exécuter les cadres en disgrâce[373].
Corée du Nord

En Corée du Nord, Kim Il-sung profite des infrastructures héritées de la colonisation japonaise pour lancer un programme d'industrialisation intensive, avec l'aide des Soviétiques. Le dirigeant nord-coréen entretient autour de lui-même un culte de la personnalité directement inspiré des modèles stalinien et maoïste, dans le cadre d'un discours de propagande mêlant références communistes et tonalité confucianistes. Durant les années 1950, la Corée du Nord connaît des tensions avec les Soviétiques, Kim Il-sung étant en désaccord avec la déstalinisation. Le dirigeant nord-coréen élimine l'opposition interne au sein du Parti du travail de Corée. S'étant assuré un contrôle total sur le régime et ayant étouffé dans l'œuf toute tentative de déstalinisation, il entreprend ensuite de réduire les références au marxisme-léninisme : avec la collaboration de divers cadres de son régime comme Hwang Jang-yop, il développe sa propre doctrine, le Juche, une idéologie nationaliste fondée sur le concept d'autosuffisance. Aucun traité de paix n'ayant été conclu à l'issue de la guerre de Corée et de la séparation du pays par la zone coréenne démilitarisée, la Corée du Nord se considère toujours comme officiellement en guerre contre la Corée du Sud et les impérialistes américains, les ennemis du pays étant dénoncés par une propagande continuelle[773].
La société nord-coréenne est organisée de manière militarisée : la population est soumise à des contrôles stricts et considérée comme une armée de travailleurs. La Corée du Nord se distingue également par une organisation sociale strictement hiérarchisée - reproduisant les structures sociales de l'ancienne Corée, marquées par l'existence d'une aristocratie héréditaire - et sans prétentions à l'égalitarisme, la figure omniprésente du « grand leader » étant le centre indiscuté du pouvoir politique. La hiérarchisation de la société nord-coréenne va jusqu'à l'emploi, inédit dans le reste du monde communiste, de deux formes différentes du mot « camarade », l'un (tongmu) désignant les égaux et l'autre (tongji) désignant les « camarades » d'un rang supérieur[774].
Inde

En Inde, après le soulèvement tibétain de 1959 qui a ému l'opinion indienne et surtout après la guerre sino-indienne de 1962, le Parti communiste d'Inde se trouve dans une position difficile : par ailleurs, lors de la rupture sino-soviétique, deux factions, l'une « de droite » et plutôt favorable à l'URSS, l'autre « de gauche » et plutôt favorable à la Chine, s'affrontent en son sein. En mai 1964, le Parti scissionne, la gauche formant le Parti communiste d'Inde (marxiste). Les deux organisations sont bientôt opposées par une rivalité particulièrement âpre[775].
Dans le courant des années 1960, le PCI oscille entre l'opposition frontale avec le Congrès et la coopération avec celui-ci[247]. Le PCI(m), de son côté, est isolé sur le plan politique ; mais la situation de ce dernier parti change quand la République populaire de Chine, alors en pleine révolution culturelle, condamne en 1967 sa dérive sur la « voie parlementaire ». La faction maoïste de stricte obédience présente au sein du Parti communiste d'Inde (marxiste) dénonce le « néo-révisionnisme » de leur parti et multiplie les actions violentes[775]. La bourgade de Naxalbari (Bengale-Occidental) devient en 1967 le centre d'un nouveau mouvement paysan inspiré des techniques révolutionnaires de Mao Zedong, qui apparaît lorsqu'une section locale du Parti communiste d'Inde (marxiste) lance une insurrection contre les grands propriétaires[629]. Les radicaux sont exclus du PCI(m) en 1968 : avec le soutien officiel de Pékin, ils fondent l'année suivante le Parti communiste d'Inde (Marxiste–Léniniste). Cette dernière tendance, connue sous le nom de naxalisme, progresse dans les zones tribales en ralliant des paysans pauvres et mène une lutte armée contre le gouvernement. Dès le début des années 1970, cependant, après l'arrestation de ses principaux dirigeants, dont son fondateur Charu Majumdar, le parti naxalite éclate : diverses scissions, comme le Centre communiste maoïste et le Groupe Guerre populaire, poursuivent l'insurrection de manière dispersée[775],[631],[776]. Malgré une sévère répression policière, la rébellion naxalite continue, par la suite, de faire chaque année plusieurs centaines de morts[777].
Le Parti communiste d'Inde et le Parti communiste d'Inde (marxiste) s'en tiennent quant à eux à la voie parlementaire et font de la redistribution des terres agricoles l'un de leurs principaux arguments de campagne. Tout en demeurant dirigés par des intellectuels issus des hautes castes, ils bénéficient d'un électorat représentatif des différentes composantes de la population indienne. En 1971, le PCI passe un accord électoral avec le Congrès dirigé par Indira Gandhi, avec qui il demeure allié lors de l'état d'urgence de 1975. Le Parti communiste d'Inde (marxiste) dépasse alors dans les urnes le PCI historique, rapport de force qui demeure ensuite inchangé. Dans les années 1970, le PCI(m) gagne les élections dans les États du Kerala et du Bengale-Occidental. Jyoti Basu dirige le gouvernement du Bengale-Occidental de 1977 à 2000, ce qui constitue un record de longévité pour un exécutif communiste issu d'un scrutin démocratique. Bien que fonctionnant sur le plan interne selon le système strictement hiérarchisé du centralisme démocratique, le PCI comme le PCI(m) s'intègrent pleinement à la démocratie indienne[247],[775],[631] : les communistes au pouvoir dans des États indiens répriment la rébellion naxalite animée par des extrémistes issus de leurs propres rangs[757].
Pour concurrencer le Congrès, les deux partis communistes indiens adoptent des lignes réformistes : tout en continuant de faire du sort des catégories démunies leur souci prioritaire, les communistes proposent des programmes susceptibles d'attirer la paysannerie moyenne, et ne visent pas à bouleverser la répartition des terres agricoles[777]. Progressivement, les deux PC évoluent vers une forme de social-démocratie, propice aux coopérations avec les capitalistes indiens et étrangers[247]. En 1980, le PCI stagne à 2,6 % des voix au niveau national, tandis que le PCI(m) séduit 6,1 % de l'électorat indien, ses suffrages étant essentiellement concentrés dans ses bastions du Bengale-Occidental et du Kerala[247],[778].
Népal
Au Népal, à partir de 1960, le parti communiste local se divise au sujet des rapports avec le pouvoir en place. L'une de ses factions coopère en effet avec le régime du roi Mahendra, tandis qu'une autre, dont les dirigeants sont exilés en Inde, appelle au renversement de la monarchie. Le PC népalais éclate alors en de multiples tendances : le mouvement communiste népalais devient l'un des plus divisés au monde. À compter de 1985, les communistes participent à la campagne de désobéissance civile qui vise à contraindre le roi Birendra à restaurer la démocratie dans le pays[630].
Japon
Le Parti communiste japonais, légalisé après la Seconde Guerre mondiale, demeure confiné dans l'opposition[631], mais multiplie les démonstrations de force par l'intermédiaire des syndicats et de la Zengakuren (organisation étudiante) qu'il contrôle. Au début de la guerre froide, il est divisé en nombreuses factions, une tendance d'extrême gauche, soutenue par le Parti communiste chinois, étant favorable à des actions armées contre les troupes d'occupation américaines. Au début des années 1950, à l'occasion de la guerre de Corée, des militants communistes japonais rentrent dans la clandestinité et commettent divers attentats ; la faction « aventuriste de gauche » revient ensuite à des actions légales, mais le Parti continue d'être divisé, les courants s'affrontant notamment à l'occasion de la rupture sino-soviétique[779]. À la fin des années 1960, le PCJ, ayant pris ses distances par rapport à la politique de l'URSS, dépasse son niveau électoral de l'immédiat après-guerre, sans pouvoir cependant espérer accéder au pouvoir : peu implanté dans les zones rurales, il se développe surtout en milieu urbain[631].
Une tendance d'extrême gauche, opposée à la ligne du PCJ, voit par ailleurs le jour au sein de la Nouvelle gauche japonaise, dans le contexte de la guerre du Viêt Nam et de la révolution culturelle en Chine : elle donne naissance à divers groupes, dont plusieurs passent à l'action terroriste à la fin des années 1960 et tissent des liens avec des organisations palestiniennes. Une partie de ces militants, expatriés au Proche-Orient pour échapper à la police et chercher des soutiens étrangers, fonde l'Armée rouge japonaise, étroitement alliée au Front populaire de libération de la Palestine ; les groupes terroristes restés sur le sol japonais sont démantelés par la police — l'une des affaires les plus connues étant la dérive sectaire et meurtrière de l'Armée rouge unifiée — mais l'Armée rouge japonaise demeure active au niveau international durant toutes les années 1970[780].
Israël
En 1965, le Maki, le parti communiste d'Israël, connaît une scission : sa faction la plus pro-palestinienne, composée principalement d'Arabes, crée un parti rival, le Rakah. Ce nouveau parti, fortement pro-soviétique et antisioniste, dépasse rapidement dans les urnes le Maki, qui est éliminé de la Knesset lors des élections de 1969. En 1977, le Rakah forme avec le mouvement protestataire des Black Panthers la coalition Hadash. Cette formation, dont le PC israélien est la principale composante, recueille un certain soutien au sein des classes sociales défavorisées — tout en conservant son principal socle électoral dans la communauté arabe israélienne — ce qui lui permet d'obtenir plusieurs députés à la Knesset. L'influence du Hadash tend cependant à décroître à partir de 1984[781],[633].
Iran
En Iran, le Tudeh connaît une longue période de clandestinité après l'opération Ajax de 1953. Autorisé après la révolution iranienne de 1979 et la chute du Chah, il soutient initialement le gouvernement islamique de Khomeini, mais est ensuite à nouveau interdit en 1983[782]. Le mouvement communiste iranien exilé est en outre parcouru de divisions à la fois politiques et ethniques : les militants kurdes opposés à l'orientation pro-soviétique du Tudeh créent ainsi un Parti communiste d'Iran, qui constitue la branche politique des Peshmergas iraniens. Diverses autres organisations communistes existent dans les milieux des exilés politiques iraniens[783].
Monde arabe
.svg.png.webp)
Malgré l'aide que l'URSS apporte aux pays arabes contre Israël, plus largement, son soutien aux mouvements de libération nationale, le communisme ne pénètre que difficilement dans le monde arabe où la majorité des mentalités ne lui sont pas favorables. Dans les années 1950, l'URSS et la Chine se livrent à des prospections politiques au Moyen-Orient, se rapprochant de l'Égypte et de la Syrie. En Égypte, les groupes communistes, divisés et qui se disputent le titre de Parti communiste égyptien, demeurent interdits ; cependant, à la faveur de la crise de Suez, Nasser, modère son anticommunisme et noue de bonnes relations avec l'URSS. Mais, en dépit de ces alliances et des efforts de Khrouchtchev en ce sens, les partenaires arabes de l'URSS se montrent peu enclins à rejoindre le « camp socialiste ». Le régime de Nasser, qui réalise de nombreuses nationalisations dans les années 1960, est qualifié par les Soviétiques de pays « sur la voie de la construction socialiste »[784] : le Parti communiste égyptien n'en est pas pour autant autorisé. En 1958-1959, au moment de l'union de l'Égypte et de la Syrie au sein de la République arabe unie, Nasser réprime les communistes avec brutalité et fait arrêter nombre d'entre eux. En 1965, une organisation se présentant comme le Parti communiste égyptien annonce son autodissolution. La création de la République arabe unie a également des conséquences pour le Parti communiste syrien, qui est interdit en 1958 pour s'être opposé à l'union avec l'Égypte de Nasser[636],[628].
En Irak, après le renversement de la monarchie, les partis politiques sont autorisés mais deux factions distinctes du Parti communiste irakien demandent séparément leur légalisation. Le général Abdel Karim Kassem, nationaliste de gauche au pouvoir après la révolution, n'autorise que la faction communiste qui lui est favorable, l'autre restant dans l'illégalité[636] ; mais l'activisme des communistes pousse rapidement le premier ministre irakien à tenter de réduire l'influence de ses alliés[628]. En 1963, lors du renversement de Qasim par le Parti Baas, le Parti communiste est à nouveau interdit, puis violemment réprimé pour avoir tenté de s'opposer aux baasistes[636].
Dans le Maghreb, les partis communistes qui avaient contribué au combat anti-colonial sont mis hors-la-loi après les indépendances de leurs pays respectifs. Le Parti communiste marocain est interdit en 1959. Le Parti communiste tunisien est interdit en 1963 par le gouvernement de Habib Bourguiba, et n'est à nouveau autorisé qu'en 1981. Le Parti communiste algérien, après avoir participé à la lutte pour l'indépendance, est interdit en 1964, le FLN se réservant le rôle de parti unique. Ahmed Ben Bella, président algérien de 1962 à 1965, conseillé par le trotskyste Michel Pablo, se montre ouvert aux expériences autogestionnaires. Le successeur de Ben Bella, Houari Boumédiène, opte en revanche pour une industrialisation inspirée de celle de l'URSS. La place tenue par le FLN en Algérie, très comparable à celle du PCUS en URSS, témoigne elle aussi de la puissance d'attraction du système politique soviétique[785].
En 1967, la guerre des Six Jours constitue dans un premier temps un camouflet pour l'URSS, par laquelle ses alliés arabes se jugent insuffisamment soutenus. Mais, à moyen terme, elle permet aux Soviétiques de renforcer leur influence dans la région, en fournissant armes et expertises aux pays arabes voisins d'Israël[786]. La défaite de Nasser lors du conflit contre Israël contribue également à la naissance d'un régime marxiste-léniniste dans la région : dans le Sud du Yémen, le Front de libération nationale, que Nasser avait soutenu, s'éloigne de son ancien protecteur égyptien pour se rapprocher de l'URSS. Ayant pris le pouvoir, le Parti socialiste yéménite (nouveau nom du Front de libération nationale) proclame la République démocratique populaire du Yémen (ou Yémen du Sud), unique régime communiste du Moyen-Orient. Le fait que les socialistes arabes aient perdu la face lors de la guerre des Six Jours contribue à renforcer l'influence du communisme dans le monde arabe, au détriment du nationalisme arabe classique qui se trouve désormais concurrencé par de nouvelles organisations marxistes-léninistes. Le Front populaire de libération de la Palestine, pour qui la lutte pour la création d'un État palestinien s'inscrit dans un combat anti-impérialiste plus global, devient ainsi une composante de l'OLP[757].
Les relations de l'Égypte avec le monde communiste se dégradent dès le début des années 1970 : après avoir signé en 1971 un traité d'amitié et de coopération avec l'URSS, l'Égypte rompt avec Moscou l'année suivante, Anouar el-Sadate se méfiant des communistes. L'URSS doit alors repenser son système d'alliances au Moyen-Orient et concentre une grande partie de son aide sur l'OLP[784].
En Syrie, après la prise du pouvoir par Hafez el-Assad en 1971, le Parti communiste syrien est à nouveau autorisé. Il s'allie avec le nouveau régime et intègre le Front national progressiste, la coalition dirigée par le Parti Baas. Les relations entre communistes et baasistes se dégradent cependant et le PC est interdit en 1981. Mais, en raison du virage pro-américain de l'Égypte qui suit la signature des accords de Camp David, l'URSS mise de plus en plus sur son alliance avec la Syrie. Assad, notamment pour complaire à son allié soviétique, lève en 1986 l'interdiction du PC syrien, qui redevient membre du Front et est autorisé à avoir un petit nombre d'élus à l'Assemblée du peuple. Mais le parti se scinde alors en deux, en raison de rivalités personnelles mais aussi de désaccords tenant à la gestion des rapports avec le régime d'Assad et à la Perestroïka : les deux factions demeurent alliées et subordonnées au Baas. À côté de ces deux PC syriens « officiels » existe également une autre scission, opposée à la collaboration avec le régime d'Assad et réduite à la clandestinité[787],[636],[788].
Le Parti communiste irakien est lui aussi autorisé en 1973 par le nouveau régime baasiste : comme son homologue syrien, il rejoint le Front national animé par le Baas irakien. Mais, contrairement à la situation syrienne, cette alliance est rompue dès la fin des années 1970, quand le PC fait à nouveau l'objet d'une répression sanglante. Renvoyé dans la clandestinité sous la présidence de Saddam Hussein, le Parti communiste irakien reçoit l'aide de la Syrie, soutient la lutte des Kurdes d'Irak et prend le parti de l'Iran lors de la guerre Iran-Irak[636],[789],[790].
Durant les années 1970, de nombreux terroristes d'inspiration communiste sont par ailleurs actifs dans le monde arabe et au Moyen-Orient, où ils participent à la lutte pour l'indépendance de la Palestine : c'est notamment le cas de l'Armée secrète arménienne de libération de l'Arménie, de l'Armée rouge japonaise, ou du vénézuélien Ilich Ramírez Sánchez alias « Carlos ». Le Front populaire de libération de la Palestine assure la formation de terroristes occidentaux et asiatiques[791],[792].
Turquie
En Turquie, les communistes demeurent confinés dans l'illégalité : ils tentent à plusieurs reprises d'en sortir, mais sans succès, et les divers groupes-paravents animés au fil des décennies par le Parti communiste de Turquie clandestin sont interdits les uns après les autres. Le mouvement communiste turc se divise ensuite en multiples tendances. Le Parti des travailleurs du Kurdistan, groupe indépendantiste kurde, se réclame lui aussi du marxisme-léninisme[635].
Intervention soviétique en Afghanistan
.svg.png.webp)
En Asie centrale, l'Afghanistan devient en 1979 une cible de la politique étrangère soviétique, bien que l'intervention de l'URSS ait été moins motivée par des visées expansionnistes que par le désir d'éviter le chaos dans un pays voisin. Mohammed Daoud Khan, président depuis le renversement de la monarchie en 1973, entretient d'abord d'excellentes relations avec l'URSS, ainsi qu'avec le PC local, le Parti démocratique populaire d'Afghanistan. Mais, à partir de 1977, ses relations avec les communistes se dégradent[793]. Le PC afghan est alors divisé en deux groupes : le Khalq, plus radical, est dirigé par Hafizullah Amin et Nour Mohammad Taraki ; l'autre, le Parcham, plus modéré, par Babrak Karmal. L'URSS, qui désire avant tout éviter que la situation dégénère en Afghanistan, soutient quant à elle la faction de Karmal[794].
En , le Khalq organise un coup d'État, la « révolution de Saur » : Daoud est tué et la première république afghane laisse la place à la République démocratique d'Afghanistan, dont Taraki devient le président. Si l'URSS a été irritée par l'initiative « gauchiste » des communistes afghans, elle pense néanmoins gagner un allié supplémentaire. Mais le régime communiste afghan applique sa politique de manière désorganisée et brutale, persécute l'islam, impose à la population une idéologie marxiste-léniniste qui lui est totalement étrangère et use de mesures de terreur : des soulèvements éclatent rapidement. Hafizullah Amin, nommé premier ministre en mars 1979, multiplie les arrestations et monte la société civile contre lui ; sa brutalité inquiète les Soviétiques, qui suggèrent à Taraki de le faire destituer. Certaines avancées sociales sont réalisées, en développant l'enseignement et en accordant aux femmes des droits équivalents à ceux des hommes : mais ces mesures progressistes, qui suscitent l'hostilité des fondamentalistes religieux, ne font qu'accroître l'opposition au régime. Entretemps, les tensions entre factions communistes afghanes ne se sont pas calmées : Karmal et ses alliés du Parcham sont marginalisés, et envisagent de mener un coup d'État avec l'aide des Soviétiques ; les relations entre leaders du Khalq se dégradent et Amin envisage de plus en plus ouvertement de prendre la place de Taraki[795],[794].
En septembre 1979, Taraki est renversé par Amin, qui le fait ensuite assassiner en prison. La situation chaotique en Afghanistan pousse les Soviétiques à intervenir et l'Armée rouge - officiellement sur « sollicitation » de Babrak Karmal - envahit l'Afghanistan en décembre. Amin est tué lors de l'assaut de sa résidence par les Soviétiques ; Karmal le remplace aussitôt[794]. Destinée à ramener le calme, l'invasion soviétique aboutit à un résultat diamétralement inverse. Le soulèvement des moudjahidines s'intensifie et reçoit bientôt des renforts de combattants islamiques étrangers : l'URSS se trouve dès lors impliquée dans une guerre d'Afghanistan à la fois financièrement ruineuse, militairement sans issue et désastreuse sur le plan de l'image. Les États-Unis, par l'entremise de leur allié le Pakistan, s'emploient à soutenir les rebelles afghans afin de contribuer à l'enlisement des Soviétiques dans un conflit comparable à ce que fut pour eux le Viêt Nam[794],[796].
La République démocratique d'Afghanistan, étroitement contrôlée par les Soviétiques[797], apparaît totalement dépendante de ces derniers, le Parti au pouvoir ne bénéficiant d'aucun soutien populaire notable[794]. Karmal, quant à lui, ne parvient ni à stabiliser les institutions du pays, ni à imposer son autorité sur l'ensemble du parti communiste afghan, qui demeure divisé en factions[798]. La poursuite de la guerre en Afghanistan suscite un mécontentement croissant au sein de la société soviétique, mais ni Léonid Brejnev, ni ses successeurs Iouri Andropov et Konstantin Tchernenko, n'infléchissent leur politique. Il faut attendre l'arrivée au pouvoir de Mikhaïl Gorbatchev pour que l'URSS change de cap[794] : le nouveau dirigeant fait du règlement de la situation afghane l'une de ses priorités[799]. Karmal, ayant perdu la confiance des Soviétiques, doit quitter le pouvoir et cède la place en 1986 à Mohammed Nadjibullah. Ce dernier, avec le soutien de l'URSS, lance une politique de « réconciliation nationale » pour tenter de préserver le régime, dont le caractère proprement communiste est progressivement abandonné : en 1987, notamment, l'Afghanistan adopte une nouvelle constitution qui reconnaît l'islam comme religion d'État[800]. Gorbatchev décide entretemps du retrait des troupes soviétiques d'Afghanistan : le désengagement de l'URSS est achevé en février 1989[794].
La difficile implantation du communisme en Afrique
L'Afrique noire ne fait pas partie des priorités du mouvement communiste avant 1945. Après la Seconde Guerre mondiale, l'URSS joue dans le tiers-monde la carte du soutien aux dirigeants nationalistes, en lutte pour la décolonisation ou déjà au pouvoir et porte un intérêt accru à l'Afrique. Le Parti communiste français s'emploie à former des cadres politiques africains, en métropole ou sur place, comme le Guinéen Ahmed Sékou Touré : en 1946, ce dernier participe à la création du Rassemblement démocratique africain, apparenté jusqu'en 1951 au groupe parlementaire communiste français. En 1958, Sékou Touré devient le président de la Guinée indépendante. L'URSS soutient le gouvernement de Patrice Lumumba au Congo et crée ensuite l'université Patrice Lumumba, destinée à accueillir et à former des cadres africains. L'URSS fonde également quelque espoir sur le Ghana de Kwame Nkrumah et sur le Mali de Modibo Keïta. La hâte de Khrouchtchev à conclure des alliances en Afrique aboutit cependant à une série d'échecs : rapidement, l'URSS est inquiète du manque de cohérence idéologique de ses alliés et des voies peu orthodoxes qu'ils empruntent. Si le Mali procède à des nationalisations et à des créations de coopératives rurales, il néglige la mise en place d'une organisation de masse ; les résultats de la planification économique du Ghana apparaissent bien modestes et Nkrumah conserve un système d'économie mixte. Les socialistes Sékou Touré — malgré des références marxistes-léninistes apparues plus tardivement — Nkrumah et Keïta ne prétendent pas à une identité communiste[801]. La Guinée, dès 1961, reproche aux Soviétiques leur ingérence dans ses affaires intérieures et expulse l'ambassadeur d'URSS. Le gouvernement de Nkrumah est renversé en 1966 et celui de Keïta en 1968[785],[802],[803].
En 1963, Alphonse Massamba-Débat, président de la République du Congo, devient le premier chef d'État africain à se réclamer ouvertement du marxisme : le nouveau régime donne asile au Mouvement populaire de libération de l'Angola (MPLA), qui mène alors une guerre d'indépendance contre le Portugal. Che Guevara, parti de Cuba pour exporter la révolution, vise le continent africain qui lui paraît un point faible de l'impérialisme et arrive en République du Congo pour un premier contact avec le MPLA. Ses rencontres suivantes avec des guérillas africaines comme le Front de libération du Mozambique (FRELIMO, également en lutte contre le colonisateur portugais) sont cependant décevantes, Guevara ne parvenant pas à persuader les Africains de l'intérêt d'un front uni. Guevara et les Cubains interviennent dans la crise de l'ex-Congo belge mais leur soutien aux guérilleros congolais, dirigés notamment par Laurent-Désiré Kabila, tourne au fiasco. Guevara sort déçu de son expérience africaine, jugeant le nationalisme africain insuffisamment mûr et trop peu pénétré par le marxisme. La présence des Cubains de l'entourage de Guevara a cependant des conséquences en République du Congo, où elle contribue à radicaliser certains éléments du régime. Le marxisme gagne également en influence dans les rangs indépendantistes, durant les guerres coloniales portugaises des années 1960 : le FRELIMO de Samora Machel, le MPLA d'Agostinho Neto et le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert (PAIGC) d'Amílcar Cabral évoluent tous, à des degrés divers, vers l'engagement communiste au détriment des groupes nationalistes traditionnels, et pratiquent leur propre version de la « guerre populaire » maoïste. Au sud du continent africain, les mouvements de guérilla gagnés au communisme ont également une influence sur les insurrections contre les gouvernements blancs d'Afrique du Sud et de Rhodésie. Le MPLA et le FRELIMO apportent leur soutien à d'autres mouvements, y compris non communistes, comme la SWAPO, alors que les guerres d'indépendance dans les colonies portugaises influent sur celle du Sud-Ouest africain (future Namibie) et sur la guerre du Bush de Rhodésie du Sud[803].
En Afrique du Sud, le Parti communiste sud-africain (SACP), interdit depuis les années 1950, repense son idéologie et conclut à la possibilité de s'allier à des nationalistes non communistes du fait de la situation spécifique du pays. Le PC s'allie alors au Congrès national africain (ANC) dans le cadre de la lutte contre l'Apartheid. Tant sur le plan de l'action syndicale que sur celui de la lutte armée, le SACP et l'ANC tissent des liens étroits : le leader communiste Joe Slovo (Blanc d'origine lituanienne) joue un rôle important dans la formation des guérilleros de l'ANC. L'URSS préfère cependant afficher son alliance avec l'ANC qu'avec le SACP, dont la plupart des dirigeants sont blancs et qui fait donc figure de combattant moins typiquement « africain » contre l'Apartheid. Des cadres de l'ANC reçoivent une formation à Moscou mais l'alliance ANC-SACP ne contribue pas à une radicalisation communiste de l'ANC : les communistes sud-africains jouent en effet la prudence et ne mettent pas leur idéologie au premier plan, préférant se présenter avant tout comme des combattants contre le régime d'Aparheid[804],[785],[280].
Basculements de pays africains dans le camp communiste

Entre 1969 et 1975 le communisme fait d'importants progrès en Afrique noire, à la faveur de l'instabilité politique et des guérillas. Malgré des revers comme au Soudan - le Parti communiste soudanais, très actif et lié aux syndicats, échoue dans sa tentative de coup d'État en juillet 1971 et est ensuite brutalement réprimé par le président Gaafar Nimeiry[805] - plusieurs régimes d'inspiration communiste sont proclamés sur le continent. En Somalie, l'assassinat en octobre 1969 du président Shermarke provoque un vide politique : l'armée, qui compte dans ses rangs de nombreux officiers sympathisants du marxisme, prend le pouvoir, et la République démocratique somalie est proclamée. Le général Siyaad Barre, chef de la junte militaire somalienne, se rapproche rapidement de l'URSS et proclame son adhésion au « socialisme scientifique ». En République du Congo, le président Alphonse Massamba-Débat est contraint par des éléments plus radicaux à quitter le pouvoir : la République populaire du Congo est proclamée le sous la présidence de Marien Ngouabi. Le Parti congolais du travail, fondé pour l'occasion, devient parti unique. Ngouabi est assassiné en 1977 ; Joachim Yhombi-Opango lui succède à la tête d'un Comité militaire du parti, mais il se rend vite impopulaire et doit céder la place deux ans plus tard à Denis Sassou-Nguesso. En novembre 1974, Mathieu Kérékou, président du Dahomey, proclame l'adhésion de son pays au marxisme-léninisme : le pays est rebaptisé l'année suivante République populaire du Bénin[806],[785],[807]. À Madagascar, le directoire militaire instaure, en décembre 1975, une nouvelle constitution « socialiste » : Didier Ratsiraka devient président de la République démocratique de Madagascar, régime d'inspiration nettement marxiste-léniniste[808].
Guerres et terreur en Éthiopie

L'Empire d'Éthiopie, où Haïlé Sélassié Ier a négligé de traiter les profondes inégalités sociales, est renversé en septembre 1974 par le Derg, une junte militaire, qui proclame le Gouvernement militaire provisoire de l'Éthiopie socialiste. La proclamation d'un régime ami en Éthiopie bouleverse pour l'URSS la donne dans la corne de l'Afrique, l'Éthiopie étant un pays autrement plus développé et puissant que la Somalie, jusque-là le seul allié soviétique dans la région. Somalie et Éthiopie sont opposées depuis longtemps par un conflit territorial, que l'URSS et Cuba tentent vainement de régler : quand, en 1977, la tension somalo-éthiopienne débouche sur la guerre de l'Ogaden, l'URSS et Cuba choisissent de soutenir l'Éthiopie de Mengistu Haile Mariam, qui leur paraît un allié plus intéressant. Siyaad Barre rompt alors avec l'URSS et se rapproche de l'Occident et des monarchies arabes, en conservant officiellement l'idéologie marxiste-léniniste qui est cependant mise au second plan au profit de l'islam[806],[785],[807],[809].
Le soutien de l'URSS à l'Éthiopie ne va cependant pas sans paradoxes, le régime de Mengistu étant dépourvu d'institutions stables comme de véritables repères idéologiques : tout en se réclamant du « socialisme » et du marxisme-léninisme, le chef de guerre au pouvoir s'abstient dans un premier temps de créer un parti communiste, réprimant même les marxistes éthiopiens du Mouvement socialiste pan-éthiopien et du Parti révolutionnaire du peuple éthiopien. Ce n'est qu'en 1984 que, sur l'insistance des Soviétiques, Mengistu fonde le Parti des travailleurs d'Éthiopie pour servir de parti unique à son régime. Par la suite, durant la période de la perestroïka, Mengistu tente de renforcer sa légitimité en stabilisant les institutions du pays : en 1987 - soit treize ans après la révolution éthiopienne - une constitution est adoptée, et la République démocratique populaire d'Éthiopie officiellement proclamée. Entretemps, l'Éthiopie traverse des périodes particulièrement tragiques et violentes, avec une campagne de répression extrêmement meurtrière, la terreur rouge éthiopienne, une guerre civile contre les divers opposants et les indépendantistes du Front populaire de libération de l'Érythrée - eux-mêmes, à l'origine, d'obédience marxiste - ainsi qu'une terrible famine en 1984-1985. Le soutien à un régime comme celui de Mengistu finit par semer le trouble chez de nombreux responsables soviétiques dès la fin des années 1970[806],[785],[807],[809].
Guerres civiles en Angola et au Mozambique
.svg.png.webp)
Les guerres d'indépendances dans les colonies portugaises s'achèvent par l'accession au pouvoir des guérillas marxistes : l'indépendance est accélérée par la révolution des Œillets au Portugal, elle-même provoquée en partie par le mécontentement suscité par les guerres coloniales. Le FRELIMO proclame l'indépendance de la République populaire du Mozambique mais doit par la suite mener une guerre civile contre la RENAMO ; le MPLA proclame quant à lui en novembre 1975 la République populaire d'Angola mais se trouve aussitôt en situation de guerre civile avec l'UNITA, le principal mouvement indépendantiste concurrent[809],[807],[810],[785].
Le conflit angolais, particulièrement violent, continue de déborder sur la frontière sud-africaine. Le MPLA est soutenu par l'URSS et Cuba, tandis que l'UNITA reçoit l'appui des États-Unis et de l'Afrique du Sud : cette guerre civile marque le sommet de l'interventionnisme cubain en Afrique, l'armée cubaine remportant même une victoire retentissante lors d'un affrontement avec les troupes sud-africaines[809]. Au Mozambique, la RENAMO reçoit elle aussi le soutien des États-Unis, de l'Afrique du Sud et, jusqu'en 1979, de la Rhodésie. Comme au temps de la guerre d'indépendance, le FRELIMO continue d'intervenir dans la guerre du Bush, où le régime mozambicain et ses alliés apportent une aide importante à la ZANU de Robert Mugabe contre le gouvernement rhodésien[811].
Des pays « d'orientation socialiste »
En 1980, sept régimes africains se réclament du marxisme-léninisme, d'autres de diverses formes de socialisme. L'historien David Priestland fait à cet égard une distinction entre les pays se proclamant marxistes-léninistes et ceux pratiquant une variation de socialisme, parmi lesquels il range entre autres la Guinée-Bissau, le Cap-Vert, les Seychelles et Sao Tomé-et-Principe[810]. Les régimes communistes africains ne se distinguent cependant pas par une cohérence idéologique particulière, le marxisme-léninisme professé par leurs dirigeants apparaissant à bien des égards très superficiel[807] : l'historien Archie Brown considère pour sa part qu'aucun des régimes africains ne réunit les critères d'organisation politique et économique permettant de les considérer comme des État communiste. L'URSS éprouve certaines difficultés à définir politiquement ses alliés africains, qu'elle range finalement dans la catégorie des « États d'orientation socialiste » : la liste dressée par l'URSS pour classer les régimes de ce type inclut également des pays socialistes non communistes comme l'Algérie et la Tanzanie[809],[812],[785].
Première vague de guérillas

En Amérique latine, Cuba s'efforce d'exporter sa révolution, Fidel Castro et Che Guevara considérant de leur devoir d'aider les peuples opprimés du continent. Guevara publie en 1960 La Guerre de guérilla, ouvrage dans lequel il détaille les techniques de guérilla et, se plaçant dans la tradition de Mao Zedong et de Hô Chi Minh, théorise la guerre révolutionnaire par le biais du foco (feu) soit de l'action menée par une force armée, d'ampleur réduite mais représentant l'avant-garde révolutionnaire, et qui servira de déclencheur à des incendies révolutionnaires dans le tiers-monde. Le souhait de Guevara est de contribuer à créer « deux, trois, de nombreux Viêt Nam » en Amérique du Sud. À travers l'Amérique latine, la révolution cubaine a un effet galvanisant : les Cubains assurent la formation de plus de mille révolutionnaires venus du continent, mais l'exemple cubain suffit à ce que de nombreux groupes, d'inspiration directement castriste ou bien maoïste, pro-soviétique ou trotskyste, prennent les armes en Amérique latine au début des années 1960[813],[814].
Entre 1960 et 1967, les mouvements de guérilla touchent une vingtaine de pays sur le continent américain. Certains ne sont que des tentatives avortées - la majorité des mouvements de guérilla, d'ampleur réduite, ne bénéficient pas d'un large soutien populaire - d'autres ont des effets durables, leur influence étant surtout importante au Venezuela, au Guatemala et en Colombie. Les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC), fondées par Manuel Marulanda et Jacobo Arenas et initialement coordonnées avec le Parti communiste colombien, apparaissent après la destruction par l'armée de la « zone organisée du mouvement paysan » de la République de Marquetalia. Cette première vague de guérillas souffre de plusieurs handicaps, notamment l'inexpérience militaire de la majorité des guérilleros, à l'exception des Tupamaros en Uruguay et de certains officiers guatémaltèques et vénézuéliens. Les guérillas échouent de plus dans la plupart des cas à mobiliser les paysans qu'elles étaient censées libérer. Inefficaces dans les pays sud-américains les plus dictatoriaux, les luttes armées communistes se développent avec plus de succès dans les pays davantage démocratisés, où elles ont pour principale conséquence de favoriser en réaction la montée du militarisme. La plupart des partis communistes locaux se montrent quant à eux particulièrement réticents face aux insurrections armées, beaucoup s'étant liés par des alliances avec des partis « bourgeois ». L'interventionnisme cubain en Amérique latine suscite dans un premier temps l'agacement de l'URSS, qui juge la politique de Castro irréaliste, coûteuse, et gênante alors que les Soviétiques cherchent à poursuivre la détente avec les États-Unis. Un modus vivendi est ensuite trouvé entre l'URSS et Cuba sur le soutien apporté aux luttes armées sur le continent. La première vague de guérillas, victime de son manque de moyens militaires et de divisions politiques incessantes, échoue largement, bien que certains mouvements comme, en Colombie, les FARC (qui perdent avec le temps leurs liens avec le PC colombien) et l'Armée de libération nationale (ELN), parviennent à exister sur la durée. Che Guevara lui-même, revenu d'Afrique, fonde en 1966 l'Armée de libération nationale de Bolivie ; il échoue totalement dans sa guérilla bolivienne et est tué le . La mort de Guevara contribue à lui conférer une aura de « martyr » et une popularité allant bien au-delà des rangs communistes, faisant de lui un symbole du tiers-mondisme, de l'anti-impérialisme, et plus largement de la révolte[813],[814].
Coup d'État au Chili contre la coalition socialistes-communistes
En 1970, la coalition de l'Unidad Popular, qui comprend le Parti socialiste et le Parti communiste, accède démocratiquement au pouvoir lors de l'élection de Salvador Allende à la présidence de la République. Allende plaide pour un passage démocratique et pacifique au socialisme, et doit souvent composer avec les membres les plus radicaux de sa coalition. Son gouvernement met en œuvre une politique de nationalisations et de contrôle des prix, mais l'ensemble des mesures entraîne une crise économique au Chili. Une visite de Fidel Castro au Chili, en 1971, a en outre des effets négatifs sur l'image d'Allende, en augmentant l'inquiétude des milieux d'affaires et de l'armée. Le mécontentement populaire grandit face à la politique économique d'Allende, qui court bientôt le risque d'être victime d'un coup d'État. Le général Augusto Pinochet est nommé par Allende à la tête des forces armées pour garantir la sécurité, mais mène ensuite lui-même, avec le soutien de la CIA, le coup d'État du 11 septembre 1973, au cours duquel Allende trouve la mort, et qui met fin au gouvernement de l'Unidad Popular[815].
Deuxième vague de guérillas

À partir des années 1970, les guérillas latino-américaines, d'inspiration castriste, guévariste, ou au contraire maoïste, connaissent un regain d'activité, tout particulièrement en Amérique centrale. Elles sont stimulées par un vaste ensemble de luttes armées à travers le monde (Viêt Nam, Angola, Mozambique, Cambodge…), le succès de la révolution sandiniste au Nicaragua en 1979 leur apportant un second souffle décisif[816],[817].
L'Armée de guérilla des pauvres puis l'Unité révolutionnaire nationale guatémaltèque au Guatemala, le Front Farabundo Martí de libération nationale au Salvador, le Mouvement révolutionnaire Tupac Amaru au Pérou, entre autres, mènent une lutte armée contre leurs gouvernements respectifs[816],[817]. Au Pérou, le Sentier lumineux, apparu en 1970 en tant que scission pro-chinoise du Parti communiste péruvien, se mue dans les années 1980 en un mouvement de guérilla à l'idéologie particulièrement radicale, dirigé par Abimael Guzmán alias « président Gonzalo ». Guzmán se veut porteur d'un maoïsme spécifiquement andin, désigné du nom de « pensée Gonzalo » : son organisation applique dans les régions rurales sous son contrôle un régime de terreur, imposant aux paysans une subordination totale au Sentier lumineux[818].
Le régime sandiniste au Nicaragua
Au Nicaragua, un mouvement de guérilla arrive au pouvoir en 1979 quand le Front sandiniste de libération nationale, d'inspiration castriste, parvient à renverser le régime dictatorial du président Somoza. Daniel Ortega, l'un des dirigeants sandinistes, devient chef de l'État. Soutenus par les pays communistes et notamment par Cuba, les sandinistes entreprennent de mettre en œuvre un projet « révolutionnaire » mais sans interdire les partis d'opposition ni procéder à une étatisation totale de l'économie. La révolution nicaraguayenne ne va pas au bout de la transformation du pays en régime communiste, un secteur privé continuant de cohabiter avec un secteur étatisé, dont le poids finit cependant par constituer un frein à l'économie[819] : les influences politiques des sandinistes, qui se veulent porteurs d'un projet politique original, sont éclectiques, mêlant le castrisme, le maoïsme, le marxisme soviétique, la social-démocratie européenne, la théologie de la libération et une touche d'anarcho-syndicalisme[820].
Le régime sandiniste connaît bientôt une dérive autoritaire et les journaux d'opposition subissent régulièrement des interdictions temporaires. Le gouvernement d'Ortega, qui a fortement développé les forces armées, doit immédiatement faire face à la guérilla anti-révolutionnaire des Contras, ensemble d'opposants bientôt soutenus financièrement par les États-Unis, lesquels voient d'un mauvais œil l'apparition d'un régime pro-castriste. Daniel Ortega est réélu à l'élection présidentielle de 1984, boycottée par l'opposition, mais la dégradation économique du pays entraîne une montée du mécontentement populaire[819],[820].
Révolution et invasion à la Grenade
À la Grenade, État insulaire situé dans la Caraïbe, les méthodes de plus en plus autocratiques du premier ministre Eric Gairy entraînent, cinq ans après l'indépendance du pays, un coup d'État mené en mars 1979 par le New Jewel Movement, parti pro-castriste. Maurice Bishop devient premier ministre du Gouvernement révolutionnaire populaire de la Grenade : les relations se tendent rapidement avec les États-Unis et la Grenade se rapproche ouvertement de Cuba. Le gouvernement du New Jewel Movement suspend la constitution du pays — qui demeure cependant officiellement un royaume du Commonwealth avec Élisabeth II comme chef d'État officiel — et, malgré la mise en place d'organes censés garantir la démocratie directe sur l'île, le comité central du Parti demeure l'unique véritable centre de décision et planifie une transition vers le « socialisme ». Principalement par l'entremise de Cuba, la Grenade établit des liens avec les autres régimes communistes. La dépendance économique du pays envers le tourisme en provenance d'Amérique du Nord pousse cependant Bishop à tenter, en 1983, de renouer des relations cordiales avec les États-Unis. Mais quelques mois plus tard, la rivalité entre le premier ministre grenadien et l'aile plus radicale du New Jewel Movement, peut-être influencée par l'URSS, tourne au conflit ouvert. En octobre, Bishop est renversé puis exécuté par ses opposants au sein du Parti : un gouvernement militaire prend le pouvoir. Ronald Reagan saisit ausitôt cette occasion, ainsi que le prétexte de la présence de militaires et coopérants cubains sur l'île, pour renverser le gouvernement grenadien. Les États-Unis envahissent la Grenade avec le soutien de divers États de la Caraïbe : les troupes grenadiennes et cubaines sont aisément défaites, et le régime du New Jewel Movement cesse d'exister[821].
Dans les démocraties occidentales
Les partis communistes et, plus largement, l'idéologie et la perception du communisme, connaissent, dans les pays occidentaux et industrialisés, d'importantes variations à partir des années 1950 et surtout de la décennie suivante. L'invasion de la Tchécoslovaquie, la détente entre l'Est et l'Ouest représentée par l'Ostpolitik du chancelier ouest-allemand Willy Brandt amènent les partis communistes de plusieurs pays européens à affirmer — à des degrés très variables — leur autonomie vis-à-vis de l'URSS et à se rapprocher des partis socialistes[822]. Parallèlement, diverses formes de « gauchisme », de mouvements d'extrême gauche et de pensées marxistes alternatives se développent en Occident dans les années 1960-1970, souvent en réaction contre le communisme soviétique[823]. Si divers PC demeurent puissants dans plusieurs pays d'Europe occidentale, la crise du communisme européen devient patente dans les années 1980[824].
France
.JPG.webp)
En France, Le PCF, initialement hostile à la Cinquième République, s'adapte ensuite pleinement à ses institutions ; il apparaît encore, en 1962, comme le parti dominant à gauche face à la SFIO. Le PCF se convertit à la déstalinisation et suit la ligne réformatrice de l'URSS. Sous l'impulsion de Waldeck Rochet, successeur de Maurice Thorez, le Parti entreprend de se rapprocher des classes moyennes. Déconcerté par les événements de Mai 68 qu'il peine à analyser, secoué par l'écrasement du printemps de Prague qui pousse Waldeck Rochet à exprimer sa « réprobation »[825], le PCF conserve cependant un électorat important. Il remporte même un succès inattendu lors du premier tour de la présidentielle de 1969, Jacques Duclos attirant 21,27 % des suffrages (soit un score plus de deux fois supérieur à celui annoncé par les premiers sondages)[826],[827].
Au début des années 1970, le PCF, désormais dirigé par Georges Marchais, se rapproche du Parti socialiste de François Mitterrand, avec lequel il signe en un programme commun de gouvernement : l'Union de la gauche frôle la victoire lors de la présidentielle de 1974[822]. Georges Marchais doit cependant osciller entre des influences antagonistes, privilégiant selon le contexte son alliance avec les socialistes ou l'état des relations avec l'URSS[828]. Dans le courant des années 1970, le PCF apparaît encore comme un parti dynamique, dont le nombre d'adhérents a doublé depuis la décennie précédente[829].
Italie

En Italie, le PCI connaît, au moment de l'insurrection de Budapest, des remous internes : des intellectuels sympathisants publient en 1956 le « manifeste des 101 » pour protester contre l'intervention soviétique. Palmiro Togliatti s'oppose à cette initiative et refuse dans un premier temps la déstalinisation[830], mais se convertit ensuite au changement et théorise dès 1957 une « voie italienne vers le communisme ». Tout en se montrant lui-même très prudent dans son évolution vers plus d'indépendance, le leader du PCI favorise l'ascension de cadres plus jeunes comme Enrico Berlinguer ou Giorgio Napolitano, partisans du recentrage du Parti. Tout en demeurant allié de l'URSS et officiellement favorable au modèle soviétique, le Parti communiste italien gagne en autonomie et en liberté de ton, jusqu'à devenir l'un des PC occidentaux les plus indépendants[831],[830].
Le PCI profite également du déclin du Parti socialiste italien qui, à partir du début des années 1960, s'allie à la Démocratie chrétienne et perd dès lors une partie de son électorat, permettant aux communistes d'apparaître comme le seul parti d'opposition de gauche. Le rapport des forces politiques entraîne cependant, jusqu'à la fin de la guerre froide, une anomalie au sein de la démocratie italienne : le fait que le PCI soit dominant à gauche, tout en demeurant à la fois exclu des coalitions gouvernementales et en dessous du seuil électoral qui lui permettrait d'accéder au pouvoir, a en effet pour conséquence d'empêcher une véritable alternance politique en Italie. Le PCI progresse encore aux élections générales, remportant 25,3 % des voix en 1963, puis 26,9 % en 1968. Il demeure cependant, dans un premier temps, divisé entre sa droite, menée par Giorgio Napolitano, qui souhaite participer aux réformes de l'État, et sa gauche, menée par Pietro Ingrao, qui souhaite s'appuyer sur les mouvements sociaux. En 1969, le PCI réprouve l'écrasement du printemps de Prague ; il se refuse néanmoins à suivre la revue Il Manifesto, trop critique à l'égard de l'URSS, et exclut ses animateurs[830]. Le groupe de Il Manifesto fusionne ensuite avec le Parti d'unité prolétarienne, pour former en 1974 le Parti d'unité prolétarienne pour le communisme, qui obtient plusieurs élus au parlement[832].
Dans les années 1970, le PCI bénéficie de sa politique de recentrage, ainsi que des scandales à répétition qui frappent la Démocratie chrétienne : il gagne ainsi plus de 200 000 adhérents entre 1970 et 1976. En 1973, Enrico Berlinguer, devenu l'année précédente secrétaire général du PCI, propose à la DC un « compromis historique », soit un modus vivendi qui pourrait évoluer vers un accord de gouvernement. En juin 1975, le PCI triomphe aux élections administratives, ce qui lui permet de gérer un grand nombre de villes et de régions[830] : un mois plus tard, Berlinguer participe au lancement de l'eurocommunisme. L'année suivante, lors des élections générales, le PCI remporte un succès sans précédent, avec 34,4 % des voix ; en vertu de la ligne du compromis historique, il soutient sans y participer l'action des gouvernements de la majorité démocrate-chrétienne. Pietro Ingrao devient en 1976 président de la Chambre des députés ; trois ans plus tard, il est remplacé par Nilde Iotti, autre personnalité du PCI et ex-compagne de feu Palmiro Togliatti, qui conserve ce poste jusqu'en 1992. L'entrée du PCI dans un gouvernement de coalition, dans le cadre du compromis historique, est sérieusement envisagée. Mais en 1978, le leader de la DC Aldo Moro, qui était favorable au compromis, est enlevé puis assassiné par les Brigades rouges. Le PCI voit alors s'éloigner la perspective d'une participation au pouvoir, mais n'en soutient pas moins le gouvernement en condamnant fermement les Brigades rouges après un moment d'hésitation. En compensation de son absence de portefeuilles ministériels, il obtient une partie des postes du système étatique et para-étatique. Cependant, sa base militante comprend mal ses positions[830],[833],[829]. Le PCI poursuit son recentrage jusqu'à s'apparenter progressivement, dans les faits, à un parti social-démocrate[831].
Finlande
La Ligue démocratique du peuple finlandais, coalition dirigée par le Parti communiste de Finlande (SKP), conserve un nombre non négligeable d'élus au parlement, bien qu'elle ne constitue plus le groupe le plus important. Le PC finlandais connaît cependant des divisions internes, entre une tendance modérée, soucieuse de s'entendre avec les autres partis finlandais, et une tendance plus orthodoxe : à partir de 1960, la première tendance prend l'avantage au sein du Parti[562]. Recueillant environ 15 % des suffrages au début des années 1970, le SKP est le parti communiste d'Europe occidentale le mieux intégré dans la vie politique de son pays[834]. En vertu de la politique d'amitié avec l'URSS suivie par le président Kekkonen, le Parti communiste participe à nouveau, entre 1966 et 1981, à plusieurs gouvernements de coalition avec le Parti social-démocrate et le Parti du centre[835].
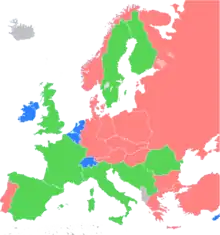
Grèce
Le Parti communiste de Grèce (KKE) est autorisé après la chute, en 1974, de la dictature des colonels. Cependant, alors qu'il avait été auparavant, faute de la présence d'un parti social-démocrate fort, le principal parti à gauche de l'échiquier politique grec, le KKE doit désormais affronter la concurrence du PASOK, qui reprend une partie de ses revendications. Les socialistes grecs dépassent vite les communistes et deviennent le principal parti d'opposition, avant d'accéder au pouvoir en 1981. Tout en conservant un électorat non négligeable, avec des scores qui avoisinent les 10 %, le KKE demeure dans l'opposition[568].
Durant toute la période des années 1970-années 1980, au contraire de la majorité des principaux PC ouest-européens, le KKE s'en tient à une ligne pro-soviétique orthodoxe, et rejette les infléchissements idéologiques de l'eurocommunisme. Outre la concurrence du PASOK, il doit également affronter celle du Parti communiste de Grèce (intérieur) (KKE esot), une dissidence apparue durant la période de la dictature et qui rassemble les partisans d'un « socialisme à visage humain ». Bien que populaire parmi les jeunes militants et l'intelligentsia, le KKE esot ne parvient cependant pas à dépasser le KKE, qui continue d'attirer la majorité des électeurs communistes grecs[568]. À la fin des années 1980, le KKE et l'ex-KKE esot (devenu la Gauche grecque) s'unissent, avec d'autres partis de gauche, au sein de la coalition du Rassemblement de la gauche et du progrès (Synaspismós), qui va jusqu'à conclure un accord avec le parti conservateur Nouvelle Démocratie contre le PASOK, en vue du scrutin de 1989. Cette alliance provoque cependant l'incompréhension de l'électorat, et se traduit par un recul du score des communistes. Un gouvernement de transition réunissant la droite, les socialistes et Synaspismós est formé après les élections anticipées de , sans convaincre davantage : les communistes reculent à nouveau lors du nouveau scrutin anticipé d'[836].
Saint-Marin
À Saint-Marin, le Parti communiste saint-marinais revient au pouvoir en 1978 à la faveur d'une nouvelle coalition, formée cette fois avec le Parti socialiste unitaire. Ce micro-État a ainsi la particularité d'être à deux reprises, durant la guerre froide, la seule démocratie européenne dirigée par un gouvernement à majorité communiste. En 1986, un scandale financier entraîne la fin de la coalition au pouvoir. Le Parti communiste forme alors une nouvelle alliance, cette fois avec le Parti démocrate-chrétien saint-marinais, parti conservateur qui était auparavant son principal adversaire[585],[837].
Espagne
Le Parti communiste d'Espagne, illégal durant la période franquiste, infléchit notablement ses positions durant les années d'exil : en 1968, il prend ses distances avec l'URSS en condamnant l'écrasement du printemps de Prague. Durant la transition démocratique, le PCE doit attendre — soit la veille des premières élections libres post-franquistes — pour être légalisé, alors que les autres partis l'ont été un an avant. Durant la transition, le PC joue ensuite la carte de la conciliation avec la monarchie et les autres partis : son secrétaire général, Santiago Carrillo, tient par ailleurs un rôle moteur dans le mouvement de l'eurocommunisme. Le parti communiste ne parvient cependant pas à s'assurer le leadership de la gauche espagnole : malgré ses efforts, il ne réussit à se défaire ni de son image de parti inféodé à l'URSS, ni du souvenir de la guerre civile. Il est dès lors largement distancé par les socialistes. Après avoir attiré plus de 10 % des suffrages lors du scrutin de 1979 — ce qui représente son maximum historique — le PCE descend à moins de 5 % lors des élections de 1982, remportées par le Parti socialiste ouvrier espagnol. La politique eurocommuniste du PCE entraîne également des scissions : durant les années 1980, le PCE coexiste avec deux groupes dissidents, le Parti communiste d’Espagne unifié — remplacé en 1986 par le Parti communiste des peuples d'Espagne — et le Parti communiste ouvrier espagnol[838],[829],[839].
En crise après sa défaite de 1982, le PCE exclut en 1985 divers proches de son chef Santiago Carrillo : ce dernier quitte alors le parti et fonde un mouvement dissident, le Parti des travailleurs d'Espagne – Unité Communiste qui, tout en se réclamant de l'eurocommunisme, reçoit le soutien de Ceaușescu et de Kim Il-sung. La scission de Carrillo ne réussit cependant pas à s'imposer sur le terrain électoral[840],[841]. À la fin des années 1980, le PCE parvient à retrouver un second souffle en s'alliant avec le Parti communiste des peuples d'Espagne au sein de la Gauche unie : cette coalition, profitant de l'impopularité des mesures d'austérité du PSOE, dépasse 9 % des suffrages lors des élections de 1989[842].
Chypre
Le Parti progressiste des travailleurs (AKEL, ex-Parti communiste de Chypre), interdit au début de la guerre froide, est autorisé en 1959 après l'indépendance du pays. Le coup d'État et l'invasion turque de 1974, puis la division de Chypre, permettent à l'AKEL de profiter du mécontentement populaire et de gagner des électeurs. Dans les années 1970-1980, il devient l'un des principaux mouvements de la partie grecque de l'île et pèse sur les scrutins présidentiels[265].
Portugal
Au Portugal, la chute du régime de l'Estado Novo en 1974 est favorisée par les guerres coloniales contre les guérillas communistes africaines : la révolution des Œillets conduit à la légalisation des partis politiques précédemment interdits, dont le Parti communiste portugais dirigé par Álvaro Cunhal. Le PCP rejoint la coalition hétéroclite au pouvoir après la révolution — Cunhal est ministre sans portefeuille, jusqu'en août 1975, dans plusieurs gouvernements provisoires successifs — et se livre bientôt à des démonstrations de force, notamment en mobilisant les défavorisés pour demander une redistribution des terres et des réformes en matière de logement. L'agitation politique au Portugal est accompagnée de heurts violents entre militants de droite et de gauche : des commentateurs comparent bientôt la situation portugaise au contexte espagnol de 1936. Le secrétaire d'État américain Henry Kissinger craint à l'époque que le Portugal rejoigne le bloc communiste. Mais, lors des élections constituantes de 1975, le Parti communiste est largement distancé par la gauche modérée. D'une manière générale, les Portugais les plus pauvres, que le PCP tente de mobiliser contre les socialistes, bénéficient des réformes lancées par le gouvernement et ne désirent pas une transformation radicale de la société : la possibilité d'une révolution communiste au Portugal est bientôt écartée[843].
Bien que maintenu dans l'opposition, le PCP conserve par la suite, comme son homologue grec, un électorat non négligeable : il recueille autour de 15 % des voix lors de certaines élections législatives, voire 20 % lors de quelques scrutins locaux[839].
Belgique
Le Parti communiste de Belgique (PCB), affaibli au début des années 1950 après sa rupture avec les socialistes, se renforce en renouant avec ses anciens alliés. Le PCB est l'un des rares partis communistes ouest-européens dont les résultats électoraux s'améliorent quelque peu dans les années 1960 : il obtient six députés en 1961. Malgré ces relatifs progrès, il demeure confiné dans l'opposition. Inégalement implanté dans le pays, il attire surtout des électeurs dans les régions ouvrières wallonnes et rencontre peu de succès en Flandre. Le Parti du travail de Belgique, un parti marxiste-léniniste de type stalinien, lui fait par ailleurs concurrence à partir de 1979. Au début des années 1980, le PCB décline à nouveau, du fait d'importantes dissensions internes entre les partisans de l'eurocommunisme et ceux d'un soutien inconditionnel à l'URSS, ainsi que des désaccords entre Wallons et Flamands. Lors des élections de 1985, le PCB perd ses deux derniers députés au parlement fédéral. Il connaît, surtout du côté flamand, des vagues de départs : en 1986, l'aile flamande ne compte plus que quelques centaines de militants. En mars 1989, le PCB se sépare en deux partis distincts, l'un francophone et l'autre flamand[581],[844],[845],[846].
Royaume-Uni
Le Parti communiste de Grande-Bretagne perd environ un tiers de ses adhérents au moment de la déstalinisation et surtout après l'insurrection de Budapest. Par la suite, le parti évolue vers des positions proches de l'eurocommunisme : sa direction condamne l'invasion soviétique de l'Afghanistan et l'état de siège en Pologne, sans que cela permette au PC britannique d'améliorer ses scores électoraux. Les communistes perdent également en influence dans le milieu syndical, et ne conservent une certaine aura que grâce à la prestigieuse revue Marxism Today, qui leur permet de continuer à toucher des milieux intellectuels[847].
Suède
Le PC suédois est perturbé en interne par la déstalinisation et les révélations du rapport Khrouchtchev, qui conduisent une partie des cadres à prôner davantage d'indépendance vis-à-vis de l'URSS. En 1964, l'équipe du dirigeant stalinien Hilding Hagberg est remplacée par une nouvelle direction, qui adopte une ligne à la fois plus modérée et plus nationaliste. Trois ans plus tard, le PC se rebaptise Parti de gauche - Les communistes (VPK). La tendance « anti-révisionniste » fonde alors un Parti communiste de Suède pro-chinois : cette scission maoïste demeure marginale et subit elle-même en 1970 la scission de son aile radicale. L'évolution du VPK lui permet de réaliser des gains électoraux durant les années 1970 : il passe de trois sièges au parlement en 1968, à vingt en 1982. Tout en restant minoritaire, le Parti de gauche n'en a pas moins un nombre d'élus suffisant pour que les sociaux-démocrates puissent trouver un intérêt à s'allier avec lui : après les élections de 1985, le premier ministre Olof Palme est amené, du fait de sa faible majorité au parlement, à compter sur le soutien du VPK[848].
Autres pays d'Europe du Nord
En Scandinavie, contrairement à leurs homologues finlandais et suédois, les PC danois et norvégiens demeurent marginaux. Le Parti communiste du Danemark fait quelque progrès dans les années 1970 : il atteint son maximum en 1975 avec 4,2 % des voix, ce qui lui permet d'être représenté au Folketing. Mais il décline ensuite et n'attire plus que 1 % de l'électorat durant la décennie suivante : il continue cependant à exercer une certaine influence sur le terrain syndical et obtient un élu au parlement de Strasbourg en participant à des listes anti-européennes. Le Parti communiste norvégien est le PC le plus faible d'Europe occidentale : lors des élections de 1973, il bénéficie cependant de sa coalition avec le Parti socialiste populaire, qui lui permet d'être représenté au Storting. Mais, après ce succès inespéré, la stratégie d'ouverture à gauche des Norvégiens est condamnée par l'URSS. Contraint de renoncer à son alliance, le PC norvégien s'effondre : en 1985, il n'attire plus que 0,2 % des électeurs[849],[847]. En Islande, le PC local a cessé d'exister avant-guerre et formé avec des dissidents du Parti social-démocrate un nouveau mouvement, le Parti de l'unité du peuple - Parti socialiste ; ce parti, où les communistes représentent la majorité, participe brièvement à un gouvernement de coalition mais doit le quitter en 1956, après l'insurrection de Budapest. En 1968, le Parti de l'unité du peuple - Parti socialiste fusionne au sein d'un nouveau parti de gauche, l'Alliance du peuple[850].
Le Parti communiste des Pays-Bas est lui aussi marginal : s'il obtient encore 4,5 % des voix lors des élections de 1972, il chute à 1,7 % cinq ans plus tard[849]. Le Parti communiste luxembourgeois obtient dans les régions sidérurgiques de bons résultats qui lui garantissent des sièges au parlement. Au niveau national, ses scores, qui tournent autour de 8 % au milieu des années 1970[849], ne lui permettent pas d'exercer de réelle influence ; le PCL décline dès la fin de cette décennie et n'a plus que deux députés en 1979[851]. Le Parti communiste d'Irlande est, quant à lui, un petit parti sans représentation parlementaire[849].
États-Unis

Aux États-Unis, le Parti communiste USA (CPUSA), dont le leader Gus Hall se contente de défendre systématiquement la ligne de l'URSS, demeure insignifiant sur le plan politique. Il bénéficie un temps de la notoriété de l'une de ses membres, Angela Davis, également membre du Black Panther Party et protagoniste d'une affaire politico-judiciaire très médiatisée entre 1969 et 1972 : la célébrité de cette militante, si elle associe le CPUSA à une figure familière du grand public, ne se traduit cependant pas en résultats électoraux. Gus Hall se présente aux élections présidentielles de 1972, 1976, 1980 et 1984, avec Angela Davis comme colistière dans les deux derniers cas : lors de ces scrutins, le CPUSA obtient respectivement 0,03 %, 0,07 %, 0,05 % et 0,04 % des suffrages nationaux[852].
Canada
Le Parti communiste du Canada, affaibli au début de la guerre froide après l'emprisonnement de plusieurs de ses cadres à la suite d'une affaire d'espionnage au profit de l'URSS, connaît une relative résurgence dans les années 1960 grâce à sa présence dans les milieux syndicaux. Il n'est cependant plus représenté au parlement, et sa branche francophone, le Parti communiste du Québec, demeure particulièrement faible. Le PC canadien connaît en outre des dissidences à la suite de la rupture sino-soviétique. Outre l'éphémère scission, en 1965, du Progressive Workers Movement, un Parti communiste du Canada (marxiste-léniniste) lui fait concurrence à partir de 1970[581].
Australie et Nouvelle-Zélande
En Océanie, les PC locaux perdent l'essentiel de leurs militants dès le début de la guerre froide. Les résultats électoraux du Parti communiste d'Australie et du Parti communiste de Nouvelle-Zélande demeurent par la suite négligeables, bien que le PC australien parvienne, un temps, à exercer quelque influence au sein de certains syndicats[853]. Le PC néo-zélandais est notamment marginalisé du fait de sa conversion au maoïsme[689],[854].
L'eurocommunisme
En tant que parti communiste le plus puissant d'Europe de l'Ouest, le Parti communiste italien bénéficie de son statut de principal parti d'opposition et progresse sur le plan électoral dans les années 1960-70. En juillet 1975, alors que le PCI, en pleine période du compromis historique, poursuit son essor électoral, Berlinguer et le secrétaire général du Parti communiste d'Espagne, Santiago Carrillo, publient une déclaration commune qui lance le mouvement dit de l'eurocommunisme : mettant en avant les spécificités de l'Europe de l'Ouest, les dirigeants communistes italien et espagnol réfutent le concept d'idéologie officielle d'État et remettent en question l'orthodoxie soviétique. Le Parti espagnol va jusqu'à retirer de ses statuts la référence au léninisme : il continue à se dire « marxiste » et « révolutionnaire », mais se veut également « démocratique ». Carrillo, qui cite le printemps de Prague comme l'élément décisif de son évolution, pousse l'audace jusqu'à suggérer qu'un modèle démocratique de socialisme européen pourra amener à la démocratisation des pays de l'Est. Georges Marchais, pour des raisons essentiellement tactiques, se joint au mouvement de l'eurocommunisme[855], le Parti communiste français prenant à cette occasion les plus grandes distances de son histoire avec l'URSS[856].
En 1976, la notion de dictature du prolétariat est abandonnée par le PCF[857] et le PCE[858]. Plusieurs partis européens cessent également de faire figurer dans leurs statuts des références au marxisme-léninisme. Le Parti communiste japonais se joint lui aussi au mouvement des PC ouest-européens[855]. A contrario, le Parti communiste de Grèce n'adhère pas à l'eurocommunisme, dont les partisans se trouvent surtout dans les rangs du PC grec concurrent, le Parti communiste de Grèce (intérieur)[568].
Très critiqué par le PCUS et les autres PC du bloc de l'Est[855], l'eurocommunisme tourne finalement court[859], mais il contribue à semer le trouble dans l'appareil soviétique, influençant notamment des cadres aux idées réformatrices[855].
Déclin électoral des partis italien, français et finlandais

Le Parti communiste italien et le Parti communiste français demeurent, jusqu'à la fin de la guerre froide, les deux PC les plus importants d'Europe de l'Ouest. Le Parti communiste de Finlande est quant à lui intégré pendant une longue période dans les coalitions gouvernementales. Dans les années 1970-1980, cependant, tous subissent à des degrés divers une série de crises d'identité, jusqu'à entrer chacun dans une phase de déclin. En 1979, le PCI sort de la majorité parlementaire pour revenir dans l'opposition ; il demeure important sur le plan électoral et Nilde Iotti conserve le poste de présidente de la chambre des députés jusqu'en 1992. Mais dès 1979, ses résultats s'érodent, tandis que le Parti socialiste italien regagne progressivement des électeurs[824].
La prise de distance du PCI avec Moscou s'accentue quand Enrico Berlinguer condamne, en 1980, l'intervention soviétique en Afghanistan ; en 1981, à la suite des évènements de Pologne, le dirigeant communiste italien prend acte publiquement de l'épuisement définitif de la « force progressiste » issue de la révolution bolchevique. Dans le même temps, et malgré ses critiques de plus en plus ouvertes envers l'URSS, le Parti communiste italien continue d'affirmer la supériorité du système soviétique et s'abstient de soutenir les dissidents du bloc de l'Est[824]. Bien que ses rapports avec Moscou se dégradent, le renouvellement idéologique du Parti communiste italien est trop lent et trop ambigu pour convaincre au-delà de son électorat traditionnel, dont il cherche à ménager la sensibilité ; la politique de « changement dans la continuité » suivie par Berlinguer semble en outre dépassée face aux mutations de la société italienne. Le recentrage du PCI lui avait permis d'attirer de nouveaux électeurs dans les années 1970 mais la modération de son discours érode ensuite sa crédibilité en tant que parti d'opposition, tandis qu'elle déçoit le noyau dur traditionnel de son électorat[860]. Si le PCI absorbe en 1984 le Parti d'unité prolétarienne pour le communisme[832], il continue d'être concurrencé à l'extrême gauche par divers mouvements, comme Démocratie prolétarienne qui dispose de plusieurs élus au parlement[861].
Le déclin électoral du parti italien est moindre que celui de son homologue français et il demeure majoritaire à gauche durant toute son histoire ; le PCI, qui soutient durant les années 1980 les réformes de Mikhaïl Gorbatchev, apparaît néanmoins isolé et sans perspective à la fin de la décennie. Alors que le communisme mondial est en crise, la mort de Berlinguer prive en 1984 le PCI d'un chef charismatique et populaire. Lors des élections de 1987, le score du PCI descend à 26,6 %, soit son plus mauvais résultat depuis vingt ans[830],[862]. En 1989, il compte 400 000 adhérents de moins qu'en 1977[829].
Le PCF est quant à lui rejeté dans l'isolement lors de la rupture, en 1977, de son alliance avec le Parti socialiste[863]. Après l'épisode de l'eurocommunisme, le PCF revient en 1978-1979 à des positions pro-soviétiques plus orthodoxes, à l'époque même où les communistes italiens, au contraire, s'éloignent de plus en plus de l'URSS : dans son rapport introductif au XXXIIIe congrès de , Georges Marchais estime que les pays communistes, bien qu'ils se heurtent à des problèmes « liés à une méconnaissance persistante de l'exigence démocratique universelle dont le socialisme est porteur », n'en présentent pas moins un « bilan globalement positif ». Le PCF soutient ensuite la guerre d'Afghanistan et l'État de siège en Pologne : il pense ainsi retrouver ses marques et son identité en se réalignant sur l'URSS, mais le calcul se révèle désastreux, du fait de la détérioration de l'image de l'Union soviétique dans l'opinion française. Lors de l'élection présidentielle de 1981, Georges Marchais obtient 15,35 % des voix, score considéré alors comme très décevant. Quelques semaines plus tard, lors des législatives, le PCF perd près de la moitié de ses députés. Les communistes intègrent néanmoins le gouvernement d'union de la gauche, mais ses ministres ne parviennent guère à peser sur les décisions de l'exécutif. Lors des élections européennes de 1984, la liste communiste obtient 11,20 % des voix, ce qui constitue alors pour le PCF son plus mauvais score national de l'après-guerre. Un mois plus tard, en désaccord avec le tournant de la rigueur, le PCF rompt à nouveau avec les socialistes et quitte le gouvernement[864].
Les contestations se multiplient au sein du PCF[825]. À partir de 1984, les rénovateurs, qui critiquent le centralisme démocratique et les pays de l'Est, se constituent en courant. Leur porte-parole, Pierre Juquin, est exclu du bureau politique l'année suivante[865]. Le PCF poursuit ensuite son déclin électoral et lors de l'élection présidentielle de 1988, son candidat, André Lajoinie, n'obtient que 6,76 % des suffrages[864]. Le parti connaît de nombreux départs : certains ex-communistes français se rapprochent des écologistes, à l'image de Pierre Juquin qui présente une candidature dissidente à la présidentielle de 1988 ; d'autres rejoignent le PS, d'autres enfin se recentrent sur l'action syndicale ou associative[865].
En Finlande, les communistes, qui refusent de soutenir les mesures d'austérité économique, rompent en 1983 avec leurs alliés[866]. Ayant quitté la majorité gouvernementale, le SKP est en outre affaibli par les divisions entre sa tendance modérée, incarnée par le président Aarne Saarinen, et sa tendance conservatrice et prosoviétique, dirigée par le vice-président Taïsto Sinisalo. Ses résultats électoraux baissent sensiblement. Le Parti finit par scissionner : les fédérations orthodoxes, exclues lors du congrès de 1985, fondent l'année suivante le Parti communiste de Finlande (Unité) (SKPy), avec le soutien de l'URSS. Le départ des prosoviétiques ne suffit cependant pas à enrayer le déclin électoral des communistes finlandais[867],[868].
Variations et renouvellements du marxisme
Dans l'ensemble des pays occidentaux et à la suite de la déstalinisation, la pensée marxiste connaît une période de foisonnement théorique, notamment dans les années 1960-70 : si certaines démarches intellectuelles se situent dans la ligne du stalinisme, d'autres en divergent au contraire radicalement. Associées pour certaines à la mouvance de la Nouvelle gauche, elles alimentent la démarche du marxisme critique, qui contribue à faire progressivement perdre leur aura d'autorité aux interprétations soviétiques du marxisme[869]. Des philosophes comme Maurice Merleau-Ponty[870], Jean-Paul Sartre[871], Herbert Marcuse[872], Cornelius Castoriadis[645], Lucio Colletti[872] ou Louis Althusser[873], proposent leurs interprétations de la théorie marxiste, aux côtés ou indépendamment des appareils militants. La relecture critique du marxisme par des auteurs comme Castoriadis nourrit un agrégat de courants d'« ultragauche », qui remettent en cause le léninisme en s'appuyant sur Marx et adoptent généralement le credo conseilliste[874]. Associés à l'ultragauche sans y être totalement assimilables, les situationnistes en arrivent à remettre en question la politique elle-même[875]. Des publications comme la New Left Review au Royaume-Uni[872], ou Socialisme ou barbarie en France[645], accueillent des analyses pointues sur la théorie marxiste et la nature de l'URSS en tant qu'État[872].
Au sein même du PCF, Roger Garaudy, partisan d'un « marxisme humaniste », s'oppose aux disciples d'Althusser, qui se rapprochent ensuite des thèses pro-chinoises[876]. La redécouverte de l'œuvre complexe et hétérodoxe d'Antonio Gramsci contribue à enrichir la réflexion théorique en Italie ; dans la période post-1968, notamment, le « gramscisme » suscite de nombreux débats[877]. Toujours en Italie, les philosophes Raniero Panzieri, Mario Tronti et Toni Negri sont les principaux représentants, à partir des années 1960, d'un courant connu sous le nom d'opéraïsme (soit « ouvriérisme », de l'italien operaio signifiant ouvrier). Né dans le contexte du miracle économique italien et de l'industrialisation du pays, l'opéraïsme vise à adapter le cadre de réflexion marxiste aux nouvelles réalités sociales, prône le refus radical de l'organisation capitaliste du travail[878],[879], et préconise les grèves sauvages[880].
Développement et déclin du maoïsme
Sur le plan militant, de multiples groupes d'extrême gauche se perpétuent ou apparaissent, proposant des visions du communisme très différentes de celles des partis communistes dominants dans leurs pays, mais de manière souvent diamétralement opposées entre elles. Des groupes maoïstes opposés à la déstalinisation naissent dans les années 1960 après la rupture sino-soviétique en se séparant des PC pro-Soviétiques, comme le Parti communiste marxiste-léniniste de France (PCMLF), dirigé par le dissident du PCF Jacques Jurquet[881], la scission pro-chinoise du Parti communiste de Belgique dirigée par Jacques Grippa[685], ou le Parti communiste d'Italie (marxiste-léniniste), scission du PCI. À une époque où les informations concrètes sur le régime de Mao en Chine sont rares et proviennent souvent de sources de propagande chinoises, le maoïsme apparaît comme une alternative séduisante pour de nombreux militants communistes[872].
La mouvance maoïste se répartit globalement en deux tendances : l'une, incarnée en France par le PCMLF, s'attache, par « anti-révisionnisme », aux formes traditionnelles du communisme ; la seconde exalte le rôle des « masses » et se veut plus « spontanéiste », ce qui vaut à ses tenants le sobriquet de « mao-spontex ». Cette tendance est représentée en France par des groupes comme la Gauche prolétarienne ou Vive la révolution. D'autres groupes apparaissent en France, comme l'Union des jeunesses communistes marxistes-léninistes ou l'Union des communistes de France marxiste-léniniste formée par des adhérents du PSU et animée notamment par le philosophe Alain Badiou. Michel Foucault, un temps proche des « maos », contribue à faire du département de philosophie du Centre universitaire de Vincennes un bastion maoïste. Les groupes maoïstes, par leur radicalisme et leur apparente nouveauté, séduisent certaines personnalités de l'intelligentsia et du monde culturel comme Jean-Paul Sartre et ont une influence et une visibilité disproportionnée par rapport à leurs effectifs souvent très réduits. Ils se perdent cependant dans un activisme souvent brouillon et disparaissent pour la plupart avec le temps[882],[883].
Le mouvement de réforme lancé en Chine par Deng Xiaoping à la fin de la décennie 1970 porte un coup décisif au militantisme maoïste déjà déclinant en Occident. Dans divers pays, après la rupture sino-albanaise, divers groupes se tournent vers le soutien à la République populaire socialiste d'Albanie. Ces partis « anti-révisionnistes », parmi lesquels on compte le Parti communiste des ouvriers de France, le Parti communiste d'Allemagne/Marxistes-léninistes, le Parti communiste du Canada (marxiste-léniniste) ou le Parti communiste d'Espagne (marxiste-léniniste), sont de dimensions souvent très modestes : le courant stalinien « pro-albanais » n'en est pas moins présent sur divers continents[884],[885]. Certains des groupes maoïstes les plus radicaux, à l'image du Parti communiste révolutionnaire américain de Bob Avakian, fondent en 1984 une nouvelle internationale, le Mouvement révolutionnaire internationaliste. Elle réunit pour l'essentiel des groupuscules — et quelques mouvements armés comme le Sentier lumineux péruvien — et se révèle vite incapable de sortir de la marginalité, surtout en Europe[886].
Les mouvements trotskystes
Les trotskistes français demeurent profondément divisés depuis le schisme provoqué par Michel Pablo. À la fin des années 1950, « Hardy » et Bois relancent l'Union communiste ; celle-ci se fait notamment connaître en éditant le bulletin Voix ouvrière[647],[648]. En Argentine, Juan Posadas ambitionne de prendre le contrôle de l'Internationale : vite marginalisé, il structure son courant autour de son journal Voz proletaria et fonde une Quatrième internationale dite « posadiste », à la ligne résolument tiers-mondiste, qui essaime notamment en Argentine, au Mexique et au Chili[651],[652].
En 1960, Pablo est incarcéré pour ses activités durant la guerre d'Algérie : Pierre Frank prend alors le contrôle du PCI. Une grande partie des trotskystes et anciens trotskystes français rejoignent le Parti socialiste unifié. Pablo, après sa libération, s'expatrie en Algérie où il devient conseiller du président Ahmed Ben Bella et s'active dans les milieux tiers-mondistes internationaux, rencontrant entre autres Che Guevara. La chute de Ben Bella en 1965 met un terme à l'influence de Pablo ; les pablistes sont évincés par Pierre Frank[887]. Ce n'est qu'en 1963, après plus de dix ans de déchirements, qu'est fondé le Secrétariat unifié de la Quatrième Internationale[888].
Dans années 1960, les lambertistes sont devenus la principale composante du trotskysme français : sur le plan international, ils sont notamment en liaison avec les Boliviens du Parti ouvrier révolutionnaire et les trotskystes britanniques, influents sur la gauche du Parti travailliste. Pierre Frank obtient quant à lui le ralliement du Parti socialiste des travailleurs américain de James P. Cannon, qui rompt avec Lambert[887].

Les mouvements français se renforcent à partir de la fin des années 1960, sans surmonter leurs divisions. Interdit en 1968, Voix ouvrière renaît sous le nom de Lutte ouvrière (LO), qui donne son nom au mouvement : le groupe de « Hardy » anime également l'Union communiste internationaliste[647],[648]. Frank encourage quant à lui l'entrisme au sein du PCF. Certains de ses partisans, comme Alain Krivine, intègrent ainsi l'Union des étudiants communistes : exclus en 1965, ils fondent la Jeunesse communiste révolutionnaire qui, en 1968, fusionne avec le Parti communiste internationaliste pour fonder la Ligue communiste[887].
Alain Krivine est le candidat de la Ligue communiste à l'élection présidentielle de 1969, à laquelle il obtient 1,06 % des suffrages ; après l'interdiction de la Ligue communiste en 1973, le parti est remplacé par la Ligue communiste révolutionnaire (LCR), que Krivine représente à nouveau à l'élection de 1974. Il est cependant cette fois en concurrence avec Arlette Laguiller, candidate de Lutte ouvrière. Krivine obtient 0,37 % des voix, et Laguiller 2,33 %[647],[887],[648]. Dans les années suivantes, le trotskysme français reste divisé : LO continue à présenter régulièrement Arlette Laguiller aux élections présidentielles en adoptant des positions strictement ouvriéristes ; la LCR, soutenant diverses causes comme la légalisation des drogues douces, se montre plus « moderne » et plus en phase avec les radicalités post-1968 ; les lambertistes (successivement représentés par l'OCI, puis par le Parti communiste internationaliste, le Mouvement pour un parti des travailleurs et enfin le Parti des travailleurs) se concentrent essentiellement sur l'entrisme au sein des syndicats - notamment à Force ouvrière - et de la franc-maçonnerie[887], et sur la défense de divers acquis sociaux tout en tenant un discours catastrophiste sur le capitalisme international. Les militants de la LCR, comme les lambertistes, essaiment dans les syndicats, les associations et les partis socialistes, où ils pratiquent l'entrisme. Cependant, un certain nombre de militants ainsi « infiltrés » dans les appareils s'éloignent progressivement du trotskysme, et font ensuite carrière au sein de la gauche modérée. D'autres rompent plus rapidement avec le trotskisme en passant directement de l'extrême gauche à la gauche réformiste[889],[890].
Cette division du trotskysme se retrouve dans d'autres pays, comme le Royaume-Uni où coexistent le Workers Revolutionary Party de Gerry Healy, le Socialist Workers Party de Tony Cliff, ainsi que la Militant tendency de Peter Taaffe, Ted Grant et Alan Woods, qui se consacre surtout à l'entrisme au sein du Parti travailliste[883] et fonde en 1974 sa propre Internationale, le Comité pour une Internationale ouvrière. En Argentine, le Parti révolutionnaire des travailleurs éclate en plusieurs tendances quelques années après sa création[891].
Durant la première moitié des années 1970, les mouvements trotskystes bénéficient de l'atmosphère d'effervescence révolutionnaire en Europe et en Amérique latine. De nouveaux groupes apparaissent dans des pays comme la Suisse, la Norvège ou le Danemark, tandis que des formations plus anciennes se renforcent. En Espagne, durant les dernières années du franquisme, une Ligue communiste révolutionnaire espagnole est fondée et l'ETA annonce son ralliement à la IVe Internationale[891]. En Belgique, une Ligue révolutionnaire des travailleurs est créée en 1971[883]. Les espoirs révolutionnaires des trotskystes, cependant, ne se concrétisent pas, que ce soit en Europe où l'extrême gauche demeure marginale, ou dans le contexte des guérillas sud-américaines. En Argentine, notamment, les trotskystes sortent décimés de leur participation à la lutte armée contre le gouvernement péroniste. En outre, le trotskysme international connaît une nouvelle scission en 1979-1980 lors de la fondation, sous l'impulsion des lambertistes, d'un Comité d'organisation pour la reconstruction de la IVe Internationale[891].
Au Royaume-Uni, l'influence de Militant au sein du Labour donne des arguments aux conservateurs qui peuvent, lors des élections de 1979, dénoncer les liens des travaillistes avec l'extrême-gauche. Militant atteint le summum de son influence au début des années 1980, en prenant le contrôle de la municipalité de Liverpool : il contribue à faire adopter au Labour, revenu dans l'opposition, des positions radicalement à gauche, qui lui valent une défaite écrasante lors des élections de 1983. Dès 1982, cependant, le Labour tente de réduire l'influence de Militant : Neil Kinnock, chef du parti après 1983, s'oppose frontalement aux trotskystes, en dénonçant notamment leur gestion désastreuse de Liverpool. Militant, dont les principaux représentants sont exclus de la direction du Labour, est dès lors marginalisé[892],[893].
Au Brésil, les mouvements trotskystes peuvent sortir de la clandestinité dans les dernières années de la dictature militaire. Ils sont cependant divisés quant à la politique à adopter vis-à-vis du Parti des travailleurs, qui gagne en influence à gauche durant les années 1980 : certains trotskystes sont d'abord hostiles au PT, tandis que d'autres choisissent d'emblée d'y pratiquer l'entrisme. Finalement, les trois principaux groupes trotskystes brésiliens décident chacun, à différentes périodes, de participer au PT, au sein duquel ils constituent des tendances minoritaires. Ils ne parviennent pas à prendre le contrôle du parti, qui englobe des tendances de gauche très différentes les unes des autres. En 1992, l'une des tendances trotskystes, Convergencia socialista, est exclue du PT[416],[894].
De l'« âge d'or » du « gauchisme » européen aux années de plomb


Dans leur ensemble, les années 1960-1970 sont marquées en Occident, surtout après 1968, par le développement d'une culture politique « gauchiste », notamment chez les étudiants issus de la génération du baby-boom. Bien que reprenant à leur compte le vocabulaire et l'imagerie du communisme[823],[895], les contestataires s'opposent de manière souvent frontale aux conceptions des partis communistes pro-soviétiques et revendiquent des formes alternatives de militantisme. Daniel Cohn-Bendit publie ainsi, après mai 68, un livre dont le titre, Le Gauchisme, remède à la maladie sénile du communisme, se veut une réponse à celui de Lénine La Maladie infantile du communisme (le « gauchisme »)[823].
Dans les contextes de la guerre du Viêt Nam et de la Révolution culturelle, l'anti-impérialisme et le tiers-mondisme sont des idées en vogue au sein d'une partie de l'opinion, et notamment de la jeunesse. Che Guevara, Hô Chi Minh, Léon Trotsky et Mao Zedong sont souvent considérés, à des degrés divers, comme des icônes, y compris par des adversaires du communisme soviétique et des formes étatisées du marxisme[872] : la rhétorique « marxiste-léniniste » est un temps à la mode chez des contestataires, souvent radicalisés par le militantisme contre la guerre du Viêt Nam et qui s'opposent au marxisme orthodoxe soviétique en lui préférant sa version maoïste[896]. Le milieu d'extrême gauche est particulièrement bouillonnant en Italie, où apparaissent une multitude de groupes. L'opéraïsme, qui dénonce le « révisionnisme » des pays de l'Est et conteste la représentativité des PC dominants en tant que partis de la classe ouvrière, sort des milieux intellectuels où il était jusque-là confiné, et touche à partir de 1968 une partie importante de l'extrême gauche italienne. Les groupes Lotta Continua et Potere operaio se réclament de l'idéologie opéraïste[880], qui influence plus largement le mouvement autonome. De nombreuses causes que les partis communistes orthodoxes condamnent ou négligent à l'époque, comme le féminisme ou le militantisme homosexuel, naissent au sein des milieux d'extrême gauche ou sont soutenues par eux, avant de s'imposer progressivement au reste de la gauche, communistes compris[897]. Les idées gauchistes sont également présentes dans certains mouvements de gauche plus modérés, à l'image du PSU qui fait alors figure, en France, de parti « carrefour » entre la gauche et l'extrême gauche[898].
Si une partie des militants d'extrême gauche, notamment ceux qui ont choisi d'intégrer les partis de la gauche classique, passe progressivement à des engagements plus modérés, la tentation de la violence existe également chez certains d'entre eux. Divers groupuscules passent ainsi à la « lutte armée », notamment en Italie et en Allemagne de l'Ouest, au cours de la période connue sous le nom d'années de plomb. Celle-ci se déroule pour l'essentiel durant les années 1970 mais se prolonge avec une moindre intensité durant la décennie suivante. Des attentats et des assassinats sont commis en Italie par de nombreux groupes d'extrême gauche dont le plus connu est celui des Brigades rouges, et en Allemagne de l'Ouest par la Fraction armée rouge[896],[899]. En Italie, les mauvais résultats électoraux de l'extrême gauche lors des scrutins de 1972 et 1976 — l'échec subi en 1976 par la coalition Démocratie prolétarienne entraîne l'autodissolution de Lotta continua — contribuent à la radicalisation d'une partie des militants, qui en arrive à considérer que la seule solution se trouve dans la violence[900],[901]. Des intellectuels italiens de la mouvance, comme Toni Negri ou Adriano Sofri, sont inculpés dans des affaires de terrorisme[902].
D'autres pays sont également touchés, à un degré moindre, par les actions de groupes d'inspiration communiste, comme l'Organisation révolutionnaire du 17‑novembre en Grèce, les Cellules communistes combattantes en Belgique, les Noyaux armés pour l'autonomie populaire et les Groupes de résistance antifasciste du premier octobre en Espagne, ou Action directe en France. Certains groupes terroristes reçoivent l'aide des services secrets de l'Est, à l'image de la Fraction Armée rouge et des Cellules communistes combattantes, soutenues par la Stasi est-allemande[896],[899],[898].
Chute de la majorité des régimes communistes
Mouvement de réformes en URSS
L'URSS et le bloc de l'Est abordent le tournant des années 1980 dans un contexte difficile. L'invasion de l'Afghanistan aggrave brutalement les relations avec l'Occident, mettant un terme à la détente, favorisant l'élection de Ronald Reagan aux États-Unis et dégradant de manière spectaculaire l'image de l'URSS dans le monde. Le conflit afghan, particulièrement impopulaire en URSS même, apparaît rapidement comme un gouffre financier et humain[903].
L'élection de Ronald Reagan contribue à faire remonter la tension dans le contexte de la guerre froide, l'administration des États-Unis adoptant un langage nettement plus martial que dans les années précédentes : le président Reagan, malgré son fort anticommunisme, poursuit néanmoins une politique plus pragmatique qu'il n'apparaît alors[904],[905].
Sur le plan intérieur, l'économie soviétique stagne et ne parvient à atteindre aucun des objectifs fixés par le pouvoir, l'agriculture apparaissant comme son principal point faible[906]. L'appareil soviétique est handicapé par une bureaucratie envahissante et sclérosé sur le plan politique[907], ce phénomène étant notamment illustré par le vieillissement de l'élite dirigeante, qui donne à l'URSS l'allure d'une « gérontocratie »[908]. Dans le reste du bloc, les PC au pouvoir, qui se veulent toujours officiellement les partis de la classe ouvrière, sont quant à eux devenus dans les faits, avec le temps, des appareils attirant l'élite administrative, principalement urbaine[909].
L'URSS et les autres pays du bloc de l'Est connaissent des problèmes économiques croissants, auxquels ils s'efforcent de répondre en ayant de plus en plus recours aux emprunts extérieurs, notamment auprès des pays de l'OPEP[910] ; l'interaction croissante, depuis les années 1960, des pays communistes avec l'économie capitaliste mondiale contribue à les rendre de plus en plus dépendants de celle-ci[911]. Les pays du bloc de l'Est, dont les systèmes économiques ont été bâtis sur le modèle soviétique sans bénéficier des ressources naturelles de l'URSS, souffrent eux aussi de dysfonctionnements permanents[912]. Au début des années 1980, du fait notamment de la hausse des taux d'intérêt, ils sont très lourdement endettés auprès du système bancaire occidental[913].
Léonid Brejnev, vieillissant et malade depuis plusieurs années, meurt en novembre 1982 ; Iouri Andropov, jusque-là président du KGB, lui succède. Technocrate compétent, Andropov entreprend de réformer l'appareil en luttant contre le népotisme et la corruption, mais le renouvellement des élites dirigeantes demeure limité. La tension diplomatique avec les États-Unis demeure par ailleurs particulièrement forte, et connaît des pics avec la crise des euromissiles et la destruction par l'aviation soviétique du vol Korean Airlines 007. La mauvaise santé d'Andropov ne lui laisse pas le temps de pousser très loin ses idées de réforme : il meurt en février 1984. Son successeur, Konstantin Tchernenko, un proche de Brejnev, se signale surtout par un « immobilisme absolu » en matière politique. Déjà gravement malade au moment de son accès au pouvoir, il meurt en mars 1985[914],[908].
Mikhaïl Gorbatchev, un membre de l'entourage d'Andropov, succède à Tchernenko en tant que secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique. Relativement jeune par rapport à ses prédécesseurs, Gorbatchev est décidé à réformer le système politique de l'Union soviétique qu'il souhaite débarrasser de ses scléroses ; il accède cependant au pouvoir sans plan préconçu. S'entourant d'une équipe de réformateurs comme Alexandre Iakovlev et Edouard Chevardnadze, le nouveau dirigeant de l'URSS s'engage rapidement dans une voie qui surprend aussi bien les soviétologues occidentaux que les conservateurs soviétiques. Gorbatchev adopte comme mots d'ordre uskorenie (accélération), perestroïka (littéralement, reconstruction, utilisé comme substitut au mot réforme pour ne pas irriter les conservateurs) et glasnost (ouverture, ou transparence). La glasnost, dans l'optique de Gorbatchev, est « la critique saine des insuffisances » et non « le torpillage du socialisme et de ses valeurs ». Ce mouvement, qui constitue dans les faits une poursuite de la déstalinisation, permet la redécouverte de pans cachés de l'histoire du pays ; il entraîne un surcroît de tensions politiques, alors que certains conservateurs tentent encore de défendre l'héritage de Staline. De nouvelles réhabilitations de victimes des purges staliniennes ont lieu, comme celle de Boukharine. La glasnost amène en outre un important dégel sur le plan culturel : des œuvres littéraires jusque-là interdites sont librement publiées[915],[916]. En 1989, L'Archipel du Goulag est publié en URSS pour la première fois[917]. En 1990, Gorbatchev reconnaît la responsabilité de l'URSS dans le massacre de Katyń[918].

Sur le plan extérieur, la période Gorbatchev se traduit entre 1985 et 1987 par une amélioration spectaculaire des rapports Est-Ouest, désignée sous le nom de Nouvelle Détente. Plusieurs rencontres, à partir de 1985, entre Ronald Reagan et Mikhaïl Gorbatchev aboutissent en à la signature du traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire, qui engage un réel processus de désarmement. Gorbatchev annonce en 1988 un retrait unilatéral des troupes d'Afghanistan. Les relations de l'URSS avec la République populaire de Chine sont également normalisées[919].
Sur le plan intérieur, Gorbatchev procède à de nombreux limogeages de cadres conservateurs. Le pouvoir soviétique s'efforce d'introduire un État de droit en adoptant des mesures pour limiter les abus des administrations, en allégeant la censure et en permettant aux Soviétiques de circuler librement à l'étranger. La XIXe conférence du PCUS adopte en un important projet de réforme constitutionnelle, qui démocratise le système soviétique : les textes prévoient d'une part, un nouveau Soviet suprême élu à bulletin secret par un Congrès du peuple, dont une grande partie des députés seront élus par la population dans les districts ; d'autre part, la création d'un poste de Président de la République aux pouvoirs étendus. Les réformes de Gorbatchev ne règlent cependant pas la question du pluralisme politique. Si Gorbatchev envisage les réformes dans le cadre du Parti communiste, la libéralisation politique entraîne l'apparition de nombreux « groupes informels » qui constituent, dans le cadre d'un système encore marqué par le parti unique, un début de « démocratisation par en bas ». Sur le plan économique, de nombreuses réformes sont engagées, développant l'autonomie dans les entreprises et les sphères d'initiative privée. Souvent insuffisantes, les mesures de libéralisation ne parviennent cependant pas à redresser l'économie soviétique, qui se dégrade au contraire dans les années 1985-1991, les résultats dans l'agriculture étant notamment catastrophiques. La perestroïka bouleverse une économie gangrénée par la coercition et la corruption et l'absence d'institutions juridiques crédibles, mais sans définir de nouvelles règles du jeu ni apporter aux travailleurs de nouvelles motivations[920].
La glasnost, en libérant la mémoire historique et en encourageant la critique des défauts du système, contribue également à déstabiliser en profondeur l'Union soviétique. Gorbatchev a en effet, dans le cadre de son programme de réformes, sous-estimé le facteur national[921] : dans presque toutes les Républiques socialistes soviétiques, des revendications identitaires se manifestent sur les champs les plus divers, allant de la reconnaissance du statut de la langue nationale à l'indépendantisme. Le , l'anniversaire de la signature du pacte germano-soviétique provoque des manifestations de masse dans les pays baltes : deux ans plus tard, la protestation prend de l'ampleur et s'exprime notamment par une gigantesque chaîne humaine, la « voie balte », qui réclame l'indépendance des trois Républiques. En mars 1990, la Lituanie proclame son indépendance, défiant ouvertement le gouvernement soviétique qui réagit par un blocus économique. La Lettonie et l'Estonie imitent à leur tour la Lituanie. En janvier 1991, les troupes soviétiques interviennent dans les pays baltes pour tenter d'en reprendre le contrôle. Un litige territorial éclate entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan sur la question du Haut-Karabagh[922].
Les réformes politique et structurelles en URSS ont un effet décisif sur les « pays frères » communistes. Gorbatchev encourage les États satellites d'Europe de l'Est à mener leur propre « perestroïka »[921]. Il prend par ailleurs la décision, en raison des difficultés de l'économie soviétique, de diminuer l'assistance matérielle consentie aux alliés du camp communiste ce qui, dans le tiers monde, a des conséquences parfois dramatiques, précipitant en Afrique l'abandon du communisme à partir de 1989. Les économies de la République populaire du Bénin et de la République populaire du Congo sont notamment dans un état désastreux. En Amérique latine, Gorbatchev plaide pour des solutions négociées aux conflits, ce qui conduit la plupart des guérillas, à l'image du Front Farabundo Martí de libération nationale et de l'Unité révolutionnaire nationale guatémaltèque, à déposer les armes, certains mouvements rebelles se transformant en partis politiques. Le régime sandiniste du Nicaragua se libéralise et conclut des accords de paix avec les Contras. Les sandinistes perdent ensuite l'élection présidentielle de 1990[819]. La diminution, puis la fin, de l'aide soviétique, plongent Cuba dans une très grave crise économique à partir de 1989[923].
Écroulement des régimes européens
Les « démocraties populaires » du bloc de l'Est, qui n'ont jamais réussi à résoudre leurs dysfonctionnements économiques et leur sclérose politique[924], sont entraînées dans le mouvement des réformes impulsées par l'URSS et s'écroulent toutes à partir de 1989.
Hongrie
En République populaire de Hongrie, János Kádár, âgé et malade, quitte le pouvoir en 1988 ; il est remplacé à la tête du Parti socialiste ouvrier hongrois par Károly Grósz. Ce dernier est rapidement débordé par les réformateurs du Parti, menés notamment par Imre Pozsgay, Gyula Horn et Miklós Németh. En mai 1989, la Hongrie démantèle la barrière du rideau de fer le long de sa frontière avec l'Autriche. L'insurrection de Budapest est réhabilitée, de même que la mémoire d'Imre Nagy ; Pozsgay évoque bientôt le passage au multipartisme. La Hongrie adopte dès une constitution amendée ; toutes les références au socialisme sont supprimées, et une série de lois assure en 1989-1990 le passage à un régime politique pluraliste et à l'économie de marché[925] ; en 1990, les premières élections libres, que le Parti socialiste hongrois espérait remporter, se soldent par la victoire de l'opposition[926],[927].
Pologne
En République populaire de Pologne, le régime entame des négociations avec Solidarność : une table ronde entre le pouvoir et l'opposition — dont Jaruzelski lui-même et le Parti ouvrier unifié polonais se tiennent volontairement à l'écart — débute en février 1989. En avril, des accords prévoient des élections législatives partiellement ouvertes à un scrutin démocratique. Solidarność remporte de manière éclatante les élections de mai, en obtenant 99 % des sièges du Sénat nouvellement créé et la quasi-totalité des sièges de la Diète ouverts à la compétition électorale. En août, un accord de coalition est conclu et Tadeusz Mazowiecki devient le premier Premier ministre non communiste de la République populaire de Pologne. Une nouvelle constitution entre en vigueur le 31 décembre, mettant un terme officiel au régime communiste polonais[928],[929].
RDA

La République démocratique allemande est bientôt victime de l'ouverture du rideau de fer par la Hongrie : à l'été 1989, des milliers d'Allemands de l'Est passant leurs vacances en Hongrie passent à l'Ouest via la frontière hongroise ou prennent d'assaut l'ambassade d'Allemagne de l'Ouest à Budapest. En septembre, la Hongrie dénonce ses accords avec la RDA et autorise le passage d'environ 65000 réfugiés est-allemands vers l'Autriche. En RDA même, le mécontentement s'exprime bientôt : le mouvement des manifestations du lundi contre le pouvoir rassemble semaine après semaine des centaines de milliers de protestataires. En octobre, Mikhaïl Gorbatchev, en visite à Berlin-Est pour le quarantième anniversaire de la RDA, n'accorde aucun soutien à Erich Honecker et lui adresse même publiquement une mise en garde à peine voilée. Le 18 octobre, une réunion du bureau politique du Parti socialiste unifié d'Allemagne mène à la démission de Honecker, remplacé par Egon Krenz. La contestation ne faiblit pas et le 9 novembre, Günter Schabowski, porte-parole du SED, pris de panique lors d'une conférence de presse, annonce par erreur l'ouverture immédiate de la frontière vers Berlin-Ouest : une foule immense entoure bientôt le mur de Berlin et la frontière est définitivement ouverte. Le gouvernement de la RDA se résout à faire abattre le mur. Le pouvoir est-allemand se délite totalement et le SED s'autodissout, se rebaptisant Parti du socialisme démocratique. En mars 1990, les ex-communistes sont largement battus par les chrétiens-démocrates lors des premières élections libres de la RDA, qui sont également les dernières de ce pays avant sa disparition. Dès , le chancelier ouest-allemand Helmut Kohl évoque en effet ouvertement une réunification de l'Allemagne, qui devient effective en [930],[931].
Tchécoslovaquie
En République socialiste tchécoslovaque, la contestation s'exprime de plus en plus ouvertement au cours de l'année 1989, débouchant en novembre sur d'importantes manifestations à Prague. Le Forum civique se constitue et porte à sa tête Václav Havel, déclenchant l'épisode de la révolution de velours. Le 24 novembre, le bureau politique du Parti communiste tchécoslovaque, dépassé par la situation, démissionne en bloc. Alexander Dubček, l'homme du printemps de Prague, est acclamé par la foule. Une grève générale éclate. Les communistes présentent un nouveau gouvernement, où ils détiennent seize portefeuilles sur vingt, mais l'opposition réagit en menaçant d'une nouvelle grève ; un gouvernement est finalement formé où les communistes sont minoritaires. Le président de la République Gustáv Husák démissionne le 10 décembre ; le 28 décembre, Dubček devient le président de l'assemblée et, le lendemain, Václav Havel est élu président de la République[932],[933].
Bulgarie
En République populaire de Bulgarie, le lendemain de la chute du rideau de fer, Todor Jivkov est démis de ses fonctions par les réformateurs du Parti communiste bulgare ; son successeur, Petar Mladenov, autorise le multipartisme. Au début de 1990, le Parti communiste renonce à son rôle dirigeant et devient le Parti socialiste bulgare. Le PSB remporte les premières élections libres en juin 1990 mais perd le pouvoir lors d'un nouveau scrutin en [934],[935].
Roumanie
En République socialiste de Roumanie, la révolution contre le régime communiste, alors dirigé depuis 23 ans par Nicolae Ceaușescu, prend un tour violent : le 21 décembre, le « conducător » est hué par la foule alors qu'il prononce un discours en plein air, retransmis en direct à la télévision. La contestation génère des émeutes à Bucarest : les membres réformateurs du Parti communiste roumain, menés par Ion Iliescu et Petre Roman, prennent bientôt la direction de la révolte et appellent à la télévision la population à défendre la Révolution contre d'imaginaires « sbires du régime » : militaires et manifestants se tirent mutuellement dessus, tous persuadés de combattre pour la liberté ; Ceaușescu prend la fuite avec son épouse Elena. Capturé, le couple présidentiel est fusillé le 25 décembre au terme d'une procédure expéditive jusque-là réservée aux opposants du régime. Les premiers jours, Ion Iliescu et Petre Roman déclarent vouloir un « socialisme scientifique et à visage humain », mais ensuite le parti communiste est dissout, un Front de salut national se constitue et prend le contrôle de la logistique et des forces du régime[936].
Yougoslavie

La vague de changements atteint également les pays communistes européens sortis depuis longtemps de l'orbite de l'URSS. En République fédérative socialiste de Yougoslavie, lors du congrès de janvier 1990 de la Ligue des communistes de Yougoslavie, les dissensions entre les diverses nationalités composant le Parti s'aggravent, et les Slovènes claquent la porte. Les délégués du PC yougoslave se séparent pour ne plus jamais se réunir, et le Parti cesse d'exister. En avril et en mai, des élections législatives entièrement libres sont organisées en Slovénie et en Croatie, portant au pouvoir l'opposition démocratique à tendance séparatiste : Milan Kučan devient le président de la Slovénie et Franjo Tuđman celui de la Croatie. Dès 1991, des affrontements ouverts autour de questions territoriales éclatent entre les États membres de la fédération, déclenchant la série des guerres civiles yougoslaves. La Yougoslavie abandonne toute référence communiste et cesse bientôt dans les faits d'exister en tant qu'État unitaire[937],[938].
Albanie
La République populaire socialiste d'Albanie, pays le plus fermé du continent, n'est pas non plus épargnée par les bouleversements en Europe de l'Est. À la fin 1989, un début de réformes politiques et économiques n'aboutit qu'à encourager des manifestations populaires. Plusieurs milliers d'Albanais entreprennent de fuir le pays. Les protestations contre les restrictions sur les produits alimentaires débouchent sur un mouvement plus vaste demandant des réformes démocratiques, tandis que le pouvoir est très divisé : en décembre 1990, le Parti du travail d'Albanie accepte d'autoriser les partis d'opposition. Des élections se tiennent en mars-avril 1991 et sont remportées par les communistes grâce au vote des campagnes, où leur influence et le régime de terreur restent présents ; les villes, cependant, votent pour l'opposition. En mai, l'opposition appelle à une grève générale, qui est massivement suivie. L'Albanie change de constitution dans le courant de 1991 et le Parti du travail devient le Parti socialiste d'Albanie ; en 1992, de nouvelles élections se tiennent dans des conditions plus libres et sont cette fois remportées par l'opposition[939],[940].
Transitions politiques en Asie et en Afrique

Hors d'Europe, la majorité des États communistes changent d'orientation politique à partir de 1989, sous l'influence directe ou indirecte des changements en Union soviétique et sous l'effet de nombreux facteurs internes et externes. La République populaire mongole, voisin et satellite de l'URSS, se convertit dès 1987 à la « transparence » et à la « démocratie » sous l'influence de Gorbatchev : des réformes économiques sont introduites. L'opposition commence à s'organiser et en 1990, des manifestations ont lieu à Oulan-Bator, déclenchant la révolution démocratique en Mongolie. Le Parti révolutionnaire du peuple mongol multiplie les concessions : le monopole du Parti est supprimé et l'opposition autorisée. Des premières élections libres sont organisées à l'été et sont remportées par les communistes, qui forment alors le seul parti réellement organisé. La Mongolie entame alors ce que le président Orchibat qualifie de « grand voyage » pour passer aux droits de l'homme et à la démocratie. Le pays se convertit à l'économie de marché et, en 1992, adopte une nouvelle constitution qui supprime toute référence au marxisme-léninisme. Le PRPM remporte à nouveau les élections de 1992 face à l'opposition divisée, mais perd ensuite celles de 1996[923],[941].
En Asie du Sud-Est, la République populaire du Kampuchéa, le régime cambodgien pro-vietnamien, entreprend en 1989 une révision constitutionnelle, prenant le nom officiel d'État du Cambodge et adoptant le bouddhisme comme religion nationale. L'armée vietnamienne se retire du Cambodge la même année. En 1991, les négociations de paix continuent entre le gouvernement cambodgien, les Khmers rouges et les sihanoukistes du FUNCINPEC et des accords de paix sont finalement signés pour assurer une transition politique et le partage du pouvoir. L'État du Cambodge abandonne officiellement le marxisme-léninisme et autorise le multipartisme : le pays passe sous tutelle de l'Autorité provisoire des Nations unies. Norodom Sihanouk fait son retour au Cambodge et la monarchie est rétablie en 1993. Les anciens cadres communistes demeurent en place et partagent, en vertu des accords, le pouvoir avec le FUNCINPEC[772],[942].
La République démocratique d'Afghanistan parvient à se maintenir un temps après le départ des troupes soviétiques : mais la politique de Réconciliation nationale de Mohammed Nadjibullah s'avère insuffisante et, du fait de la multiplication des dissidences internes et de l'arrêt total de l'aide soviétique, le régime finit par s'écrouler au bout de trois ans de guerre civile. Fin avril 1992, les rebelles prennent Kaboul[943],[944].
Au Moyen-Orient, la République démocratique populaire du Yémen (Sud-Yémen) se réunifie en 1990 avec la République arabe du Yémen (Nord-Yémen) : la réunification est cependant suivie en 1994 par une guerre civile entre le personnel politique de l'ex-Sud et celui de l'ex-Nord, avec pour résultat la défaite de l'ancien régime sudiste et le départ en exil d'une partie de ses cadres[945].
En Afrique, le FRELIMO du président Joaquim Chissano, renonce au marxisme en , emmenant la République populaire du Mozambique vers la voie de la démocratie et passant de statut de parti communiste à celui de parti lié à la bourgeoisie capitaliste mozambicaine. Une nouvelle constitution est adoptée en 1990 et des accords de paix sont réalisés deux ans plus tard ; le FRELIMO remporte nettement les premières élections libres[923]. En République populaire d'Angola, une voie similaire est suivie, mais de manière plus heurtée : le MPLA du président José Eduardo dos Santos abandonne le communisme et la constitution est modifiée[946]. Le processus de paix angolais est cependant vite interrompu : l'UNITA refuse sa défaite électorale face au MPLA et reprend les armes[947],[923]. En République populaire du Bénin, Mathieu Kérékou renonce dès 1989 au marxisme-léninisme « en tant que voie de développement » : il participe ensuite aux travaux d'une conférence nationale qui permet le passage au multipartisme et à la démocratie ainsi que l'adoption d'une nouvelle constitution[948]. Denis Sassou-Nguesso suit la même voie en République populaire du Congo[949]. Les autres pays africains influencés par le marxisme-léninisme, comme la République démocratique de Madagascar, se convertissent également à la démocratie et aux élections libres[923]. La transition politique n'est pas pacifique dans la corne de l'Afrique où la République démocratique populaire d'Éthiopie de Mengistu ne cesse d'exister qu'au terme d'une guerre civile[950] ; c'est également le cas de la République démocratique somalie, pays sorti depuis 1977 de l'orbite soviétique, où Siyaad Barre doit fuir le pays face à l'avance des rebelles[951],[923]. L'Érythrée obtient en 1993 son indépendance vis-à-vis de l'Éthiopie mais l'ex-Front populaire de libération de l'Érythrée, devenu parti unique sous le nom de Front populaire pour la démocratie et la justice, a abandonné ses références marxistes avant même de prendre le pouvoir, au profit d'un discours purement nationaliste[952],[953],[954],[955].
L'écrasement du « Printemps de Pékin »

La Chine est également touchée par le mouvement de réformes qui secoue le monde communiste : contrairement à ce qui se passe dans la majorité des autres pays, elle ne connaît cependant pas de passage à la démocratie. Les tensions entre réformateurs chinois s'accroissent cependant dans les années 1980, les dirigeants du PCC n'étant pas d'accord sur les modes d'évolution du système. Zhao Ziyang, secrétaire général du PCC, penche pour une solution « néo-autoritaire » paternaliste, du type de celle qui s'est imposée dans les nouveaux pays industrialisés d'Asie ; les idées liées à la démocratie et aux droits de l'homme deviennent de plus en plus populaires dans les milieux intellectuels. La mort de l'ancien secrétaire général Hu Yaobang, alors en disgrâce, est l'occasion du déclenchement d'un mouvement de protestations aux origines plus sociales que politiques, qui débouche sur d'importantes manifestations étudiantes à Pékin au printemps 1989 : ce mouvement se trouve encore stimulé par la visite en Chine du no 1 soviétique réformateur Mikhaïl Gorbatchev, que l'opposition chinoise salue comme un « symbole de la démocratie ». Face au retentissement international de la contestation, Deng Xiaoping choisit l'épreuve de force et les manifestations de Pékin sont écrasées en par la troupe, entraînant plus de 1000 morts dans la capitale ; plusieurs milliers de personnes sont arrêtées. Deng Xiaoping fait ainsi le choix d'une transition, non pas démocratique mais économique, passant d'un communisme réformateur à un « communisme capitaliste » : il continue d'engager la Chine sur la voie des réformes tout en s'assurant que le parti communiste conserve le monopole du pouvoir[956].
Malgré l'indignation internationale suscitée par la répression des manifestations, les liens avec l'Occident ne sont pas rompus. La répression des manifestations de Pékin entraîne de la part de l'URSS des réactions modérées, Gorbatchev ne souhaitant pas sacrifier son rapprochement avec la Chine. Deng Xiaoping parvient entretemps à freiner les conservateurs du PCC et à empêcher un retour en arrière de l'économie chinoise : il poursuit au contraire le mouvement de réformes, qui amènent bientôt à la Chine un important taux de croissance. Le niveau de vie des citoyens chinois s'améliore notablement tandis que la Chine devient, au début des années 1990, un acteur essentiel de l'économie capitaliste mondiale[956].
Fin de l'URSS

En URSS même, le changement de climat politique mène à un effondrement rapide du système communiste. Les reformes institutionnelles, en vertu desquelles Mikhaïl Gorbatchev prend le nouveau poste de président de l'Union soviétique, débouchent sur des élections législatives libres dans les États de l'Union : dans les pays baltes et en Géorgie, les nationalistes et indépendantistes remportent la victoire. En juin 1991 une élection présidentielle libre est organisée en Russie et Boris Eltsine, ancien cadre communiste limogé du PCUS et passé à l'opposition, est élu président de la République socialiste fédérative soviétique de Russie, principal État de l'URSS, battant très largement le candidat communiste Nikolaï Ryjkov. L'autorité du président de l'URSS est désormais contrebalancée par celle du président de la Russie, qui apparaît comme un rival politique[957].
Durant l'été 1991, les évènements se précipitent. En juillet, un ensemble de réformateurs, dont Chevarnadze et Yakovlev qui ont rompu avec Gorbatchev, appelle à la formation d'un nouveau parti politique, le « Mouvement pour les réformes démocratiques ». Dans le même temps, Gorbatchev impose au Comité central l'abandon de toute référence au marxisme-léninisme dans les statuts du PCUS. L'adoption d'un nouveau traité de l'Union, préparé par le gouvernement central, se heurte à de nombreuses oppositions au sein des républiques. Les républiques musulmanes d'Asie centrale passent des accords bilatéraux sans plus se soucier du centre et l'Ukraine refuse de signer le traité avant d'avoir adopté sa propre constitution. Eltsine supprime, le , les comités et cellules du PCUS dans les entreprises et les administrations[958].
Les conservateurs, face à la déliquescence du pouvoir central et de l'autorité du Parti, décident de réagir : en août, un groupe mené entre autres par Guennadi Ianaïev et le directeur du KGB Vladimir Krioutchkov réalise un putsch contre Mikhaïl Gorbatchev, qui est mis aux arrêts et placé en résidence surveillée ; l'État d'urgence est proclamé « pour six mois » et le rétablissement de la censure est annoncé. Le coup de force des conservateurs, très mal préparé, est un échec total, aboutissant au résultat inverse à celui recherché : le camp des réformateurs, au premier rang desquels Boris Eltsine, défie aussitôt les putschistes et se pose en garant de la démocratie. Les conspirateurs sont désarçonnés devant la réaction de la population : plusieurs dizaines de milliers de moscovites descendent dans les rues pour manifester leur hostilité au coup d'État. L'Armée rouge, divisée, hésite à tirer sur la foule. En un peu plus de 48 heures, la résistance de la classe politique et de la société civile a raison du coup d'État. Les putschistes sont arrêtés et, le , Gorbatchev, libéré, revient à Moscou. Boris Eltsine apparaît en Russie comme le grand vainqueur sur le plan politique ; dans les jours qui suivent l'échec du putsch, huit des républiques de l'URSS proclament leur indépendance, les pays baltes obtenant immédiatement une reconnaissance internationale. Le Parti communiste de l'Union soviétique et le KGB sont dissous et le parlement fédéral retire à Mikhaïl Gorbatchev tous ses pouvoirs spéciaux en matière économique. Le 1er décembre, l'Ukraine fait approuver son indépendance par référendum. Une semaine plus tard, les présidents russe, ukrainien et biélorusse constatent que l'URSS n'existe plus et décident de la formation d'une Communauté des États indépendants ouverte à toutes les anciennes républiques soviétiques. Le , un sommet est tenu à Alma-Ata pour entériner la fin de l'Union soviétique et son remplacement par la CEI. Mikhaïl Gorbatchev, qui n'avait même pas été convié au sommet, démissionne de ses fonctions de président de l'Union le 25 décembre et l'URSS cesse définitivement d'exister[959],[960],[961].
Le communisme après 1989
Le communisme continue d'exister en tant que mouvance politique après la chute de l'URSS et de la plupart de ses alliés, mais à des degrés très variables selon les pays. De nombreux partis politiques dans le monde revendiquent à des titres divers une identité communiste : des conférences internationales des partis communistes et ouvriers (Solidnet) sont organisées depuis 1998. Les PC de l'UE se réunissent au sein du Parti de la gauche européenne, créé en 2004. Cinq régimes communistes, en République populaire de Chine, au Viêt Nam, au Laos, en Corée du Nord et à Cuba, existent encore à ce jour[962].
Chine

La République populaire de Chine, où le Parti communiste chinois demeure parti unique, s'impose en tant qu'acteur majeur de l'économie mondialisée : membre de l'Organisation mondiale du commerce à partir de 2001, elle apparait bientôt comme une superpuissance émergente. Sur le plan économique, la Chine s'est éloignée des principes du collectivisme à un tel point que l'identité communiste du régime est réduite à la portion congrue[963]. La sinologue Marie-Claire Bergère compare ainsi le modèle économique de la Chine contemporaine à un « capitalisme sauvage »[964]. Si le marxisme-léninisme et la « pensée Mao Zedong » continuent d'être l'idéologie officielle du régime, plus aucune référence n'étant faite au communisme au sens utopique du mot[963]. La Chine abandonne toute prétention à l'égalité sociale et les inégalités augmentent au contraire fortement[965].
Sous les présidences de Jiang Zemin (1993-2003), Hu Jintao (2003-2013) et Xi Jinping (depuis 2013), la Chine connaît une croissance économique record, et une forte augmentation des salaires moyens, qui triplent entre 2000 et 2010[966]. Elle est néanmoins confrontée, du fait de sa rapide modernisation économique, à d'importants défis environnementaux[967] et le pouvoir doit entamer des réformes de grande ampleur, notamment pour lutter contre la corruption et pour maintenir le niveau de développement du pays. Toute contestation du monopole du Parti communiste continue d'être sévèrement réprimée[968],[969]. La présidence de Xi Jinping est accompagnée par une réaffirmation du rôle dirigeant du Parti communiste chinois. En 2017, la « pensée de Xi Jinping du socialisme aux caractéristiques chinoises pour une nouvelle ère » fait son entrée dans la charte du PCC : c'est la première fois depuis l'époque de Mao Zedong qu'un dirigeant chinois reçoit un tel honneur de son vivant[970].
Viêt Nam et Laos
Le Viêt Nam, quant à lui, s'engage à partir de 1986, sous l'influence des évolutions politiques alors en cours en URSS et en Chine, vers un mouvement de réforme de l'économie, le Đổi mới, qui aboutit à une insertion croissante au sein de l'économie de marché mondialisée[971]. Si le Viêt Nam continue de se réclamer officiellement du marxisme-léninisme[972], le discours politique communiste est souvent analysé comme un élément relevant moins de l'idéologie que de l'outil de légitimation historique, progressivement assimilé à un élément de folklore national[973]. La bourse des valeurs de Hô-Chi-Minh-Ville est ouverte en 2000[974] et le pays est désormais jugé attractif sur le long terme par les investisseurs étrangers[975].
Des réformes économiques, plus modestes qu'au Viêt Nam, ont lieu à partir de 1989 au Laos[971], toujours gouverné par le Parti révolutionnaire populaire lao[976] ; le pays s'engage sur la voie de l'économie de marché et ouvre la bourse de Vientiane en 2011[977].
Corée du Nord

La Corée du Nord représente un cas à part : les difficultés causées par l'arrêt de l'aide soviétique n'ont fait que convaincre le régime de persister dans ses choix idéologiques. Très fermé et encore éloigné de toute perspective de démocratisation, le pays est victime, dans les années 1990, d'une terrible famine qui nécessite le recours à l'aide internationale. Soutenu sur le plan international par la Chine, le régime nord-coréen se maintient également par le biais du chantage à la guerre, en développant son arsenal militaire. Kim Il-sung, mort en 1994, est remplacé par son fils Kim Jong-il : le pays est gouverné à partir de 1998 en fonction d'une doctrine militariste, la politique de songun, qui donne une place de plus en plus prépondérante à l'Armée populaire de Corée[978].
En 2011, Kim Jong-un, fils de Kim Jong-il, succède à ce dernier, perpétuant le maintien au pouvoir de la « dynastie Kim »[979]. Dans les années qui suivent, le régime nord-coréen continue de jouer la carte du développement militaire, entretenant les tensions diplomatiques en raison de son programme nucléaire[980],[981].
Cuba
À Cuba, malgré les graves difficultés économiques dues entre autres à l'arrêt de l'aide soviétique et à la poursuite de l'embargo américain, Fidel Castro refuse de céder à la « cochonnerie » du multipartisme et proclame, en décembre 1989, « l'île coulera dans la mer avant que l'on n'amène les bannières de la révolution et de la justice ». L'orthodoxie communiste la plus stricte est réaffirmée. Mais les problèmes économiques du pays sont tels que, dès 1993, des réformes limitées autorisent les marchés libres, puis l'initiative privée dans le domaine des petites activités. L'ouverture aux capitaux étrangers est accentuée ; elles ne suffisent pas à redresser l'économie de l'île, qui subit un fort développement du marché noir et de la prostitution[923]. Fidel Castro mise sur la ressource du tourisme pour redresser la situation du pays[982]. La dissidence cubaine continue de faire périodiquement l'objet de vagues de répression, notamment lors du « Printemps noir » en 2003[983].
Cuba bénéficie ensuite de l'élection en Amérique latine, dans les années 1990-2000, de plusieurs chefs d'État de gauche dont certains, comme les socialistes Hugo Chávez au Venezuela ou Evo Morales en Bolivie, revendiquent leur proximité avec le régime castriste. Fidel Castro, octogénaire et malade, cède à son frère Raúl Castro le poste de chef de l'État en 2008, puis celui de chef du Parti en 2011. Un ensemble de mesures de libéralisation économique est annoncé en 2011[984],[985],[986].
L'alliance avec le Venezuela s'avère cruciale pour Cuba, qui bénéficie des largesses économiques de ce pays pétrolier. Sous les présidences de Chávez et - après la mort de ce dernier en 2013 - de son successeur Nicolás Maduro, Cuba multiplie les coopérants et les conseillers au Venezuela, au point d'acquérir une influence grandissante sur la marche des affaires internes de ce pays. Durant le mouvement de contestation de 2014, les opposants au gouvernement socialiste vénézuélien dénoncent régulièrement l'ingérence cubaine[987],[988],[989],[990],[991].
En , après 52 ans de conflit, les États-Unis et Cuba annoncent l'ouverture de discussions en vue de normaliser leurs relations diplomatiques[992],[993].
Russie et autres pays de l'ex-URSS

Dans les pays anciennement communistes, une grande partie des cadres des anciens régimes demeure présente en politique. En Russie, le Parti communiste de la Fédération de Russie, dirigé par Guennadi Ziouganov et successeur du Parti communiste de l'Union soviétique, est devenu le premier parti d'opposition, jusqu'à constituer le principal groupe à la Douma lors des élections législatives de 1995 et 1999 ; il n'a cependant jamais réussi à revenir au pouvoir sur le plan national depuis la fin de l'URSS. Guennadi Ziouganov s'est qualifié pour le second tour lors de l'élection présidentielle russe de 1996, mais a été nettement battu par le sortant Boris Eltsine. Lors des scrutins présidentiels suivants en Russie, le candidat communiste est arrivé systématiquement second, mais sans jamais pouvoir espérer l'emporter ni même provoquer un second tour. Lors des scrutins législatifs postérieurs à 1999, les communistes ont été nettement distancés par Russie Unie, le parti de Vladimir Poutine[994],[995],[996].
Dans les pays de l'ex-URSS, les PC nostalgiques de l'ancien régime se réunissent au sein d'une organisation appelée Union des partis communistes - Parti communiste de l'Union soviétique. La Moldavie est la seule des anciennes Républiques soviétiques où un parti toujours officiellement communiste est revenu au pouvoir via des élections libres : le Parti des communistes de la République de Moldavie, se réclamant toujours officiellement de l'héritage du léninisme mais acceptant dans les faits l'économie de marché, a gagné les élections de 2001[997] et a conservé le pouvoir jusqu'en juillet 2009, date à laquelle les élections législatives anticipées - organisées après des accusations de fraudes lors du scrutin d' - ont été remportées par l'opposition[998],[999].
En 2014, dans le contexte de la crise ukrainienne, le Parti communiste d'Ukraine est marginalisé en raison de ses positions pro-russes : il perd tous ses députés lors des législatives d'octobre[1000].
Autres anciens pays du bloc
Dans la majorité des ex-« pays frères » de l'URSS, les anciens PC au pouvoir ont, à la différence du parti tchèque, renoncé à l'identité communiste, beaucoup s'étant rebaptisés Parti socialiste. D'anciens cadres des PC ont à nouveau exercé le pouvoir dans leur pays à la faveur d'élections libres, comme Gyula Horn en Hongrie, Ion Iliescu en Roumanie ou Aleksander Kwaśniewski en Pologne, mais aucun de ces dirigeants « post-communistes » ne s'est plus présenté comme communiste. Des partis ouvertement nostalgiques des anciens régimes, et s'affichant ouvertement comme communistes, existent toujours, mais demeurent tous dans l'opposition. En République tchèque, le Parti communiste de Bohême et Moravie, successeur du Parti communiste tchécoslovaque, conserve un certain poids électoral. En Allemagne, le parti Die Linke (La Gauche) est créé en 2007 par la fusion du Parti du socialisme démocratique (héritier du SED est-allemand) et de Alternative électorale travail et justice sociale (dissidence du SPD) : plusieurs élus de Die Linke sont d'anciens membres de la Stasi. Malgré les controverses sur le passé de ses membres, Die Linke a réussi à s'imposer dans le paysage politique allemand[1001],[1002].
La « décommunisation » de l'ancien bloc de l'Est s'est déroulée dans des conditions difficiles, après des décennies sans démocratie. Les réformes de libéralisation économique et les privatisations, menées à un rythme souvent trop rapides, ont parfois durement affecté une population longtemps tenue à l'écart de l'économie de marché, entraînant dans certains secteurs de l'opinion des phénomènes de nostalgie — dite en Allemagne Ostalgie — des anciens régimes, ou du moins des conditions de vie moins complexes qu'ils garantissaient ; cette nostalgie a cependant pour certains un caractère moins idéologique que sentimental ou de simple curiosité. Pour d'autres, notamment dans certaines ex-Républiques soviétiques, elle s'accompagne d'un véritable regret de la sécurité économique garantie sous l'ancien régime. Le changement de système politique s'est souvent accompagné du maintien d'une partie de l'ancienne élite à de nombreux postes-clés et l'arrivée de la démocratie n'a pas fait disparaître la corruption, qui s'est au contraire encore développée à la faveur de la libéralisation de l'économie. Néanmoins, la démocratie s'est implantée dans la plupart des pays ex-communistes, malgré de graves imperfections et des exceptions comme la Biélorussie ou le Turkménistan, qui ont au contraire dérivé vers des pratiques autoritaires. L'historien Romain Ducoulombier souligne que « malgré son succès, la transition démocratique et économique vers l'économie libérale de marché n'a pas profité également à toutes les catégories de la population : elle possède aussi ses perdants (les ouvriers non qualifiés, les paysans, les femmes parfois) qui ont payé le prix fort de la dérégulation d'un système avec lequel ils avaient aménagé une forme de modus vivendi. Quinze ans après la chute du Mur, de nouvelles forces politiques, comme Die Linke en Allemagne de l'Est ou le parti Jobbik en Hongrie, exploitent cette désillusion »[1003],[1004],[1005],[1006],[924].
Cambodge
Au Cambodge, la guérilla des Khmers rouges, victime de défections, s'éteint dans les années 1990. En 1997, Pol Pot est mis aux arrêts par ses propres subordonnés. Il meurt l'année suivante alors que l'armée cambodgienne entreprend de démanteler les dernières bases du mouvement rebelle. Ta Mok, le dernier chef khmer rouge encore en fuite, est arrêté en 1999. L'ancien Parti révolutionnaire du peuple du Kampuchéa, rebaptisé Parti du peuple cambodgien et ayant renoncé à l'idéologie communiste, reste au pouvoir, évinçant son allié du FUNCINPEC lors de la crise de 1997 : Hun Sen, déjà premier ministre sous le régime communiste pro-vietnamien, demeure ensuite l'homme fort du Cambodge[942].
Un tribunal spécial destiné à juger les anciens responsables des crimes khmers rouges est laborieusement créé dans les années 2000, mais le gouvernement cambodgien n'autorise les poursuites que contre quelques personnes : « Douch » ancien responsable de la prison politique de Tuol Sleng, est condamné en 2012 à la prison à vie pour crimes contre l'humanité[1007]. Nuon Chea et Khieu Samphân, deux des anciens dirigeants du Kampuchéa démocratique, subissent une condamnation analogue en 2014[1008].
Afrique
En Afrique, divers chefs d'État ex-communistes demeurent au pouvoir démocratiquement, comme Joaquim Chissano au Mozambique ou José Eduardo dos Santos en Angola, ou y reviennent à la faveur d'élections libres, comme Mathieu Kérékou au Bénin ou Didier Ratsiraka à Madagascar (Denis Sassou-Nguesso étant, lui, revenu au pouvoir en République du Congo à la faveur d'une guerre civile). Ces dirigeants, ayant rompu de manière parfois radicale avec leur ancienne idéologie, ne rétablissent en aucune manière l'ancien régime communiste[923],[1009],[1010],[1011],[1012].
Les mouvements communistes dans le reste du monde
Dans les pays occidentaux où les PC bénéficiaient d'un électorat important, l'évolution du mouvement communiste a été contrastée après 1989. Certains partis renoncent à toute référence communiste et cessent d'exister pour renaître sous la forme de partis de centre gauche : outre le Parti communiste italien, principal PC d'Europe de l'Ouest, c'est le cas du Parti communiste de Grande-Bretagne[1013], ou du Parti communiste des Pays-Bas qui disparaît en fusionnant au sein de la Gauche verte[1014] : d'autres conservent leur identité et connaissent des fortunes inégales selon les pays, à l'image du Parti communiste français ou du Parti communiste de Grèce. Hors d'Europe, des PC comme ceux de l'Inde, du Népal ou de l'Afrique du Sud, conservent un poids électoral. Dans certains pays, des partis communistes ont été associés au pouvoir à diverses périodes, ou le sont encore.
Italie
Le leader du Parti communiste italien, Achille Occhetto, décide en novembre 1989, après la chute du mur de Berlin, de constituer un nouveau parti en abandonnant l'identité communiste. Le PCI est dissous en 1991 et ses dirigeants constituent pour le remplacer un parti de centre gauche, le Parti démocrate de la gauche (PDS). La fin du Parti socialiste italien, victime de l'opération Mains propres, permet en outre à l'ex-PCI d'acquérir une position dominante au sein de la gauche modérée italienne. Les orthodoxes, conduits par Armando Cossutta, créent de leur côté le Parti de la refondation communiste en fusionnant avec divers mouvements d'extrême gauche comme Démocratie prolétarienne. Le Parti de la refondation communiste passe ensuite sous le leadership plus recentré de Fausto Bertinotti, tandis que les partisans de Cossutta, devenus minoritaires, fondent le Parti des communistes italiens. Le PDS perd les élections générales de 1994 mais celles de 1996 portent ensuite au pouvoir la coalition de l'Olivier, dirigée par le PDS et à laquelle participent les deux partis communistes. L'Olivier est ensuite victime de ses divisions, et perd les élections de 2001. Une nouvelle coalition de gauche, L'Union, est à nouveau au pouvoir entre 2006 et 2008, période durant laquelle Fausto Bertinotti est président de la chambre des députés[1015],[830].
De nombreux anciens cadres communistes italiens se retrouvent dans des partis de centre gauche comme le Parti démocrate, ou moins recentrés comme Gauche, écologie et liberté. Un ancien cadre du PCI, Massimo D'Alema, est président du conseil entre 1998 et 2000 et un autre ancien communiste, Giorgio Napolitano, devient président de la République italienne en 2006. Les partis italiens ayant conservé l'étiquette communiste demeurent séparés. Lors des élections de 2008, le PRC et le PDCI présentent une liste électorale commune, mais ils perdent tous leurs élus au parlement. Ils forment alors l'année suivante, avec d'autres mouvements une coalition, la Fédération de la gauche : celle-ci se défait cependant dès [1016]. Lors des élections européennes de 2014, le Parti de la refondation communiste participe à la liste L'Autre Europe, présentée par le Parti de la gauche européenne et regroupant diverses formations de la gauche radicale[1017].
France
.JPG.webp)
Le Parti communiste français négocie au contraire mal le tournant de 1989 et, à la différence des partis italien et finlandais, ne change pas d'identité politique. Les effectifs du PCF, de même que ses résultats électoraux, continuent de s'effondrer[825]. Une partie de ses anciens militants choisit de nouvelles formes de militantisme, en intégrant des associations comme ATTAC[865].
Robert Hue, qui succède en 1994 à Georges Marchais, engage le PCF sur la voie d'une « mutation » démocratique en reconnaissant les erreurs du passé et en tolérant désormais l'expression des désaccords au sein du parti. Le PCF, désormais minoritaire à gauche, participe entre 1997 et 2002 au gouvernement Lionel Jospin en tant que membre de la coalition de la Gauche plurielle mais subit ensuite une série d'humiliations électorales : Robert Hue remporte 3,37 % des voix à l'élection présidentielle de 2002 - lors de laquelle il est dépassé par deux des trois candidats trotskystes - et Marie-George Buffet, 1,93 % à celle de 2007[825]. Le PCF s'allie ensuite au Parti de gauche au sein de la coalition du Front de gauche : c'est l'ancien socialiste Jean-Luc Mélenchon, leader du PG, qui représente le Front de gauche à l'élection présidentielle de 2012 en s'appuyant sur l'appareil militant du PCF[1018],[1019], marginalisant au passage les candidats trotskystes[1020]. La démarche de Jean-Luc Mélenchon est alors comparable à celle de Die Linke en Allemagne, par la volonté de constituer un pôle radical à gauche en se fédérant avec les communistes[1021]. À l'occasion des scrutins de 2017, cependant, l'alliance du Front de gauche se défait, Mélenchon et ses partisans se présentant désormais sous la bannière de La France insoumise, sans accord avec le PCF[1022],[1023].
Scandinavie
Les deux principaux PC scandinaves renoncent à l'identité communiste à la fin de la guerre froide. Le Parti communiste de Finlande cesse d'exister en 1992[1024] pour donner naissance à un nouveau parti, l'Alliance de gauche. L'ancienne scission pro-soviétique, le Parti communiste de Finlande (Unité), reprend en 1997 le nom du parti historique, mais sans parvenir à en retrouver l'envergure[866]. En Suède, le Parti de gauche - Les communistes change quant à lui de nom pour s'appeler simplement Parti de gauche[848].
Chypre
À Chypre, le Parti progressiste des travailleurs (AKEL) entre au gouvernement en 2003 après l'élection de Tássos Papadópoulos, candidat d'une coalition entre le Parti démocrate et les communistes. Dimitris Christofias, secrétaire général d'AKEL, est élu en février 2008 président de la République, ce qui fait de lui le seul chef d'État communiste de l'Union européenne. Le pays n'en demeure pas moins acquis à l'économie de marché[1025]. Une grave crise financière contribue à rendre impopulaire Christofias, qui ne se représente pas pour un second mandat : l'élection présidentielle de 2013 est remportée par le candidat conservateur face au candidat soutenu par les communistes[1026].
Grèce
.jpg.webp)
Le Parti communiste de Grèce est affaibli après la chute de bloc de l'Est, mais ne réalise aucun aggiornamento et se raidit au contraire sur le plan idéologique[1027] ; les modérés, exclus du comité central, transforment alors la coalition Synaspismós en un parti politique concurrent[1028]. Le KKE continue ensuite d'attirer une frange de l'électorat grâce à un discours mâtiné de nationalisme et en se concentrant sur des thèmes comme l'opposition à l'OTAN[568]. Dans les années 2010, ses résultats sont largement distancés à gauche par ceux de SYRIZA, formation de gauche radicale au sein de laquelle a fusionné Synaspismós[1029].
Afrique du Sud
En Afrique du Sud, après la chute de l'Apartheid, le Parti communiste sud-africain demeure allié à l'ANC, désormais au pouvoir, au sein d'une alliance tripartite qui inclut également le Congress of South African Trade Unions. Cette alliance, qui a permis au PC sud-africain de détenir différents ministères, ne se traduit cependant pas par une quelconque rupture de l'Afrique du Sud avec l'économie de marché. Nelson Mandela a revendiqué le fait d'avoir pratiqué l'alliance avec les communistes pour des raisons tactiques, admettant que les communistes aient pu se servir de l'ANC à l'époque de l'Apartheid mais considérant que l'ANC s'est également servie des communistes en retour pour atteindre ses propres buts[804],[1030].
Inde
_Ghosh_Para_Branch_Office_-_Ghosh_Para_Road_-_Barrackpore_-_North_24_Parganas_2012-04-11_9536.JPG.webp)
En Inde, où la rébellion naxalite menée par le Parti communiste d'Inde (maoïste) est par ailleurs toujours en cours, les partis communistes modérés demeurent présents sur le plan électoral. Unis avec d'autres partis au sein du Front de gauche, le Parti communiste d'Inde (marxiste) et le Parti communiste d'Inde cherchent, à la fin des années 1980, à nouer des alliances avec d'autres partis d'opposition au Congrès. En 1989, ils participent à la coalition du Front national, qui remporte les élections : le PCI(m) soutient alors le gouvernement de V.P. Singh aux côtés du BJP, un parti nationaliste de droite. Le Congrès revient au pouvoir dès l'année suivante : les communistes persistent ensuite dans leur stratégie d'alliance. Après les élections de 1996, qui ne parviennent pas à dégager de réelle majorité, les communistes se joignent à une nouvelle coalition assez lâche, le Front uni, qui constitue un gouvernement de « troisième force »[247]. Jyoti Basu est un temps pressenti pour devenir premier ministre au nom du Front uni, mais le politburo du PCI(m) ne l'autorise pas à se porter candidat. Le Front uni, trop fragile et instable, perd le pouvoir lors des élections anticipées de 1998[1031].
De 2004 à 2008, le Front de gauche indien est à nouveau associé au pouvoir en participant à la coalition majoritaire de l'Alliance progressiste unie, dirigée par le Congrès. Les communistes rompent ensuite leur alliance avec le Congrès à la suite de la signature de l'accord indo-américain de coopération sur le nucléaire, qu'ils dénoncent comme une atteinte à la souveraineté nationale. À la fin des années 2000, les communistes indiens se replient sur leurs bastions, où une partie de leurs électeurs leur reproche leurs compromissions avec le Congrès[247]. En 2011, le Parti communiste d'Inde (marxiste) perd les élections dans ses deux fiefs du Bengale-Occidental — ce qui met fin à 34 ans de gouvernement communiste dans cet État indien — et du Kerala[1032] : il conserve uniquement l'État du Tripura[1033].
Népal

Au Népal, les multiples partis communistes participent, aux côtés du Congrès népalais, à la campagne en faveur de la démocratisation. Après le rétablissement du multipartisme, deux des factions communistes fusionnent pour donner naissance au Parti communiste du Népal (marxiste-léniniste unifié) qui, malgré son idéologie officielle, est classé au centre gauche, et qui devient l'un des principaux partis du pays[630]. Mais un PC rival, le Parti communiste du Népal (maoïste), dirigé par Pushpa Kamal Dahal dit « Prachanda », reste radicalement opposé à la monarchie, contre laquelle il mène une guerre civile de 1996 à 2006. La signature de l'accord de paix est suivie d'une période de transition politique et, en avril 2008, l'élection de l'Assemblée constituante est remportée par les maoïstes. La république est proclamée, et Pushpa Kamal Dahal devient chef du gouvernement. La transition au Népal, nation pauvre et très dépendante des échanges avec l'Inde, ne débouche cependant pas sur la mise en place d'un régime de type communiste : le pays conserve un système d'économie mixte et des élections libres[1034].
En outre, le contexte politique népalais ne permet pas aux maoïstes de conserver longtemps le pouvoir : « Prachanda » démissionne dès de son poste de premier ministre, à la suite d'un conflit avec le chef de l'État. Le Népal connaît ensuite une période d'instabilité gouvernementale, alors que les maoïstes alternent au pouvoir avec la coalition formée par le Congrès népalais et le Parti communiste du Népal (marxiste-léniniste unifié). L'élection de novembre 2013 est largement remportée par le Congrès, tandis que les maoïstes, perdant près des deux tiers de leurs sièges, sont renvoyés dans l'opposition[1035] ; le Parti communiste du Népal (marxiste-léniniste unifié) est associé au gouvernement dirigé par le Congrès népalais[1036]. En , Prachanda redevient premier ministre dans le cadre d'un accord avec le Congrès[1037].
Autres pays
À Saint-Marin, le Parti communiste saint-marinais participe au gouvernement jusqu'en 1990. À cette date, dans le contexte de l'effondrement du communisme européen et à la suite du Parti communiste italien, il abandonne son identité communiste et se rebaptise Parti progressiste démocrate saint-marinais[585].
Le Parti communiste du Venezuela, qui n'a qu'un petit nombre d'élus, devient à la fin des années 1990 une composante minoritaire de la coalition d'Hugo Chávez. Le PCV refuse en 2007 de fusionner au sein du Parti socialiste unifié du Venezuela fondé par Chávez, mais maintient ensuite son alliance avec le gouvernement socialiste et pro-castriste vénézuélien[1038].
Au Brésil, la majorité du Parti communiste brésilien décide en 1991 de se transformer en Parti populaire socialiste. Le Parti communiste du Brésil conserve quant à lui son nom : allié avec le Parti des travailleurs, il entre au gouvernement en 2003 après l'élection de Luiz Inácio Lula da Silva, en obtenant le ministère des sports. Il demeure associé au pouvoir sous la présidence de Dilma Rousseff[1039].
En Irak, après la chute de Saddam Hussein en 2003, le Parti communiste irakien est à nouveau autorisé. Sa liste, l'Union du peuple, obtient deux sièges de députés lors des élections de janvier 2005. Il participe au gouvernement d'union nationale de 2006, mais perd ensuite ses sièges au parlement lors des élections de 2010[1040]. Le PC irakien s'allie par la suite au leader chiite Moqtada al-Sadr pour former en la coalition En marche, qui remporte les législatives de mai suivant[1041].
En Syrie, les deux PC issus du Parti communiste syrien historique demeurent des partenaires du régime en place ; ils sont tous deux membres du Front national progressiste dirigé par le Parti Baas du président Bachar el-Assad[1042].
Les diverses tendances de l'extrême gauche


Outre le maintien du PCF et la présence de références communistes chez une partie de la gauche radicale, la France est l'un des rares pays occidentaux où le courant trotskyste bénéficie d'un certain poids électoral : lors de l'élection présidentielle de 2002, les trois principaux courants trotskystes français ont été représentés respectivement par Arlette Laguiller (LO), Olivier Besancenot (LCR) et Daniel Gluckstein (PT), cumulant à eux trois environ 10 % des suffrages. Olivier Besancenot bénéficie dans les années suivantes d'une certaine médiatisation, présentant un visage moderne de l'engagement trotskyste[1043]. Les résultats des présidentielles de 2007 et 2012 sont néanmoins décevants pour les trotskystes. La LCR laisse la place en 2010 au Nouveau Parti anticapitaliste et s'éloigne de son identité trotskyste dans le but d'élargir son audience, en axant son discours sur une critique globale des injustices du capitalisme et en adoptant une position plutôt « libertaire »[1044] : le NPA connaît cependant un rapide reflux et, comme le reste de l'extrême gauche française, souffre de la concurrence du Front de gauche[1020],[1045],[1046].
Quelques guérillas continuent d'exister dans certains pays d'Amérique latine, comme celles menées par les FARC et l'ELN en Colombie, mais sans approcher les niveaux d'activité des décennies précédentes. Les FARC continuent de faire peser une menace sur les autorités mais leur projet politique, sans grande précision, laisse progressivement la place à des activités relevant essentiellement du grand banditisme. Au Pérou, la guérilla du Sentier lumineux s'étiole dès le début des années 1990 : Abimael Guzmán est arrêté en 1992, de même que la plupart des autres dirigeants de l'organisation[1047],[818].
Des partis staliniens ou « néo-staliniens », issus notamment de l'ancien courant « pro-albanais » ou de certaines formes de maoïsme, continuent d'exister. On peut citer, en Europe, le Parti marxiste-léniniste d'Allemagne, l'Organisation communiste marxiste-léniniste – Voie prolétarienne, le Parti communiste des ouvriers de France, le Parti du travail de Belgique, le Parti marxiste-léniniste italien ou l'Organisation communiste de Grèce. Les ex-« pro-albanais » se réunissent au sein de la Conférence internationale des partis et organisations marxistes-léninistes (Unité et lutte), tandis que des groupes maoïstes font partie d'une autre internationale au nom presque identique, la Conférence internationale des partis et organisations marxistes-léninistes (correspondance de presse internationale). Le poids électoral de ces partis est généralement insignifiant en Europe[875] - à quelques rares exceptions près, comme le Parti du travail de Belgique[1048] - mais ils conservent une certaine influence sur d'autres continents, mis à part le cas du Népal où les maoïstes ont exercé le pouvoir. En Équateur, le Parti communiste marxiste-léniniste est le membre dominant d'une coalition électorale, le Mouvement populaire démocratique : l'un de ses dirigeants, Edgar Isch, a été un temps ministre de l'environnement. En Tunisie, un parti issu de la même tendance, le Parti communiste des ouvriers de Tunisie, a longtemps constitué la principale force d'opposition laïque au régime de Ben Ali[875].
Des formes de rapprochements avec l'islamisme ont par ailleurs été observées, dans des contextes et à des degrés très divers, chez certaines franges de l'extrême-gauche communiste. Cela peut concerner des personnalités isolées comme l'ex-terroriste « Carlos » qui proclame son admiration pour Oussama ben Laden, mais aussi certains mouvements présents sur la scène politique comme le Parti socialiste des travailleurs britannique (trotskyste) ou le Parti du travail de Belgique (stalinien)[1049].
Permanence des références communistes
Une partie de l'univers référentiel du communisme demeure présent dans des milieux de gauche ou d'extrême gauche, que ce soit dans les discours de certains chefs d'État comme le vénézuelien Hugo Chávez (1954-2013), dans la mouvance de l'altermondialisme ou plus largement dans celles de la gauche antilibérale et de la gauche radicale, ainsi que dans certains milieux intellectuels[1050],[1051],[1052]. L'historien Robert Service souligne que les conditions historiques qui ont permis la naissance et le développement de la mouvance communiste, à savoir de profondes injustices politiques et économiques, sont toujours présentes. Si le retour du communisme sous la forme qu'il a adopté au XXe siècle lui paraît improbable, il juge que l'idée de communisme a laissé une trace suffisamment forte dans les esprits pour pouvoir renaître sous d'autres formes[1053].
Notes et références
- Le Siècle des communismes 2004, p. 9-19
- Ducoulombier 2011, p. 11
- Ducoulombier 2011, p. 9
- Winock 1992, p. 146-155
- Archie Brown, The Rise and Fall of communism, Vintage Books, 2009, page 105 ; Jean-François Soulet, Histoire comparée des États communistes de 1945 à nos jours, Armand Colin, coll. « U », 1996, pages 11-42 et Alexandre Zinoviev, Le Communisme comme réalité, Julliard, 1981, p. 58.
- Ducoulombier 2011, p. 128-132
- Droz 1972, p. 25-35
- Droz 1972, p. 55-59
- Droz 1972, p. 62-66
- Droz 1972, p. 67-71
- Service 2007, p. 14-15
- Droz 1972, p. 96-97
- Brown 2009, p. 13-14
- Droz 1972, p. 85-87
- Droz 1972, p. 89
- Winock 1992, p. 13
- Brown 2009, p. 14-15
- Winock 1992, p. 15-18
- Droz 1972, p. 262-265
- Brown 2009, p. 16
- Brown 2009, p. 22-25
- Droz 1972, p. 248-249
- Priestland 2009, p. 18-19
- Fairbank 1989, p. 114-121
- « Communisme Centre national de ressources textuelles et lexicales-CNRTL »
- Grandjonc 1983, p. 144
- Grandjonc 1983, p. 145
- Grandjonc 1983, p. 146
- Cassely, 2016 : Aix insolite et secrète JonGlez pp. 192-193 (références Bibliothèque nationale de France)
- Grandjonc 1983, p. 147
- D'Hondt 1989, p. 220
- D'Hondt 1989, p. 221
- D'Hondt 1989, p. 232
- Hölderlin, Œuvres, Gallimard, « la Pléiade », Paris, 1967, p. 230
- Droz 1972, p. 278
- Droz 1972, p. 390, 394
- Grandjonc 1983, p. 148
- Pierre Haubtmann, Pierre-Joseph Proudhon, Beauchesne, 1997, p. 320
- Gilles Candar, Le Socialisme, Les Essentiels Milan, 1996, p. 8-11
- Droz 1972, p. 287-286
- Brown 2009, p. 17-18
- Dmitri Georges Lavroff, Les Grandes étapes de la pensée politique, Dalloz, 1999, p. 400
- Celestin Charles Alfred Bougle, La sociologie de Proudhon, Arno Press, 1979, p. 39
- Priestland 2009, p. 20-22
- Collectif, Louis Blanc, un socialiste en république, Créaphis, 2004, p. 12, 207
- Jean-Michel Humilière (dir.), Louis Blanc, 1811-1882 (recueil de textes), Éditions de l'Atelier / Éditions ouvrières, 1982, p. 74-75
- Droz 1972, p. 390-393
- Denis Berger et Loïc Rignol, article Communismes, in Michèle Riot-Sarcey, Thomas Bouchet et Antoine Picon (dir.), Dictionnaire des utopies, Larousse, 2002, pages 53-58
- Droz 1972, p. 390-395
- Winock 1992, p. 43-44
- Claude Pichois, Le Romantisme : 1843-1869, Arthaud, 1979, p. 131
- Brown 2009, p. 17 ; Brown cite le Oxford English Dictionary qui attribue à Cabet l'invention du mot
- « Si vous étiez Chrétien, vous seriez Communiste ; car Jésus-Christ vous prescrit la Communauté, et vous devez suivre son commandement sans examen, sans discussion, sans la moindre résistance, sans la moindre hésitation. N'être pas Communiste, c'est mettre votre jugement au-dessus de votre Dieu, c'est être désobéissant, factieux, séditieux, rebelle, révolté contre Dieu ! C'est mériter l'enfer ! » Étienne Cabet, Le gant jeté au Communisme par un riche jésuite, académicien à Lyon, ramassé par M. Cabet, Au Bureau du populaire, 1844, p. 17.
- Michel Cordillot, La sociale en Amérique. Dictionnaire biographique du mouvement social francophone, Éditions de l'Atelier, 2002, pages 81-87
- William Alfred Hinds, American communities, Office of the American Socialist, 1878, p. 87-88
- Melvin Gingerich, The Christian and revolution, Herald Press, 1968, p. 56
- Droz 1972, p. 419-427
- Priestland 2009, p. 25
- Droz 1972, p. 434-435
- Droz 1972, p. 446-452
- Courtois 2007, p. 482
- Première édition : V. Lecou, 1848 ; réédition Éditions du Trident, 2010
- Du communisme, Terrain vague, édition de 1993, p. 5
- Priestland 2009, p. 26
- Karl Marx, Contribution à la critique de l’économie politique, traduction de Laura Lafargue, Giard & Brière, Paris, 1909 p. 3
- Priestland 2009, p. 27
- Priestland 2009, p. 28
- Priestland 2009, p. 29
- Priestland 2009, p. 30
- Priestland 2009, p. 31
- Priestland 2009, p. 39
- Priestland 2009, p. 38
- Priestland 2009, p. 40
- Priestland 2009, p. 34
- Service 2007, p. 30
- Annie Kriegel, L'Association internationale des Travailleurs (1864-1876), in Droz 1972, p. 603-634
- Priestland 2009, p. 41
- Winock 1992, p. 107-108
- Droz 1972, p. 531-532
- Priestland 2009, p. 37-42
- Georges Bublex, Marx vérifié par l'expérience, L'Harmattan, 2010, p. 66-67
- Textes d'histoire contemporaine, Presses universitaires de Bordeaux, 1995, p. 125-126
- Winock 1992, p. 216-221
- Sonia Dayan-Herzbrun, Mythes et mémoires du mouvement ouvrier, l'Harmattan, 2000, p. 98-100
- Olivier Meuwly, Anarchisme et modernité, L'Âge d'homme, 1998, p. 82
- Winock 1992, p. 60
- Droz 1978, p. 184
- Priestland 2009, p. 42
- André Piettre, Marx et marxisme, Presses universitaires de France, 1966, p. 20-31
- Winock 1992, p. 107-134
- Schumacher 1998, p. 22
- Schumacher 1998, p. 30
- Mathias 1964, p. 22
- Winock 1992, p. 109-111
- Winock 1992, p. 128-134
- Berg 2003, p. 98
- Berg 2003, p. 97
- Eduard Bernstein, Cromwell & Communism: Socialism and Democracy in the Great English Revolution, Routledge, 1963, p. 222
- Schumacher 1998, p. 226
- Winock 1992, p. 112-114
- Gilles Candar, le Socialisme, les Essentiels Milan, 1996, p. 20
- Winock 1992, p. 75
- Winock 1992, p. 75-81
- Serge Audier, Le Socialisme libéral, la Découverte, 2006, p. 38-39
- Winock 1992, p. 113-122
- Droz 1974, p. 54-55
- Figes 1998, p. 113
- Figes 1998, p. 129-138
- Droz 1974, p. 401-415
- Figes 1998, p. 132-134
- Service 2007, p. 30, 48
- Figes 1998, p. 139-149
- Droz 1974, p. 404
- Service 2000, p. 132-136
- Figes 1998, p. 149-150
- Service 2000, p. 137-142
- Figes 1998, p. 149-151
- Colas 1987, p. 13-31
- Service 2009, p. 68-72
- Service 2009, p. 152-157, 48
- Figes 1998, p. 1151-153
- Service 2009, p. 82-83
- Service 2000, p. 170-174
- Carrère d'Encausse 1998, p. 127-138
- Service 2009, p. 88-91
- Carrère d'Encausse 1998, p. 142-153
- François-Xavier Coquin, 1905 — La Révolution russe manquée, Complexe, 1999, p. 138-141
- Carrère d'Encausse 1998, p. 156-157, 176-196
- Colas 1987, p. 39-42
- Service 2000, p. 189-190, 214-215
- Carrère d'Encausse 1998, p. 200-206
- Droz 1977, p. 585-590
- Winock 1992, p. 137-138
- Dreyfus 1991, p. 67-69
- Service 2000, p. 235
- Carrère d'Encausse 1998, p. 216-222
- Brown 2009, p. 48-49
- Figes 1998, p. 326-327
- Brown 2009, p. 49-50
- Figes 1998, p. 385-386
- Service 2007, p. 59-60
- Carrère d'Encausse 1998, p. 265-266, 274
- Figes 1998, p. 370
- Figes 1998, p. 421-433
- Service 2007, p. 60-61
- Service 2009, p. 178-179
- Service 2000, p. 292-298
- Droz 1974, p. 440-441
- Vladimir Ilitch Lénine, L'État et la Révolution, Gonthier, réédition de 1964, p. 91-93
- Figes 1998, p. 471-472
- Werth 2004, p. 124
- Service 2007, p. 67-70
- Brown 2009, p. 51
- Werth 2004, p. 124-127, 132-134, 138-140
- Graziosi 2010, p. 23
- Souvarine 1985, p. 177-178
- Service 2007, p. 71
- Werth 2004, p. 142-163
- Service 2000, p. 355
- Service 2007, p. 70-73
- Nicolas Werth, Crimes et violences de masse des guerres civiles russes, Online Encyclopedia of Mass Violence / Sciences-Po Paris, 2008
- Figes 1998, p. 535-536, 630-632, 641-649
- Figes 1998, p. 745-749
- Carrère d'Encausse 1998, p. 565-569
- Carrère d'Encausse 1998, p. 431-433
- Nicolas Werth, Un État contre son peuple : violences, répression, terreurs en Union soviétique, in Le Livre noir du communisme 1997, p. 85
- Figes 1998, p. 640, 677-679
- Werth 2004, p. 163-169
- Figes 1998, p. 574-575
- Figes 1998, p. 751-769
- Service 2007, p. 75
- Ferro 1997, p. 56-64
- Ferro 1997, p. 83
- Brown 2009, p. 68
- Figes 1998, p. 740-742
- Service 2007, p. 138
- Werth 2004, p. 170-181
- Courtois 2007, p. 87
- Nicolas Werth, Un État contre son peuple : violences, répression, terreurs en Union soviétique, in Le Livre noir du communisme 1997, p. 130
- Nicholas Riasanovsky, Histoire de la Russie, Robert Laffont, 1999, pages 529-530
- Figes 1998, p. 770
- Werth 2004, p. 182-184
- Brown 2009, p. 84-85
- Conord 2012, p. 79
- Hentilä, Jussila et Nevakivi 1999, p. 149-166
- Hentilä, Jussila et Nevakivi 1999, p. 174-175
- Winkler 2005, p. 303-304
- Serge Berstein, Pierre Milza, L'Allemagne de 1870 à nos jours, Armand Colin, 2010, p. 67-68
- Nolte 2011, p. 130
- Serge Berstein, Pierre Milza, L'Allemagne de 1870 à nos jours, Armand Colin, 2010, p. 71
- Nolte 2011, p. 138-140
- Winkler 2005, p. 322-330
- Courtois et Lazar 1993, p. 39-40
- Droz 1974, p. 634
- Serge Berstein, Pierre Milza, Le Fascisme italien, Seuil, 1980, p. 147-153
- Helen Graham, Paul Preston, The Popular Front in Europe, Macmillan, 1987, p. 38
- Droz 1974, p. 129-131
- Busky 2002, p. 74, vol 1
- Rees et Thorpe 1998, p. 130-132
- Droz 1977, p. 327-328
- Serge Wolikow, Aux origines de la galaxie communiste : l'Internationale, in Le Siècle des communismes 2004, p. 294-296
- Service 2007, p. 108-110
- Nikolaï Boukharine, L'ABC du communisme (première partie), Les Nuits rouges, 2007, page 148
- Droz 1977, p. 178
- Droz 1977, p. 294-297
- Busky 2002, p. 8, vol 1
- Miklós Molnar, Histoire de la Hongrie, Hatier, 1996, p. 330-336
- Service 2007, p. 87-90
- Droz 1977, p. 242
- Winkler 2005, p. 90-92
- Nolte 2011, p. 140-141
- André Gerrits, The myth of Jewish communism : a historical interpretation, Peter Lang Pub Inc, 2009, p. 20
- William Brustein, Roots of hate: anti-semitism in Europe before the Holocaust, Cambridge University Press, 2003, p. 293-294
- Busky 2002, p. 66, vol 1
- Werth 2004, p. 169-170
- Service 2000, p. 406-412
- Carrère d'Encausse 1998, p. 512
- Nolte 2011, p. 159-161
- Droz 1977, p. 220-222
- Serge Wolikow, Aux origines de la galaxie communiste : l'Internationale, in Le Siècle des communismes 2004, p. 302
- Brown 2009, p. 78-79
- Sarah C. M. Paine, Imperial Rivals : China, Russia, and Their Disputed Frontier, M. E. Sharpe, 1996, p. 329
- Ducoulombier 2011, p. 49-55
- Courtois 2007, p. 78
- Brown 2009, p. 117-132
- Nolte 2011, p. 163-164
- Furet 1995, p. 104-120
- Courtois 2007, p. 87-88
- Michel Dreyfus, Syndicalistes communistes, in Le Siècle des communismes 2004, p. 691
- Courtois 2007, p. 92
- Winkler 2005, p. 336-340
- Hobsbawm 1999, p. 172
- Regin Schmidt, Red Scare: FBI and the Origins of Anticommunism in the United States, Museum Tusculanum Press, 2008, page 115
- Michaud Nelson, Droite et Démocratie au Québec : Enjeux et Paradoxes, Presses Universitaires de Laval, 2007, page 76
- Gotovitch, Delwit et De Waele 1992, p. 338
- Brown 2009, p. 83
- Serge Wolikow, Aux origines de la galaxie communiste : l'Internationale, in Le Siècle des communismes 2004, p. 297-298
- Carrère d'Encausse 1998, p. 473-475
- Serge Wolikow, Internationalistes et internationalismes communistes, in Le Siècle des communismes 2004, p. 515
- Courtois 2007, p. 397
- Anthony D'Agostino, The Rise of Global Powers: International Politics in the Era of the World Wars, Cambridge University Press, 2011, p. 124
- Carrère d'Encausse 1998, p. 483-484
- Marc Ferro, Histoire des colonisations : des conquêtes aux indépendances (XIIIe ‑ XXe siècles), Seuil, 1994, pages 367-369
- Service 2007, p. 119
- Ruth T. McVey, The Rise of Indonesian Communism, Equinox Publishing, 2006, p. 7
- Carrère d'Encausse 1998, p. 474
- Catherine Clémentin-Ojha, Christophe Jaffrelot, Denis Matringe, Jacques Pouchepadass, Dictionnaire de l'Inde, Larousse, 2009, pages 180-182
- Bulent Gokay, Soviet Eastern Policy and Turkey, 1920-1991: Soviet Foreign Policy, Turkey and Communism, Routledge, 2007, pages 23-27
- Jon Jacobson, When the Soviet Union Entered World Politics, University of California Press, 1994, page 118
- Ducoulombier 2011, p. 53
- Manuel Caballero, Alan Knight, Latin America and the Comintern 1919-1943, Cambridge University Press, 2002, p. 45
- Courtois et Lazar 1993, p. 41-42
- Courtois et Lazar 1993, p. 48-49
- Winock 1992, p. 400-401
- Courtois et Lazar 1993, p. 57-67
- Winock 1992, p. 84
- Droz 1977, p. 436-437
- Rees et Thorpe 1998, p. 169-171
- Rees et Thorpe 1998, p. 187-192
- Margaret E. Kenna, The Social Organization of Exile: Greek Political Detainees in the 1930s, Routledge, 2013, page 10
- Droz 1977, p. 310-314
- Olivier Delorme, La Grèce et les Balkans : Du Ve siècle à nos jours, t. 2, Paris, Éditions Gallimard, coll. « Folio histoire », , 800 p. (ISBN 978-2-07-045271-2), p. 96.
- Droz 1977, p. 303-304
- Droz 1977, p. 263-266
- Busky 2002, p. 87-88, vol 1
- Robert J. Alexander, A History of Organized Labor in Argentina, Praeger Publishers, 2003, p. 47-48
- Thomas 2001, p. 348-350, 458
- Domenach et Richer 1987, p. 9-15
- Droz 1974, p. 534-538
- Brown 2009, p. 98-99
- Werth 2004, p. 305
- Rees et Thorpe 1998, p. 287-293
- Collectif, Sources of Korean Tradition : From the Sixteenth to the Twentieth Centuries, Columbia University Press, 2001, p. 353
- Priestland 2009, p. 242, 268
- Daniel B. Schirmer et Stephen Rosskamm Shalom, The Philippines Reader : A History of Colonialism, Neocolonialism, Dictatorship, and Resistance, South End Press, 1987, p. 73-74
- Alfredo B. Saulo, Communism in the Philippines: an introduction, Ateneo de Manila University Press, 1990, p. 216-217
- Pierre Brocheux, Libération nationale et communisme en Asie du Sud-Est, in Le Siècle des communismes 2004, p. 405-406
- Courtois 2007, p. 396-398
- René Gallissot, Libération nationale et communisme dans le monde arabe, in Le Siècle des communismes 2004, p. 382-384
- Priestland 2009, p. 398
- Courtois 2007, p. 69-70
- Courtois 2007, p. 102-103
- Courtois 2007, p. 252
- Winock 1992, p. 64-66
- Nolte 2011, p. 160-161
- Denis Authier, Jean Barrot, La gauche communiste en Allemagne, 1918-1921, Payot, 1976, p. 61
- Michael Löwy, Georg Lukács — From romanticism to bolshevism, NLB, 1979, p. 156
- Winock 1992, p. 64-65
- Daryl Glaser, David M. Walker (dir.), Twentieth-Century Marxism : A Global Introduction, Routledge, 2007, p. 30
- Courtois et Lazar 1993, p. 77
- Conord 2012, p. 70
- Branko Lazitch, Milorad M. Drachkovitch, Biographical Dictionary of the Comintern, Hoover Institution Press, 1986, pages 37-38
- Jean-Michel Palmier, David Fernbach, Weimar in Exile: The Antifascist Emigration In Europe And America, Verso Books, 2006, p. 51
- Winkler 2005, p. 390
- Furet 1995, p. 238
- Serge Wolikow, Aux origines de la galaxie communiste : l'Internationale et Internationalistes et internationalismes communistes, in Le Siècle des communismes 2004, p. 298-304, 526-528
- Michel Dreyfus, Syndicalistes communistes, in Le Siècle des communismes 2004, p. 691-702
- Courtois 2007, p. 416-417
- Ducoulombier 2011, p. 53-55
- Droz 1977, p. 222-224
- Nolte 2011, p. 190-191
- Droz 1977, p. 304-306
- Diniou Charlanov, Lioubomir Ognianov, Plamen Tzvetkov, La Bulgarie sous le joug communiste, Courtois 2002, p. 313-315
- Droz 1977, p. 189
- Colarizi 2000, p. 211
- Priestland 2009, p. 111-112
- Colas 1987, p. 113-114
- Gotovitch, Delwit et De Waele 1992, p. 118-119
- Pierre Brocheux, Histoire de l'Asie du Sud-Est: révoltes, réformes, révolutions, Presses universitaires du Septentrion, 2000, page 235
- Philippe Devillers, Histoire du viêt-nam de 1940 à 1952, Seuil, 1952, page 60-61
- Michael Löwy, Figures du communisme latino-américain, in Le Siècle des communismes 2004, p. 678
- Courtois 2007, p. 80
- Service 2000, p. 436, 443-473
- Werth 2004, p. 212-213
- Service 2009, p. 308
- Bensaïd 2002, p. 11
- Werth 2004, p. 212-214
- Service 2009, p. 308-312
- Service 2000, p. 381-382
- Souvarine 1985, p. 310-312
- Courtois 2007, p. 348
- Raynaud 2010, p. 132
- Colas 1987, p. 110-111
- Werth 2004, p. 216-222
- Werth 2004, p. 226-231
- Service 2004, p. 250-255
- Service 2009, p. 373-375
- Werth 2004, p. 226-235, 251-252
- Souvarine 1985, p. 435
- Werth 2004, p. 297
- Service 2004, p. 281-282
- Werth 2004, p. 298
- Priestland 2009, p. 125-126
- Claude Pennetier, Bernard Pudal, Du parti bolchevik au parti stalinien, in Le Siècle des communismes 2004, p. 505-506
- Furet 1995, p. 139-143
- Michel Prat, L'échec d'une opposition internationale de gauche dans le Komintern, revue Communisme no 5 : Le mouvement communiste international et ses oppositions: 1920-1940, 1984
- Courtois et Lazar 1993, p. 95-106
- Brown 2009, p. 83-86
- Robert Jackson Alexander, The right opposition — The Lovestoneites and the International Communist Opposition of the 1930s, Greenwood Press, 1981, p. 12, 290-293
- Conord 2012, p. 69
- Service 2007, p. 190-201
- Furet 1995, p. 140
- Werth 2004, p. 232-235
- Hobsbawm 1999, p. 505-506
- Brown 2009, p. 82-83
- Werth 2004, p. 238-239
- Brown 2009, p. 62-77
- Nicolas Werth, Un État contre son peuple : violences, répression, terreurs en Union soviétique, in Le Livre noir du communisme 1997, p. 173-174
- Courtois 2007, p. 544-546
- Werth 2004, p. 242-243
- Graziosi 2010, p. 110-118
- Ducoulombier 2011, p. 89-90
- Werth 2004, p. 245-252
- Brown 2009, p. 65-70
- Brigitte Studer, La Femme nouvelle, in Le Siècle des communismes 2004, p. 565-578
- Service 2004, p. 268
- Service 2004, p. 257-266
- Werth 2004, p. 257-258
- Service 2007, p. 148-149
- Werth 2004, p. 260-266
- Nicolas Werth, Un État contre son peuple : violences, répression, terreurs en Union soviétique, in Le Livre noir du communisme 1997, p. 203-205
- Courtois 2007, p. 173-174
- Brown 2009, p. 221
- Service 2007, p. 149
- Souvarine 1985, p. 514-516
- Werth 2004, p. 266-269
- Werth 2004, p. 268-276
- Nicolas Werth, Un État contre son peuple : violences, répression, terreurs en Union soviétique, in Le Livre noir du communisme 1997, p. 206-225
- Graziosi 2010, p. 129-137
- Service 2004, p. 347-356
- Brown 2009, p. 80-88, 168-169
- Hentilä, Jussila et Nevakivi 1999, p. 237-239
- Jacqueline Thévenet, La Mongolie, Karthala, 1999, p. 70-75
- « Christopher Kaplonski : "Thirty thousand bullets : remembering political repression in Mongolia", in Kenneth Christie and Robert Cribb, eds., Historical Injustice and Democratic Transition in Eastern Asia and Northern Europe : Ghosts at the Table of Democracy, London 2002, p. 156 »
- Priestland 2009, p. 179-180
- Robert Conquest, The Great Terror : a reassessment, Pimlico, 2008, p. 484-489
- Nicolas Werth, La Vérité sur la Grande Terreur, L'Histoire no 324, octobre 2007
- Serge Wolikow, Aux origines de la galaxie communiste : l'Internationale, Le Siècle des communismes 2004, p. 306-310
- Courtois et Lazar 1993, p. 97-109
- Brown 2009, p. 92-98
- Service 2007, p. 119-129, 194-201
- Droz 1977, p. 540
- Brown 2009, p. 123-128
- Priestland 2009, p. 185-186
- Furet 1995, p. 235-237
- Hobsbawm 1999, p. 147
- Brown 2009, p. 85-88
- Courtois et Lazar 1993, p. 110
- Courtois 2007, p. 93-94
- Priestland 2009, p. 191-192
- Furet 1995, p. 249-281
- Brown 2009, p. 88
- Brown 2009, p. 118-119
- Courtois 2007, p. 164
- Courtois 2007, p. 165
- Service 2007, p. 203-206
- Furet 1995, p. 185-188
- Brown 2009, p. 122-123
- Priestland 2009, p. 192-193
- Courtois et Lazar 1993, p. 123-148
- Beevor 2006, p. 84-86
- Priestland 2009, p. 193-194
- Lois Hecht Oppenheim, Politics in Chile: Socialism, Authoritarianism, And Market Democracy, Westview Press, 2006, p. 14
- Droz 1978, p. 219-220
- Thomas 2001, p. 438-445, 458-459
- Service 2009, p. 410-412
- Nick 2002, p. 174-181
- Michael Löwy, Figures du communisme latino-américain, in Le Siècle des communismes 2004, p. 681
- Bensaïd 2002, p. 28-31
- Service 2009, p. 437-440
- Service 2009, p. 222, 296-297, 500-501
- Bensaïd 2002, p. 25
- Raynaud 2010, p. 62-67
- Bensaïd 2002, p. 31-32
- Service 2009, p. 441-445
- Robert Jackson Alexander, International Trotskyism, 1929-1985: A Documented Analysis of the Movement, Duke University Press, 1991, pages 132-139
- Bensaïd 2002, p. 36
- Service 2009, p. 434-435
- Service 2009, p. 444-445
- Bensaïd 2002, p. 41-48
- Service 2009, p. 483-495
- Hermet 1989, p. 119-126, 146
- Beevor 2006, p. 157-167
- Hermet 1989, p. 118-136
- Hermet 1989, p. 134
- Beevor 2006, p. 168
- Beevor 2006, p. 290-291
- Rémi Skoutelsky, Brigadistes internationaux et résistants, in Le Siècle des communismes 2004, p. 655-673
- Brown 2009, p. 89-90
- Hermet 1989, p. 142-151
- Gotovitch, Delwit et De Waele 1992, p. 125
- Jean-Louis Margolin, Chine : une longue marche dans la nuit, in Le Livre noir du communisme 1997, p. 513
- Domenach et Richer 1987, p. 17
- Fairbank 1989, p. 323
- Priestland 2009, p. 249-256
- Brown 2009, p. 100
- Priestland 2009, p. 255-256
- Fairbank 1989, p. 347-356
- Fairbank 1989, p. 352-356
- Priestland 2009, p. 257-258
- Brown 2009, p. 146-147
- Fairbank 1989, p. 349-350
- Courtois 2007, p. 378-380
- Priestland 2009, p. 256-258
- Werth 2004, p. 318-323
- Werth 2004, p. 326-327
- Service 2004, p. 399-403
- Service 2007, p. 214-216
- Courtois et Lazar 1993, p. 167-169
- Busky 2002, p. 62, vol 1
- Werth 2004, p. 323-326
- Brown 2009, p. 136-142
- Alexander Werth, Russia at war 1941-1945, Penguin Books, 1965, p. 85-89, 338
- Hentilä, Jussila et Nevakivi 1999, p. 249-251
- Werth 2004, p. 326-329
- Brown 2009, p. 136-138
- Service 2004, p. 399-419
- Werth 2004, p. 334-339, 346-351
- Werth 2004, p. 351-356
- Halik Kochanski, The Eagle unbowed : Poland and the Poles in the Second World War, Penguin Books, 2012, pages 338-344
- Service 2007, p. 219-223
- Werth 2004, p. 357-358
- Service 2007, p. 217-223
- Busky 2002, p. 150, vol 2
- Werth 2004, p. 358-360
- Fejtö 1952, p. 42-43
- Fejtö 1952, p. 45
- Fejtö 1952, p. 90-94
- Werth 2004, p. 360
- Alexander Werth, Russia at war 1941-1945, Penguin Books, 1965, 338
- Hobsbawm 1999, p. 319
- Brown 2009, p. 145-146
- François Kersaudy, Winston Churchill, Taillandier, 2004, p. 555-556
- Werth 2004, p. 360-362
- Philippe Masson, La Seconde Guerre mondiale — Stratégies, moyens, controverses, chronologie, filmographie, Tallandier, 2003, p. 724-725
- Fairbank 1989, p. 367-368, 377
- Priestland 2009, p. 267
- Brown 2009, p. 143
- Droz 1977, p. 493-495
- Hobsbawm 1999, p. 224
- Courtois et Lazar 1993, p. 170-202
- Mark Mazower, Inside Hitler's Greece, Yale University Press, 2001, p. 97-98, 103-106, 329-330, 355-377
- (en) Stevan K. Pavlowitch, Hitler's new disorder : the Second World War in Yugoslavia, New York, Columbia University Press, , 332 p. [détail de l’édition] (ISBN 978-1850658955), p. 55-57
- François Kersaudy, Winston Churchill, Taillandier, 2004, p. 529
- (en) Stevan K. Pavlowitch, Hitler's new disorder : the Second World War in Yugoslavia, New York, Columbia University Press, , 332 p. [détail de l’édition] (ISBN 978-1850658955), p. 191-192.
- Walter R. Roberts, Tito, Mihailović, and the allies, 1941–1945, Duke University Press, 1987, p. 312–313
- Nicolette Frank, La Roumanie dans l’engrenage, Elsevier-Sequoia, Paris 1977
- (en) Milan Vajda, « History – Wartime Bratislava », Ville de Bratislava, (consulté le )
- Stefan Pascu (dir.): Atlas pour l'Histoire de la Roumanie, Ed. didactique et pédagogique, Bucarest 1983, p. 79.
- Articles du journal Ziua (« Le Jour ») no 3723 du vendredi 8 septembre 2006, du Jurnalul Național du mardi 5 décembre 2006, et du Ziarul Financiar du 23 juin 2006 sur « Ziarul Financiar, 23 iunie 2006 - Războiul din Est »(Archive • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?)
- Droz 1977, p. 317-318
- Richard C. Hall, War in the Balkans: An Encyclopedic History from the Fall of the Ottoman Empire to the Breakup of Yugoslavia, ABC-Clio, 2014, page 224
- Brown 2009, p. 145
- « Chronologie Bulgarie : D’un conflit mondial à l’autre (1919-1945) », sur clio.fr
- Colarizi 2000, p. 277-293
- Brown 2009, p. 146
- Fejtö 1952, p. 134-143
- François Léger, La Malaisie britannique et ses problèmes, Politique étrangère, année 1955, volume 20
- Dalloz 1987, p. 66-73
- Pierre Brocheux, Hô Chi Minh, Presses de Sciences Po, 2000, p. 155-157
- Philippe Franchini, Les Guerres d'Indochine, tome 1, Pygmalion - Gérard Watelet, 1988, p. 193-194
- Cesari 1995, p. 30-31
- Service 2007, p. 272
- Priestland 2009, p. 221-225
- Service 2007, p. 244-245, 272
- Brown 2009, p. 157-158
- Serge Wolikow, Antony Todorov, Le Communisme comme système, in Le Siècle des communismes 2004, p. 332-333
- Service 2007, p. 249-250
- Priestland 2009, p. 213
- Soulet 1996, p. 28-31
- Fejtö 1952, p. 204-207
- Brown 2009, p. 157, 190-192, 340
- Werth 2004, p. 399
- Brown 2009, p. 151-153
- Service 2007, p. 252
- Fejtö 1952, p. 48-75
- Frédéric Le Moal, Le Front yougoslave pendant la Seconde Guerre mondiale : de la guerre de l'Axe à la guerre froide, Éditions Soteca, , 272 p. [détail de l’édition] (ISBN 978-2-916385-53-2), p. 243-250.
- Fejtö 1952, p. 44-47, 206-207
- Brown 2009, p. 165-169
- Fejtö 1952, p. 94-95, 102-103, 289-290
- Romulus Rusan, Le système répressif communiste en Roumanie, in Courtois 2002, p. 375-398
- Fejtö 1952, p. 102-103
- Brown 2009, p. 172-173
- Diniou Charlanov, Lioubomir Ognianov, Plamen Tzvetkov, La Bulgarie sous le joug communiste, in Courtois 2002, p. 311-334
- Brown 2009, p. 157-160
- Fejtö 1952, p. 208-221
- Miklós Molnar, Histoire de la Hongrie, Hatier, 1996, p. 384-386
- Fejtö 1952, p. 105, 263-272
- Brown 2009, p. 173-176
- Winkler 2005, p. 570-571
- Service 2007, p. 243
- Fejtö 1952, p. 196-197
- Conord 2012, p. 136-137
- Ducoulombier 2011, p. 127-129, 160-161
- Soulet 1996, p. 60
- Milovan Djilas, The New Class — An analysis of the communist system, HBJ Book, édition de 1985, p. 37-100
- Service 2007, p. 256
- Andrzej Paczkowski et Karel Bartošek, in Le Livre noir du communisme, Robert Laffont, 1997, p. 414-416
- D. Charlanov, L. Ognianov et P. Tzvetkov, La Bulgarie sous le joug communiste, in Courtois 2002, p. 346-357
- Romulus Rusan (dir.), Le système répressif communiste en Roumanie, in Courtois 2002, p. 415-420
- Service 2004, p. 484
- Service 2007, p. 243-249
- Soulet 1996, p. 73-85
- Fejtö 1952, p. 297-330
- Soulet 1996, p. 47-49
- Soulet 1996, p. 54-57
- Conord 2012, p. 140-143
- Service 2007, p. 250
- Fejtö 1952, p. 197-203
- Fejtö 1952, p. 222-241
- Service 2004, p. 516
- Priestland 2009, p. 319
- Werth 2004, p. 398
- Brown 2009, p. 168-169
- Fejtö 1952, p. 245-247, 274-293
- Soulet 1996, p. 60-61
- Fejtö 1952, p. 247-248
- Brown 2009, p. 203
- Priestland 2009, p. 320-321
- Service 2007, p. 255-257
- Priestland 2009, p. 292-294
- Conord 2012, p. 165-166
- Busky 2002, p. 75, vol 1
- Gotovitch, Delwit et De Waele 1992, p. 172
- Priestland 2009, p. 217
- Brown 2009, p. 203, 205
- Ilios Yannakakis, Les Victimes grecques du communisme, in Courtois 2002, p. 517-536
- Nikos Marantzidis, in Communist and post-communist parties in Europe, Vandenhoeck & Ruprecht, 2008, p. 246-253
- Aron 1970, p. 117-159
- Courtois 2007, p. 372-373
- Courtois et Lazar 1993, p. 213-287
- Colarizi 2000, p. 319-325
- Serge Wolikow, Antony Todorov, L'Expansion européenne d'après-guerre, Michel Dreyfus, Bruno Groppo, Les Partis communistes français et italiens, in Le Siècle des communismes 2004, p. 328-329, 423-438
- Gotovitch, Delwit et De Waele 1992, p. 174
- Hentilä, Jussila et Nevakivi 1999, p. 347-374, 379-423, 432-433
- Gotovitch, Delwit et De Waele 1992, p. 176
- Gerhard Robbers (dir.), Encyclopedia of World Constitutions, Facts On File, 2006, p. 342
- Mary Fulbrook, A Concise History of Germany, Cambridge University Press, 2004, p. 221
- Gotovitch, Delwit et De Waele 1992, p. 258
- Busky 2002, p. 68-69, vol 1
- Busky 2002, p. 72-73, vol 1
- Gotovitch, Delwit et De Waele 1992, p. 177
- Busky 2002, p. 88, vol 1
- Busky 2002, p. 74, vol 63-64
- Busky 2002, p. 57-58, vol 1
- Service 2007, p. 127-129, 273-274
- Droz 1978, p. 77-81
- Droz 1978, p. 203-211
- Michael Löwy, Figures du communisme latino-américain, in Le Siècle des communismes 2004, p. 680-682
- Droz 1978, p. 219-222
- Vayssière 2001, p. 186
- Soulet 1996, p. 215
- Thomas 2001, p. 535-574
- Vayssière 2001, p. 136
- Thomas 2001, p. 580
- Fairbank 1989, p. 368-380
- Domenach et Richer 1987, p. 20-21
- Werth 2004, p. 400
- Priestland 2009, p. 294-296
- Nolte 2011, p. 755
- Domenach et Richer 1987, p. 33-52
- Soulet 1996, p. 77
- Brown 2009, p. 313-331
- Domenach et Richer 1987, p. 57-71
- Domenach et Richer 1987, p. 77-94, 117
- Soulet 1996, p. 101-102
- Priestland 2009, p. 267-269
- Brown 2009, p. 189-192
- Service 2007, p. 244
- Domenach et Richer 1987, p. 57-62
- Soutou 2010, p. 317-346
- Dalloz 1987, p. 85-97
- Dalloz 1987, p. 101-114, 130-131
- Courtois 2007, p. 296
- Dalloz 1987, p. 115-130
- Dalloz 1987, p. 157-158
- Kaonn Vandy, Cambodge 1940-1991, ou la politique sans les Cambodgiens, l'Harmattan, 17 avril 1992, p. 34-35
- Arnold R. Isaacs, Gordon Hardy, Boston Publishing Company et al., Pawns of War : Cambodia and Laos, vol. 22, Time Life UK, coll. « The Vietnam experience », 26 mai 1988, p. 22
- Dalloz 1987, p. 165-171, 178-200
- Carine Hahn, Le Laos, Karthala, 1999, p. 104-108
- Philip Short (trad. Odile Demange), Pol Pot : Anatomie d'un cauchemar [« Pol Pot, anatomy of a nightmare »], Denoël éditions, , 604 p. (ISBN 9782207257692), chap. 2 (« La ville lumière »), p. 77-78
- Dalloz 1987, p. 213-214
- Dalloz 1987, p. 228-272
- Jean-Louis Margolin, Vietnam : les impasses d'un communisme de guerre, in Le Livre noir du communisme 1997, p. 621-624
- Cesari 1995, p. 127-129
- Stanley Karnow, Vietnam : a History, Penguin Books, 1997, p. 240-243
- Priestland 2009, p. 270-272
- Priestland 2009, p. 377
- Jaffrelot 2006, p. 447-448
- Busky 2002, p. 63-64, vol 2.
- Brown 2009, p. 357-358
- Service 2007, p. 392
- As'ad Ghanem, Ethnic Politics in Israel. The Margins and the Ashkenazi Centre, Routledge, 2009, pages 33-35
- Robert Gellately, Lenin, Stalin and Hitler. The Age of social catastrophe, Vintage Books, 2007, pages 592-593
- Busky 2002, p. 25, vol 2
- Busky 2002, p. 75-82, vol 2
- André Fontaine, La Guerre froide 1917-1991, Éditions de la Martinière, 2004, p. 104-106, 237-238
- Droz 1977, p. 692-693
- Service 2009, p. 495-498
- Nick 2002, p. 7-18
- Nick 2002, p. 325-332
- Nick 2002, p. 230-233
- Bourseiller 2009, p. 35
- Bensaïd 2002, p. 64-69
- Nick 2002, p. 349-350
- Nick 2002, p. 343-347
- Nick 2002, p. 396-398
- Bourseiller 2009, p. 35-38
- Nick 2002, p. 360-379
- Raynaud 2010, p. 72-73
- Droz 1978, p. 195-196
- Nick 2002, p. 408-410
- Werth 2004, p. 374-378
- Werth 2004, p. 383-387
- Werth 2004, p. 378-383
- Werth 2004, p. 402-405
- Brown 2009, p. 231
- Werth 2004, p. 410-412
- Brown 2009, p. 220-223
- Werth 2004, p. 415-419
- Brown 2009, p. 197
- Service 2007, p. 310
- Werth 2004, p. 423-424, 440-447
- Fejtö 1972, p. 16-20
- Soutou 2010, p. 389
- Brown 2009, p. 271-272
- Soutou 2010, p. 394, 420-428
- Werth 2004, p. 428
- Fejtö 1972, p. 21-26
- Fejtö 1972, p. 32
- Fejtö 1972, p. 40-48
- Werth 2004, p. 430-434
- Brown 2009, p. 240-246
- Soutou 2010, p. 455-456
- Furet 1995, p. 528
- Courtois 2007, p. 393-395
- Brown 2009, p. 276-292
- Fejtö 1972, p. 76-77
- Fejtö 1972, p. 104-131
- Brown 2009, p. 244-266
- Graziosi 2010, p. 233-235
- Soutou 2010, p. 484-496, 502-517
- Soutou 2010, p. 511-515
- Brown 2009, p. 318-324
- Gotovitch, Delwit et De Waele 1992, p. 216-217
- Fejtö 1972, p. 167-172
- Soulet 1996, p. 154-155
- Bourseiller 2008, p. 58-59
- Busky 2002, p. 71-72, vol 2
- Werth 2004, p. 440-472
- Priestland 2009, p. 347
- Brown 2009, p. 264-266
- Werth 2004, p. 475-535
- Brown 2009, p. 405-418
- Graziosi 2010, p. 269-293
- Brown 2009, p. 575-577
- Fejtö 1972, p. 104-131, 167
- Winkler 2005, p. 623-625
- Soutou 2010, p. 517-557
- Service 2007, p. 356-357
- Service 2007, p. 381
- Fejtö et Kulesza-Mietkowski 1992, p. 198
- Soutou 2010, p. 762-763
- Fejtö 1972, p. 180-185
- Fejtö et Kulesza-Mietkowski 1992, p. 206-214
- Brown 2009, p. 368-397
- Fejtö 1972, p. 245-283
- Service 2007, p. 383-385
- Brown 2009, p. 423-426
- Brown 2009, p. 426-437
- Brown 2009, p. 460-464
- Soutou 2010, p. 794-803
- Dreyfus 1991, p. 234
- Fejtö 1972, p. 225-244
- Paul Garde, Vie et mort de la Yougoslavie, Fayard, , 480 p., broché [détail de l’édition] (ISBN 2213605599 et 978-2213605593), p. 107-108.
- Fejtö et Kulesza-Mietkowski 1992, p. 228-235
- Fejtö et Kulesza-Mietkowski 1992, p. 328-330
- Service 2007, p. 358-359, 380-381
- Andrew C. Janos, East Central Europe in the Modern World The Politics of the Borderlands from Pre- to Postcommunism, Stanford University Press, 2000, pages 283-284
- Vayssière 2001, p. 136-141
- Priestland 2009, p. 383-389
- Vayssière 2001, p. 142-147
- Service 2007, p. 345-347
- Thomas 2001, p. 923-927
- Vayssière 2001, p. 148-149
- Priestland 2009, p. 389-392
- Vayssière 2001, p. 156-157
- Vayssière 2001, p. 165-169
- Olivier Dabène, L'Amérique latine à l'époque contemporaine, Armand Colin, 2011, page 142
- Vayssière 2001, p. 157-161
- Vayssière 2001, p. 307-312
- Brown 2009, p. 365-366
- Brian Latell, After Fidel, Palgrave MacMillan, 2007, p. 194-200
- Jean-Louis Margolin, Chine : une longue marche dans la nuit, in Le Livre noir du communisme 1997, p. 544-560
- Domenach et Richer 1987, p. 122-134
- Domenach et Richer 1987, p. 139-151
- Domenach et Richer 1987, p. 156-181
- Roland Lew, Le Communisme chinois, in Le Siècle des communismes 2004, p. 369-372
- Jean-Louis Margolin, Chine : une longue marche dans la nuit, in Le Livre noir du communisme 1997, p. 530-541
- Roland Lew, Le Communisme chinois, in Le Siècle des communismes 2004, p. 372-379
- Domenach et Richer 1987, p. 243-253
- Domenach et Richer 1987, p. 263-278
- Service 2007, p. 334
- Domenach et Richer 1987, p. 278-309
- Domenach et Richer 1995, p. 361-390
- Domenach et Richer 1995, p. 390-398
- Domenach et Richer 1995, p. 407-448
- « Constitution de la République populaire de Chine », sur le site de l'Université de Perpignan
- Domenach et Richer 1995, p. 632-644
- Cesari 1995, p. 126-135
- Cesari 1995, p. 136-159
- Jean-Louis Margolin, Indonésie 1965 : un massacre oublié. Revue internationale de politique comparée 1/2001 (vol. 8), p. 59-92.
- Soutou 2010, p. 649-651
- Soulet 1996, p. 228-229
- Depuis les années 1990, les historiens estiment que le nombre de morts se situe entre 500 000 et 1 million, Robert Cribb, "Unresolved Problems in the Indonesian Killings of 1965–1966", Asian Survey, (vol. 42), no 4, juillet-août 2002, p. 550-563.
- Cesari 1995, p. 174
- Priestland 2009, p. 471-472
- Brown 2009, p. 337-350
- Cesari 1995, p. 169-183
- Busky 2002, p. 52, 69, vol 2
- Cesari 1995, p. 187-219
- Jean-Louis Margolin, Cambodge : au pays du crime déconcertant, Le Livre noir du communisme 1997, p. 631-695
- Cesari 1995, p. 221-247
- (en) « Vietnam, post-war Communist regime (1975 et seq.): 365,000 », Secondary Wars and Atrocities of the Twentieth Century, (consulté le ).
- Carine Hahn, Le Laos, Karthala, 1999, p. 36, 126-127
- Brown 2009, p. 342-344
- Soulet 1996, p. 231-233
- Service 2007, p. 402-404
- Cesari 1995, p. 249-274
- Henri Locard, Le « Petit Livre Rouge » de Pol Pot ou les Paroles de l'Angkar entendues dans le Cambodge des Khmers Rouges du 17 avril 1975 au 7 janvier 1979, l'Harmattan, 2000, p. 78
- Frank Chalk, Kurt Jonassohn, The History and Sociology of Genocide: Analyses and Case Studies, Yale University Press, 1990, p. 406
- Cesari 1995, p. 249-283
- Priestland 2009, p. 302-303
- Priestland 2009, p. 410-411
- Droz 1978, p. 135-142
- Jaffrelot 2006, p. 51-52
- Jaffrelot 2006, p. 451
- Jaffrelot 2006, p. 72
- Robert A. Scalapino, The Japanese Communist Movement 1920-1966, University of California Press, 1967, p. 79-122
- Janet D. Hunter (dir), Concise dictionary of modern Japanese history, University of California Press, 1992, page 175
- Bernard Reich et David H. Goldberg, Historical Dictionary of Israel, Scarecrow Press, 2013, page 177
- Federal Research Division, Iran : A Country Study, Kessinger Publishing Co, 2004, p. 242
- Busky 2002, p. 58-59, vol 2
- Soulet 1996, p. 210-213
- Courtois 2007, p. 70-75
- Pierre Hazan, La Guerre des Six jours, Complexe, 2001, pages 49-59
- Robin Leonard Bidwell, Dictionary Of Modern Arab History, Routledge, édition de 2012, page 402
- Itamar Rabinovich et Haim Shaked (dir), Middle East Contemporary Survey, Westview Press, 1988, page 607
- Droz 1978, p. 303-307
- The Iraqi Communists and Baathist Iraq, site de la Bibliothèque du Congrès
- Courtois 2007, p. 568-569
- Édouard Sablier, Le Fil rouge — Histoire secrète du terrorisme international, Plon, 1983, p. 303-333
- Dorronsoro 2000, p. 98-100
- Brown 2009, p. 350-356
- Dorronsoro 2000, p. 103-106
- Aparna Pande, Explaining Pakistan's Foreign Policy: Escaping India, Routledge, 2011, page 73
- Dorronsoro 2000, p. 196-197
- Dorronsoro 2000, p. 193-195
- Werth 2004, p. 565
- Dorronsoro 2000, p. 216-218
- Droz 1978, p. 333-338
- Soulet 1996, p. 220-226
- Priestland 2009, p. 392-398
- Brown 2009, p. 359-363
- Droz 1978, p. 337
- Priestland 2009, p. 480-486
- Soulet 1996, p. 221-226
- Revue Madagascar Océan Indien no 4, l'Harmattan, 1991, p. 117
- Brown 2009, p. 364-369
- Priestland 2009, p. 469-480
- Daniel Jouanneau, Le Mozambique, Karthala, 1995, page 132-146
- Yves Santamaria, Afrocommunismes : Éthiopie, Angola, Mozambique, in Le Livre noir du communisme 1997, p. 747
- Priestland 2009, p. 390-392
- Vayssière 2001, p. 173-188
- Service 2007, p. 406-409
- Vayssière 2001, p. 188-200
- Soulet 1996, p. 219-220
- Priestland 2009, p. 566-567
- Vayssière 2001, p. 239-260
- Service 2007, p. 469
- Vayssière 2001, p. 165-166
- Dreyfus 1991, p. 275-276
- Droz 1978, p. 637-657
- Dreyfus 1991, p. 277
- Courtois 2007, p. 434-441
- Courtois et Lazar 1993, p. 303-342
- L'électorat communiste dans l'élection présidentielle de 1969, Jean Ranger, Revue française de science politique, 1970, volume 20, numéro 2, p. 282-311
- Courtois et Lazar 1993, p. 347-351
- Conord 2012, p. 194
- Courtois 2007, p. 441-447
- Colarizi 2000, p. 367-368
- Unita proletaria per il comunismo, Partito di, Encyclopédie Treccani en ligne
- Colarizi 2000, p. 449-452
- Gotovitch, Delwit et De Waele 1992, p. 265-266
- David Childs (dir.), The Changing Face of Western Communism, Croom Helm Ltd, 1980, p. 172
- Gotovitch, Delwit et De Waele 1992, p. 306-307
- « SAN MARINO in "Enciclopedia Italiana" », sur www.treccani.it
- Busky 2002, p. 48-49, vol 1
- Gotovitch, Delwit et De Waele 1992, p. 251-252
- Santiago Carrillo 1915-2012, Símbolo de las dos Españas, El Mundo, 2012
- Gotovitch, Delwit et De Waele 1992, p. 278-279
- Gotovitch, Delwit et De Waele 1992, p. 304-305
- Priestland 2009, p. 475-476
- Gotovitch, Delwit et De Waele 1992, p. 260, 286, 296
- Pascal Delwit, Giulia Sandri, La gauche de la gauche, Département de science politique de l'Université libre de Bruxelles (ULB)
- Le Communisme en Europe Occidentale: Déclin Ou Mutation, revue Communisme no 11-12, février 1990, page 172
- Gotovitch, Delwit et De Waele 1992, p. 288-289
- Busky 2002, p. 83, vol 1
- Gotovitch, Delwit et De Waele 1992, p. 259-261
- Busky 2002, p. 89, vol 1
- Gotovitch, Delwit et De Waele 1992, p. 286-287
- Service 2007, p. 128
- Brown 2009, p. 358
- Anne-Marie Brady, Making the Foreign Serve China: Managing Foreigners in the People's Republic, Rowman & Littlefield Publishers, 2003, page 124
- Brown 2009, p. 464-468
- Dreyfus 1991, p. 276
- Courtois et Lazar 1993, p. 356
- Pierre Birnbaum, Genèse du populisme : Le peuple et les gros, Paris, Fayard/Pluriel, coll. « Pluriel », , 288 p. (ISBN 978-2-8185-0225-9), p. 157.
- Courtois 2007, p. 230
- Colarizi 2000, p. 474-476
- (it) « Democrazia proletaria in "Dizionario di Storia" », sur treccani.it
- « Élection en Italie d'un gouvernement dirigé par Giovanni Goria - Perspective monde », sur perspective.usherbrooke.ca
- Courtois et Lazar 1993, p. 358-361
- Courtois et Lazar 1993, p. 386-400
- Conord 2012, p. 195-196
- Busky 2002, p. 81, vol 1
- Conord 2012, p. 194-195
- Gotovitch, Delwit et De Waele 1992, p. 302-303
- Raynaud 2010, p. 124-145
- Aron 1970, p. 66-77
- Aron 1970, p. 28-61
- Service 2007, p. 371-375
- Aron 1970, p. 193-220
- Bourseiller 2009, p. 143-144
- Bourseiller 2009, p. 57-61
- Courtois et Lazar 1993, p. 322
- Christine Buci-Glucksmann, in Dictionnaire critique du marxisme, Presses universitaires de France, 1985, pages 509-513
- Guigou J. Wajnsztejn, L'individu et la communauté humaine : Anthologie de textes de Temps critiques, l'Harmattan, 1998, p. 71-72
- Dolores Negrello, Il PCI padovano nell'ultimo '900 — Dissenzi e antagonismi politici, Franco Angeli, 2003, p. 219
- Vladimiro Satta, I nemici della Repubblica, Rizzoli, 2016, pages 27-30
- Bourseiller 2008, p. 108-109
- Bourseiller 2008, p. 210-334
- Conord 2012, p. 180-181
- Uwe Backes, Patrick Moreau, Communist and post-communist parties in Europe, Vandenhoeck & Ruprecht, 2008, p. 28
- Bourseiller 2009, p. 56
- Bourseiller 2008, p. 412-414
- Nick 2002, p. 405-441
- Droz 1978, p. 195
- Raynaud 2010, p. 74-93
- Nick 2002, p. 485-557
- Bensaïd 2002, p. 100-109
- From the archive, 16 July 1991: Labour picks fight with Militant Tendency, The Guardian, 16 juillet 2014
- Service 2007, p. 400
- Benjamin Goldfrank, Deepening Local Democracy in Latin America: Participation, Decentralization, and the Left, Pennsylvania State University Press, 2011, pages 38-39
- Hobsbawm 1999, p. 393-396
- Priestland 2009, p. 464-467
- Raynaud 2010, p. 34-35
- Conord 2012, p. 181-183
- Courtois 2007, p. 566-567
- Colarizi 2000, p. 410-413
- Giorgio Galli, Piombo rosso. La storia completa della lotta armata in Italia dal 1970 a oggi, BCDe, 2007, pages 76-77
- Colarizi 2000, p. 451-453
- Werth 2004, p. 525-528
- Brown 2009, p. 475-478
- Service 2007, p. 419-423
- Werth 2004, p. 493-500
- Ferro 1997, p. 125-128
- Brown 2009, p. 481-486
- Conord 2012, p. 138
- Hobsbawm 1999, p. 612-613
- Hobsbawm 1999, p. 334-335
- Service 2007, p. 388
- Service 2007, p. 417
- Werth 2004, p. 528-534
- Werth 2004, p. 537-546
- Brown 2009, p. 486-502
- Priestland 2009, p. 538
- Upheaval in the East; Gorbachev Hands Over Katyn Papers, The New York Times, 14 avril 1990
- Werth 2004, p. 563-567
- Werth 2004, p. 550-563
- Ferro 1997, p. 131
- Werth 2004, p. 546-550
- Soulet 1996, p. 360-373
- Ducoulombier 2011, p. 125-133
- « Constitution de la Hongrie », sur le site de l'université de Perpignan
- Brown 2009, p. 529-531
- Fejtö et Kulesza-Mietkowski 1992, p. 265-274
- Fejtö et Kulesza-Mietkowski 1992, p. 253-259
- Brown 2009, p. 531-534
- Brown 2009, p. 534-538
- Fejtö et Kulesza-Mietkowski 1992, p. 275-288
- Fejtö et Kulesza-Mietkowski 1992, p. 290-304
- Brown 2009, p. 538-541
- Fejtö et Kulesza-Mietkowski 1992, p. 305-312, 368-370
- Brown 2009, p. 541-542
- Fejtö et Kulesza-Mietkowski 1992, p. 313-327 et Jean-Marie Le Breton, La fin de Ceaușescu, histoire d'une révolution, l'Harmattan 1996, (ISBN 978-2738443946).
- Fejtö et Kulesza-Mietkowski 1992, p. 377-389
- Brown 2009, p. 546-548
- Fejtö et Kulesza-Mietkowski 1992, p. 374-377
- Brown 2009, p. 544-546
- Jacqueline Thévenet, La Mongolie, Karthala, 1999, p. 78-80
- François Ponchaud, Une brève histoire du Cambodge, Siloë, 2007, p. 116-127
- Nabi Misdaq, Afghanistan : Political Frailty And External Interference, Routledge Studies in Middle Eastern History, 2006, p. 167
- Dorronsoro 2000, p. 261-263
- Collectif, Saudi Arabia and Yemen, Rosen Publishing Group, 2011, p. 132
- Europa Publications, Africa South of the Sahara 2003, Routledge, 2002, p. 36
- Philippe Lemarchand, L'Afrique et l'Europe — Atlas du XXe siècle, Complexe, 1999, p. 134
- Philippe David, Le Bénin, Karthala, 1998, p. 69-70
- Omer Massoumou et Ambroise Queffélec, Le français en République du Congo : sous l'ère pluripartiste (1991-2006), éditions Archives contemporaines, 2007, p. 16
- Collectif, Freedom in the World: The Annual Survey of Political Rights and Civil Liberties 1993-1994, Freedom House, 1994, p. 254
- Terrence Lyons, Ahmed I. Samatar, Somalia: State Collapse, Multilateral Intervention, and Strategies for Political Reconstruction, Brookings Institution, 1995, p. 20-22
- Fabienne Le Houerou, Éthiopie-Érythrée frères ennemis de la Corne de l'Afrique, l'Harmattan, 2000, p. 49-50
- Érythrée, université Laval
- La Corée du Nord de l'Afrique, Jeune Afrique, 17 mars 2010
- Jean-Baptiste Jeangène Vilmer et Franck Gouéry, Érythrée, un naufrage totalitaire, Presses universitaires de France, 2015, page 20
- Domenach et Richer 1995, p. 547-572
- Brown 2009, p. 552-553
- Werth 2004, p. 575-576
- Werth 2004, p. 576-577
- Brown 2009, p. 575-573
- Graziosi 2010, p. 365-371
- Brown 2009, p. 606
- Brown 2009, p. 605-606
- "La Chine pratique un capitalisme sauvage", RTBF, 24 mai 2013
- La Chine s'inquiète de sa fracture sociale, Le Figaro, 3 février 2013
- Rapport mondial sur les salaires 2012/13 Chine: Est-ce la fin du modèle de production établi sur les bas salaires?, site de l'organisation internationale du travail, 14 décembre 2012
- La Chine confrontée à un immense défi écologique, Le Figaro, 11 novembre 2011
- « Le rêve chinois du président Xi Jinping ? Prospérité et puissance », L'Express, 3 août 2013.
- « Chine. Mais que veut vraiment le président Xi Jinping ? », Le Nouvel Observateur, 26 mars 2014.
- « En Chine, la consécration de Xi Jinping », Le Monde, 24 octobre 2017.
- Brown 2009, p. 606-607
- Constitution du Viêt Nam, site de l'université de Perpignan
- Yann Bao An, Benoît de Tréglodé, Christophe Feuché, Viêt Nam contemporain, Les Indes savantes, 2005, p. 117-125, 240-245
- La Bourse vietnamienne souffle ses cinq bougies, Vietnamese Law Consultants, 27 juillet 2005
- Les investisseurs étrangers misent sur le potentiel à long-terme du Vietnam, l'Express, 24 avril 2011
- Constitution du Laos, site de l'université de Perpignan
- Le Laos ouvre sa Bourse de Vientiane, Le Figaro, 9 janvier 2011
- Priestland 2009, p. 565
- « La Corée du Nord intronise son nouveau chef devant une foule de militaires », Le Monde, 29 décembre 2011.
- Les étapes de la montée en puissance du programme nucléaire nord-coréen, Le Figaro, 3 septembre 2017
- Crise nord-coréenne: «l'homme-fusée» Kim Jong-un répond à Donald Trump, RFI, 22 septembre 2017
- Vayssière 2001, p. 323-333
- Cinq ans après le printemps noir cubain, Libération, 19 mars 2008
- (es) Raúl Castro compra tiempo, El País, le 25 avril 2011
- (es) Parlamento cubano aprueba plan de reformas económicas para el país, America Economia, le 8 août 2011
- Cuba publie les grandes lignes des réformes économiques, L'Express, 9 mai 2011
- Quel avenir pour Cuba après la mort d'Hugo Chavez ?, Le Monde, 19 mars 2013
- Comment Nicolas Maduro est devenu l’élu de Cuba au Venezuela, et Le rôle de Cuba dans la crise au Venezuela, blog America latina sur Le Monde, 16 avril 2013 et 30 avril 2014
- Cuba fed a president’s fears and took over Venezuela, Financial Times, 15 avril 2014
- «C’est Fidel Castro qui dirige le Venezuela», Libération, 25 mars 2014
- Protesting in Venezuela, With Antipathy Toward Cuba’s Government, The New York Times, 25 mars 2014
- Rapprochement diplomatique historique entre Cuba et les États-Unis, Le Monde, 17 décembre 2014
- États-Unis-Cuba : les secrets du rapprochement, Le Point, 18 décembre 2014
- L'élection présidentielle de 1996 en Russie, Revue française de science politique, Année 1997, Volume 47
- Léger revers pour le parti au pouvoir en Russie, RFI, 5 décembre 2011
- Russie : un score soviétique pour Poutine ?, France Info, 4 mars 2012
- Moldova timeline, BBC, 19 mars 2012
- Moldavie: la contestation 2.0, L'Express, 8 avril 2009
- Moldavie : l'opposition libérale en tête des législatives, Le Parisien, 30 juillet 2009
- « http://au.ibtimes.com/articles/571021/20141028/ukraine-election-communist-party-poroshenko-russia-obama.htm#.VF3FGcnfCuJ Results Of Ukraine’s Election ‘A Death Sentence To The Communist Party’ – Poroshenko »(Archive • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), International Business Times, 28 octobre 2014
- Quand la Stasi rattrape les néocommunistes de Die Linke, Libération, 10 novembre 2009
- Beate Klarsfeld, candidate controversée à la présidence allemande, Libération, 14 mars 2012
- Courtois 2007, p. 361-369
- L'Ostalgie fait son business, L'Expansion, 9 novembre 2009
- Priestland 2009, p. 556-566
- « Nostalgia for communism on rise »(Archive • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), Sydney Morning Herald, 4 novembre 2009.
- Cambodge: "Douch" condamné à la prison à vie, le Nouvel Observateur, 3 février 2012
- Deux ex-dirigeants khmers rouges condamnés pour crimes contre l'humanité, Le Monde, 7 août 2014
- Congo : situation institutionnelle, Sciences Po Bordeaux
- Madagascar : situation institutionnelle, Sciences Po Bordeaux
- Bénin : situation institutionnelle, Sciences Po Bordeaux
- Mathieu Kérékou, l'incontournable, Jeune Afrique, 25 mars 2010
- Gotovitch, Delwit et De Waele 1992, p. 294
- Gotovitch, Delwit et De Waele 1992, p. 297
- Colarizi 2000, p. 498-504, 626-627
- Le primarie spaccano la Fds « Copie archivée » (version du 13 décembre 2013 sur l'Internet Archive), L'Unità, 4 novembre 2012
- Alexis Tsipras, le gri-gri grec, Libération, 9 avril 2014
- "Avec Mélenchon, le PCF fait le choix de la raison", Le Nouvel Observateur, 8 avril 2011
- Front de gauche : derrière la déception, des raisons d'espérer, Le Nouvel Observateur, 23 avril 2012
- L'ascension de Mélenchon, concurrence malvenue pour Hollande, Le Point, 23 mars 2012
- Raynaud 2010, p. 228
- Mélenchon achève le Front de gauche, Le Monde, 5 juillet 2016
- Les communistes ne s’allient pas à La France insoumise à l’Assemblée nationale, Le Monde, 21 juin 2017
- Boris Kagarlitsky, Renfrey Clarke, The Disintegration of the Monolith, Verso Books, 1992, p. 4
- Le communiste Christofias élu président de Chypre, L'Express, 25 février 2008
- Chypre, les banques, priorité no 1 après l‘élection présidentielle, Euronews, 25 février 2013
- Gotovitch, Delwit et De Waele 1992, p. 306-308
- Busky 2002, p. 61, vol 1
- Syriza, coalition de la gauche radicale, devance le Pasok, Le Monde, 7 mai 2012
- The Practical Mr. Mandela, the New York Times, 18 décembre 1994
- Jaffrelot 2006, p. 86-87
- Is communism dead in India? BBC, 14 mai 2011.
- India 2014 Elections: Communists Thriving In One Remote Corner Of Subcontinent As Marxism Wanes Globally, International Business Times, 10 avril 2014
- Brown 2009, p. 603-604
- Election Results in Nepal Signal a Political Right Turn, The New York Times, 25 novembre 2013
- Two deputy PMs for Sushil Koirala, The Hindu Times, 26 février 2014
- Nepal picks Maoist as PM, amid revolving-door politics, Reuteurs, 3 août 2016
- Jorge I. Domínguez et Michael Shifter, Constructing Democratic Governance in Latin America, Johns Hopkins University Press, 2013, pages 323-325
- Tom Lansford (dir), Political Handbook of the World 2014, CQ Press, 2014, page 184
- The Post 2003 Iraqi Electoral Laws: A Comparison and An Assessment, International Journal of Humanities and Social Science , Vol. 1 No. 17, novembre 2011
- Irak: le nationaliste Moqtada Sadr remporte les législatives après recomptage, La Croix, 10 août 2018
- « Syria - CIA World Factbook », sur CIA World Factbook
- Raynaud 2010, p. 63-64
- Raynaud 2010, p. 226-229
- Nouvelle vague de départs du NPA vers le Front de gauche, Le Monde, 29 juin 2012
- Le NPA se ligue contre son déclin, Libération, 31 janvier 2013
- Vayssière 2001, p. 193-194, 333-352
- En Belgique, la percée des anciens maoïstes du Parti du travail, Le Monde, 17 mai 2014
- Bourseiller 2009, p. 87-92
- Courtois 2007, p. 406-408
- Raynaud 2010, p. 27-28
- Vayssière 2001, p. 356-364
- Service 2007, p. 481-482
Annexes
Articles connexes

A
- Communisme libertaire
- Anticommunisme
- Architecture stalinienne
- Association internationale des travailleurs
B
C
- Campagne des Cent fleurs
- Capitalisme d'État
- Capitalisme monopoliste d'État
- Castrisme
- Centralisme démocratique
- Chronologie du mouvement communiste au Québec
- Chute des régimes communistes en Europe
- Classe sociale
- Coexistence pacifique
- Collectivisation
- Collectivisation en Union soviétique
- Collectivisme
- Collectivisme économique
- Collectivisme politique
- Commissaire politique
- Communisme
- Communisme chrétien
- Communisme de conseils
- Communisme primitif
- Comparaison entre le nazisme et le communisme
- Conférences mondiales des Partis communistes
- Conseil ouvrier, soviet
- Coup de Prague
- Crimes du régime khmer rouge
- Crise des euromissiles
- Crise des missiles de Cuba
- Critique du capitalisme
- Critiques du communisme
D
- Débarquement de la baie des Cochons
- De chacun selon ses facultés, à chacun selon ses besoins
- Décosaquisation
- Dékoulakisation
- Démocratie populaire
- Déstalinisation
- Détente (guerre froide)
- Dictature du prolétariat
- Dirigisme
- Déstalinisation
- Doctrine Brejnev
- Doctrine Jdanov
- Drapeau rouge
E
- Économie de l'URSS
- Économie de la république populaire de Chine
- Économie marxiste
- Économie planifiée
- Épuration (politique)
- État communiste
- Étatisme
- Eurocommunisme
- Extrême gauche
F
- Famines soviétiques de 1931-1933
- Faucille et marteau
- Forces productives
- Front de l'Est (Seconde Guerre mondiale)
G
- Gauche
- Gauche communiste
- Gauchisme
- Glasnost
- Goulag
- Grand Bond en avant
- Grande famine en Chine
- Grandes Purges
- Guerre civile chinoise
- Guerre civile russe
- Guerre du Viêt Nam
- Guerre fraîche
- Guerre froide
H
I
- Infrastructure et superstructure
- Insurrection de Budapest
- Insurrection de juin 1953 en Allemagne de l'Est
- L'Internationale
- Internationale communiste
- Internationale communiste ouvrière
J
K
L
- Laogai
- Léninisme
- Ligue des communistes
- Livre noir du communisme (Le)
- Longue Marche
- Lustration (politique)
- Lutte des classes
- Luxemburgisme
- Lyssenkisme
M
- Maoïsme
- Mao-spontex
- Marxisme
- Marxisme-léninisme
- Matérialisme historique
- Matérialisme dialectique
- Mouvement autonome
- Mouvement communiste international
- Mouvement ouvrier
- Moyens de production
- Mur de Berlin
N
O
P
- Pacte de Varsovie
- Pacte germano-soviétique
- Partis communistes dans le monde
- Perestroïka
- Phase supérieure de la société communiste
- Post-communisme
- Printemps de Prague
- Procès de Moscou
- Procès de Prague
- Procès des seize
Q
R
- Réalisme socialiste soviétique
- Révolte de Kronstadt
- Révolte de Tambov
- Révolution
- Révolution communiste
- Révolution cubaine
- Révolution culturelle
- Révolution de velours
- Révolution d'Octobre
- Révolution mondiale
- Révolution roumaine de 1989
- Révolution russe
- Rupture Tito-Staline
S
- Siècle des communismes (Le)
- Social-démocratie
- Socialisation des biens
- Socialisme
- Socialisme à visage humain
- Socialisme d'État
- Socialisme scientifique
- Société sans classes
- Soulèvement de Poznań en 1956
- Soviet
- Stalinisme
- Syndicalisme
T
- Terreur rouge (Espagne)
- Terreur rouge (Russie)
- Théoriciens du communisme
- Titisme
- Totalitarisme
- Troisième camp
- Trotskisme
U
Bibliographie



![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.
: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.
Ouvrages généraux
- (en) Archie Brown, The Rise and fall of communism, éditions Vintage Books, , 720 p. (ISBN 978-1-84595-067-5).

- (en) Robert Service, Comrades! A History of World Communism, Pan Books, , 571 p. (ISBN 978-0-330-43968-8).

- (en) David Priestland, The Red Flag : Communism and the making of the modern world, New York, Allen Lane / Penguin Books, , 675 p. (ISBN 978-0-8021-4512-3).

- François Furet, Le Passé d'une illusion : Essai sur l'idée du communisme au XXe siècle, Robert Laffont, (ISBN 978-2-221-07136-6).

- Le Livre noir du communisme (ouvrage collectif), Paris, Robert Laffont, , 1104 p. (ISBN 978-2-266-19187-6).

- Stéphane Courtois (directeur), Du passé faisons table rase ! — Histoire et mémoire du communisme en Europe, Paris, Robert Laffont, , 1019 p. (ISBN 978-2-266-13599-3).

- Le Siècle des communismes (ouvrage collectif), Paris, Éditions ouvrières / Éditions de l'Atelier, (ISBN 978-2-7578-1106-1).

- Stéphane Courtois, Communisme et totalitarisme, Perrin, (ISBN 978-2-221-09500-3)
- Stéphane Courtois (directeur), Dictionnaire du communisme, Paris, Larousse, , 639 p. (ISBN 978-2-03-583782-0).

- (en) Orlando Figes, A People's tragedy : the Russian revolution 1891-1924, Penguin Books, , 923 p. (ISBN 978-0-7126-7327-3).

- Alexandre Adler, Le Communisme, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Que sais-je ? », , 127 p. (ISBN 978-2-13-051451-0)
- Romain Ducoulombier, De Lénine à Castro : Idées reçues sur un siècle de communisme, Paris, Le Cavalier bleu, , 168 p. (ISBN 978-2-84670-380-2).

- Romain Ducoulombier, Histoire du communisme, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Que sais-je ? », , 127 p. (ISBN 978-2-13-062612-1, présentation en ligne)
- Jacques Droz (dir.), Histoire générale du socialisme, tome 1 : des origines à 1875, Presses universitaires de France, , 658 p. (ISBN 978-2-13-036150-3).

- Jacques Droz (dir.), Histoire générale du socialisme, tome 2 : de 1875 à 1918, Presses universitaires de France, (ISBN 978-2-13-036369-9).

- Jacques Droz (directeur), Histoire générale du socialisme, tome 3 : de 1918 à 1945, Presses universitaires de France, (ISBN 978-2-13-034875-7).

- Jacques Droz (directeur), Histoire générale du socialisme, tome 4 : de 1945 à nos jours, Presses universitaires de France, , 705 p. (ISBN 978-2-13-035368-3).

- Jean-François Soulet, Histoire comparée des États communistes de 1945 à nos jours, Armand Colin, (ISBN 978-2-200-01465-0).

- José Gotovitch, Pascal Delwit et Jean-Michel De Waele, L'Europe des communistes, Complexe, , 352 p. (ISBN 978-2-87027-467-5, lire en ligne).

- Ernst Nolte (trad. de l'allemand), La Guerre civile européenne : National-socialisme et bolchevisme 1917-1945, Paris, Perrin, , 937 p. (ISBN 978-2-262-03458-0)

- Eric Hobsbawm, L'Âge des extrêmes : Histoire du court XXe siècle, Complexe, (ISBN 978-2-87027-745-4)

- Karel Bartošek, Les Aveux des archives — Prague-Paris-Prague, 1948-1968, Fayard, coll. « Archives du communisme », , 458 p. (ISBN 978-2-02-025385-7)
- (en) Tim Rees et Andrew Thorpe, International Communism and the Communist International 1919-43, Manchester University Press, .

- Georges Vidal, Histoire des communismes, Ellipses, 2013.
- Thierry Wolton, Histoire mondiale du communisme, tome 1 : Les bourreaux, Paris, Grasset, , 1128 p. (ISBN 978-2-246-73221-1)
- Thierry Wolton, Histoire mondiale du communisme, tome 2 : Les victimes, Paris, Grasset, , 1132 p. (ISBN 978-2-246-80424-6)
- Thierry Wolton, Histoire mondiale du communisme, tome 3 : Les complices, Paris, Grasset, , 1171 p. (ISBN 978-2-246-81149-7)
Histoires nationales
- Nicolas Werth, Histoire de l'Union soviétique, Presses universitaires de France, , 588 p. (ISBN 978-2-13-056120-0).

- François Fejtö, Histoire des démocraties populaires, tome 1 : l'ère de Staline, Seuil, , 380 p. (ISBN 978-2-02-014443-8).

- François Fejtö, Histoire des démocraties populaires, tome 2 : après Staline, Seuil, , 378 p. (ISBN 978-2-02-014444-5).

- François Fejtö et Ewa Kulesza-Mietkowski, La fin des démocraties populaires, Seuil, (ISBN 978-2-02-031185-4).

- Andrea Graziosi (trad. de l'italien), Histoire de l'URSS, Paris, Presses universitaires de France, , 559 p. (ISBN 978-2-13-051813-6).

- Stéphane Courtois et Marc Lazar, Histoire du Parti communiste français, Presses universitaires de France, , 480 p. (ISBN 978-2-13-051063-5).

- Jean-Luc Domenach et Philippe Richer, La Chine, t. 1 : 1949-1971, Seuil, coll. « Points Histoire », (ISBN 978-2-02-019895-0).

- Jean-Luc Domenach et Philippe Richer, La Chine, t. 2 : de 1971 à nos jours, Seuil, coll. « Points Histoire », (ISBN 978-2-02-021826-9).

- Guy Hermet, La Guerre d'Espagne, Seuil, , 339 p. (ISBN 978-2-02-010646-7).

- Antony Beevor (trad. de l'anglais), La Guerre d'Espagne, Paris, Calmann-Lévy, , 893 p. (ISBN 978-2-253-12092-6).

- John King Fairbank, La Grande révolution chinoise 1800-1989, Flammarion, , 548 p. (ISBN 978-2-08-124550-1).

- Heinrich August Winkler, Histoire de l'Allemagne XIXe-XXe siècle : Le long chemin vers l'Occident, Fayard, .

- Jacques Dalloz, La Guerre d'Indochine 1945-1954, Seuil, (ISBN 978-2-02-009483-2).

- Pierre Vayssière, Les révolutions d'Amérique latine, Seuil, (ISBN 978-2-02-052886-3).

- (it) Simona Colarizi, Storia del Novecento italiano : Cent'anni di entusiasmo, di paure, di speranze, BUR Rizzoli, , 680 p. (ISBN 978-88-17-11876-7).

- (en) Hugh Thomas, Cuba : a History, Penguin Books, , 1151 p. (ISBN 978-0-14-103450-8).

- Laurent Cesari, L'Indochine en guerres, 1945-1993, Belin, , 315 p. (ISBN 978-2-7011-1405-7).

- Georges-Henri Soutou, La Guerre froide : 1943-1990, Paris, Librairie Arthème Fayard / Pluriel, , 1103 p. (ISBN 978-2-8185-0127-6).

- Donald F. Busky, Communism in History and Theory, Greenwood Publishing Group, (ISBN 978-0-275-97954-6).
 (volume 1, The European experience ; volume 2, Asia, Africa, and the Americas)
(volume 1, The European experience ; volume 2, Asia, Africa, and the Americas) - Seppo Hentilä, Osmo Jussila et Jukka Nevakivi, Histoire politique de la Finlande — XIXe-XXe siècle, Fayard, (ISBN 978-2-213-60486-2).

- Christophe Jaffrelot (directeur), L'inde contemporaine, de 1950 à nos jours, Paris, Fayard-Ceri, , 329 p. (ISBN 978-2-8185-0346-1).

- Martin Malia, La Tragédie soviétique. Histoire du socialisme en Russie, 1917-1991, Seuil, , 633 p. (ISBN 978-2-02-036283-2)
- Moshe Lewin, Le Siècle Soviétique, Fayard, (ISBN 978-2-213-61107-5)
- Marc Ferro, Naissance et effondrement du régime communiste en Russie, Librairie générale française, , 152 p. (ISBN 978-2-253-90538-7).

- Gilles Dorronsoro, La Révolution afghane : des communistes aux tâlebân, Karthala, , 350 p. (ISBN 978-2-84586-043-8, lire en ligne).

Biographies
- Hélène Carrère d'Encausse, Lénine, Fayard, (ISBN 978-2-213-60162-5).

- Boris Souvarine, Staline : Aperçu historique du bolchévisme, Gérard Lebovici, (ISBN 978-2-85184-076-9).

- (en) Robert Service, Lenin : a biography, Pan Books, , 561 p. (ISBN 978-0-330-51838-3).

- (en) Robert Service, Stalin : a biography, Pan Books, , 715 p. (ISBN 978-0-330-51837-6).

- (en) Robert Service, Trotsky : a biography, Pan Books, , 600 p. (ISBN 978-0-330-43969-5).

Familles idéologiques

- Michel Winock, Le Socialisme en France et en Europe : XIXe-XXe siècle, Seuil, , 426 p. (ISBN 978-2-02-014658-6).

- Dominique Colas, Lénine et le léninisme, Presses universitaires de France, (ISBN 978-2-13-041446-9).

- Alois Schumacher, La social-démocratie allemande et la IIIe République : Le regard de la revue Die Neue Zeit — 1883-1914, Paris, CNRS Éditions, (ISBN 978-2-271-05624-5).

- [Berg 2003] (en) Axel van den Berg, The Immanent Utopia : From Marxism on the State to the State of Marxism, New Brunswick, Transaction Publishers, , 580 p. (ISBN 978-0-7658-0517-1).

- Christophe Nick, Les Trotskistes, Fayard, , 614 p. (ISBN 978-2-213-61155-6).

- Christophe Bourseiller, Les Maoïstes : La folle histoire des gardes rouges français, Paris, Plon, , 505 p. (ISBN 978-2-7578-0507-7).

- Philippe Raynaud, L'Extrême gauche plurielle : Entre démocratie radicale et révolution, Paris, Perrin, , 272 p. (ISBN 978-2-262-02932-6).

- Daniel Bensaïd, Les Trotskysmes, Presses universitaires de France, coll. « Que sais-je ? », , 127 p. (ISBN 978-2-13-052544-8).

- Raymond Aron, Marxismes imaginaires : d'une sainte famille à l'autre, Paris, Gallimard, , 345 p. (ISBN 978-2-07-040491-9).

- Christophe Bourseiller, À gauche, toute ! : Trotskistes, néo-staliniens, libertaires, « ultra-gauche », situationnistes, altermondialistes…, CNRS éditions, , p. 978-2271068477.

- Fabien Conord, Les Gauches européennes au XXe siècle, Paris, Armand Colin, , 272 p. (ISBN 978-2-200-27275-3).

- Michel Dreyfus, L'Europe des socialistes, Complexe, , 349 p. (ISBN 978-2-87027-405-7, lire en ligne).

- Pierre Broué, Communistes contre Staline : massacre d'une génération, Paris, Fayard, , 439 p. (ISBN 978-2-213-61544-8)
Articles
- Jacques Grandjonc, « Quelques dates à propos des termes communiste et communisme », Mots, no 7, , p. 143-148 (lire en ligne).

- [D'Hondt 1989] Jacques d'Hondt, « Le meurtre de l'histoire », dans Jean-François Courtine (dir.), Hölderlin, Paris, L'Herne, , 219-238 p.

- Erich Mathias, « Idéologie et pratique : le faux débat Bernstein-Kautsky », Annales — Économie, Société, Civilisations, no 1, , p. 19-30 (lire en ligne).

Liens externes
- Communisme sur l'encyclopédie en ligne Larousse
- Portail du communisme
- Portail de l’histoire
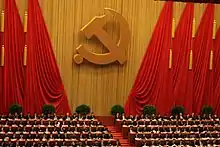








.jpg.webp)





.jpg.webp)



