Progrès
Bien que n'ayant été propagée qu'au XIXe siècle, l'idée de progrès s'appuie sur l'idée que l'histoire a un sens. Cette conception remonte jusqu'à l'Antiquité et a considérablement évolué à travers le temps.
- Durant l'Antiquité, notamment en Mésopotamie, en Égypte et jusqu'en Grèce, chez les philosophes stoïciens, prédomine l'idée que le sens de l'histoire est circulaire : c'est le mythe de l'Éternel retour, étudié notamment par Mircea Eliade[1].
- Le judaïsme puis le christianisme cultivent au contraire une conception linéaire mais de nature eschatologique : le monde « ici-bas », création divine, fait partie de la révélation divine qui mènera, selon leur rapport à Dieu, au salut de leur âme dans l'au-delà.
- À partir de la Renaissance, très lentement, la société se sécularise : à travers les textes de Machiavel et l'émergence de la philosophie politique, se manifeste l'idée que les hommes forgent eux-mêmes leur histoire : celle-ci ne tend plus vers l'au-delà (transcendance) mais est circonscrite à « l'ici-bas » (immanence).
- Au début du XVIIe siècle, l'Anglais Bacon (Novum organum, 1620 ; La Nouvelle Atlantide, 1627) puis le Français Descartes (Discours de la méthode, 1637) sont les premiers à formaliser l'idée de progrès : ils l'assimilent à la capacité des hommes de connaître la nature (science), la façonner, puis finalement, s'en rendre "comme maîtres et possesseurs". « Le progrès » tend ainsi à se substituer à « la providence ».
- Au début du XIXe siècle, l'Allemand Hegel considère que l'État constitue le degré suprême du progrès car il concrétise plus que tout la capacité de l'homme à écrire sa propre histoire au moyen de sa raison[2]. Et en formulant le concept de philosophie de l'histoire, il confère au terme « progrès » un sens dogmatique : « l'histoire universelle est le progrès dans la conscience de la liberté » proclame t-il[3]. Dès lors, cinq grands concepts au moins sont liés à l'idée de progrès : l'humanisme, la sécularisation, la laïcisation, la modernité et l'occidentalisation[4].
- Au début du XXe siècle, les idéaux progressistes gagnent la Chine. Ainsi, lors du grand mouvement nationaliste de 1919, et guidés par de jeunes intellectuels, les étudiants dénoncent le poids des traditions et se déclarent favorables à la modernité et à la science (cet événement est toujours célébré aujourd'hui[5]). En revanche, après les carnages de la Première Guerre mondiale, ces idéaux commencent à être critiqués en Europe. En 1922, toutefois, Carl Schmitt se félicite du fait que l'État est la déclinaison « moderne » de l'Église et estime qu'il revient à la politique de remplir une mission qui était autrefois celle de la religion[6].
- Après la Seconde Guerre, un autre Allemand, Karl Löwith, avance que la philosophie de l’histoire est l'avatar de l’eschatologie du salut, raison pour laquelle l'idée de progrès peut être assimilée à une simple croyance.
Pour les articles homonymes, voir Progrès (homonymie).
_04.jpg.webp)




Illustration : prototype de l'équipement en IA Watson, d'IBM, 2011
L’idée de progrès présente quatre caractéristiques, les trois dernières lui étant propres :
- la conviction que « l'histoire » ne résulte pas du hasard mais qu'elle a un sens (philosophie de l'histoire, déjà présente dans le christianisme) ;
- la conviction que ce sens est assigné par l'ensemble des hommes, désireux d'atteindre ensemble un même objectif : le bonheur ;
- la conviction que la science permet de toujours mieux connaître l'univers dans toute son étendue et au fil de son évolution ;
- la conviction que l'économie, l'État et la technique peuvent et doivent permettre d'appliquer les avancées de la science.
L’appréhension de la notion du « progrès » traverse un conglomérat d'idéologies : philosophie de l'histoire, eudémonisme, « progrès scientifique », « progrès technique », « progrès social », étatisme et croissance économique.
La question est régulièrement soulevée quant à savoir si l'articulation de ces différentes composantes est réaliste ou si elle ne relève pas plutôt d'une utopie[Sp 1], un processus sans finalité clairement assignée et qui s'avèrerait ensuite incontrôlable. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, se plaçant dans une perspective morale, certains intellectuels assimilent « le progrès » à une fatalité[Sp 2]. Et d'autres, à la fin du XXe siècle, quand émerge la crise écologique, à une catastrophe. En parallèle, en dehors de toute approche axiologique et ne considérant que le seul « progrès technique », d'autres penseurs estiment que celui-ci se poursuit à un rythme toujours plus rapide et développent le concept de « progrès accéléré ».
Au XXIe siècle, dans un contexte général ouvertement technophile mais axé sur la gestion des risques, le terme « progrès » est devenu un mot fourre-tout et tend à laisser la place à de nouvelles expressions tout autant apologétiques telles que « développement économique et social », « développement durable », « recherche et développement », « innovation »[n 1]... (selon les contextes). Une autre raison explique que le mot « progrès » tombe en désuétude : alors que, pendant des siècles — avant même que ce mot n'entre dans le langage commun — la notion de progrès a été associée à la conquête et à la domination de la nature par l'homme, le développement exponentiel de l'intelligence artificielle vient brouiller la réflexion : doit-on craindre que celle-ci ne dépasse un jour en capacité les compétences « naturelles » de l'homme ou faut-il l'espérer ?
Origine, histoire et ambiguïté du mot
Origine
Le mot est issu du latin progressus, qui désigne la marche en avant (donc la progression) d'une troupe ou d'une armée (pro : en avant ; gradi : marcher).
Histoire
- Le terme « progrès », comme beaucoup d'autres, date du XVIe siècle, quand la langue française se structure. Il est lié à la montée en puissance de l'idéologie humaniste : Rabelais l'utilise en 1532[7] puis en 1546, dans Le Tiers Livre pour qualifier l'idée d'avancement ou de développement d'une action[Sp 3]. Et en 1588, Montaigne lui confère le sens d'une « transformation graduelle vers le mieux »[Sp 4].
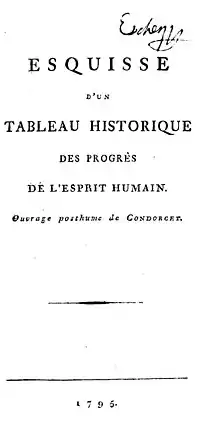
- Au début du XVIIe siècle en Angleterre, le mot prend le sens qu'on lui prête communément aujourd'hui : « En forgeant le concept d'advancement, dont le mot "progrès" constitue une traduction approximative, Francis Bacon est responsable du nouveau sens temporel accordé au terme progression/progrès, lequel, désignant une avancée, une simple marche en avant, n'était doté jusque là que d'un sens spatial. Par cette innovation conceptuelle, qui permet de concevoir le processus d'amélioration du savoir (progressus scientiarum) comme continu, cumulatif et sans fin, il a ouvert la voie à la conception moderne du progrès »[Ta 1].
- Durant la seconde moitié du XVIIIe siècle, le mot « progrès » prend un sens philosophique à part entière mais on parle encore des progrès et non du progrès. En 1750, Turgot rédige son Tableau philosophique des progrès successifs de l’esprit humain. Et quatre ans plus tard, dans son Traité sur la population, Mirabeau définit le terme comme le « mouvement en avant de la civilisation vers un état de plus en plus florissant ». Et au lendemain de la Révolution française, en 1795, l'Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain de Condorcet confère au mot un sens politique et une dimension idéologique : « progrès » et « civilisation » sont considérés comme deux processus indissociables[8].
- Dans la seconde moitié du XIXe siècle, le mot est de plus en plus utilisé au singulier et prend alors une connotation morale et édifiante : « le Progrès est le développement de l’Ordre » proclame notamment le philosophe Auguste Comte dans les années 1850[9]. Et à la fin du siècle, cette dimension apologétique est officialisée dans le dictionnaire de Pierre Larousse : « Ce mot, qui signifie "marche en avant", désigne de façon toute spéciale, dans le langage philosophique, la marche du genre humain vers la perfection, vers son bonheur. (...) L'humanité est perfectible et elle va incessamment du moins bien au mieux, de l'ignorance à la science, de la barbarie à la civilisation. »[10],[Ta 2]
- Au début du XXe siècle, les critiques l'emportent sur l'apologie : en 1908, Georges Sorel analyse ce qu'il appelle « les illusions du progrès »[11] et en 1936, Bernard Charbonneau utilise pour la première fois l'expression « idéologie du progrès »[12]. Durant la deuxième moitié du siècle, les critiques se poursuivent mais les prises de position, moins militantes et plus distanciées, visent essentiellement à déconstruire le terme « progrès »[13]celui-ci tend alors à n'être plus utilisé que sous l'angle économique et social[14].
- Au début du XXIe siècle, marqué notamment par l'expansion d'internet dans les divers domaines de la vie courante, l'idée que recouvre le terme n'est plus contestée que de façon marginale. Toutefois, dans un contexte marqué par la crise environnementale, les catastrophes nucléaires et les difficultés des États militarisés à combattre le terrorisme, ce terme — comme l'adjectif « progressiste » — est dévalué et n'est plus usité que par quelques personnalités politiques. Il est alors de plus en plus remplacé par le mot « innovation », dans une visée aussi laudatrice que celle dont bénéficiait le terme « progrès » au XIXe siècle, mais moins triomphaliste, sauf dans les milieux technophiles, dont celui du transhumanisme[15](lire infra).
Ambiguïté
Selon le Dictionnaire d'économie et de Sciences sociales (1993), le terme est à la source d'ambiguïté voire de confusions[16] :
- « Concept central de la pensée des Lumières et des courants évolutionnistes, le progrès incarne la croyance dans le perfectionnement global et linéaire de l'humanité; la société, tout en se développant, évolue vers le "mieux" : augmentation des richesses, progrès scientifique et technique... mais aussi amélioration des mœurs et des institutions, voire progrès de l'esprit humain. (...) En réalité, rien n'assure que le progrès économique entraîne mécaniquement le mieux-être ».
De fait, depuis son émergence au XVIIIe siècle, le terme a été très diversement interprété, évoluant de l'éloge à la critique acerbe.
- Au XIXe siècle, période marquée par les changements sociétaux résultant du processus d'industrialisation, il est fréquemment repris par des mouvements idéologiques en vantant les mérites (saint-simonisme, scientisme...). Il associe alors quatre registres : la science, la technique, les structures sociales et l'économie (elle-même découlant de l'évolution des modes de production) et deux approches : l'une quantitative (exprimée notamment par le concept de croissance économique), l'autre qualitative (s'exprimant par la recherche de bien-être).
.jpg.webp)
- Tout au long du XXe siècle, certains auteurs (citons Sorel, 1908[Sp 5] et Aron, 1969[17]) affirment que la cohésion des différents aspects du concept de progrès (notamment le « progrès technique » et le « progrès social ») est utopique et qu'en conséquence, le concept de progrès n'est rien d'autre qu'une idéologie. Le terme est alors de moins en moins utilisé dans un sens triomphaliste et les conséquences du « progrès technique » sont de plus en plus posées, notamment l'impact dans le monde du travail[18] de même que les risques environnementaux — le mouvement écologique éclot dans les années 1970, quand se développent les premières centrales nucléaires. Le progrès commence alors à être perçu comme une fatalité, comme en témoigne l’économiste et sociologue Alfred Sauvy : « le progrès technique ne souffre pas d’arrêt. Tout ralentissement équivaut à un recul. L’humanité est condamnée à un progrès à perpétuité[19]. »
L'idéal portant sur l'articulation croissance économique / bonheur perdure toutefois à travers de nouveaux concepts, notamment la notion de développement économique et social. En définitive, le terme est surtout employé par les politiciens dans l'idée de faire valoir le caractère dynamique de leurs partis et attester qu'ils sont en phase avec l'évolution technoscientifique et les changements sociaux que celle-ci provoque.
A la fin du siècle, le sociologue allemand Norbert Elias estime que l'idée de progrès est entièrement construite sur une approche émotionnelle (et aucunement rationnelle) du temps. Selon lui, depuis que les humains ont inventé et perfectionné des instruments destinés à mesurer le temps, ils ont pris l'habitude d'objectiver, réifier, essentialiser celui-ci : « C'est finalement à Einstein que revient d'avoir mis en évidence que le temps est une forme de relation et non, comme le croyait Newton, un flux objectif, élément de la création au même titre que les fleuves et les montagnes[20] ». Toutefois, « pour intégrer cette réflexion, précise la sociologue Nathalie Heinich, il faut accepter l'hypothèse d'une évolution, comme le firent les théories évolutionnistes du XXe siècle, mais en les débarrassant de leurs présupposés historicistes et normatifs (...) : tout d'abord cesser de confondre évolution et linéarité (...) ; ensuite, se débarrasser de la téléologie spontanée, ancrée dans les traditions religieuses, qui confond évolution et but assigné (...). Cette double limite des théories évolutionnistes — téléologie et normativité, résumées dans la notion de "progrès" — est caractéristique de l'historicisme, qui conçoit l'histoire comme déterminée par une orientation préétablie et tendant vers un but positif[21].»
- Au XXIe siècle, le terme « progrès » est de plus en plus controversé. La plupart des analyses s'accordent en effet sur le fait que la rationalisation de la production introduite par le taylorisme et le fordisme a certes permis une évolution en termes quantitatifs (une baisse des coûts, donc une augmentation du pouvoir d'achat et une élévation du niveau de vie dans les pays industrialisés), mais non en termes qualitatifs puisqu'elle se paie au prix d'un durcissement des conditions de travail, de la montée du chômage, de la précarité, du stress et d'autres risques psychosociaux ainsi que des désordres sociaux et écologiques liés aux écarts de richesses dans le monde et au réchauffement climatique. Il ressort alors nettement que le « progrès social » s'inscrit en net décalage par rapport aux évolutions scientifique, technique et économique.
À la différence par exemple du « progrès technique », qui peut s'évaluer en termes de performances (par exemple l'évolution de l'aviation entre le premier vol des frères Wright, en 1904, et le premier vol supersonique, en 1947), la notion de « progrès » est floue car elle fait appel à l'histoire des idées et des croyances ainsi qu'à des considérations d'ordre éthique.
Précision
Quand il est utilisé dans un sens dénotatif, le mot « progrès » est souvent remplacé par le mot « progression ». À l'inverse, « regrès », son antonyme, dont l'origine remonte également au XVIe siècle, ne sera guère utilisé ensuite, remplacé par « régression ». Y recourent volontiers, en revanche, les adversaires les plus radicaux de la notion de progrès[22].
Histoire de la notion
La notion de progrès a été diversement interprétée selon les époques mais peut globalement se comprendre comme une combinaison de « progrès moral », « progrès social », « progrès scientifique », « progrès technique », « progrès spirituel » et - à partir du XVIIIe siècle - de « progrès économique » (on parle alors plutôt de « croissance économique »).
Toutefois, elle ne naît pas ex nihilo mais a partie liée avec celle d'évolution. Pour en saisir les multiples nuances, il faut réfléchir au concept d'évolution et donc remonter non seulement aux origines mêmes de l'histoire de l'humanité mais aussi à ce qui précède celle-ci[Sp 6].
Avant l'humanité

Les réflexions sur « le progrès » se fondent sur une série de vastes interrogations : par quelle suite de processus l'homme évolue t-il ? Ces processus sont-ils naturels, innés, simplement relatifs aux efforts instinctifs d'adaptation de tout animal à son milieu ambiant ? Dans quelle mesure sont-ils au contraire culturels, acquis au prix d'une volonté réfléchie de dépasser sa condition ? Où se situe la distinction entre évolution et progrès ?
La notion de progrès n'a vraiment été débattue qu'à partir du XIXe siècle, notamment après 1859, quand le paléontologue Charles Darwin a fait connaître ses théories sur la sélection naturelle et l'évolution des espèces et que le questionnement sur les origines de l'humanité est devenu de plus en plus collectif : la fameuse phrase « l'homme descend du singe » (qui caricature la pensée de Darwin mais qui n'est pas de lui) a choqué un moment bon nombre d'âmes puritaines et, encore aujourd'hui, au-delà des milieux créationnistes, elle fait toujours couler beaucoup d'encre. Afin d'évaluer la différence d'échelle entre « évolution » (biologique) et « progrès » (culturel), « pour comprendre notre nature, notre histoire et notre psychologie, il nous faut entrer dans la mentalité de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs »[23] et même rappeler brièvement quelques données relatives à la vie sur Terre avant l'apparition de l'homme[24].
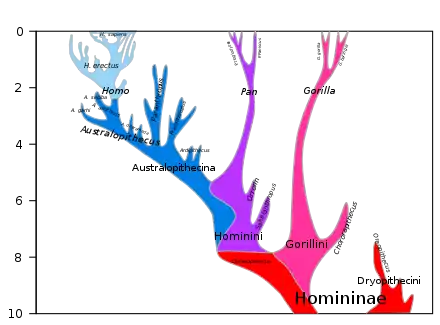
La Terre naît il y a 4,5 milliards d'années; la vie y apparaît il y 4 milliards d'années, sous la forme de bactéries. Il y a 2,5 milliards d'années, l'atmosphère terrestre est plus oxygénée, donc plus ressemblante à celle que l'on respire aujourd'hui, ce qui permet l'apparition de créatures au métabolisme toujours plus complexe ; il y a 500 millions d'années les poissons sont les premiers animaux ; les grands reptiles, tels que les dinosaures, ainsi que les mammifères surgissent il y a 250 millions d'années ; pour une raison inexpliquée, les grands reptiles disparaissent il y a 66 millions d'années, au profit des mammifères, qui, eux, se diversifient.

Parmi ceux-ci figurent les premiers grands singes, ou « hominoïdes », dépourvus de queues, qui apparaissent il y a 45 millions d'années; ils se développent il y a 20 millions d'années sur l'actuel continent africain ; l'évolution se poursuit avec les hominidés, de grande taille, puis les homininés, au même titre que les gorilles.
Il y a 5 à 7 millions d'années, la lignée humaine (en couleur bleu foncé sur le diagramme à gauche) se différencie de celle du chimpanzé (en violet). Le processus d'hominisation (transformation progressive des primates en humains) s'amorce alors. L'australopithèque, apparu il y a 4,2 millions d'années et dont la locomotion est généralement mixte, associant une forme de bipédie à une capacité à grimper encore marquée, est notre plus lointain ancêtre direct[Sp 7]. S'il utilise des pierres pour casser des noix, il n'est pas capable de les tailler intentionnellement en vue de tel ou tel usage, comme l'homme le fera plus tard.
Préhistoire
La préhistoire est définie comme la période comprise entre l'apparition de l'humanité, il y a près de 3 millions d'années, et l'apparition des premiers documents écrits, environ 4 500 av. J.-C. Elle se divise en deux parties, le paléolithique (l'âge de la pierre taillée) - qui est de loin la plus longue - et le néolithique (l'âge de la pierre polie). Entre ces deux parties, les paléontologues conçoivent une période intermédiaire : le mésolithique.
Au fil de tous ces millénaires, très « progressivement », et bien que sa morphologie physique ne l'y prédispose pas, l'homme affirme sa domination sur les autres espèces animales et il va en retirer un sentiment de supériorité qui débouchera ultérieurement sur l'idée de progrès.
Paléolithique

On appelle « paléolithique » la toute première période de l'humanité. Les premiers représentants du genre Homo surviennent il y a 2,8 à 2,5 millions d'années (couleur bleu clair sur le diagramme ci-dessus), avec homo habilis, non seulement capable - comme les grands singes - de préhension mais aussi le premier être au monde pouvant fabriquer des artefacts, en l'occurrence des outils et des armes, en taillant la pierre.
Viennent ensuite d'autres espèces (aujourd'hui toutes disparues) qui ressemblent davantage à l'homme actuel, ne serait-ce que parce qu'elles ne grimpent plus autant aux arbres mais se déplacent exclusivement au sol. En premier lieu homo ergaster, il y a 1,9 million d'années, qui est de plus grande taille que ses prédécesseurs. Selon le paléoanthropologue Pascal Picq, « il fait mieux qu'utiliser son environnement comme le ferait un chimpanzé, il le transforme »[25]. Le premier être équipé de toute une panoplie d'armes de chasse, il se présente comme un chasseur accompli. Et du fait que son régime alimentaire s'enrichit en protéines, son espérance de vie s'allonge. Qui plus est excellent marcheur, il est également le premier hominidé à sortir du continent africain.
Nouveau palier dans l'évolution d'homo : homo erectus, il y a 1,7 million d'années, qui améliore encore ses techniques de taille de la pierre, étend la gamme de ses outils, transmet ses connaissances de génération en génération et qui, finalement, il y a 400 000 ans, domestique le feu : d'une part afin de cuire ses aliments, d'autre part pour se chauffer et se protéger des prédateurs.
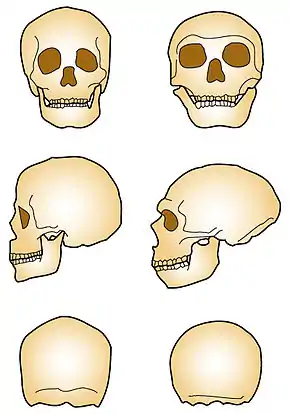
Beaucoup plus proche de nous, l'homme de Néandertal, il y a environ 350 000 ans, qui vit en Europe, au Moyen-Orient et en Asie centrale. Sachant s'adapter aux grands froids, c'est un nomade capable d'effectuer de grands déplacements pour rechercher sans cesse de nouveaux gibiers. Il habite aussi bien dans des grottes et des abris rocheux que dans des huttes en peaux d'animaux tendues sur des poteaux de bois ou dans des constructions en pierre.
Il y a environ 300 000 ans commence la deuxième phase du paléolithique (« paléolithique moyen »). Apparaît alors homo sapiens, espèce à laquelle appartiennent les hommes d'aujourd'hui[26]. Du point de vue physiologique, il se distingue par une bipédie quasi-exclusive et une boîte crânienne plus volumineuse (voir illustration), donc un cerveau plus développé ; également par un système pileux moins abondant, du fait qu'il confectionne lui-même des vêtements, depuis 170 000 ans avant le présent. Du point de vue de l'éthologie, il se caractérise par l'utilisation d'un langage articulé élaboré, rendu possible à la fois par un larynx situé plus bas que chez les autres espèces et par l'apprentissage. Il est le premier être à domestiquer une autre espèce animale, en l'occurrence le chien, pour les besoins de la chasse. Faits majeurs : apparaissent les premières préoccupations esthétiques (blocs ou os gravés) et spirituelles, car l'homme enterre ses morts. Ses relations sociales deviennent alors plus complexes.
Durant plusieurs millénaires, alors que les périodes glaciaires ne cessent d'alterner avec les périodes inter-glaciaires, la population humaine vit dans des cavernes, ne produit pas sa nourriture, étant exclusivement composée de chasseurs-cueilleurs, et elle est nomade. Sa densité reste faible et invariable : on l'estime à un habitant/km² contre 47 aujourd'hui.

La troisième et dernière période (« paléolithique supérieur ») s'amorce lors d'une amélioration relative du climat, il y a environ 45 000 ans, quand homo sapiens s'installe en Europe, où il va cohabiter avec l'homme de Néandertal, lequel va progressivement disparaître. Sa capacité crânienne augmente régulièrement, passant de 1 100 cm3 pour les premiers sapiens à 1 650 cm3 il y a 40 000 ans[27]. Appelé homme de Cro-Magnon, il ressemble alors sensiblement à celui que nous connaissons aujourd'hui. Sur le plan psychosocial, il se caractérise par l'abondance et la sophistication de ses armes ainsi que par l'importance de l'apprentissage et l'apport culturel dans son développement. Ainsi, il orne d'images les parois de ses cavernes (les plus anciennes répertoriées datent de 35 000 à 40 000 ans avant le présent, dont celles de la Grotte Chauvet) ainsi que différents objets utilitaires. Il pratique la monogamie. La taille des sépultures diffère selon le rang qu'occupait le défunt dans le clan (chefferie) et les convictions religieuses sont plus marquées.
Mésolithique

Quand la dernière ère glaciaire s'achève, il y a environ 12 000 ans, une nouvelle phase s'amorce dans l'histoire de l'humanité, relativement courte et considérée comme transitoire : le mésolithique (« mesos » = moyen, intermédiaire).
Alors que les mammouths et les rennes émigrent vers les régions froides du nord et que se multiplient des gibiers de tailles plus modestes (sangliers, cerfs...), les territoires de chasse se réduisent et de nouvelles armes, comme l'arc, apparaissent. Les hommes conservent certes un mode de vie essentiellement nomade mais l'abondance et la diversité des ressources favorisent des déplacements sur des territoires relativement restreints, variant selon les rythmes saisonniers.
On peut donc dire que cette période traduit une tendance progressive à la sédentarisation.
Néolithique
La période néolithique s'amorce au Proche-Orient vers 10 000 av. J.-C. et, à la suite de multiples mouvements migratoires. Elle est marquée par de profondes mutations techniques et sociales, liées à l’adoption d’un modèle de subsistance fondé sur l’agriculture et l’élevage, et impliquant par conséquent une sédentarisation et une montée de la démographie. Pour la première fois, les humains ne semblent pas se contenter de s'adapter au milieu mais manifestent la volonté de le transformer afin de prendre en main leur destin. Ils font alors preuve d'une ingéniosité sans précédent, perfectionnant sans cesse leurs techniques et en concevant de nouvelles à un rythme inégalé. Les principales innovations sont la généralisation de l'outillage en pierre polie (d'où l'appellation « néolithique »), la poterie, ainsi que le développement de l'architecture : premières maisons, premiers villages (donc premières chefferies), puis premières constructions massives à finalité religieuse et premières villes, à partir de la fin du Ve millénaire avant notre ère. L'invention de la roue, qui permet le transport de cargaisons lourdes et volumineuses, date du IVe millénaire (vers 3700 av. J.-C. en Mésopotamie. Environ 7 000 av. J.-C., le mouvement atteint l'Europe et, vers 4 500 av. J.-C., l'ensemble de celle-ci est occupée par les agriculteurs.
Ces mutations s'opérant sur plusieurs millénaires, il n'est pas concevable que les hommes d'alors aient eu conscience d'être à l'origine d'un quelconque « progrès ». L'hypothèse d'un changement rapide est même discutée par certains préhistoriens. Cependant, d'autres estiment que, dans quelques régions, l'évolution est si prompte qu'il est pertinent de parler de « révolution néolithique ». C'est d'abord le cas de l'archéologue australien Vere Gordon Childe, qui crée l'expression en 1925. Plus proche de nous, c'est également l'avis de Jean-Paul Demoule[28], qui insiste sur le caractère volontaire des changements opérés et qui estime qu'un changement dans les mentalités pourrait avoir précédé l'évolution des techniques et en serait l'origine :
« En prenant le contrôle de certains animaux et de certaines plantes, les humains se sont extraits de la nature; ils se sont "dé-naturés", pour reprendre le titre d'un roman de l'écrivain Vercors, Les animaux dénaturés, justement consacré à la définition de l'humain par rapport à l'animal. L'archéologue français Jacques Cauvin a même suggéré, au moins pour le Proche-Orient, l'idée d'une "révolution des symboles", d'une révolution dans la culture, et plus précisément dans les conceptions religieuses, qui aurait précédé la révolution technique de l'agriculture : au lieu de se percevoir au milieu de la nature, les humains se seraient sentis en droit d'en prendre possession[29]. »
L'archéologue précise toutefois :
« Cette hypothèse est séduisante, proposée sous des formes voisines dès le XIXe siècle par l'ethnologue allemand Eduard Hahn et plus récemment par le philosophe français René Girard. Cependant, elle peine à être démontrée par les faits. Il est beaucoup plus probable que les causes environnementales, techniques, culturelles se sont indissociablement entremêlées pour provoquer cette rupture radicale, quoique lente et progressive, dans le mode de vie. Rupture qui ne s'est produite qu'en un très petit nombre de régions du monde[30]. »
La période néolithique prend fin vers 3 300 av. J.-C. avec la généralisation de la métallurgie du bronze et surtout l’invention de l’écriture, qui marque la fin de la préhistoire et le début de l'histoire.
Premières civilisations
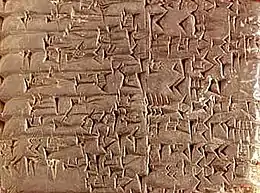
Le développement de l'agriculture a pour principale conséquence un boom démographique et la concentration des populations dans des cités, se regroupant parfois ensuite en États[n 2], voire plus tard en Empires. Ce vaste mouvement caractérise ce qu'on appelle la civilisation. Les premières sont la civilisation sumérienne (vers 3500 av. J.-C.), la civilisation égyptienne (vers 3300 av. J.-C.) et la civilisation de la vallée de l'Indus (vers 3300 av. J.-C.).
L'organisation sociale et économique devenue sophistiquée, c'est alors que se développent tout à la fois l'écriture, les religions, le commerce sur les longues distances, le droit, les guerres expansionnistes... ainsi que les sciences, la capacité à élaborer une pensée abstraite, créer et utiliser des concepts (en particulier avec les mathématiques) dans la perspective de structurer le raisonnement et ainsi mieux connaître le monde environnant.
L'idée de progrès ne peut émerger qu'à partir du moment où les humains se préoccupent de mesurer le temps. Au début du troisième millénaire avant notre ère, les Égyptiens conçoivent le premier calendrier solaire connu de l'histoire et, au début du IIe millénaire av. J.-C., ils sont parmi les premiers à diviser le jour en unités de temps, dans un but religieux. La question du temps, en effet, est sous-jacente à toutes les grandes interrogations de l'homme, que ce soit d'un point de vue concret, physique (par exemple l'incidence du cycle des saisons sur l'agriculture) ou d'un point de vue métaphysique (exemple : qu'y a t-il après la mort ?) et ce sont d'abord les mythes et les religions qui tentent d'y apporter des réponses: ainsi dans la mythologie grecque, Chronos est un dieu primordial personnifiant le Temps et la destinée.

Autre événement majeur : l'apparition de la monnaie. À ses débuts, celle-ci a pris des formes extrêmement diverses (bœuf, sel, nacre, ambre...) mais, dans tous les cas, elle s'est caractérisée par la confiance qu’avaient ses utilisateurs dans la persistance de sa valeur et de sa capacité à servir de moyen d'échange. La monnaie recouvre donc non seulement une fonction économique mais plusieurs dimensions majeures, notamment psychologique, juridique, sociale et politique. C'est au VIIe siècle av. J.-C. en Lydie (à l'ouest de l'actuelle Turquie) qu'ont été découvertes les premières pièces métalliques. Le développement de la monnaie métallique est corollaire au développement de vastes territoires, politiquement unifiés et centralisateurs. Celle-ci permet en effet de payer les soldats et l'administration, donc de gouverner à distance.
Au fur et à mesure que les nécessités économiques et politiques l'imposent, la capacité de raisonnement s'affine. Appliquée tout d'abord à la gestion des affaires matérielles, la raison est peu à peu utilisée à des fins réflexives : les hommes deviennent pour eux-mêmes un objet d'étude et prennent l'habitude de discourir sur la ou les manière(s) de s'améliorer d'un point de vue éthique. On a l'habitude de considérer les Grecs du Ve siècle av. J.-C. comme les inventeurs de cette capacité réflexive : la philosophie.
Civilisation grecque
La Grèce antique est le foyer d'un tout nouveau type de conception du monde : non plus strictement mythique et religieux mais philosophique, c'est-à-dire basé sur un usage accru de la raison. Cette évolution s'opère toutefois lentement, entre le VIIIe siècle av. J.-C. et le Ve siècle av. J.-C., et l'on passe alors d'une approche négative (la volonté de maîtriser techniquement le monde est haïssable) à une approche ouvertement positive mais basée sur d'autres critères. « Progresser » devient « philosopher », étymologiquement : « aimer (φιλεῖν, philein) la sagesse (σοφία, sophia) » ; plus précisément « savoir différencier le monde réel et les idées qu'on en a ».

L'historien Jacques Le Goff voit dans les poèmes didactiques d'Hésiode (VIIIe siècle av. J.-C.) les premières grandes réflexions sur l'évolution de l'humanité[31]. Dans Les Travaux et les Jours, Hésiode rapporte le mythe des cinq âges de l'humanité, au cours desquels l'existence, d'abord idéale, des humains se serait dégradée progressivement au fil des générations successives. Vient d'abord l'Âge d'or :
« Les hommes, à cette époque, ne travaillaient pas et vivaient en accord parfait avec la faune et la flore, les sacrifices étaient inexistants. (...) Les saisons étaient inexistantes, ils vivaient dans un printemps éternel. La nature était d'ailleurs bienfaitrice et leur fournissait tout sans aucun effort (...) Ils vivaient comme des dieux, le cœur libre de soucis, à l'écart et à l'abri des peines et des misères : la vieillesse misérable sur eux ne pesait pas ; mains, bras et jarret toujours jeunes, ils s'égayaient dans les festins, loin de tous les maux. Mourants, ils semblaient succomber au sommeil[Sp 8]. »
Suivent ensuite l'Âge d'argent, durant lequel les humains se montrent coupables d’hybris et découvrent le mal et la douleur ; l'Âge de bronze, où les guerres succèdent aux guerres ; l'Âge des héros, période également très conflictuelle ; l'Âge de fer, enfin, où les affrontements deviennent carrément fratricides. Dans la Théogonie, Hésiode raconte comment Prométhée, de la famille des Titans, a dérobé le feu aux dieux et en a été puni, enchaîné à un rocher, où un aigle venait chaque matin lui dévorer le foie[32]. La figure de Prométhée sera régulièrement interprétée comme emblématique de la malédiction qui résulte de toute volonté de puissance et des risques que celle-ci, immanquablement, fait courir à l'humanité[33],[34].

Tout comme le judaïsme, qui, à la même époque, place l'origine de l'humanité au Paradis (ou jardin d'Éden) et la fait décliner avec l'épisode de la Chute, les Grecs assignent une connotation négative au progrès de l'emprise sur la nature. Celle-ci est une forme d'hybris et a pour sanction la décadence de l'humanité tout entière.
Un renversement des valeurs se produit entre le VIIe siècle av. J.-C. et le Ve siècle av. J.-C.. Les sciences grecques constituent l'expression d'une véritable pensée rationnelle et logique, elle-même fondée sur la capacité d'abstraction. La période des premiers philosophes marque le passage de la pensée mythique à la raison: à la place des légendes expliquant la création du monde ou les phénomènes naturels, on formule des théories sur la base d'arguments considérés comme logiques. Du reste, Thalès, Pythagore, Héraclite, Parménide, Hippocrate, Démocrite... sont à la fois mathématiciens, physiciens et/ou médecins : sciences et philosophie s'alimentent respectivement, au point qu'il est difficile d'établir une frontière entre les deux domaines. Il est d'usage de qualifier de « miracle grec » cette fusion[35],[36].
Le Ve siècle av. J.-C., dit « Siècle de Périclès », est celui des premiers grands sculpteurs (notamment Phidias), et des premiers grands philosophes, Socrate et Platon, qui - à la différence de leurs prédécesseurs - ne s'interrogent pas seulement sur la nature, la structure et l'évolution de l'Univers mais aussi sur les possibilités et les limites de la pensée humaine. Pour Platon, les « idées » sont le modèle imaginaire de tout ce qui est sensible : la connaissance se fonde sur le raisonnement abstrait, elle vise à catégoriser le réel. L'évolution de la statuaire est significative d'une soudaine mutation : en quelques années, en effet, on passe d'un type de représentation du corps humain qui est archaïque, relativement statique, et qui répond à un modèle prédéterminé, le kouros, à un autre, dit « classique », où les mouvements amples sont signifiés de façon à sublimer les corps : la maîtrise de l'anatomie est parfaite et chaque œuvre est pensée comme unique, originale, singulière.

Au IVe siècle av. J.-C., avec Aristote, la science acquiert une méthode, basée sur la déduction, l'observation des faits et la recherche des causalités. Il est l'un des premiers penseurs de son temps à aborder presque tous les domaines de connaissance : biologie, physique, métaphysique, logique, poétique, éthique, politique, logique, cosmologie, rhétorique et de façon ponctuelle l'économie. Ce faisant, il confère à la philosophie un sens plus large que son maître Platon : il s'interroge non seulement sur « le monde des idées », c'est-à-dire sur l'homme en tant qu'être doué de connaissance, mais aussi sur « le monde sensible ».
Toutefois, se fondant sur les recherches de l'historien des sciences Abel Rey, Jacques Ellul considère que, chez les Grecs, à la différence notoire de ce que l'on observera plus tard dans la civilisation romaine, le progrès scientifique ne s'accompagne nullement d'un progrès technique ; du moins, pas dans les mêmes proportions :
« (Certes), les Grecs sont les premiers à avoir une activité scientifique cohérente (...) mais il se produit alors un phénomène qui n'a pas fini d'étonner l'histoire : c'est la séparation presque totale entre la science et la technique. (...) Les besoins matériels sont méprisés, la recherche technique apparaît indigne de l'intelligence, le but de la science n'est pas l'application mais la contemplation. Platon se refuse à tout compromis d'application, même pour faciliter la recherche scientifique. C'est l'exercice de la raison la plus abstraite qui doit seul être conservé[Sp 9]. »
Civilisation romaine
Née au VIIIe siècle av. J.-C. avec la fondation de Rome, la civilisation romaine s'est manifestée sous trois régimes successifs : la monarchie (jusqu'au Ve siècle av. J.-C.) ; la République (du Ve au Ier siècle av. J.-C.), caractérisée par une séparation des pouvoirs législatif et exécutif ainsi que par un système juridique élaboré et une administration très hiérarchisée ; enfin l'Empire (du Ier au Ve siècle), période durant laquelle les Romains dominent l'ensemble du monde méditerranéen et de l'Europe de l'Ouest par la conquête militaire, l'assimilation des élites locales et l'imposition d'une conception du monde nouvelle, dans laquelle on s'accorde parfois à voir les bases d'une véritable philosophie du progrès.
Deux facteurs justifient cette analyse : l'évolution des modes de vie vers toujours plus d'organisation et l'évolution des idées.

L'idée de progrès émerge principalement durant la République, soit du IIIe siècle av. J.-C. au Ier siècle av. J.-C., avec tout d'abord Ennius « «semble avoir conçu de façon grandiose la marche de l'humanité vers toujours plus de lumière ... Il a choisi de raconter l'histoire de la cité qui de son temps prenait la tête des hommes dont le souci est le progrès[37]. » L'idée réapparait chez Caton l'Ancien, puis Lucrèce, Cicéron et Varron, enfin Salluste, Virgile et Horace[38].
C'est principalement chez Cicéron (le premier à avoir utilisé le terme humanitas) que se révèle « l'idée que l'humanité se façonne, s'améliore dans le développement même de la civilisation, celle que les progrès matériels et intellectuels servent une promotion spirituelle en humanité, celle que la culture est nécessaire à l'épanouissement de l'humanité en chaque individu »[37]. L'optimisme de Cicéron est tempéré par Lucrèce et Varron, le premier mettant les hommes en garde contre la bestialité qui sommeille en eux, le second étant « partagé entre la conviction que, depuis son enfance, les mœurs des magistrats et des particuliers s'étaient relâchés et son admiration pour les progrès de la civilisation, sa passion pour l'idéal de l'humanité que faisaient concevoir les progrès accomplis par les hommes depuis leur apparition sur la terre[37]. »
Judaïsme
La tradition attribue la naissance du judaïsme à Moïse, au XIIIe siècle av. J.-C., mais les recherches exégétiques, archéologiques et historiques tendent à remettre en cause le récit traditionnel. Selon les recherches actuelles, le premier livre de la Bible, le récit de la Genèse, serait la compilation d’un ensemble de textes écrits entre les VIIIe et IIe siècles av. J.-C. Quoi qu'il en soit, le judaïsme constitue la première grande religion monothéiste de l'histoire de l'humanité. Selon celle-ci, la communauté juive était autrefois réduite en esclavage en Égypte puis, après l'exode, a connu une histoire parsemée de drames (exils, persécutions...). C'est pourquoi, cette religion est entièrement axée sur l'idée d'une recherche d'un avenir meilleur, appelé à se concrétiser par la venue d'un messie libérateur et une vie libre en Terre promise.

Associant étroitement les idées de communauté (« peuple élu », « nation juive »...) et d'individualité, le judaïsme se caractérise par un dialogue permanent, personnel, presque intime (cf Le Livre de Job) entre les hommes et Yahweh, le dieu unique ; ce que les Juifs appellent l'Alliance. C'est ainsi qu'au VIIIe siècle av. J.-C., les prophètes Amos, Osée et Isaïe réclament une religion de justice, d'amour et de sincérité plutôt que de rites et de sacrifices. Ce dialogue homme-dieu a un caractère téléologique : il est structuré d'une part sur l'idée de providence (volonté de Dieu de libérer le peuple juif), d'autre part sur l'idée d'espérance (volonté du peuple juif d'entendre et respecter la providence divine). Selon C. G. Jung, il poursuit une double finalité : non seulement l'évolution de l'homme vers le bien mais également - tout autant, en même temps et dans le même sens - celle de Dieu[39].
Le judaïsme constituant une pensée qui s'inscrit dans le temps long, il assigne une perspective à l'histoire. Et il est considéré comme la première « religion du livre » car c'est par le biais de l'Écriture qu'il évolue et se transmet de génération en génération. Les prophètes sont ceux qui, reconnus comme inspirés par Dieu et analysant le présent avec lucidité, annoncent des événements à venir si le peuple ne change pas de comportement. Au IIe siècle av. J.-C., le Livre de Daniel invite même le croyant à adapter sa conduite en fonction de la fin des temps (eschatologie).
La pensée juive est donc entièrement axée sur l'idée de progrès moral. Dans son Essai sur l’histoire de l’idée de progrès, en 1910, Jules Delvaille écrit :
« Si le progrès était davantage inscrit dans la civilisation latine que grecque, il l’était encore plus dans la société hébraïque durant les derniers siècles de la royauté juive et pendant la captivité de Babylone. Durant cette période de décadence, la parole appartenait aux prophètes, qui défendaient leur foi en un avenir – terrestre – meilleur, comme pour conjurer un présent peu amène. En élevant la voix, ils prouvaient l’importance de l’idéal et annonçaient le triomphe de la morale, moyen de renouer avec Dieu[40]. »
Plus récemment, en 2000, le philosophe Michel Lacroix estime lui aussi que le progrès (formulé en termes de providence) trouve ses racines dans la religion juive et doit être compris comme un « progrès moral », une éthique. Il y a en quelque sorte « progrès » quand il y a capacité à tirer parti du mal pour accéder au meilleur :
« La Bible met en œuvre une dialectique de la transformation du mal en bien, qui constituera la racine de la pensée occidentale sur le mal. On la retrouvera dans les théodicées et les philosophies de l'histoire. Elle sera l'un des piliers de la théorie du progrès[41]. »
Christianisme
Selon l'essayiste Jean-Claude Guillebaud, les idéaux progressistes formulés par la modernité sont l'héritage du message chrétien :
« L’idée de progrès humain, d’amélioration du monde, est incompréhensible sans référence à l’espérance chrétienne et à sa source originelle qui est le prophétisme juif. De la même façon, le concept d’égalité, qui paraît si naturel à quiconque, trouve son origine dans le monothéisme – les créatures humaines égales sous le regard d’un Dieu unique – et plus précisément dans l’Épître aux Galates de Paul. La liberté individuelle elle-même – qu’on tend à dévoyer en « individualisme » – est une invention chrétienne, si on peut dire. Elle n’existe pas dans les autres grandes civilisations, qu’elles soient chinoise, indienne ou précolombienne. Elle était étrangère aux Grecs et n’est pas reconnue par l’islam[42]. »
Apparue dans le sillage du judaïsme en Galilée, terre alors administrée par les Romains, la religion chrétienne repose sur la croyance que Dieu entre dans l'histoire des hommes en s'incarnant en la personne de Jésus de Nazareth, que les chrétiens reconnaîtront plus tard comme le Christ, le messie (fils de Dieu et Dieu lui-même) annoncé par les Hébreux mais non reconnu comme tel par eux.
Le Nouveau Testament raconte que durant les deux ou trois dernières années de son existence, Jésus entre en contact avec douze disciples, les apôtres, et qu'il leur délivre un enseignement, en grande partie sous forme de récits allégoriques, les paraboles. L'une d'entre elles, dite la parabole des oiseaux du ciel, les invite à croire en la providence, la « volonté de Dieu » :
« Regardez les oiseaux du ciel : ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers; et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? »[43]
De façon explicite, le message évangélique postule ainsi qu'en aucune manière les hommes n'ont à se préoccuper de leur confort ni de leur avenir. Pour autant, il ne peut nullement s'assimiler à une quelconque forme de présentisme car il est construit sur l'idée que le déroulement des faits a un sens ainsi qu'une finalité (la fin des temps et la Jérusalem céleste), tous deux prévus par Dieu et transcendant les humains. Ce message constitue donc pour eux une eschatologie et ils sont incités à adapter leur conduite à une éthique de caractère téléologique. L'essentiel de ce message s'articule autour du commandement d'« aimer son prochain », amour comparable à l'estime de soi (« Tu aimeras ton prochain comme toi-même ») et à l'image de l'amour de Dieu pour les hommes, l'idée étant que ce commandement doit se transmettre dans le futur, de génération en génération :
« Je vous donne un commandement nouveau : aimez-vous les uns les autres ; comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres[44]. »
Le présent est étroitement associé à l'idée de salut éternel, donc d'éternité. Le contact avec Dieu nécessite un effort régulier, chaque jour : la prière ; ce que traduit ce verset du Notre-Père : « Donne nous chaque jour notre pain quotidien ». Le « progrès » à promouvoir est donc exclusivement moral et le présent s'inscrit dans l'histoire à travers l'anamnèse, le commandement d'aimer son prochain étant symbolisé par l'épisode de la Cène, plus précisément du sacrement de la communion, comme le soulignent les Évangiles :
« « Ensuite il prit du pain. Et, après avoir rendu grâces, il le rompit et le donna à ses disciples, en leur disant : "ceci est mon corps, qui est donné pour vous et pour la multitude ; faites ceci en mémoire de moi" »[45]. »
À la suite du judaïsme, le christianisme participe donc de la dialectique de la conversion du mal en bien, qui constitue pour Michel Lacroix l'un des piliers de toute la théorie du progrès, conférant au parcours de chacun et à la façon dont il fait le bien quotidiennement une valeur universelle[n 3] : l'histoire de chaque individu contribue à l'histoire de l'humanité et vice versa. Pour le chrétien, le « tu aimeras ton prochain comme toi-même » rend ainsi le progrès moral et le progrès social à la fois fondamentaux[n 4] et indissociables.
Moyen Âge
La notion de progrès est pour le moins discrète durant tout le Moyen Âge, raison pour laquelle celui-ci est d'ailleurs souvent considéré comme une période « obscure »[46]. La conception du monde qui prédomine alors est en effet marquée par la chrétienté. Or la doctrine chrétienne présuppose que les hommes doivent d'une part faire preuve d'une extrême humilité, d'autre part n'accorder au monde existant qu'un rôle secondaire : ce monde est jugé méprisable et il n'y a pas à chercher à l'améliorer de quelconque façon car il est celui de la Chute, celui dans lequel Adam et Ève ont été précipités par Dieu, après avoir été chassés du jardin d'Éden, pour avoir goûté au fruit défendu de l'Arbre de la connaissance du bien et du mal. Seul importe le salut de l'âme par-delà la mort.
Le Moyen Âge est-il donc une période de stagnation, hermétique à toute idée de progrès, comme le veut une idée répandue et comme le laissent même entendre certains philologues médiévistes ?
« S'il est un thème dominant dans l'idéologie et dans l'imaginaire des hommes du Moyen Âge, ce n'est sûrement pas l'idée de progrès mais bien son antithèse : la roue de Fortune, qui fait son apparition dans la Consolation de Philosophie de Boèce au Ve siècle pour dominer ensuite l'imaginaire médiéval[47]. »
En réalité, le fait que l'idéologie progressiste ait émergé dans l'Occident chrétien suffit à prouver qu'au Moyen Âge, le rapport des gens d'Église à l'idée de progrès est plus subtil et complexe qu'il ne paraît. Ceci pour au moins deux raisons :
- D'abord parce que l'idée même de salut dans l'au-delà peut être interprétée comme un idéal progressiste. Certes, à l'inverse des sociétés modernes, le progrès n'est pas pensé sous un angle scientifique ou technique, mais il l'est en revanche en termes d'individus et de communauté : en termes éthiques : « Le concept de salut dans le monde médiéval n'a de sens que dans une perspective eschatologique : l'individu ne peut progresser que dans la voie du salut tout comme les sociétés, qui ne peuvent que viser le développement de la voie chrétienne dans le monde entier. (...) Le christianisme donne un sens à l'histoire (...) mais le mépris du monde implique le mépris du progrès matériel. Le seul but envisageable est le progrès moral, défini comme recherche du salut éternel »[48].
- La seconde raison pour laquelle les chrétiens ne se ferment pas tout à fait à l'idée d'un progrès matériel tient également au contenu de leur doctrine : celle-ci est fondée sur le dogme de l'incarnation de Dieu dans le monde, ce qui sous-entend que celui-ci n'est finalement pas si méprisable que cela et que, pour l'aborder, les sensations et la raison sont à cultiver. Ainsi, au Ve siècle, Saint Augustin élève l'érudition au rang de vertu[49],[50] et, après lui, durant tout le haut Moyen Âge, de nombreux docteurs et hommes d'Église se montrent ouverts aux sciences, tels Gerbert d'Aurillac, pape autour de l'an mille mais également mathématicien.
Haut Moyen Âge

Au début du Moyen Âge, la philosophie occidentale est marquée principalement par la figure d'Augustin d'Hippone, théologien chrétien de la fin de l'Empire romain, à la charnière du IVe siècle et du Ve siècle. Selon lui, toute avancée dans le temps est une « fuite en avant » dès lors qu'elle ne puise pas dans la mémoire du passé ; plus exactement dans l'anamnèse, le récit des événements écoulés et la réflexion qu'ils sont censés susciter :
« Quiconque n'envisage pas le commencement de son activité est incapable d'en prévoir la fin. Ainsi, à la mémoire qui se retourne vers le passé se lie nécessairement l'attention qui se porte à l'avenir. Qui oublie ce qu'il commence saura t-il comment il peut finir ? »[51]
Comme le souligne la théologienne orthodoxe Julija Vidović, « l’anthropologie d’Augustin n’envisage jamais l’homme que dans la relation à son origine et à son terme », mais, précise t-elle, cette relation ne peut s'opérer que dans le cadre d'une relation de l'homme à Dieu.
« Quand [l’homme] prétend être comme Dieu, c’est-à-dire n’avoir personne au-dessus de lui, son châtiment est de tomber [...] dans ce qu’il y a de plus bas [...] En négligeant sa relation à Dieu, il perd ses forces et se trouve en position de ne plus pouvoir revenir en arrière. [...] Il se laisse entraîner et glisse du moins au moins en croyant aller du plus au plus, [...] il ne se suffit plus à lui-même et rien ne lui suffit, dès lors qu’il se détourne de Celui qui seul lui suffit[52]. »
Selon Alain de Benoist, Saint Augustin est « le premier à tirer [du récit biblique] une philosophie de l'histoire universelle englobant toute l'humanité, celle-ci étant appelée à progresser d'âge en âge vers le mieux »[53].
Moyen Âge central
Stimulée au XIe siècle par l'émergence d'une classe d'intellectuels étudiant la culture antique (notamment l'École de Chartres), la chrétienté du Moyen Âge central vit au XIIe siècle une profonde mutation de ses structures culturelles. C'est en jetant les bases de ce qui deviendra plus tard la philosophie de l'histoire que le moine cistercien calabrais Joachim de Flore, contribue alors à l'émergence de l'idée de progrès. Son influence sera très tardive : il est en effet « impossible d’affirmer qu’il a un impact déterminant dans la pensée médiévale »[54]. En revanche, sa théologie sera très commentée au XIXe siècle[55]. De même, au début de la seconde moitié du XXe siècle, elle influencera profondément les philosophes qui élaboreront les premières critiques de la modernité. Ainsi, dans son Histoire et Salut, en 1949, Karl Löwith estimera que « (son) historisme théologique » est la source de toutes les tentatives récentes pour « accomplir l'histoire ». Et la même année, le mythologue roumain Mircea Eliade dira que son œuvre se présente comme une « géniale eschatologie de l'histoire, la plus importante qu'ait connue le christianisme après saint Augustin[56]. Un peu plus tard, Ernst Jünger, le considèrera lui aussi comme un précurseur de la philosophie de l'histoire[57]. Et commentant récemment son « immanentisation de l’eschaton chrétien », le philosophe Robert Redeker dit que c'est sous son impulsion que « le progressisme est une sécularisation du christianisme »[58].


La montée en puissance de la sécularisation intervient surtout au XIIIe siècle. Albert le Grand, un frère dominicain connu également comme philosophe, naturaliste et chimiste, joue un rôle majeur dans le développement de la scolastique, un courant de pensée visant à concilier la philosophie grecque et la théologie chrétienne. Au sein de l'Université de Paris, créée sous son impulsion, les débats portent sur une question cruciale : « comment articuler la raison et la foi ? ». On doit à son élève, Thomas d'Aquin[Sp 10], d'opérer une synthèse entre les sciences, la philosophie et la théologie.
Selon Toby Huff, c'est au cours des XIIe et XIIIe siècles, que l'extraordinaire fusion de la philosophie grecque, du droit romain et de la théologie chrétienne crée en Europe les conditions favorisant le développement de la science moderne en donnant une autonomie légale à une variété de corporations : universités, villes, guildes marchandes et groupes professionnels[59].
François d'Assise, par l'intermédiaire des récits relatant son rapport empathique aux animaux, valorise la sensibilité par rapport à la raison et confère à la nature une image franchement positive, qui se démarque radicalement de celle qui prévalait jusqu'alors et dont le récit de la Chute est le paradigme. Avec le franciscanisme, donc, le mouvement de sécularisation s'accentue : « le vocabulaire du progrès (proficere, percifere bonum, profectus...) est récurrent chez Bonaventure », ministre général des franciscains[60]. Entré lui aussi dans l'ordre des franciscains, en 1256, mais critique à l'égard d'Albert le Grand[Sp 11], l'Anglais Roger Bacon est l'auteur de plusieurs recherches en optique. Sa double appartenance à la philosophie et à la science lui confère le rang d'initiateur de la science expérimentale.
Tout à la fin du siècle et au début du XIVe siècle, le peintre Giotto réalise à Assises une série de fresques relatant l'histoire de Saint François. Par leur degré de réalisme inégalé, de nombreuses générations d'historiens de l'art vont considérer ces peintures comme fondatrices de l'idée de progrès dans le domaine artistique[61].
Depuis ces deux entrées que sont la raison et la sensibilité, l'Église laisse alors le champ libre à ceux qui seront plus tard qualifiés d'humanistes[62],[63] et qui mettront la question du progrès à l'ordre du jour (Rabelais en 1532, Montaigne en 1588).
XVe siècle

L'époque du Moyen Âge tardif est marquée par une profonde mutation en Europe occidentale, à commencer par l'Italie du Nord et les Flandres. Les historiens modernes l'appelleront « Renaissance », dans la mesure où la culture de l'Antiquité gréco-romaine est en quelque sorte réhabilitée après plusieurs siècles marqués par la chrétienté. Chez les élites, une nouvelle manière de penser émerge qui, elle aussi, sera qualifiée : l'humanisme. Sa singularité est en effet d'attribuer à « l'homme » et aux valeurs humaines une place centrale (anthropocentrisme), quand le christianisme leur conférait jusque-là une place seconde, après Dieu (théocentrisme) : les premiers humanistes ne se sentent plus exclusivement des créatures mais également des créateurs, des inventeurs, des découvreurs... non pas en situation de concurrence avec Dieu - qui conserve le statut de Créateur par excellence - mais à son image. En cela, ils se sentent encouragés par la doctrine chrétienne depuis qu'elle a été révisée au XIIIe siècle - on l'a vu - par le thomisme, lequel établit une relation dialectique, équilibrée, entre foi et raison.
Ce changement dans l'histoire des idées résulte de plusieurs facteurs existentiels. Après plusieurs années de mauvaises récoltes puis une épidémie de peste qui élimine un tiers de la population européenne, l'économie connait une profonde mutation. La société s’est urbanisée (plusieurs villes comptent désormais plus de 40 000 habitants) et les premières compagnies internationales éclosent, appliquant de nouvelles techniques financières. Les banquiers lombards, qui – dès les années 1250 – avaient institué la pratique du prêt bancaire contre intérêt, implantent des bureaux dans le nord de l'Europe. Leurs débiteurs sont des rois, des seigneurs et des commerçants soucieux de mener à bien différents projets. Ce passage d'une économie féodale au commerce de l’argent coïncide d'une part avec l’éclosion des États modernes (nouvelles instances juridiques, qui gagnent d'autant plus de légitimité dans l'imaginaire collectif que l'Église en perd, ébranlée par un schisme[64]), d'autre part avec la main mise de la bourgeoisie, classe sociale montante, sur l'économie.
Apparue au XIIe siècle, la bourgeoisie prend en effet le contrôle total de l'économie, dont elle tire profit, et par voie de conséquence celui des grandes cités. Et ce faisant, elle impose ses propres valeurs tout au long du siècle : alors qu’auparavant le monde d’ici-bas était associé à l’image de la Chute, il va peu à peu être approché de façon objective et être assimilé à un territoire à conquérir et maîtriser toujours plus et mieux. Et alors que, durant les siècles précédents, la chrétienté avait orienté l'idée de progrès vers l'intériorité (le salut de l'âme, la providence...), la bourgeoisie la projette désormais à l'extérieur : l'invention de l'imprimerie sera décisive, car elle va accélérer sensiblement la circulation des idées, provoquant toutes sortes d'autres transformations : non seulement d'autres inventions et les premières grandes découvertes (notamment celle de l'Amérique, à la fin du siècle), mais une réflexion de fond sur l'idée d'éducation[65].
Progresser, c'est faire renaître
L'idée de progrès émerge au Quattrocento non pas dans des interrogations concernant le futur mais, paradoxalement, dans l'idée de faire « re-naître » un certain nombre d'idéaux anciens, puisés dans l'Antiquité gréco-romaine. Plus exactement, si les premiers humanistes focalisent leur intérêt sur des œuvres d'art ou des textes antérieurs au christianisme (et plus ou moins occultés par lui), c'est pour jeter sur eux un regard neuf, se situer par rapport à eux, condition nécessaire pour pouvoir ensuite agir sur eux : non seulement « penser » leur propre histoire, donc, mais « écrire » celle-ci; ce qui - trois siècles plus tard - sera l'objectif affiché des Lumières.

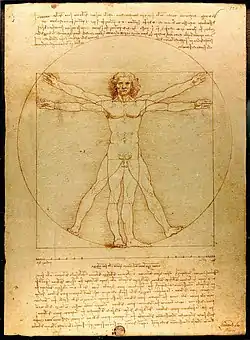
De par son caractère réaliste qui tranche avec l'art médiéval, la sculpture antique exerce une influence décisive sur la mentalité de la bourgeoisie naissante : elle attise chez celle-ci une volonté d'élaborer une vision du monde plus « réaliste » encore. L'un des événements les plus significatifs de cette démarche est l'invention du point de fuite (donc de la perspective linéaire) par le peintre Masaccio, à Florence, durant la seconde moitié des années 1420. Car si la capacité de restituer une image plus ou moins réaliste du monde s'observait déjà dans l'Antiquité (par exemple dans les fresques de Pompei, l'art copte ou, plus récemment, l'art hérité de Giotto...), c'est la première fois qu'un artiste utilise une méthode scientifique pour restituer ce réalisme de façon aboutie, au point que, dès cette époque, l'idée de progrès pénètre fortement le monde de l'art[66],[67].
Non seulement les principes mathématiques tels que la mesure ou les proportions entrent de plus en plus dans les préoccupations des artistes toscans mais durant la seconde moitié du siècle, ils vont se concrétiser dans différents domaines de la vie économique puis de la vie quotidienne de toute l'Italie du Nord. Ainsi, par exemple, le moine franciscain Luca Pacioli est-il l'inventeur de la comptabilité. L'époque se caractérise ainsi par une approche non plus exclusivement qualitative du monde, axée sur l'éthique chrétienne, mais aussi et de plus en plus (d'où l'idée de progrès) quantitative, axée sur le calcul et les méthodes rationnelles.
L'idée de progrès se caractérise également par l'accélération du processus de sécularisation, amorcé au siècle précédent à Sienne[68] et qui trouve à présent sa pleine expression dans la vie politique et culturelle de Florence, sous l'impulsion de la famille Médicis. En 1434, Cosme, un banquier habitué à parcourir l'Europe pour inspecter ses filiales, est nommé à la tête de la ville et devient le premier grand mécène privé de l'art (rôle qui était jusqu'alors la prérogative de l’Église). Sous l'influence du philosophe Gemiste Pléthon, il conçoit l'idée de faire revivre une académie platonicienne, qui sera finalement fondée en 1459, sous légide de Marsile Ficin puis de Jean Pic de la Mirandole et Ange Politien.
Technique « donnant des idées »
Dans les années 1450, l'Allemand Gutenberg invente un procédé aujourd'hui considéré comme l'une des plus grandes dates du « progrès technique » : l'imprimerie. Celle-ci va en effet jouer un rôle clé dans la diffusion des idées humanistes, en accélérant le processus vers l'Europe du Nord. Ainsi, grâce à elle, l'esprit de la Renaissance s'effectue en moins de deux générations dans les autres pays d'Europe[69]. L'imprimerie n'influe pas sur les mentalités uniquement par les idées qu'elle véhicule mais aussi parce qu'elle permet de toucher un nombre accru de personnes, à qui elle donne des idées.
C'est du reste un imprimeur bavarois, Mathias Roriczer, qui formule en 1486[Sp 12] l'idée d'un progrès continuel dans le domaine de l'artisanat et de l'architecture[70]. La science (ou plutôt l'idée que l'on peut s'en faire à l'époque) y est considérée comme une coopération menée à des fins non individuelles et s'inscrivant dans la longue durée.
XVIe siècle
.jpg.webp)
C'est durant ce siècle que le mot « progrès » apparaît pour la première fois en français. Tout d'abord en 1532 sous la plume de François Rabelais puis en 1588, dans les Essais de Montaigne qui lui confère alors le sens d'une « transformation graduelle vers le mieux ».
Pour saisir les raisons de l'émergence de ce terme à cette époque, il importe d'en rappeler brièvement le contexte.
Dès la fin du siècle précédent, en 1492, les Européens se sont aventurés loin de leurs terres et ont découvert un continent nouveau, l'Amérique. Ce repoussement des frontières physiques traduit une émancipation intellectuelle : parti de l'Italie et des Flandres, l'idéal humaniste s'étend aux autres nations. Et de façon corrélée, la plupart des dirigeants de celles-ci s'émancipent de la tutelle de l'Église, ce qui se traduit par un schisme retentissant, la Réforme (initiée en 1517 par Luther) puis, aussitôt en France, par les fratricides Guerres de religion.
Ce n'est pas un hasard si c'est chez un imprimeur luthérien de Nuremberg que parait en 1543 un ouvrage (rédigé déjà depuis plusieurs années) aux retombées retentissantes : De Revolutionibus Orbium Coelestium (Des révolutions des sphères célestes) de Nicolas Copernic. L'astronome y expose la théorie de l'héliocentrisme : contrairement à l'idée communément répandue, la Terre ne se situe pas au centre de l'univers.
Sur le coup, cette théorie est plutôt bien reçue mais sa signification symbolique (« l'homme n'est pas au centre de l'univers », donc, contrairement au récit biblique de la Création, « il n'a pas à considérer son territoire comme supérieur aux autres mais comme un parmi d'autres possibles ») va ébranler considérablement la conception du monde jusque là régnante et en initier une nouvelle.
Cette nouvelle conception se manifeste en Italie en 1520 et 1580 à travers une manière nouvelle de peindre : le maniérisme. Les artistes s'autorisent alors toutes sortes d'entorses aux règles, les licences, comme de contorsionner ou allonger exagérément les corps. Ces transgressions contribuent à valoriser la subjectivité (l'artiste en tant que « sujet ») au détriment du motif représenté (l'« objet »). Pendant au moins quatre siècles, cette novation sera considérée comme un « progrès » par plusieurs générations d'historiens de l'art[61].
Il importe enfin de signaler que c'est au moment où l'Europe occidentale commence à promouvoir le concept de « progrès » qu'elle commet sur d'autres continents d'effroyables ravages. Depuis le siècle précédent, les Portugais se livrent au commerce d'esclaves en Afrique. Mais cette fois, des conquistadores espagnols anéantissent deux civilisations entières outre atlantique (les Aztèques, à partir de 1519 en Amérique centrale puis les Incas, à partir de 1532 en Amérique du Sud), les pillant au passage de leurs matières précieuses. Ces contradictions entre le discours idéologique et les exactions commises dès le début de l'ère coloniale ne seront toutefois soulevées que des siècles plus tard.
Dialectique foi-raison

Comme Copernic, Érasme et Léonard de Vinci font partie des personnalités aujourd'hui considérées comme les plus représentatives de l'époque. Et pour cause : tous trois visitent des régions éloignées des leurs et tous trois pratiquent différentes disciplines. ce faisant, ils invitent aussi bien à estomper les frontières physiques qu'à décloisonner le savoir. Faisant preuve d'une ouverture d'esprit exceptionnelle, ils témoignent d'une réceptivité au monde sensible par l'entremise de l'expérience et du raisonnement méthodique, démarche que systématisera un siècle plus tard l'Anglais Roger Bacon et qui constituera le fondement de la science moderne.
La posture scientifique invite à observer et analyser le monde indépendamment de tout présupposé métaphysique. Ainsi, tout comme Copernic a conceptualisé son étude du système solaire indépendamment de sa foi chrétienne et tout comme le théologien Érasme préfigure les sciences humaines lorsqu'il s'efforce d'analyser « l'âme humaine » à travers par exemple l'art, la façon d'éduquer ou les motivations à faire la guerre, Leonard se montre capable de peindre L'adoration des mages, disséquer des cadavres pour se livrer à des études d'anatomie ou encore concevoir toutes sortes de machines, dont certaines ne se concrétiseront que plus tard.
« Le progrès » pourrait donc se caractériser alors par la capacité de cultiver en soi l'art de différencier et dialectiser la foi et la raison sans qu'aucun des deux termes l'emporte jamais sur l'autre. Cette capacité s'avérant particulièrement délicate à exercer, il s'ensuit au fil du siècle un véritable conflit entre la science et la religion, dont le mouvement de la Réforme et les Guerres de religion constituent les premières manifestations avant, au siècle suivant, l'opposition de l'Église à l'héliocentrisme et le procès qu'elle intentera à Galilée.
C'est ainsi que, peu à peu dans les consciences, « le progrès » va s'identifier non pas à une dialectique de la foi et de la raison mais à une substitution de la première par la seconde, jusqu'à déboucher sur déisme et sur les « religions naturelles » au XVIIIe siècle puis finalement à l'athéisme et au scientisme au XIXe siècle.
Sécularisation et criticisme
Depuis qu'il existe des civilisations, il existe des États. Mais la place qu'ils jouent au XVIe siècle est singulière dans le sens où leur légitimité s'accroît au fur et à mesure que décroît celle de l'Église, laquelle constituait depuis des siècles la première instance politique, au sens large du terme.

En 1511 parait l'Éloge de la Folie d'Érasme. Sur le mode satirique, celui-ci fustige l'hypocrisie des théologiens et des gens d'Église, y compris le pape, qui se réfèrent sans cesse aux Écritures mais qui, par leurs actes, les dévoient au gré de leurs intérêts. Connaissant aussitôt un grand retentissement en Europe, l'ouvrage contribue indirectement à l'éclosion de la Réforme protestante six ans plus tard mais aussi, précisément, à la montée en puissance des États.
Grand ami d'Érasme et, lui aussi, animé par un vif esprit critique avant même le début de la Réforme, l'Anglais Thomas More est un précurseur en matière de philosophie politique. En 1516, dans son essai Utopia, il conçoit un véritable projet de société. Il prône l'abolition de la propriété privée et de l'argent, le principe des biens communs, l'égalité des hommes et des femmes et surtout la liberté de pensée, y compris religieuse.
Né en Allemagne en 1517 avec Luther, le mouvement de la Réforme protestante constitue un événement majeur, bien au-delà de sa signification en termes théologiques. Au point que l'historien E. G. Léonard voit en Calvin le « fondateur d'une nouvelle civilisation »[71]. De fait, le luthéranisme et le calvinisme vont peu à peu contribuer à ce que le sociologue allemand Max Weber appellera plus tard « le désenchantement du monde ». Tout en préconisant l'obéissance aux Écritures, la spiritualité protestante invite en effet à ne pas les fétichiser, les sur-évaluer, de sorte ainsi à mieux comprendre le monde et expliquer, critiquer, le déroulement des événements.
En 1532, Machiavel théorise pour la première fois l'État, contribuant ainsi à rendre sa puissance plus légitime que celle de l'Église. Car si dès le IVe siècle, sous l'empereur Constantin, le partage des tâches avait été fixé entre le « pouvoir temporel » et le « pouvoir spirituel » dans le sens d'un relatif équilibre entre les deux, l'argumentaire de Machiavel, dans le contexte de la Réforme, rompt cet équilibre et assoit la supériorité du « prince » sur le pape.
Cette légitimation soudaine et considérable des États-nations est un facteur essentiel dans le processus de sécularisation qui se met en place dans toute l'Europe. Non seulement le criticisme précède le « progrès scientifique » (naissance de la science expérimentale au XVIIe siècle) et le « progrès technique » (industrialisation au XVIIIe siècle) mais il constitue une condition nécessaire à leur émergence[réf. nécessaire]. Son impact est si profond que rares sont ceux qui se risquent à le critiquer, tels Étienne de La Boétie qui, en 1576 dans son Discours de la servitude volontaire, s'étonne que ses contemporains se soumettent aussi volontiers à la nouvelle autorité.
Rabelais et Montaigne : se décrire pour décrire
Actif à partir des années 1530, l'écrivain français François Rabelais joue un rôle substantiel dans l'histoire du concept de « progrès », ne serait-ce que parce que c'est à lui qu'on attribue le premier usage du mot en français[72]. Figure majeure du courant humaniste en raison de son fort esprit critique, il exerce celui-ci pour analyser son époque, extrêmement mouvementée du fait de l'émergence de la Réforme protestante et des guerres de religion qui s'ensuivent, mais aussi pour cultiver ses propres contradictions : ecclésiastique, il est aussi anticlérical ; chrétien, il se présente également comme un libre penseur. « Progresser » signifie d'abord pour lui se pencher sur les paradoxes de la « nature humaine » pour prôner la tolérance et la paix. Il s'en prend notamment aux abus des princes et des hommes d'Église, et leur oppose d'une part les sources de la pensée évangélique, d'autre part la culture populaire, jusqu'à la paillardise.
Cinquante ans plus tard, son compatriote Montaigne confère également un sens moral au mot « progrès ». En 1588, il désigne par là une « transformation graduelle vers le mieux », un art de s'améliorer soi-même en pratiquant régulièrement l'introspection et le témoignage sans concession de sa vie[73].
XVIIe siècle
C'est au XVIIe siècle que le concept de « progrès » émerge véritablement, du fait de l'émancipation de la raison de tout présupposé théologique et de l'abandon du principe d'autorité de la tradition, qui prévalait depuis la scolastique médiévale. Les conditions sont alors réunies pour provoquer la grande éclosion de la science, au sens où l'on entend aujourd'hui ce terme : la science moderne.

Toutefois, au début du siècle, les choses ne se passent ainsi qu'en Europe du Nord, dans les États protestants, où le principe de libre examen est établi. Dans les États catholiques (Italie, Espagne…), au contraire, le processus est sévèrement réprimé par l'Église. En 1600, celle-ci déclare hérétique Giordano Bruno et l'envoie au bûcher pour avoir osé développer la théorie de l'héliocentrisme et démontré la pertinence d'un univers infini, n'ayant ni centre ni circonférence. En 1616, elle condamne la thèse de Copernic et en 1633, elle ouvre un procès contre Galilée, qui est parvenu à confirmer la thèse copernicienne par le calcul, le contraignant finalement à se rétracter.
Le siècle est marqué par l'incessante montée en puissance de deux nations, l'Angleterre et la France. Les mentalités évoluent toutefois différemment dans les deux pays. Outre-Manche, la République est proclamée en 1649. Elle n'est maintenue que deux ans mais, quand la monarchie est rétablie, le pouvoir royal est fortement contrebalancé par la bourgeoisie qui, organisée au sein du Parlement, devient la plus puissante d'Europe. En France, au contraire, la monarchie est dite « absolue », le pouvoir fortement centralisé, surtout à la fin du siècle autour de Louis XIV. Il s'ensuit que deux grands systèmes s'affrontent : le libéralisme et la libre initiative en Angleterre ; le centralisme étatique en France. Ce type de différences s'observe également dans la façon d'approcher la science : pragmatique et axée sur une observation débouchant sur des déductions en Angleterre, tandis que la France marque une préférence pour le rationalisme, la raison étant posée comme un a priori et les observations du monde étant traitées en fonction de ce cadre. Deux figures incarnent à elles seules ces deux approches : l'Anglais Bacon, selon qui l'expérimentation constitue le premier fondement de la science, et le Français Descartes, pour qui celle-ci s'appuie d'abord sur le raisonnement et le doute méthodique, lequel sert à mettre la raison à l'épreuve, donc d'établir des preuves.
Bacon et l'expérimentation
Le philosophe Francis Bacon (1561-1626) joue un rôle majeur dans l'établissement de la notion de progrès. En 1605, il publie le premier des six livres de sa Grande restauration des sciences, De dignitate et augmentis scientiae[Sp 13]. Dans le Nouvel Organon, en 1620, il classe les sciences selon un modèle qui servira à la publication en 1728 de l'Encyclopédie de Chambers, modèle de celle de Diderot. Dans un ouvrage de fiction publié un an après sa mort, La Nouvelle Atlantide, il imagine une cité parfaite dévolue à l'essor des sciences et des techniques qui n'est pas sans annoncer les utopies saint-simoniennes du XIXe siècle :
« Le but de notre établissement est la découverte des causes la connaissance de la nature intime des forces primordiales et des principes des choses, en vue d'étendre les limites de l'empire de l'homme sur la nature entière et d'exécuter tout ce qui lui est possible[Sp 14]. »
Comme le souligne l'historien des idées Pierre-André Taguieff, « Bacon donne ses lettres de noblesse à la thèse selon laquelle l'augmentation des connaissances implique un accroissement du pouvoir de l'homme sur la nature »[Ta 3]. De fait, quand il précise ce qu'il attend du « progrès » (à nouveau dans La Nouvelle Atlantide), ses propos annoncent ceux des transhumanistes du XXIe siècle :
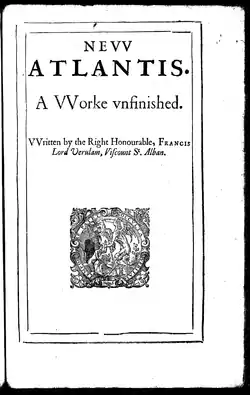
« Prolonger la vie. Rendre à quelque degré, la jeunesse. Retarder le vieillissement. Guérir des maladies réputées incurables. (...) Augmenter la force et l'activité. (...) Transformer la stature. Transformer les traits. Augmenter et élever le cérébral. Métamorphose d'un corps dans un autre. Fabriquer des espèces nouvelles. Transplanter une espèce dans une autre. (...) Rendre les esprits joyeux et les mettre dans une bonne disposition[Ta 4]. »
Et, toujours dans le même ouvrage, son approche du progressisme annonce l'eugénisme :
« Il est temps (...) de suivre un système de vues plus digne d'une époque de régénération, (...) d'oser revoir et corriger l'oeuvre de la nature. (...) C'est ainsi qu'on pourrait à la longue , et pour des collections d'hommes prises en masse, produire une espèce d'égalité de moyens qui n'est point dans l'organisation primitive et qui, semblable à l'égalité des droits, serait alors une création des lumières et de la raison perfectionnée[Ta 5]. »
Ce qui inspire à Bacon autant d'audace conceptuelle, c'est une nouvelle approche du temps. « La Vérité est la fille du temps et non de l'Autorité » écrit-il dans le Novum Organum. Selon Taguieff, « le temps n'est plus pour lui, comme chez les anciens, ni un néant ni un principe de corruption des choses, il devient une promesse de nouveauté utile, de vérité et de bonheur »[Ta 6]. De fait, dans son essai sur les « innovations », Bacon considère que le temps est « le plus grand des novateurs » et, selon lui, seule cette nouvelle conception du temps peut mettre fin aux « sortilèges » qui, jusqu'ici, ont « paralysé le génie des hommes » en les empêchant de « se familiariser avec les choses elles-mêmes », c'est-à-dire de se fonder sur l'expérience (experientia) et l'expérimentation (experimentum : l'expérience recherchée)[Ta 6].
Les penseurs des Lumières reconnaîtront Bacon comme un véritable pionnier. Ainsi d'Alembert, qui le décrit en 1751 comme « le plus grand, le plus universel, le plus éloquent des philosophes »[74].
Descartes et la méthode
En France, René Descartes joue également un rôle déterminant dans l'histoire de l'idée de progrès, notamment en 1637 avec la publication de son célèbre Discours de la méthode, sous-titré « Pour bien conduire sa raison, et chercher la vérité dans les sciences », qui constitue un plaidoyer pour une nouvelle fondation des sciences, sur des bases empiriques et non plus spéculatives, comme au temps de la scolastique médiévale.
Comme Bacon, Descartes insiste sur la nécessité de promouvoir les sciences, d'en faire reconnaître la « dignité » en en faisant connaître les résultats et en en montrant les applications socialement utiles. Taguieff fait remarquer que « l'espace visé reste toutefois dans les limites de la communauté des pairs, augmentée des représentants de l'honnête homme (mais que) la question de la communication et de la publication des recherches est expressément posée dans la sixième et dernière partie du Discours de la méthode et (que ceci) dérive de la volonté de Descartes d'améliorer les conditions matérielles de l'existence humaine »[Ta 7].
Une petite phrase du Discours offre une approche du « progrès » aux accents prométhéens : « nous pourrions (...) nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature ». Le philosophe se fait alors le promoteur du « progrès technique » avant la lettre. Ce qu'il présuppose en effet, c'est qu'il n'y a pas de différence fondamentale entre les corps naturels et les constructions artificielles, dues aux « divers métiers de nos artisans » : il n'existe pas de différence entre les machines que font les artisans et les divers corps que seule la nature compose »[Sp 15].
L'expression ne doit toutefois pas induire en erreur sur les intentions de Descartes : celui-ci ne revendique pas la moindre volonté de puissance, sans quoi il aurait été immanquablement repris par l'Église ; le mot « comme » vise précisément à dissiper toute ambiguïté. À l'inverse, le philosophe se réclame de la sagesse : « Par sagesse, précise-t-il, on n'entend pas seulement la prudence dans les affaires mais une parfaite connaissance de toutes les choses que l'homme peut savoir, tant pour la conduite de sa vie que pour la conservation de sa santé et l'invention de tous les arts »[Ta 8]. Taguieff insiste sur le fait que le savoir prôné par Descartes est d'abord un savoir utile et que son acquisition vise ni plus ni moins un « retour à l’Éden par les effets conjugués de la science et des arts mécaniques »[Ta 7].
Comme Bacon, donc, Descartes développe un idéal du progrès calqué sur une conception du monde eudémoniste.
Hobbes et l'État
En 1651 parait un essai de Thomas Hobbes qui va rendre célèbre son auteur : Léviathan. Tirant son titre d'un monstre biblique, et traitant de la formation de l'État et de la souveraineté, l'ouvrage sera plus tard considéré comme un chef-d'œuvre de philosophie politique. Le philosophe met l'accent sur la précision des termes et la rigueur du raisonnement afin de construire, par une démarche déductive inspirée de la géométrie, une théorie scientifique des lois morales et de l'organisation politique.
Au lieu de partir d'une vérité révélée, Hobbes base sa théorie sur sa conception de la nature humaine : « La politique de Hobbes […] est une théorie de la relation entre pouvoir et sujets fondée sur la nature humaine[75] ». Il rejette les prétentions du pouvoir ecclésiastique ou spirituel à régenter le pouvoir temporel et le « droit auquel prétend telle ou telle église de s'arroger la puissance civile »[76].
Il est ainsi, selon Leo Strauss, le premier à préconiser qu'une « société athée ou a-religieuse constitue la solution au problème social ou politique »[77].
Spinoza et le libre examen
L'un des héritiers du cartésianisme, Baruch Spinoza, contribue à démarquer plus radicalement encore le rationalisme du phénomène religieux au point de se faire excommunier et d'être rejeté par la communauté juive. Écrit entre 1665 et 1670 et laissé inachevé, son Traité de la réforme de l'entendement peut être considéré comme un progrès dans la mesure où il inaugure la théorie de la connaissance moderne[réf. nécessaire]. Par ailleurs, son Traité théologico-politique, publié en 1670 sans nom d'auteur et avec une fausse adresse d'éditeur, par crainte de poursuites politiques et religieuses, constitue un véritable éloge de la tolérance et de la liberté. Selon le philosophe, c'est à partir de la raison et pour elle que se pose la question des limites du pouvoir des théologiens et du pouvoir de l'État.
En s'attachant à théoriser la liberté de philosopher dans la Cité, le rejet de l'argument d'autorité et l'exercice du libre examen, Spinoza prépare le terrain des Lumières. Il peine encore toutefois à distinguer les prérogatives de la politique et celles de la religion. Ainsi, quand dans son Éthique (qu'il rédige entre 1661 et 1675 mais qui n'est publiée qu'après sa mort, en 1677), il prône la connaissance en tant que vertu, c'est encore dans le registre d'une quête de salut[78].
Naissance de « la modernité »
Au milieu du siècle, Blaise Pascal fonde le principe d'un homme universel, universel du fait même qu'il progresse. En 1644, il écrit :
« Non seulement chacun des hommes s'avance de jour en jour dans les sciences mais (...) tous les hommes ensemble y font un continuel progrès à mesure que l'univers vieillit, parce que la même chose arrive dans la succession des hommes que dans les âges différents d'un particulier[Sp 16]. »
À la fin du siècle, en Angleterre et en France, l'idée de progrès ne s'installe vraiment que par opposition à celle de conservatisme[79].
C'est ainsi qu'en 1687 en France, dans le domaine circonscrit de la littérature et de sa critique, la Querelle des Anciens et des Modernes oppose les défenseurs des auteurs antiques, menés par Boileau, et ceux qui, derrière Charles Perrault, pensent au contraire que l'époque peut et doit amener des « perfectionnements ». Inspiré par la Recherche de la Vérité de Malebranche (1674), qui fustige l'adoration pour l'Antiquité, posture qui gouverne à l'époque les arts et les lettres, Fontenelle prend position pour les seconds dès l'année suivante. Il développe alors l'idée de perfectibilité, jetant ainsi les bases d'une vision ouvertement optimiste du progrès : inéluctable, général, universel et linéaire :
« Un bon esprit cultivé est, pour ainsi dire, composé de tous les esprits des siècles précédents ; ce n'est qu'un même esprit qui s'est cultivé pendant tout ce temps là.(...) Les hommes ne dégénéreront jamais et (...) les vues saines de tous les bons esprits qui se succèderont s'ajouteront toujours les unes aux autres[80]. »
Il décrit le processus de perfectionnement comme cumulatif et a priori dénué de fin déterminable. Sans ambiguïté, sa conclusion prend presque la valeur d'un dogme :
« Rien n'arrête tant le progrès des choses, rien ne borne tant les esprits, que l'admiration excessive des Anciens[81]. »
Selon l'essayiste Frédéric Rouvillois, c'est durant les années 1680, avec cette Querelle des Anciens et des Modernes, que la question du rapport au temps devient centrale et décisive chez les intellectuels et qu'émerge alors véritablement le concept de progrès : on passe selon lui de l'idée d’un « monde traditionnel cyclique » à celle « d’un perfectionnement perpétuel »[82],[n 5].
De fait, l'année 1687 est marquée par un événement attestant une rupture radicale avec le passé : la publication des Philosophiae naturalis principia mathematica (« Principes mathématiques de la philosophie naturelle ») d'Isaac Newton, un esprit polymathe puisqu'à la fois philosophe, mathématicien, physicien, astronome et théologien. Si l'on ne s'en tient qu'à l'impact qu'il a exercé sur sa postérité, l'ouvrage est l'un des plus importants livres scientifiques jamais édités. Le livre III présente le système de la gravitation universelle ainsi que des « Règles de philosophie », expliquant la méthode de Newton.
Outre Manche, le concept de modernité s'exprime explicitement, appliqué non pas à l'évolution de la littérature, comme en France, mais à celle des individus. En 1689, dans son Essai sur l'entendement humain, John Locke reprend en détail une thèse déjà amorcée (notamment par Bacon et Descartes) qui assimile la conscience, à ses débuts, à une table rase et qui se remplit ensuite au fur et à mesure de l’expérience. L'ouvrage constituera l’un des principaux fondements de l’empirisme et de la philosophie moderne.
Premier dictionnaire critique

Peu avant que n'éclate la fameuse Querelle des Anciens et des Modernes, l'écrivain Pierre Bayle a choisi son camp, celui de la modernité. L'intolérance des catholiques envers les protestants l'indigne profondément et en même temps l'inspire. En 1684, il crée un périodique de critique littéraire, historique, philosophique et théologique, les Nouvelles de la république des lettres, qui rencontre un rapide succès dans toute l’Europe. Entrant alors en relation avec les principaux savants de son temps, il rend compte de leurs travaux de façon accessible, ceci d'autant plus que le langage de la littérature et celui de « la science » sont encore très proches[83].
En 1697, il publie son Dictionnaire historique et critique, un ouvrage aujourd'hui réputé pour préfigurer la grande Encyclopédie de Diderot et d'Alembert, dont le premier volume paraîtra cinquante ans plus tard. De cette œuvre, composée d’articles emboîtés les uns dans les autres, de nombreuses notes et citations, se dégage nettement l'idée que le monde ne se réduit pas à une vision manichéenne et suppose le croisement permanent d'opinions contradictoires. L'objectivité semble non seulement possible si on respecte quelques principes de base mais elle apparaît clairement ici comme le fondement d'une éthique nouvelle : à aucun moment, on ne cherche à asséner « une » ou « la » vérité. Le doute, le risque d'erreur et l'amendement font partie intégrante de la connaissance et de sa diffusion.
La tolérance apparaît alors clairement comme le principe souverain qui conduira les philosophes des Lumières dans leur conception du progrès.
XVIIIe siècle
Les multiples découvertes scientifiques ont provoqué un tel virage dans l'histoire des idées que la formule « révolution scientifique » est souvent accolée au XVIIe siècle[84]. Certains critiques estiment pourtant que cette appellation est exagérée[85]. De fait, si Descartes pose bien l'hypothèse que l'univers est organisé selon des principes mathématiques, selon lui, Dieu en reste encore l'ordonnateur. Ses conceptions demeurent donc fortement teintées de métaphysique.
Au fil du nouveau siècle, cette dimension métaphysique ne va cesser de s'estomper au profit d'une conception du monde mécaniste, donc matérialiste et immanentiste : les phénomènes de l'existence sont analysés suivant le modèle des liens de cause à effet. Ce qui stimule et structure cette nouvelle conception du monde, c'est l'application des sciences dans la vie concrète de tous les jours.
- Durant la première moitié du siècle, plusieurs idées émergent ou se consolident (l'expérience, la liberté, le bonheur...) qui, peu à peu, sont aussi érigées en valeurs et qui seront ultérieurement considérées comme « les valeurs du progrès »[86].
- À partir de la seconde moitié du siècle, ces valeurs se déclinent en grands principes politiques (égalitarisme, contractualisme, parlementarisme...). C'est alors que « le progrès » devient à la fois un concept à part entière et, en raison du processus d'industrialisation en cours dans toute l'Europe, une réalité patente.
Ce sont tout à la fois ces valeurs, ces principes politiques et ce mouvement d'anthropisation et d'artificialisation des villes et des campagnes qui serviront de socle à l'idéologie du progrès durant le siècle suivant.
Valeurs du progrès
Mettant fin au paradigme cartésien, auquel se référait toute la société intellectuelle européenne, plusieurs concepts émergent ou se renforcent durant la première moitié du siècle et sont vécus comme des valeurs[réf. souhaitée]. Et durant la seconde moitié, lorsque ces valeurs seront implantées dans les mentalités et agrégées les unes aux autres de façon à former un système de pensée, l'idée de progrès deviendra elle-même une valeur à part entière et un sujet de débat[réf. souhaitée].
On peut retenir sept valeurs fondatrices et composantes de l'idéologie du progrès.
- L'expérience
Contrairement aux Français (Descartes en particulier) qui estiment que le renouvellement des idées par la raison permet de transformer le monde (rationalisme), les philosophes anglais et écossais, à la suite de Bacon et de Locke et influencés par les théories de Newton, considèrent que l'expérience façonne les idées et permet de structurer celles-ci en théories, lesquelles constituent elles-mêmes le corpus de la science (empirisme).
George Berkeley (Principes de la connaissance humaine, 1710) et surtout David Hume (Traité de la nature humaine, 1739-1740 ; Enquête sur l'entendement humain, 1748) poursuivent et approfondissent les investigations de Locke. S'opposant radicalement à Descartes et aux philosophies considérant l'esprit humain d'un point de vue théologico-métaphysique, leur conception du monde ouvre la voie à l'application de la méthode expérimentale non plus seulement aux phénomènes physiques mais aussi aux phénomènes mentaux. Le processus de la connaissance va lui-même peu à peu devenir un objet d'études.
C'est finalement l'empirisme et non le rationalisme qui sert de ferment à l'idée de progrès. De 1726 à 1728, soit avant même que Hume ne développe ses idées, le Français Voltaire séjourne en Angleterre. Marqué par l'esprit de liberté intellectuelle et de tolérance de la bourgeoisie anglaise, il consigne un peu plus tard ses impressions dans les Lettres philosophiques), vingt-cinq lettres ouvertes dont l'originalité et la force sont de traiter conjointement des sujets a priori (à l'époque) sans lien : religion, sciences, arts, politique, philosophie. Voltaire voit dans l'Angleterre une « terre de liberté » dans la mesure où les comportements, selon lui, n'y sont pas dictés par des impératifs religieux ou moraux mais précisément par l'ouverture à l'expérience.
- La diffusion de la connaissance
Les découvertes et les inventions se multipliant, la nécessité de les inventorier et de les classer s'impose. Les traités, dictionnaires et plus tard les encyclopédies fleurissent. La diffusion du savoir devient un élément majeur et structurant de l'idéologie du progrès car, au-delà des savoirs que ces ouvrages compilent, les finalités qu'ils visent en font une arme politique confrontant les rédacteurs et les éditeurs (pour qui ils constituent des instruments de propagande) au pouvoir séculier et au pouvoir ecclésiastique, dont les sphères d'influence s'en trouvent amoindries.
Les auteurs de ces ouvrages sont pleinement conscients des enjeux qu'ils soulèvent. Ainsi, en 1751, dans le Discours préliminaire de l'Encyclopédie, d'Alembert explique les motivations de l'équipe des encyclopédistes en critiquant sévèrement les abus de l'Église dans la condamnation de Galilée en 1633 : « Un tribunal (...) condamna un célèbre astronome pour avoir soutenu le mouvement de la terre, et le déclara hérétique (...). C'est ainsi que l'abus de l'autorité spirituelle réunie à la temporelle forçait la raison au silence ; et peu s'en fallut qu'on ne défendit au genre humain de penser[87]. »
- L'immanence
Le siècle constitue la période au cours de laquelle ce qui relève de la science est sans cesse davantage séparé de ce qui relève de la religion. La raison, en tant que fondement de la connaissance, est fréquemment qualifiée de « lumière naturelle » et un grand nombre de philosophes expriment alors le concept de religion naturelle, déjà esquissé dans l'antiquité par Cicéron, en opposition à celui de « religion révélée », dans la perspective de substituer une morale universelle au judaïsme et au christianisme, jugés trop dogmatiques.
L'idée d'un dieu créateur n'est pas écartée, mais est associée à l'image d'un « Être suprême », d'un « Grand horloger » ou d'un « Grand Architecte de l’Univers » (Leibniz emprunte cette formule à Calvin). Selon cette conception déiste, « l'expérience », célébrée par les philosophes empiristes se substitue à la foi : on considère que certaines caractéristiques de Dieu peuvent être comprises par la raison. Tout ce qui était projeté autrefois dans l'au-delà, et donc considéré comme transcendant, est reporté dans le monde ici-bas, celui de l'immanence.
Alors que certains philosophes, comme Diderot (Lettre sur les aveugles à l'usage de ceux qui voient, 1749) ou d'Holbach (Le Christianisme dévoilé, 1766) se déclarent ouvertement athées, Voltaire, en 1772, écrit ces mots : « L’univers m’embarrasse, et je ne puis songer que cette horloge existe et n’ait point d’horloger[88]. »
- La liberté
Dès lors qu'ils ne s'inscrivent plus dans une relation avec un dieu ni une quelconque forme de transcendance, les humains exercent leur libre examen. Vécue comme une autonomie totale dans le jugement, la liberté constitue le principal fondement de la philosophie des Lumières.
En 1784, à la question Qu'est-ce que les Lumières ?, Kant répond :
« Les Lumières, c’est la sortie de l’homme hors de l’état de tutelle dont il est lui-même responsable. L’état de tutelle est l’incapacité de se servir de son entendement sans la conduite d’un autre. On est soi-même responsable de cet état de tutelle quand la cause tient non pas à une insuffisance de l’entendement mais à une insuffisance de la résolution et du courage de s’en servir sans la conduite d’un autre. Sapere aude ! Aie le courage de te servir de ton propre entendement ! Telle est la devise des Lumières »[89]. »
Même si, dans ses écrits, Kant ne parle jamais explicitement de « progrès », l'idée de progrès est omniprésente chez lui mais il faut l'entendre alors comme un progrès moral et c'est précisément l'appétit de liberté qui en constitue la charpente[90]. Ainsi que l'explique le philosophe Michel Lacroix, l'approche kantienne de la liberté (donc sa conception du progrès moral) relève d'une véritable théodicée :
« Selon Kant, ce sont les mauvais penchants qui font progresser l'humanité. Ils sont le combustible du progrès car, sans l'orgueil, sans la cupidité, sans l'esprit de rivalité et de domination, les individus n'auraient aucun motif d'agir, de se surpasser, de créer quoi que ce soit, et « toutes les dispositions naturelles de l'homme seraient étouffées dans un éternel sommeil ». Ainsi, dans la philosophie kantienne de l'histoire, le mal joue un rôle positif. Loin d'être un obstacle à la marche en avant de l'humanité, il est l'aiguillon du progrès et il remplit ce rôle en se transformant continuellement en son contraire[91]. »
À la fin du siècle, Wilhelm von Humboldt, dans son Essai sur les limites de l'action de l'État (1792), estime que la liberté qui a été conquise sur les autorités religieuses ne doit pas davantage être cédée à l'État. Son analyse sera développée en Angleterre au siècle suivant (notamment par John Stuart Mill, De la liberté, en 1859), donnant naissance à la pensée libérale, tant dans le champ de la politique que celui de l'économie.
Au XXe siècle, le philosophe Isaiah Berlin estimera que, contrairement à l'idée répandue, les philosophes des Lumières tels que Kant et Rousseau sont des « adversaires de la liberté » car ils défendent une conception autoritaire (qu'il appelle « liberté négative ») dont la Révolution française sera l'héritière et qui s'oppose à la conception anglo-saxonne du libéralisme (qui, selon lui, relève de la « positive »).
- Le bonheur
Toujours consécutivement à la rupture avec l'idée d'un dieu transcendant, l'idée du salut de l'âme disparaît également. Et c'est alors l'idée de bonheur qui la remplace. Le bonheur, compris comme une optimisation incessante du « bien-être matériel » devient le but suprême de l'existence[92],[93].
Dès le début du siècle, en 1714, Leibniz écrit : « Notre bonheur ne consistera jamais et ne doit point consister dans une pleine jouissance, où il n'y aurait plus rien à désirer et qui rendrait notre esprit stupide, mais dans un progrès perpétuel à de nouveaux plaisirs et de nouvelles perfections »[Ta 9].
De nombreux philosophes traiteront du sujet (Montesquieu, l'Abbé Prévost, Voltaire...) et tout particulièrement Diderot, selon qui, en 1778, « il n'y a qu'un devoir, c'est d'être heureux »[94] et pour qui également le bonheur doit être compris comme l'articulation du bonheur individuel et du bonheur collectif, comme « la base fondamentale du catéchisme civil » :
« En politique, le bonheur doit être le lieu de jonction des devoirs d'un individu, libre par nature, et des règles du législateur qui lui assurent ses droits correspondants : puisque ma pente naturelle, invincible, inaliénable, est d'être heureux, c'est la source et la source unique de mes vrais devoirs, et la seule base de toute bonne législation. La loi qui prescrit à l'homme une chose contraire à son bonheur est une fausse loi, et il est impossible qu'elle dure [...]. Aucune idée ne nous affecte plus fortement que celle de notre bonheur. Je désirerais donc que la notion de bonheur fût la base fondamentale du catéchisme civil. Que fait le prêtre dans sa leçon ? Il rapporte tout au bonheur à venir. Que doit faire le souverain dans la sienne ? Tout rapporter au bonheur présent[95]. »
« Le bonheur est une idée neuve en Europe »... Par cette formule restée célèbre, le révolutionnaire Saint-Just résumera lui-même à la fin du siècle l'importance de l'idée de bonheur dans la philosophie des Lumières[96].
- Le travail
Autre conséquence de la rupture avec l'idée d'un dieu transcendant, le monde ici-bas non seulement n'est plus considéré comme quelque chose de méprisable (comme le laissait supposer le récit biblique de la Chute) mais comme devant être « travaillé ». La bourgeoisie érige le travail en valeur et les philosophes en font maintes fois l'éloge :
- « Le travail éloigne de nous trois grands maux, l’ennui, le vice et le besoin » (Voltaire, Candide, 1759) ;
- « Forcez les hommes au travail, vous les rendrez honnêtes gens » (Voltaire, Commentaire sur le livre des délits et des peines, 1766) ;
- « Le travail, entre autres avantages, a celui de raccourcir les journées et d'étendre la vie » (Diderot, Essai sur les règnes de Claude et de Néron, 1778).
Jacques Ellul estime que l'idéologie du travail découle directement de l'idéologie du bonheur : dès lors que le bonheur est vécu comme une promesse, une sorte de paradis sur terre, l'équivalent de ce qu'était autrefois le salut de l'âme, l'effort pour accéder au bien-être matériel devient l'équivalent de la conduite vertueuse sous la chrétienté ; il est le prix à payer pour accéder au bonheur et ne peut être qu'érigé en valeur[97] et devenir lui-même une idéologie à part entière[98].
- L'histoire
Dès lors qu'ils procèdent de façon empirique et s'assignent le bonheur comme objectif, les humains dirigent eux-mêmes le cours de leur existence ; c'en est alors fini du destin et de la providence divine, c'est désormais sous l'égide de l' histoire qu'ils évoluent (en écrivant le droit, ils écrivent l'histoire).
En 1750, Turgot, futur secrétaire d'État de Louis XVI, prononce un discours sur « les progrès successifs de l'esprit humain » et, l'année suivante, il écrit ces mots :
« L'histoire universelle embrasse la considération des progrès successifs du genre humain et le détail des causes qui y ont contribué[Sp 17]. »
Taguieff souligne que Turgot n'a d'autre ambition que de mettre un terme définitif à la conception de l'histoire qui prévalait encore à l'époque, axée sur le concept biblique de providence divine[Ta 10], dont Bossuet s'était fait champion dans son Discours sur l'histoire universelle (1681).
Quelques années plus tard, en 1765, Voltaire s'inscrit dans la même lignée. Très influencé par l'Italien Vico, il introduit en 1765 le concept de « philosophie de l'histoire », qui accompagnera par la suite la conception moderne de l'histoire.
- L'universalité et la démocratie
Les philosophes des Lumières reprennent à l'Église la prétention à la vocation universelle[n 6] : ils défendent l'idée selon laquelle les humains, étant supérieurs à toutes les autres créatures du fait qu'ils disposent de la raison et de la parole, peuvent s'organiser entre eux et s'accorder autour des nouvelles valeurs, en recherchant systématiquement le consentement de tous. Selon cette conception, les individus sont compris comme des éléments interactifs du tout qu'est la société (en ce sens, l'universalisme s'oppose à l'individualisme, qui considère les individus indépendamment les uns des autres[99]).
Signée en 1789, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est considérée comme l'acte fondateur de l'approche universaliste moderne, le symbole de référence du « progrès social »[100] et le prototype de la Déclaration universelle des droits de l'homme, au XXe siècle.
Élément clé de l'idéal progressiste[101], l'universalisme des Lumières sera plus tard analysé comme l'un des principaux fondements de l'ethnocentrisme européen moderne, justifiant toutes sortes de dominations, à commencer par le colonialisme[102].
Grands principes politiques
À ces valeurs « modernes » viennent se greffer quatre grands principes politiques.
- L'égalité devant la loi
Voltaire et Rousseau développent des conceptions différentes de l'égalité[103].
En 1738, dans De l’égalité des conditions, Voltaire estime que la véritable égalité se définit comme « le droit égal au bonheur ».
En 1755, dans son Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, Jean-Jacques Rousseau sépare « l'état de nature » et « l'état de droit ». Selon lui, une société ne peut progresser qu'en veillant à ce que les inégalités naturelles entre les individus soient compensées par des dispositifs juridiques. Or, affirme t-il, le principe de la propriété privée s'inscrit à l'encontre de cet idéal, il constitue à lui seul la source de toutes les inégalités. Et il s'étonne que ce principe ne soit pas collectivement contesté : « Le premier qui, ayant enclos un terrain, s'avisa de dire "Ceci est à moi", et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. »
L'idéal égalitariste de Rousseau influencera considérablement les révolutionnaires français, en 1789.
- Le droit constitutionnel
Dès lors que la liberté et l'égalité en droit constituent les objectifs premiers des Lumières, les philosophes concentrent leurs réflexions sur les modalités - les lois - à mettre en œuvre, développant ainsi le débat sur le contractualisme. À la suite de Hobbes et de Locke[104], au siècle précédent, Montesquieu est le principal à s'y employer.
En 1748, dans De l'esprit des lois, ouvrage qui connaîtra un grand retentissement dans la sphère intellectuelle, il s'attache à faire une analyse comparée de trois différents types de gouvernements : la république, la monarchie et le despotisme. Il se montre ouvert à tous les régimes : « le gouvernement le plus conforme à la nature est celui qui se rapporte le mieux à la disposition du peuple pour lequel il est établi ». Selon lui, donc, la diversité des peuples entraîne une grande diversité de lois, et par contrecoup un grand nombre de régimes politiques différents : il n’existe pas un régime politique qui serait universellement valable : « les lois doivent être tellement propres au peuple pour lequel elles sont faites, que c’est un très grand hasard si celles d’une nation peuvent convenir à une autre. » Elles sont définies comme « des rapports nécessaires dérivant de la nature des choses ». Toutefois, dans le Livre XI, Montesquieu ne cache pas sa sympathie pour le système parlementaire anglais. Ce qu'il en retire essentiellement est la célèbre théorie de la séparation des pouvoirs. La visée est d'empêcher qu'une seule personne (ou un groupe restreint de personnes) exerce tous les pouvoirs : « c'est une expérience éternelle, que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser ; il va jusqu'à ce qu'il trouve des limites[105] ».
- Le parlementarisme
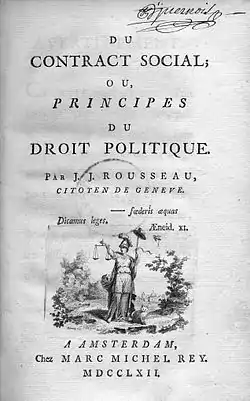
Durant les années 1760, les considérations théoriques sur le droit, du type de celles de Montesquieu, débouchent sur une volonté de transformer la société. Notamment en France où, en comparaison du système parlementaire qui a cours en Angleterre, le système de la monarchie absolue fait figure, aux philosophes des Lumières, de système archaïque. Et c'est Jean-Jacques Rousseau qui, le premier, va incarner cette volonté de changement.
Contrairement à d'autres grands philosophes de son temps, ce n'est pas de l'Angleterre qu'il tire son inspiration mais de la République de Venise, où il séjourne en 1743-1744. En 1755, il exprime son intérêt pour la politique dans l’article « Économie Politique » de l'Encyclopédie (« Il est certain que les peuples sont, à la longue, ce que le gouvernement les fait être ») et surtout dans son Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, dans lequel il expose notamment sa conception de la perfectibilité humaine.
Et c'est en 1762 qu'est publié Du contrat social qui, encore aujourd'hui, est considéré comme l'un des textes majeurs de la philosophie politique. L'idée maîtresse en est le principe de « souveraineté du peuple » (autrement dit de démocratie), appuyé sur les notions de liberté, d'égalité, et de volonté générale.
Les théories de Rousseau influenceront profondément les révolutionnaires français, en 1789. Et au-delà, ils conduiront à ériger le principe même de révolution comme fondement et aboutissement du progrès social.
- L'économie de marché
Dès lors que le travail est collectivement vécu comme une valeur, s'impose la nécessité de théoriser la « chose économique ».
Dans les années 1750 en France, les physiocrates sont les premiers à faire de l'économie une science à part entière. La plupart viennent du Parti philosophique et ont collaboré à l'Encyclopédie, ils s'inscrivent donc pleinement dans l'esprit des Lumières. Mirabeau et Turgot sont les plus connus d'entre eux et François Quesnay, auteur du Tableau économique en 1758, en est le chef de file. Leur originalité est de considérer que la richesse d'un pays repose non pas tant sur celle de l'État que sur celle de ses habitants (elle constitue le produit de leur travail) c'est pourquoi ils préconisent que l'État se mette en retrait. En popularisant une petite phrase, « Laissez faire les hommes, laissez passer les marchandises », Vincent de Gournay inscrit les physiocrates comme les premiers partisans du libre-échange et les précurseurs du libéralisme économique.
Mais à leur époque l'économie européenne est en grande partie agricole. Les choses changent quand elle s'industrialise à un rythme sans cesse croissant. C'est donc en Grande-Bretagne (qui est alors la première puissance mondiale), que le développement économique va être vécu comme l'élément moteur du « progrès ». En 1776, l'écossais Adam Smith, qui est à l'origine un philosophe moraliste (Théorie des sentiments moraux, 1759) publie les Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, considéré depuis comme le credo du libéralisme, au sens où celui-ci, qui n'avait qu'une portée d'ordre philosophique et politique, prend un sens économique et où cette seconde acception va alimenter considérablement l'idéologie du progrès[réf. nécessaire].
Mécanisation et division du travail
Durant la seconde moitié du siècle, s'amorce en Grande-Bretagne un double processus qui va transformer profondément les mentalités : la mécanisation et la division du travail. Et c'est précisément parce que ce phénomène va être collectivement vécu comme étant irréversible que le terme « progrès » va prendre de l'ascendant et qu'à inverse le mot « regrès » va s'effacer.
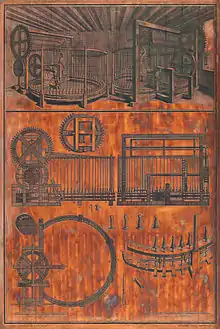
Cette métamorphose s'opère dans les villes (qui se peuplent au détriment des campagnes), principalement dans le monde du travail, du fait que la production des biens devient massive. Elle s'est amorcée dès le siècle précédent avec les manufactures mais s'est accentuée au début du XVIIIe : la fabrication prend la forme de tâches parcellaires, exécutées de façon mécanique par des individus peu qualifiés - comme le feront plus tard des robots - ceci afin d'accroître la productivité et les gains y afférant. Le Hollandais Bernard Mandeville a été le premier à faire l'éloge de la division du travail (l'expression est d'ailleurs de lui) dans sa Fable des abeilles, éditée en 1714 et complétée en 1729. En 1740, l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert décrit la fabrication de l'aiguille à coudre en Normandie, selon son principe (article Description des Arts et Métiers)
Mais en 1750, dans son Discours sur les sciences et les arts, Jean-Jacques Rousseau pose la question de la limite de la division et de la mécanisation du travail :
« Les arts ne se perfectionnent qu'en se subdivisant et en multipliant à l'infini les techniques : à quoi cela sert-il d'être un être sensible et raisonnable, c'est une machine qui en mène une autre. »
Et il approfondit sa réflexion cinq ans plus tard dans son Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, un essai philosophique d'une centaine de pages qui compte parmi les ouvrages fondamentaux de la pensée politique de l'époque. Le livre est original en ce qu'il oppose frontalement les notions de progrès technique et de progrès social. Contestant vigoureusement les théories de Hobbes et Locke, Rousseau considère que, laissée à elle-même, l'économie ne peut conduire qu'à un renforcement des inégalités sociales. Sa position reste toutefois marginale. Dès la publication du Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité, Voltaire voit en celui-ci un livre « contre le genre humain ».
Le principe de la division du travail, en revanche, sera vanté par les premiers théoriciens du libéralisme économique, les Anglais Adam Smith (en 1776) et David Hume, selon qui elle est « l'un des moteurs de la constitution de la société ».
Un concept discuté
C'est dans ce contexte d'industrialisation naissante que le terme « progrès » commence à irriguer les débats.
Deux ans après le discours de Turgot sur « les progrès successifs de l'esprit humain », en 1750, Maupertuis publie une Lettre sur le progrès des sciences dans laquelle il exprime le souhait que les Européens reconnaissent les découvertes scientifiques des autres civilisations :
« Nous ne pouvons guère douter que plusieurs nations des plus éloignées n’aient bien des connaissances qui nous seraient utiles. Quand on considère cette longue suite de siècles pendant lesquels les Chinois, les Indiens, les Égyptiens ont cultivé les Sciences, et les ouvrages qui nous viennent de leur pays, on ne peut s’empêcher de regretter qu’il n’y ait pas plus de communication entre eux et nous. Un Collège où l’on trouverait rassemblés des hommes de ces nations, bien instruits dans les Sciences de leur pays, qu’on instruirait dans la Langue du nôtre, serait sans doute un bel établissement et ne serait pas fort difficile. »
En 1756, dans l'Essai sur la manière de perfectionner l’espèce humaine, le médecin Charles-Augustin Vandermonde théorise l'hygiénisme et l'eugénisme, préfigurant une thèse qui se développera deux siècles et demi plus tard avec les thèses transhumanistes : utiliser le progrès technique afin de modifier la nature même de l'être humain.
L'année suivante, dans son Traité sur la population, Mirabeau définit le progrès comme le « mouvement en avant de la civilisation vers un état de plus en plus florissant ».
D'autres écrits suivront, dont l''Histoire des progrès de l’esprit humain dans les sciences exactes et les arts qui en dépendent de Savérien, en 1766, où l'auteur dresse tout un inventaire des innovations et découvertes et où sont abordées successivement « l'arithmétique, l'algèbre, la géométrie, l'astronomie, la gnomonique, la chronologie, la navigation, l'optique, la méchanique, l'hydraulique, l'acoustique et la musique, la géographie, l'architecture civile, l'architecture militaire, l'architecture navale ».
Aucun des deux grands ouvrages de référence de l'époque - l'Encyclopédie, supervisée par Diderot et d'Alembert de 1751 à 1772, et le Dictionnaire philosophique de Voltaire, en 1764 - ne donnent une définition précise du mot « progrès » mais plusieurs articles y font plus ou moins explicitement référence.
Alors que l'apologétique progressiste se développe, une critique s'ébauche en France en la personne de Jean-Jacques Rousseau[106]. Dans son Discours sur les sciences et les arts, en 1750, il avance l'idée que tout progrès aboutit à la corruption des mœurs d'une société. Puis, cinq ans plus tard, dans son Discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes, il considère que les écarts de richesse entre les hommes naissent et s'accroissent du fait de leur éloignement « progressif » de l'état de nature. C'est ainsi, estime t-il, qu'ils en viennent à défendre la propriété privée[107]. Dans le même ouvrage, Rousseau indique comment il serait selon lui possible d'échapper à cet écueil. Introduisant le terme « perfectibilité » (qu'il définit comme « la faculté de se perfectionner » soi-même), il pense que c'est par cette faculté que les hommes pourraient sortir de leur « état primitif », de leur « condition originaire », et ainsi s'améliorer. Ce que Rousseau critique dans l'engouement de ses contemporains à vouloir transformer le monde, c'est le fait de ressentir cette volonté comme absolument nécessaire sans veiller, dans le même temps, à se transformer eux-mêmes, intérieurement[108].
Les éloges du progrès se raréfient durant l'épisode de la Révolution française, comme si la guillotine était un désaveu de l'idéal de tolérance professé par les philosophes des Lumières[109]. Et c'est alors qu'il se cachait sous la Terreur, en 1793, que Condorcet rédige son Esquisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit humain. De mémoire, il résume la plus grande partie du savoir de son temps et se projette dans un avenir qu'il imagine éclairé par la raison, l'éducation, les connaissances, les découvertes scientifiques et techniques.
Selon Condorcet, estime la philosophe Catherine Kintzler, « un peuple qui ne se propose pas le progrès scientifique et technique, soit parce qu'il lui est hostile, soit parce qu'il en néglige l'importance, soit parce qu'il ne s'en donne pas les moyens, est nécessairement exposé à régresser et à tomber dans la servitude[110]. »
Bien qu'elle ne cadre pas avec le parcours personnel de Condorcet, sa vision du progrès dominera tout le XIXe siècle.
« Progrès technique » et « intérêt général »
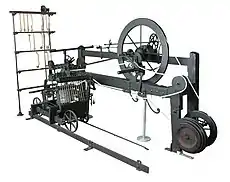
%252C_French_politician.jpg.webp)
La mécanisation et la division du travail (lire supra) s'amplifient dans le dernier quart du siècle, notamment à partir de 1775, quand la machine à vapeur est commercialisée en Grande-Bretagne et que l'usine supplante la manufacture. Le mouvement de l'industrialisation gagne alors la France puis le reste de l'Europe.
Toutefois, on aurait tort de n'expliquer l'évolution des rapports sociaux que par celle des techniques. Celle-ci bénéficie en effet du concours actif et puissant de l'État, qui peut abroger des institutions dépassées, telles les corporations abolies en 1791 au nom de « l'intérêt général » ou en créer de nouvelles, tel le Conservatoire des arts et métiers — aujourd'hui un musée — destiné à former des techniciens et des ingénieurs. Le rôle de l'État dans l'économie, comme les thèmes du libre-échange et du protectionnisme, feront l'objet d'une longue réflexion, toujours en cours. Ainsi, par exemple en 1776, dans ses Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, Adam Smith se montre à la fois libéral et partisan d'un État-gendarme, assurant d'une part des prérogatives régaliennes, d'autre part des fonctions tutélaires.
Plus généralement les libéraux parviennent à imposer l'idée que le travail est une valeur et que la division du travail est non seulement une source d'efficience et de meilleure productivité mais que, pour cette raison, elle constitue un « progrès » pour l'ensemble de l'humanité. Ils se basent sur l'argument qu'elle favorise et stimule les échanges humains, du moins entre les agents économiques qui y ont recours. En définitive, leur argument est l'intérêt général. Ainsi que le résume en 1791 le député Isaac Le Chapelier, à l'origine de la loi supprimant les corporations :
« Il n'y a plus de corporations dans l'État ; il n'y a plus que l'intérêt particulier de chaque individu et l'intérêt général. »[111]
Plus tard, Jacques Ellul assimilera le concept d'intérêt général à un moyen rhétorique utilisé par la classe bourgeoise pour imposer l'idée de progrès, quoi qu'il en coûte aux individus :
« L'intérêt général, c'est le progrès technique ; même s'il n'a rien à voir avec l'intérêt des hommes, même si l'entreprise est extrêmement douteuse, même si on ignore en définitive les résultats de ce que l'on entreprend. Du moment que c'est un progrès technique, c'est l'intérêt général. Ne disons pas surtout : « le progrès technique s'effectue dans l'intérêt général ». Cette formule générale permettrait encore la discussion. Non ! Dans l'esprit de nos contemporains, l'assimilation est entière : le progrès technique quel qu'il soit est en soi l'intérêt général[112] »
XIXe siècle
En 1807 parait la Phénoménologie de l'esprit de l'Allemand Hegel. Celui-ci considère que ce sont les idées qui mènent le monde, façonnent l'histoire, font progresser les hommes. Certes, tout au long de son cours, l'histoire est ponctuée de conflits et de guerres, mais Hegel estime que le progrès de l'histoire n'est pas linéaire mais dialectique (il se réalise par ses contraires). Comme Kant, il voit dans la déraison l'aiguillon du progrès. « Les deux penseurs (...) se rejoignent dans une même foi envers la dialectique du mal et du bien. Ils reconnaissent la valeur fécondante du négatif. Pour tous deux, le progrès repose, en dernière instance, sur un processus de métabolisation du mal en bien »[113].
La théorie hégélienne va toutefois être très vite démentie par les faits : du début jusqu'à la fin, le siècle se caractérise en effet par le façonnage incessant de l'environnement et surtout des villes par toutes sortes de machines ainsi que par la création de multiples réseaux : routiers, ferroviaires[n 7] et fluviaux. Comme l'avancera bientôt Marx, toutes ces infrastructures déterminent et façonnent le monde bien plus qu'aucune « idée » et superstructure. Plus que jamais, « le progrès » se voit et s'éprouve par tout le monde, au travail et dans la vie quotidienne : à un rythme sans aucun précédent dans l'histoire de l'humanité, il est la concrétisation même de l'injonction lancée par Descartes en 1637 : se rendre « comme maîtres et possesseurs de la nature ». Le processus d'industrialisation occupe une telle place dans l'imaginaire collectif qu'il est qualifié de « révolution » dès 1837. Si bien qu'en Europe puis aux États-Unis, « le progrès » devient le vecteur d'une conception du monde ouvertement optimiste, voire euphorique et que la pensée technocritique reste rare et peu entendue.
Certes, durant la seconde moitié du siècle, les conditions d'exploitation des ouvriers dans les usines sont analysées et dénoncées par Marx et le courant socialiste. Mais c'est alors pour promouvoir l'autre forme du progrès, le « progrès social », dont le thème de la révolution constitue le paradigme. Ce que Marx remet en cause, c'est essentiellement le capitalisme, la question de la propriété des moyens de production, très peu les moyens eux-mêmes et leur impact dans l'imaginaire collectif. Le productivisme continue d'être unanimement considéré comme le mode d'accès privilégié au « bonheur » et le confort matériel devient l'horizon suprême de l'ensemble de la société occidentale, toutes classes sociales confondues.
Qui plus est, à la suite de la théorie darwinienne de l'évolution (L'Origine des espèces, 1859), « le progrès » trouve une nouvelle forme de légitimation : il est considéré comme un processus naturel, donc non idéologique.
.jpg.webp)
C'est fort de cette légitimitée et avec le soutien des milieux cléricaux et des populations, donc en toute bonne conscience, qu'à partir des années 1870, les dirigeants des États « modernes » promulguent l'occupation d'un grand nombre de contrées à travers le monde (l'Angleterre victorienne et la Troisième république française s'installant principalement en Afrique et en Asie), vantant « le progrès » et le christianisme tout en pillant les ressources naturelles et en exploitant les peuples[114]. « Le progrès » sert lui-même à légitimer le racisme : « Les races supérieures ont le devoir de civiliser les races inférieures » proclame en 1885 le politicien Jules Ferry.
Même chose outre-Atlantique : partis de la côte est et franchissant le continent jusqu'au Pacifique, les Américains déciment les tribus amérindiennes ou les parquent dans des réserves. Jusqu'en 1865, « le progrès de la civilisation » sert de justification à l'esclavage de populations noires importées d'Afrique.
De l'évolution au progrès
Au tout début du siècle, un naturaliste français va, sans le savoir, contribuer à impulser considérablement le débat sur le progrès : Jean-Baptiste de Lamarck. Dans sa Philosophie zoologique (en) (1809), il développe en détail le concept d'évolution, l'idée que tous les organismes sont les produits d'un long et lent processus naturel de développement, et il associe cette idée à des théories sur l'humanité et ses cultures.
Mais s'il s'avise à considérer le monde animal comme « le miroir de ce qui arrive et doit arriver dans le monde des hommes civilisés »[115], il ne tente pas pour autant d'ériger ce processus en paradigme d'une conception philosophique et morale de l'humanité. D'autres, en revanche, participant du climat scientiste ambiant, franchiront ce pas dans la seconde moitié du siècle, à commencer par l'Anglais Herbert Spencer (lire infra) et, en Allemagne, les premiers représentants du matérialisme scientifique : Vogt, Büchner, Moleschott...
Prosélytes du progrès
Certains intellectuels expriment une véritable « foi dans le progrès ». C'est le cas notamment du philosophe Saint-Simon, auteur en 1825 d'un Nouveau Catéchisme, ouvrage inachevé dans lequel il préconise une société fraternelle, sorte de technocratie, dont les membres les plus compétents (industriels, scientifiques, artistes, intellectuels, ingénieurs…) auraient pour tâche d'administrer le pays le plus utilement possible, afin de le rendre prospère, et où régneraient l'esprit d'entreprise, le sens de l'intérêt général, la liberté et la paix.
Principal disciple de Saint-Simon, Auguste Comte commence en 1822 à formuler sa « loi des trois états », selon laquelle chaque branche des connaissances, que ce soit au niveau individuel ou à l'échelle de l'humanité, progresse, passant par trois états successifs : théologique, métaphysique et positif[Sp 18]. Il reprend cette théorie dans les années 1830[Sp 19] puis à nouveau dans les années 1840[Sp 20]. Partant du principe que les humains ne peuvent subsister que dans un système de relations (la famille, le milieu du travail, la nation...) qu'il désigne sous le mot « ordre », il estime que « le Progrès est le développement de l’Ordre ». Sa « philosophie positive » est si influente que certains l'assimilent à une religion naturelle[116].
Un des plus fervents défenseurs et prosélytes du « progrès » est un politicien socialiste Pierre Leroux, connu en 1851 pour sa « doctrine de la perfectibilité et du progrès continu ». Dans le sillage de Saint Simon et Comte, il confère à l'idée de perfectibilité un sens mystique, « la rédemption du genre humain par la réalisation de plus en plus grande de l’idéal »[117]. Il devient alors un lieu commun que les intellectuels de gauche sont des « progressistes » réalistes quand ceux de droite ne sont que « conservateurs » idéalistes[118].
De fait, en 1853, l'anarchiste Pierre-Joseph Proudhon assimile « le progrès » au mouvement de l'histoire et se défend vigoureusement d'en faire un idéal[119] :
« Ce qui domine dans toutes mes études, ce qui en fait le principe et la fin, le sommet et la base, la raison, en un mot; ce qui donne la clef de toutes mes controverses, de toutes mes disquisitions, de tous mes écarts ; ce qui constitue, enfin, mon originalité comme penseur, si je puis m'en attribuer quelqu'une, c'est que j'affirme résolument, irrévocablement, en tout et partout, le Progrès, et que je nie, non moins résolument, en tout et partout, l’Absolu[Sp 21]. »
Partagé toute sa vie entre sa foi chrétienne et son intérêt pour la philosophie et les sciences, Ernest Renan incarne à lui seul le conflit entre foi et raison. Soucieux de voir émerger dans la société des échanges plus riches sur le plan spirituel, plus désintéressés, il affirme finalement en 1890 :
« Organiser scientifiquement l'humanité, tel est le dernier mot de la science moderne, telle est son audacieuse, mais légitime prétention. Je vais plus loin encore. (...) il est indubitable que la raison (...) après avoir organisé l’humanité, organisera Dieu[120]. »
Premières critiques
Dans ce contexte fébrile, ceux qui se risquent à critiquer cet idéal restent rares et peu entendus. L'écrivain suisse Rodolphe Töpffer est l'un des premiers à s'engager dans cette voie. Dès 1835, il assimile « le progrès » à une idéologie foncièrement bourgeoise et conservatrice :
« Le progrès, la foi au progrès, le fanatisme du progrès, c’est le trait qui caractérise notre époque, qui la rend si magnifique et si pauvre, si grande et si misérable, si merveilleuse et si assommante. Progrès et choléra, choléra et progrès, deux fléaux inconnus aux anciens. […] Le progrès, c’est cette fièvre inquiète, cette soif ardente, ce continuel transport qui travaille la société toute entière, qui ne lui laisse ni trêve, ni repos, ni bonheur. Quel traitement il faut à ce mal, on l’ignore. D’ailleurs, les médecins ne sont pas d’accord : les uns disent que c’est l’état normal, les autres que c’est l’état morbide ; les uns que c’est contagieux, les autres que ce n’est pas contagieux. En attendant, le choléra – le progrès veux-je dire – va son train[Sp 22]. »
En 1843, l'historien Jules Michelet ne critique pas explicitement « le progrès » mais il s’inquiète des effets du « machinisme » (il est à cette occasion le premier à utiliser le terme) : « Le génie mécanique qui a simplifié, agrandi la vie moderne, dans l’ordre matériel, ne s’applique guère aux choses de l’esprit, sans l’affaiblir et l’énerver. De toutes parts je vois des machines qui viennent à notre secours (et) vous font croire que vous savez »[Sp 23]. Cette prise de position inaugure le mouvement technocritique.
En 1851, dans Parerga et Paralipomena, Arthur Schopenhauer écrit ces mots : « Le progrès c’est là votre chimère. Il est le rêve du XIXe siècle comme la résurrection était celui du Xe siècle ; chaque âge a le sien. »
En 1853, Gustave Flaubert est plus sévère encore : « Ô Lumières, Ô Progrès, Ô humanité! (...) Quelle éternelle horloge de bêtises que le cours des âges ! (...) C'est une chose curieuse comme l'humanité, à mesure qu'elle se fait autolâtre, devient stupide[Sp 24]. »
En 1855, le philosophe Eugène Huzar formule la première approche catastrophiste du « progrès »[Sp 25],[121].
Les critiques se feront plus nombreuses à la fin du siècle, émanant parfois d'anciens prosélytes du progrès.
Ainsi, bien qu'ayant toute sa vie fait l'éloge de la science, Ernest Renan n'a jamais renoncé à sa foi chrétienne et cédé au positivisme et au matérialisme de Saint-Simon et Comte. En 1890, soit deux ans avant sa mort, il ne cache pas son scepticisme et ses inquiétudes, estimant que : « la destinée de l'homme est devenue plus obscure que jamais[122] ». Ayant fait part de son pessimisme à son ami, le chimiste et biologiste Marcellin Berthelot (par ailleurs ministre de la IIIe République), celui-ci lui répond qu'il demeure progressiste, comme malgré lui : « Je serai dupe jusqu'au bout de ce désir de progrès que vous reléguez sagement parmi les illusions », écrit-il à Renan[123].
Ancien fervent défenseur du progrès, lui aussi, Charles Renouvier[124] renonce en 1896 à « l'esprit optimiste du XVIIIe siècle »[125] et avancera huit ans plus tard que « la vraie banqueroute est celle du progrès »[126].
Karl Marx
En 1856, Karl Marx se montre beaucoup plus virulent, assimilant le progrès à une forme de décadence, l'aliénation :
« Aujourd’hui, tout paraît porter en soi sa propre contradiction. Nous voyons que des machines, dotées de merveilleuses capacités de raccourcir et de rendre plus fécond le travail humain, provoquent la faim et l’épuisement du travailleur. Les sources de richesse récemment découvertes se transforment, par un étrange maléfice, en sources de privations. (...) La domination de l’homme sur la nature est de plus en plus forte, mais en même temps l’homme se transforme en esclave des autres hommes et de sa propre infamie. Il n’est jusqu’à la lumière limpide de la science qui ne puisse briller que sur le fond ténébreux de l’ignorance. Toutes nos inventions et nos progrès semblent doter de vie intellectuelle les forces matérielles, alors qu’elles réduisent la vie humaine à une force matérielle brute[127]. »
L'année suivante, il écrit :
« Tous les progrès de la civilisation ou, en d’autres termes, toute augmentation des forces productives sociales, des forces productives du travail lui-même – telles qu’elles résultent de la science, des inventions, de la division et de la combinaison du travail, de l’amélioration des moyens de communication, de la création du marché mondial, des machines, etc. –, n’enrichissent pas le travailleur, mais le capital, ne font donc à leur tour qu’accroître le pouvoir qui exerce sa domination sur le travail, augmentent seulement la force productive du capital. Comme le capital est l’opposé du travailleur, ces progrès n’augmentent que la puissance objective qui règne sur le travail[128]. »
Et en 1863, dans Le Capital, influencé par les travaux de Justus von Liebig contestant les nouvelles techniques agricoles, il se pose en précurseur de l'écologie politique lorsqu'il affirme :
« Tout progrès dans l’agriculture capitaliste est un progrès dans l’art, non seulement de voler le paysan mais de spolier le sol ; tout progrès dans l’accroissement temporaire de la fertilité du sol est un progrès vers la ruine à terme des sources de cette fertilité. (...) La production capitaliste ne développe donc la technique et la combinaison du procès de production sociale qu’en épuisant en même temps les deux sources d’où jaillit toute richesse : la terre et le travailleur[129]. »
De Darwin à Spencer
Dans les années 1850-1860, le débat sur le progrès est profondément infléchi par les prises de position de deux Anglais évoluant pourtant dans des disciplines différentes : le philosophe Herbert Spencer et le paléontologue Charles Darwin.
- En 1851, Spencer affirme que le progrès de la civilisation est « une partie de la nature » et qu'en conséquence il n'est « pas un accident mais une nécessité »[Ta 11] et six ans plus tard, il confère au « progrès » une signification scientifique, allant jusqu'à utiliser l'expression « loi du progrès »[Sp 26].
- En 1859, Darwin publie De l'origine des espèces (sous-titré : La préservation des races favorisées dans la lutte pour la vie), ouvrage considéré depuis comme le texte fondateur de la théorie de l'évolution. Sur la base de recherches scientifiques, il soutient que les espèces vivantes, végétales et animales, descendent d'autres espèces, les plus anciennes ayant disparu, et qu'il est possible d'établir une classification en vue de déterminer leurs « liens de parenté » (thèse de la sélection naturelle).
Considérées séparément, ces deux positions sont lourdes de signification :
- Bien que la thèse de Spencer n'ait pas la même audience que celle de Darwin, en tant que « conception à la fois nécessariste et naturaliste du progrès », elle nourrit « la rhétorique de la confiance (qui) culmine dans un optimisme nourri de positivisme et de scientisme, attendant de la science et de la société industrielle qu'ils satisfassent tous les besoins de l'homme »[Ta 12]. Se généralise alors « la croyance que tous les problèmes de l'humanité vont être rapidement résolus »[Ta 12].
- Rapidement célèbre, le livre de Darwin va quant à lui faire l'objet de débats intenses et passionnés, qui ne cesseront que des années plus tard, suscitant notamment l'opposition de l’Église anglicane[Sp 27] et du Vatican[130] car il contredit la théorie religieuse en vigueur à l'époque de la création divine des espèces et leur immutabilité (créationnisme).
Mais c'est sans aucun doute par leur conjonction que les théories de Spencer et Darwin vont impacter profondément et durablement les mentalités dans une Angleterre qui est alors la première puissance industrielle et coloniale et qui impose ses valeurs jusqu'à toute une partie du continent africain. Dans son essai sur le progrès, soit deux ans avant que ne paraisse L'origine des espèces, Spencer n'évoque plus « l'homme », comme au temps des Lumières, mais « différentes races humaines ». La découverte de Darwin l'incitera d'autant plus à légitimer « la supériorité de l'homme blanc ». En assimilant « le progrès » à « la mission civilisatrice de l'homme occidental », il justifie la politique expansionniste de son pays.
Depuis 1880, on désigne par l'expression darwinisme social l'ensemble des convictions de Spencer et celles de ses émules, à commencer par Clémence Royer, traductrice en France de L'origine des espèces en 1862. Celle-ci modifie le sous-titre du livre (« des lois du progrès chez les êtres organisés »), ajoute une préface de 64 pages qui constitue un véritable pamphlet positiviste ainsi que des notes de bas de page allant dans le même sens.
Selon de nombreux commentateurs, le darwinisme social constitue le socle de nombreuses dérives, en premier lieu l'eugénisme (sur lequel s’appuiera notamment le régime nazi au XXe siècle). Et plus communément, elles servent également à légitimer le principe de concurrence et de façon plus générale le capitalisme[Ta 13],[131].
Le progrès est « un fait »

À partir des années 1850, du fait de l'industrialisation, de grandes expositions internationales sont organisées régulièrement dans les capitales européennes en vue de rendre compte au grand public des « avancées » de l'industrie. Plus tard, en 1928, le Bureau international des Expositions, organisme régulant leur organisation, précisera qu'elles ont « un but principal d'enseignement pour le public, faisant l'inventaire des moyens dont dispose l'homme pour satisfaire les besoins d'une civilisation et faisant ressortir dans une ou plusieurs branches de l'activité humaine les progrès réalisés ou les perspectives d'avenir »[Sp 28].
À partir des années 1870-1880, le processus d'anthropisation s'accélère, les humains façonnent littéralement leur environnement. La célèbre citation de Descartes, « nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature », ne relève plus tant du concept ou du rêve que de la réalité. Dès lors, « le progrès » tend à être vécu comme un fait. C'est du moins l'avis du philosophe français Ludovic Carrau, en 1875 :
« Le progrès est un fait, incontestable et indiscutable, pour qui contemple de haut et en sincérité d’esprit la marche du genre humain. Ce fait, comme tous les autres, a une loi ; mais cette loi n’a rien de commun avec celles qui gouvernent les phénomènes astronomiques, physiques, chimiques et vitaux : elle n’est pas nécessitante, elle ne contraint pas ; elle échappe à l’inflexible rigidité des formules mathématiques. Elle est pour l’humanité l’obligation, sourdement sentie d’abord comme un besoin, acceptée plus tard librement comme une dignité et un devoir, de tendre dans toutes les directions vers un idéal de beauté, de vérité, de bonheur, de perfection[Sp 29]. »
Et c'est précisément parce que le progrès est vécu comme une « obligation sourdement sentie comme un besoin » qu'il est quasi unanimement sacralisé. Carrau poursuit ainsi son argumentation :

« Cet idéal, si défiguré qu’il soit par l’ignorance et la superstition, nul individu, nulle race humaine, n’en sont totalement dépourvus. C’est la lumière qui éclaire tout homme venant en ce monde ; à nous d’en recueillir, d’en concentrer, d’en fortifier les rayons ; à nous de nous faire une raison capable de l’apercevoir de plus en plus distincte et pure, une volonté qui y tende avec une grandissante énergie : à nous par conséquent, à cette force intelligente et libre que développe en nous la pratique du devoir et qui seule est véritablement nous-mêmes, d’accomplir l’œuvre sacrée du progrès. Ni la fatalité, ni la nature, ne peuvent nous dispenser de cette tâche, car le progrès, c’est précisément le triomphe de la raison et de la liberté morale sur la nature et la fatalité. »
Concrètement, « le progrès » est vécu comme la combinaison des innovations techniques et de l'économie, le processus qui crée une synergie entre ces faits que sont la conception, la fabrication, la commercialisation et l'utilisation de ces innovations. En 1888, l'économiste John Kells Ingram invente l'expression « homo œconomicus » pour exprimer le changement radical qui s'opère alors dans la civilisation occidentale : la révolution industrielle[132].
En 1948, Jacques Ellul affirmera que c'est parce que « le progrès » constitue un enchevêtrement de faits (et non plus une simple conception philosophique) qu'il est extrêmement difficile de formuler sur lui un avis consensuel :
« Sans aucun doute, le motif le plus puissant qui pèse sur nous comme un interdit, le motif qui nous empêche de remettre en question les structures de cette civilisation et de nous lancer dans la voie de la révolution nécessaire, c'est le respect du fait. [...] Actuellement, le fait constitue la raison dernière, le critère de vérité. Il n'y a pas de jugement à porter sur lui, estime t-on, il n'y a qu'à s'incliner. Et dès lors que la technique, l'État ou la production sont des faits, il convient de s'en accommoder. Nous avons là le nœud de la véritable religion moderne : la religion du fait acquis[133]. »
Une critique clairsemée mais radicale
L'impact de l'industrialisation sur les mentalités est tel que l'idée de progrès est de plus en plus prégnante. Mais alors que sa critique s'était amorcée dès les années 1830, elle demeure rare et sans réel impact durant toute la fin du siècle. Lorsqu'elle s'exprime, elle est toutefois cinglante.
En 1872, le philosophe et mathématicien français Antoine Augustin Cournot assimile l'idéal progressiste ni plus ni moins à une religion :
« Aucune idée, parmi celles qui se réfèrent à l'ordre des faits naturels, ne tient de plus près à la famille des idées religieuses que l'idée de progrès, et n'est plus propre à devenir le principe d'une sorte de foi religieuse pour ceux qui n'en ont plus d'autre. Elle a, comme la foi religieuse, la vertu de relever les âmes et les caractères. L'idée du progrès indéfini, c'est l'idée d'une perfection suprême d'une loi qui domine toutes les lois particulières, d'un but éminent auquel tous les êtres doivent concourir dans leur existence passagère. C'est donc au fond l'idée du divin ; et il ne faut point être surpris si, chaque fois qu'elle est spécieusement invoquée en faveur d'une cause, les esprits les plus élevés, les âmes les plus généreuses se sentent entraînés de ce côté. Il ne faut pas non plus s'étonner que le fanatisme y trouve un aliment, et que la maxime qui tend à corrompre toutes les religions, celle que l'excellence de la fin justifie les moyens, corrompe aussi la religion du progrès. »[134]
En Allemagne, Friedrich Nietzsche rejette radicalement l'idée de progrès.
- En 1886, dans Par delà le bien et le mal, il critique l'ensemble des penseurs ayant contribué selon lui à la propagation de l'idée de progrès et qu'il considère tous comme « médiocres » : selon lui essentiellement les Anglais (Bacon, puis Hobbes, Hume et Locke, enfin ses contemporains Darwin, Mill et Spencer), les Français n'étant selon lui que leurs « singes » et leurs « soldats »[Sp 30].
- En 1896, dans L'Antéchrist, Nietzsche la qualifie d'idée fausse : « L’humanité ne représente nullement une évolution vers le mieux, vers quelque chose de plus fort, de plus élevé au sens où on le croit aujourd’hui. Le progrès n’est qu’une idée moderne, c’est-à-dire une idée fausse. L’Européen d’aujourd’hui reste, en valeur, bien au-dessous de l’Européen de la Renaissance ; le fait de poursuivre son évolution n’a absolument pas comme conséquence nécessaire l’élévation, l’accroissement, le renforcement[Sp 31]. »
C'est en Grande-Bretagne, alors le pays le plus industrialisé de la planète, que la critique est la plus rare. En 1894, toutefois, lors d'une conférence donnée à Manchester, William Morris vitupère contre le processus d'industrialisation[135],[Sp 32].
« On n'arrête pas le progrès »
Si, comme l'avance Ludovic Carrau, « le progrès est (devenu) un fait » et s'il est « sacralisé », c'est qu'il est profondément désiré. La littérature romanesque en témoigne. À partir de 1851, l'écrivain Jules Verne publie une longue série de récits qui en font l'éloge sous tous ses aspects et qui connaîtront un vif succès : découverte de la terre jusque dans ses entrailles, reconnaissance d'autres peuples, glorification de la science, instruction pour tous, éducation morale des enfants[136]... En 1865, avec De la Terre à la Lune, il inaugure le récit d'anticipation en tant que genre littéraire, se posant par la suite en visionnaire.
Jules Verne n'est toutefois pas un technophile béat. Ainsi par exemple, en 1870, dans Une ville flottante, il écrit : « créer une île artificielle, une île qui se déplace à la surface des mers, n’est-ce pas dépasser les 737 limites assignées au génie humain, et n’est-il pas défendu à l’homme, qui ne dispose ni des vents ni des flots, d’usurper si témérairement sur le Créateur ? ». Et dans Paris au XXe siècle, un de ses premiers romans (écrit vers 1860 mais qui ne sera publié qu'en 1994), il imagine que les campagnes n’existeront bientôt plus que dans des discours nostalgiques et avance l'idée qu'il faudra « peut-être faire une révolution contre le progrès »[137].
XXe siècle
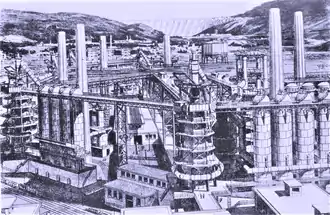

Au tout début du siècle, « le progrès » est on ne peut plus voyant dans les villes européennes. Les innovations se multiplient à un rythme sans précédent. Non seulement les machines équipent toujours plus les usines mais toutes sortes d'équipements métamorphosent des paysages entiers (urbanisme, éclairage urbain...). Les ingénieurs prennent un certain ascendant sur les architectes (ex : Tour Eiffel), les nouveaux moyens de transports (automobile, train, paquebot, avion...) réduisent les distances. Le développement de la presse, la démocratisation de la photographie, l'invention du cinéma... transforment profondément les mentalités, générant le plus souvent une certaine euphorie dans le grand public, au point que l'on qualifiera plus tard cette période de « Belle Époque ».
Mais certains intellectuels ne partagent pas cet enthousiasme. Ainsi en 1905, le géographe Élisée Reclus, dans son dernier livre L'homme et la Terre, et plus spécialement dans le dernier chapitre, intitulé « Progrès », invite à la circonspection :
« De quels chants de triomphe en l’honneur du progrès n’ont pas été accompagnées les inaugurations de toutes les usines industrielles avec leurs annexes de cabarets et d’hôpitaux ! Certes, l’industrie amena de réels progrès dans son cortège, mais avec quel scrupule il importe de critiquer les détails de cette grande évolution ! »
L'année suivante, commentant les idées de Fontenelle, le journaliste et écrivain Remy de Gourmont tient des propos plus fermes :
« En comparant l’état des connaissances humaines avec les états précédents, (il) découvrit non pas précisément l’idée de progrès, qui n’est qu’une illusion, mais l’idée de croissance. Il vit assez bien que l’humanité, à force de vivre prend de l’expérience et aussi de la consistance. (...) Progrès ne voulut pas dire autre chose d’abord qu’avancement, marche dans l’espace et dans le temps, avec ce qu’implique d’heureux un état de constante activité. Plus tard, on donna à ce mot le sens d’amélioration continue (Turgot), indéfinie (Condorcet) et il devint ridicule. »[138]
En 1908, le philosophe et sociologue Georges Sorel (considéré comme l'un des principaux introducteurs du marxisme en France[139]) est plus radical dans Les illusions du progrès, un recueil d'articles préalablement publiés dans le Mouvement socialiste. Il perçoit dans « le progrès » une idéologie qui trouve son origine au XVIIe siècle avec la pensée cartésienne, pour s'affirmer au siècle suivant en tant qu'idéologie de la bourgeoisie, notamment à travers l'Encyclopédie. La bourgeoisie ne poursuit selon Sorel qu'une ambition : se maintenir au pouvoir, et c'est précisément le rôle de l'idéologie du progrès de l'aider dans cette entreprise, en diffusant dans l'ensemble de la société un discours de propagande, à forte tonalité optimiste, qui la légitime en tant que classe dirigeante. Cette idéologie, poursuit Sorel, a un principe : trouver des explications simples permettant de « résoudre toutes les difficultés que présente la vie quotidienne ». Dès lors, conclut-il, le progrès n'apparaît nullement « comme l'accumulation de savoirs mais dans l'ornement de l'Esprit qui, débarrassé des préjugés, sûr de lui-même et confiant dans l'avenir, s'est fait une philosophie assurant le bonheur à tous les gens qui possèdent les moyens de vivre largement »[Sp 5].
En 1910, Jules Delvaille est l'auteur d’une thèse universitaire dans laquelle il dresse une « histoire de l’idée de progrès jusqu’au XVIIIe siècle »[Sp 33]. Il perçoit trois niveaux de lecture, susceptibles de se compléter :
- le constat d’une continuité des évènements passés ayant abouti à un état meilleur dans le présent ;
- l’idéologie, s'exprimant par le besoin d’un état meilleur et dont la réalisation semble accessible ;
- l’utopie, quand se manifeste une confiance inébranlable en l’avènement de temps meilleurs.
Modernité en procès
Au lendemain de la Première Guerre mondiale, qui s'est soldée par des millions de morts, la notion de progrès est fortement questionnée[140]. L'Allemand Oswald Spengler questionne non pas spécifiquement « le progrès » mais plus généralement la culture occidentale et sa prétention à être « moderne ». Dans Le Déclin de l'Occident dont le premier volume paraît en 1918 et le second quatre ans plus tard, il assimile les grandes cultures historiques à des êtres biologiques : elles naissent, croissent, déclinent et meurent[Sp 34].
En 1922, son compatriote Carl Schmitt avance quant à lui que « tous les concepts prégnants de la théorie moderne de l'État ne sont que des concepts théologiques sécularisés »[Sp 35].
En 1927, l'essayiste français René Guénon publie La Crise du monde moderne, un ouvrage qui connait rapidement un grand retentissement et dans lequel il dénonce une montée en puissance du matérialisme dans "le monde moderne", formule dont il se sert pour désigner les pays occidentaux, par opposition aux pays d'Orient, où subsisterait selon lui une authentique spiritualité[141].
Tous trois ouvrent ainsi un nouveau pan de la philosophie, la « critique de la modernité », qui ne se développera vraiment qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, quand le philosophe allemand Karl Löwith avancera l'idée que la philosophie de l’histoire et l'idée de progrès ont pour origine l'eschatologie chrétienne; l'idée de progrès peut donc être assimilée à une simple croyance[Sp 36]. Le philosophe Emmanuel d'Hooghvorst ira, lui, jusqu'à qualifier cette croyance de dogme, « dernier dogme auquel notre monde croit encore : l'espoir sans fin occultant l'art ancien »[142].
Haro sur la machine !
Dès le début des années 1920, dans son roman d'anticipation R. U. R. (Rossum's Universal Robots), le Tchèque Karel Čapek décrit un monde façonné par des ingénieurs fabriquant des machines androïdes dénuées de toute sensibilité et qui finissent par anéantir l'humanité. Le mot « robot » est alors utilisé pour la première fois. De son côté, l'écrivain français Romain Rolland publie La révolte des machines. Un peu plus tard, en 1927, recevant le Prix Nobel de littérature, le philosophe Henri Bergson prononce ces mots :
« On avait pu croire que les applications de la vapeur et de l’électricité, en diminuant les distances, amèneraient d’elles-mêmes un rapprochement moral entre les peuples : nous savons aujourd'hui qu'il n’en est rien, et que les antagonismes, loin de disparaître, risqueront de s’aggraver s’il ne s’accomplit pas aussi un progrès spirituel, un effort plus grand vers la fraternité[143]. »
La même année en Allemagne sort le film de Fritz Lang, Metropolis. L'action se déroule en 2026 dans une mégalopole où les humains adoptent des comportements exclusivement rationnels et où une machine se mue en divinité monstrueuse à laquelle les ouvriers les moins productifs sont impitoyablement sacrifiés.
Durant les années 1930 se développe la pensée technocritique, avec un grand nombre d'ouvrages qui tendent à ruiner l'idée même de progrès. Alors que les usines se mécanisent toujours davantage, des intellectuels de tous pays s'interrogent sur les raisons incitant les humains à s'échiner au travail et à produire toujours plus, au mépris parfois de leur santé. Ils pointent alors une dimension sacrificielle du travail. Ainsi, au terme d'un long voyage aux États-Unis, Georges Duhamel dresse dans Scènes de la vie future un portrait sévère de la société américaine, les humains s'effaçant selon lui derrière la machine, à laquelle ils sont aliénés[Sp 37]. Et en 1931, l'écrivaine italienne Gina Lombroso voit dans l’industrialisation un symptôme de décadence intellectuelle et morale[Sp 38].
La même année, Robert Aron et Arnaud Dandieu fustigent le fordisme et le taylorisme[Sp 39] et, en Allemagne, Spengler écrit :
« La mécanisation du monde est entrée dans une phase d'hyper tension périlleuse à l'extrême. La face même de la terre, avec ses plantes, ses animaux et ses hommes n'est plus la même. [...] Un monde artificiel pénètre un monde naturel et l'empoisonne. La civilisation est elle-même devenue une machine, faisant ou essayant de tout faire mécaniquement[Sp 40] »
Avec le Russe Nicolas Berdiaev, la critique du progrès continue de se focaliser sur le « progrès technique » :
« Si la technique témoigne de la force et de la victoire de l’homme, elle ne fait pas que le libérer, elle l’affaiblit et l’asservit aussi. Elle mécanise sa vie, la marquant de son empreinte. (...) La machine détruit l’intégralité et la coalescence anciennes de la vie humaine. Elle scinde, en quelque sorte, l’esprit de la chair organique et mécanise la vie matérielle. Elle modifie l’attitude de l’homme à l’égard du temps, modifie ce dernier lui-même qui subit alors une accélération précipitée[Sp 41],[144]. »
En 1933, Berdiaev estime que « l'apparition de la machine et le rôle croissant de la technique représentent la plus grande révolution, voire la plus terrible de toute l'histoire humaine »[Sp 42] et Georges Duhamel revient à la charge dans un article intitulé « La querelle du machinisme » :
« La machine manifeste et suppose non pas un accroissement presque illimité de la puissance humaine, mais bien plutôt une délégation ou un transfert de puissance. (...) L’homme a conquis, entre toutes les bêtes, une place éminente et exceptionnelle. II a pris possession d’une grande partie du globe. Il s’est rendu, redoutable à beaucoup d’autres êtres. Que l’outil et la machine soient les instruments de cette victoire, c’est clair. (...) Dès maintenant s’explique le sens des mots transfert ou délégation de puissance. L’homme nu est un animal très misérable. Je veux bien reconnaître que l’homme est rarement nu, rarement privé des produits de son industrie. Faut-il dire qu’à toute délégation de puissance correspond une délégation des devoirs et des responsabilités ? (...) Il ne faut pas se hâter de parler d’une décadence de l’homme : la puissance, même accessoire et extérieure, est toujours la puissance. Il ne faut pas se hâter de parler d’une dégénérescence de l’homme. (...) Je ne vois pas, dans le machinisme, une cause, pour l’homme, de décadence, mais plutôt une chance de démission. Il est bien évident que nous demandons à nos machines de nous soulager non seulement des travaux physiques pénibles, mais encore d’un certain nombre de besognes intellectuelles. (...) Notre goût de la perfection, l’une de nos vertus éminentes, nous le reportons sur la machine. (...) Il est clair que les appareils et les machines tendent non seulement à prolonger, à compléter, à corriger, à multiplier nos sens, mais encore à les suppléer[Sp 43]. »
L'année suivante, l'historien américain Lewis Mumford s'interroge : « En avançant trop vite et trop imprudemment dans le domaine des perfectionnements mécaniques, nous n’avons pas réussi à assimiler la machine et à l’adapter aux capacités et aux besoins humains. »[Sp 44]. Et la philosophe française Simone Weil décrit le progrès technique comme n'apportant nullement le bien-être mais la misère physique et morale : « Le travail ne s’accomplit plus avec la conscience orgueilleuse qu’on est utile, mais avec le sentiment humiliant et angoissant de posséder un privilège octroyé par une passagère faveur du sort, un privilège dont on exclut plusieurs êtres humains du fait même qu’on en jouit, bref une place. »[Sp 45]
En 1936, Bernard Charbonneau fustige littéralement l'idée même de progrès :
Et dans une scène devenue célèbre de son film Les Temps modernes, montrant un ouvrier pris dans les engrenages d'une gigantesque machine, Charles Chaplin, popularise l'idée d'aliénation dans le travail mécanisé.
En 1937, dans Le Quai de Wigan, George Orwell fustige à son tour l'adoration collective de la machine. Selon lui, le progrès technique recherché pour lui-même ne peut conduire l'humanité qu'à la ruine. Il déplore particulièrement le manque total de lucidité des socialistes sur ce point[146].
Durant toute la Deuxième Guerre mondiale, et partout dans le monde, l'activité industrielle se concentre à nouveau sur l'armement. Les critiques à l'égard du progrès sont inexistantes à l'exception notable de Stefan Zweig qui, réfugié au Brésil en 1942, écrit ces lignes dans son livre testamentaire, Le Monde d'hier. Souvenirs d'un Européen :
« Le XIXe siècle, avec son idéalisme libéral, était sincèrement convaincu qu’il se trouvait sur la route droite qui mène au meilleur des mondes possibles. On ne considérait qu’avec dédain les époques révolues, avec leurs guerres, leurs famines et leurs révoltes, on jugeait que l’humanité, faute d’être suffisamment éclairée n’y avait pas atteint la majorité. Cette foi en un « progrès » fatal et continu avait dans ce temps là toute la force d’une religion. Déjà l’on croyait dans ce progrès plus que dans la Bible et cet évangile semblait irréfutablement démontré par les merveilles sans cesse renouvelées de la science et de la technique[147]. »
La critique du progrès reprend toutefois de plus belle à la fin du conflit en 1945, quand des milliers de Japonais sont décimés en quelques minutes par des bombes atomiques, à Hiroshima et Nagasaki.
En 1946, l'Allemand Friedrich Georg Jünger estime que « le progrès technique » correspond en fait à un déficit spirituel, que la raison cherche à dissimuler. Et que, bien qu'illusoire, ce progrès n'en finit pas de méduser les consciences[Sp 47],[148]. De son côté, le sociologue français Georges Friedmann analyse les « problèmes humains liés au machinisme industriel », en premier lieu dans le monde du travail[Sp 48].
L'année suivante, Georges Bernanos émet lui aussi une vive critique de la société industrielle, estimant que le machinisme limite la liberté des hommes et perturbe jusqu'à leur mode de pensée[Sp 49].
En 1948, dans La mécanisation au pouvoir, l'historien américain Siegfried Giedion écrit : « Les relations entre l'homme et son environnement sont en perpétuel changement, d'une génération à l'autre, d'une année à l'autre, d'un instant à l'autre. (...) Notre époque réclame un type d'homme capable de faire renaître l'harmonie entre le monde intérieur et la réalité extérieure »[149].
Et l'année suivante, dans son roman d'anticipation 1984, l'écrivain George Orwell décrit un monde totalitaire où la domination est assurée par un dispositif de télésurveillance.
« Progrès » versus « processus d'individuation »
Le psychiatre suisse C. G. Jung estime d'une part que le progrès est une mystification, une idéologie, d'autre part que toutes les idéologies naissent dans l'inconscient et que, depuis de nombreuses générations, elles constituent un moyen privilégié pour les humains de se défausser de leur responsabilité première : se connaître soi-même.
« Le progrès et l'évolution sont des idéaux qu'on ne saurait nier ; mais ils perdent leur valeur si l'homme ne parvient au stade nouveau qu'à l'état de fragment de soi même, ayant laissé dans l'ombre de l'inconscient tout ce qui constitue son arrière-plan et forme l'essentiel, l'ayant abandonné à l'état primitif, disons même de barbarie[150]. »
Véronique Liard, professeur en études germaniques, résume ainsi la position de Jung à l'égard du progrès :
« Les progrès qu’a permis l’intellect ne sont certes pas négligeables, mais le matérialisme croissant s’accompagne d’une perte des connaissances sur l’âme. L’homme, pour qui seul l’extérieur compte, ne se contente pas de ce qui lui est nécessaire ; il veut toujours plus, toujours mieux. Mais plus il recherche les merveilles de ce monde, plus il fait taire la voix intérieure qui s’élève de temps en temps pour réclamer elle aussi son tribut. (...) La prospérité nous a convaincus des joies que procure le matérialisme ; elle a même contraint l’esprit à trouver toujours plus de moyens pour l’améliorer, mais elle n’a jamais produit d’esprit en soi. Rares sont ceux qui s’aperçoivent que le bonheur matériel est un danger pour l’esprit. De plus, la soif de connaissance scientifique, l’avidité de richesses et l’ambition sociale nous font vivre dans le futur. On essaie d’oublier le plus vite possible le passé, alors que la culture est essentiellement basée sur la continuité et une préservation du passé. »[151]
À la fin de sa vie, en 1957, Jung écrit ces mots :
« On dit que le monde moderne est le monde de l'Homme. On dit que c'est lui qui domine les airs, l'eau et la terre et que c'est de sa décision que dépend le destin historique des peuples. Hélas, ce fier tableau de la grandeur humaine n'est qu'une pure illusion et il est compensé par une réalité bien différente. Dans cette réalité, l'homme est l'esclave et la victime des machines qui conquièrent pour lui l'espace et le temps. Il est opprimé et menacé au suprême degré par la puissance de ses techniques de guerre qui devraient protéger son existence physique[152]. »
Jung estime qu'au lieu de se perdre dans des considérations matérialistes et se dépenser à l'extrême dans le travail, les individus auraient tout intérêt à se livrer à un « travail sur soi » (qu'il appelle « processus d'individuation »), se confronter à leurs démons et cultiver leur intériorité en recourant à une méthode qu'il appelle « psychologie analytique » (pour se différencier de la psychanalyse, freudienne[153]).
Progrès = création + destruction
Joseph Schumpeter, économiste américain d'origine autrichienne, se situe en marge de toutes ces approches négatives du concept de progrès. De surcroît, il se positionne en dehors de toute considération éthique et raisonne de façon pragmatique.
En 1939, dans son livre Les cycles des affaires[154], il estime non seulement que le progrès technique est au cœur de l'économie mais qu'il se manifeste par grappes et que ses conséquences sont antinomiques. Selon lui, toute innovation constitue à la fois une avancée et un moment destructeur : dès qu'elle advient, certes elle pénalise les entreprises qui ne l'ont pas anticipée, causant par là-même des suppressions d'emplois, mais elle est en même temps créatrice d'emplois. Les patrons qui réalisent sans cesse des innovations (de produits, de procédés, de marchés...) assurent non seulement la productivité de leurs entreprises mais la vitalité de l'économie dans son ensemble. La croissance économique peut alors se définir comme synonyme de « progrès » : un processus permanent et cyclique de création, de destruction et de restructuration des activités, les moments d'expansion alternant avec les crises. Schumpeter reste acritique vis-à-vis de ce processus : il considère en effet qu'il va de soi et que les hommes doivent impérativement s'y adapter.
Quelques-uns se demandent si, ainsi, les hommes ne deviennent pas les « esclaves de l’économie », tel Jacques Ellul en 1947 :
« L’homme moderne, quel que soit le régime politique dans lequel il s’inscrit, est englobé dans l’économie. Il n’y est plus considéré qu’en tant que producteur - consommateur. Le socialisme comme le capitalisme l’asservissent à l’économie car ils ont récupéré dans leurs doctrines respectives tout ce qui, auparavant, relevait de la vie spirituelle. L’homme idéal est un homme hygiénique, vivant dans le confort et l’immédiateté au prix d’un travail qui l’absorbe et lui évite de se poser des questions morales ou métaphysiques. L’apologie du travail a atteint le stade d’une véritable mystique. Ainsi l’homme est-il devenu l’esclave de l’économie. »[155]
Ce type de réaction reste toutefois assez marginal. À la fin du XXe siècle, les thèses de Schumpeter sont valorisées et prolongées par d'autres, telle en France la théorie du déversement, d'Alfred Sauvy, ouvertement optimiste : certes, avance l'économiste, le progrès technique détruit beaucoup d'emplois mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter car il peut en créer d'autres aussitôt et en proportion, pour peu que l'on soit réactif. L'innovation engendre des gains de productivité qui, précise t-il, se traduisent par des hausses de salaires ou des baisses de prix, donc une élévation du pouvoir d'achat et du bien-être[156].
Bien que cette thèse soit régulièrement contestée et que les chiffres du chômage ne cessent d'augmenter, tendant à l'invalider, au début du XXIe siècle, le concept schumpeterien d'innovation tendra à remplacer celui de progrès sans susciter d'objections notoires[157] (lire infra).
« Progrès », « développement », « croissance »
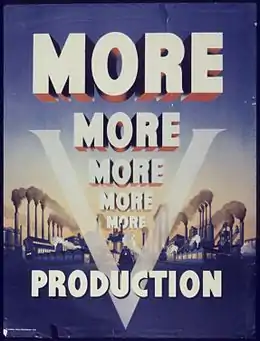
La Seconde Guerre mondiale donne aux États-Unis et à l'URSS l'occasion de devenir les premières puissances mondiales. Pour aider leurs alliés européens à remporter le conflit sur l'Allemagne nazie, ces deux nations investissent considérablement dans la production industrielle. Si bien que, durant la seconde moitié des années 1940, une fois la paix rétablie, les nations européennes sont en quelque sorte obligées de s'aligner sur l'une ou sur l'autre. Idéologiquement, tout oppose à première vue les deux blocs : l'un opte pour le capitalisme et l'encouragement de l'initiative privée dans une économie de marché, l'autre choisit le communisme et le contrôle de l'économie par l'État. En réalité, les deux systèmes s'appuient sur une même idéologie : le productivisme.
Dans ce contexte politique de « guerre froide », le mot « progrès » tend à être remplacé par le mot « développement. Conduits par les États-Unis, les plans de reconstruction de l'Europe de l'Ouest sont portés par des politiques de croissance et de plein emploi, ils se concrétisent par une forte élévation du niveau de vie dans les pays industrialisés, qui est elle-même vécue par les populations comme un « progrès », procurant toujours plus de bien-être matériel[réf. nécessaire]. À travers la culture de masse (notamment le cinéma), les Américains vantent leur mode de vie, l'American way of life, axé sur l'usage de l'automobile et des appareils électro-ménagers et la consommation de toutes sortes de nouveaux produits, y compris alimentaires. La publicité ne se contente plus de promouvoir ces produits (ce que faisait autrefois « la réclame ») : couplée avec le marketing, et comme lui, elle constitue une technique de communication visant à influencer les comportements. Le progrès se retrouve associé aux idées de croissance économique et de pouvoir d'achat. Ainsi, lors de son discours d'investiture, le 20 janvier 1949, le président Truman désigne l'état de pauvreté qui touche un grand nombre de nations sous le terme « sous-développement »[158].
Durant les années 1950, il arrive que le terme « progrès » reste usité dans le champ des sciences humaines sans être remis en question. Ainsi, le démographe et économiste Alfred Sauvy lui accole des qualificatifs connotés scientifiquement. Il distingue le « progrès processif » du « progrès récessif »[Sp 50] : le premier profite aux « dominés » parce qu'il ouvre des emplois nouveaux ; inversement le second profite aux « dominants » parce qu'il renforce le monopole des possédants[159]. À la même époque, son collègue Jean Fourastié tient un discours profondément optimiste à l'égard du progrès[160]. À l'heure des Trente Glorieuses (l'expression est de Fourastié), la société industrielle se structure autour de critères économiques considérés comme rationnels et fiables, tant du côté de la production que chez les consommateurs (homo œconomicus). Et dans ce contexte d'accoutumance générale des individus au confort matériel, on la qualifie alors de « société de consommation ».
Au fil des années 1960, l'économie ne cesse de se techniciser, démontrant notamment ses capacités à modéliser mathématiquement les comportements humains et imposant sa légitimité au statut de science[161],[n 8]. Un grand nombre d'économistes adhèrent alors à la « théorie du choix rationnel », selon laquelle les individus sont des « acteurs » se comportant systématiquement de façon logique. La notion de progrès est alors assimilée à celle de croissance économique[162] et pour Bernard Charbonneau, cette assimilation est lourde de conséquences :
« Célébré par Fourastié, Sauvy, les médias et les politiciens, le culte du Changement[n 9] atteint son apogée durant les Trente Glorieuses. Partout, des gros ouvrages scientifiques aux manuels scolaires, chiffres et statistiques démographiques et économiques démontrent ce qui va de soi. (...) Le progrès, c'est l'indiscutable, donc l'indicible : la Vérité autant que la réalité par excellence. Car il est non seulement en marche vers la justice sociale et la liberté pour tous les individus mais c'est le Fait : la Nécessité à laquelle nul ne peut échapper. Ainsi, il résout toutes les contradictions, y compris la contradiction fondamentale entre l'Esprit et la Matière. On comprend que, pour qu'il y ait Progrès, il faut non seulement que celui-ci progresse mais qu'il le fasse de plus en plus vite : les taux de croissance aussi doivent croître. Le développement est exponentiel ou il n'est pas ; une courbe qui ne se redresse pas est une courbe qui retombe. Le Progrès est en marche vers l'Absolu. Aussi s'intègre t-il dans l'Évolution qui, partie de la matière élémentaire, s'élève implacablement jusqu'à la perfection infinie. Plus de querelle comme autant de Lamarck : la Science et la Raison, la Morale et la Religion sont d'accord. L'Évolution peut être alors accommodée à la sauce rationaliste et athée, ou à la sauce chrétienne selon la recette Teilhard. (...) Le dogme du Progrès spirituel, identifié à celui de l'Histoire et de la science humaines, succède à celui du Péché[163]. »
Au XXIe siècle, le philosophe Michel Lacroix reprendra la thèse contenue dans cette dernière phrase (lire supra). Et certains économistes se demanderont s'il est toujours pertinent de croire que le progrès technique constitue une source de croissance[164].
Modélisation de la pensée
De 1942 à 1953 se déroulent à New York les conférences Macy, qui réunissent des mathématiciens, logiciens, anthropologues, psychologues et économistes. Par le caractère interdisciplinaire de ces rencontres, leurs participants entendent élaborer une vision du monde systémique et se fixent pour objectif l'édification d'une « science générale du fonctionnement de l'esprit ».

Parmi ceux-ci, le mathématicien Norbert Wiener introduit la notion de cybernétique et les concepts de « machine à penser » et de feedback (rétroaction)[165]. Précisons ici brièvement le contexte : l'avènement de l'informatique. En 1945, grâce au financement de l'armée américaine, l'Université de Pennsylvanie a conçu et fait construire ENIAC, le tout premier ordinateur. Puis, entre 1949 et 1951, trois appareils ont été commercialisés (BINAC, Ferranti Mark I et UNIVAC I). Au milieu des années 1950, un nouveau composant électronique, le transistor (inventé en 1947, de petite taille et peu consommateur d'énergie), a remplacé le tube à vide. La taille et le coût des ordinateurs ont ainsi été considérablement réduits. Les moyennes entreprises américaines ont alors commencé à s'équiper et certains penseurs, dont précisément Wiener, ont imaginé qu'à terme, les particuliers pourraient s'en doter à leur tour.
Wiener n'a pas qu'une approche quantitative de l'informatique mais aussi qualitative. Il estime en effet que si l'on perfectionne ses algorithmes, un ordinateur peut être bien plus qu'un simple calculateur et qu'on peut le programmer pour effectuer des opérations complexes, s'apparentant à la pensée logique. S'appuyant sur la théorie de l'information de Claude Shannon et analysant la façon dont l'information circule dans le cerveau d'un animal et chez l'homme, il pense que l'on peut intégrer un processus similaire dans des machines. Cette approche aura plus tard un impact considérable tant sur la robotique que sur les neurosciences.
Wiener expose ses théories dans deux livres[n 10]. Dans la seconde partie de « Cybernétique et société », il affirme que « de même qu'une révolution est en cours, permettant aux machines de remplacer les muscles de l'homme, une autre est en train de poindre qui leur permettra de se substituer à son cerveau »[166]. Ses investigations préfigurent la recherche en intelligence artificielle.
Comme l'atteste le titre même de son second livre, « Cybernétique et société », loin de cantonner son approche à une discipline scientifique fermée sur elle-même, Wiener en fait le fondement d'une conception du monde progressiste, dont les concepts centraux sont la rationalité et l'efficacité : « Vivre efficacement, c’est vivre avec une information adéquate », affirme t-il. Dès l'introduction du livre, il indique que celui-ci comprend « une partie philosophique concernant l’activité humaine et la façon dont nous devrions réagir en face du monde nouveau auquel nous nous trouvons confrontés ».
À la fin du XXe siècle, certains considèrent la cybernétique comme « une science du contrôle social » préfigurant l'époque actuelle :
« Le type de société qui émerge aujourd'hui dans les pays industrialisés découle directement des applications de la cybernétique: processus de robotisation de la production, réseaux financiers mondialisés, nouvelles méthodes de management et d'organisation de l'entreprise, réseaux de communication et réseaux informatiques, nouveaux systèmes d'armes intelligentes... »[167]
Et en 2015, Imane Sefiane, sociologue spécialiste de « l'apologie de l’ère informationnelle »[168], voit dans les positions de Wiener « une célébration du progrès technologique » :
« Plus de soixante ans après la publication de Cybernétique et société, à l’ère des NTIC, le message de Wiener prend une résonance particulière. La société de l’information n’est plus un rêve. Nous vivons bien à l’ère de machines informationnelles régissant et structurant notre société. La profusion de nouvelles technologies toujours plus performantes, la rapidité des transformations qu’elles génèrent, et les prodigieuses possibilités qu’elles permettent dans différents domaines de l’activité humaine ne sont plus à démontrer. (...) Le discours originel sur la société de l’information, tel qu’on peut le lire chez Wiener, est normatif. Cela implique que les propositions avancées ont une portée clairement philosophique et devraient, à notre sens, être appréhendées comme telles. »[169]
Sefiane estime que, selon Wiener,
« les TIC sont des « bienfaits » à vocation « universelle » dont dépend la « confiance en l’avenir ». Le message véhiculé tend à inciter les citoyens à « s’équiper » de ces nouvelles techniques afin de ne pas être « exclus » ou marginalisés et « participer » à la société de l’information[170]. »
Il considère toutefois que Wiener reste continuellement partagé entre « l'enthousiasme et l'inquiétude » :
« deux tonalités semblent s’opposer (chez lui). La première fait entendre que les machines informationnelles sont notre futur : « les messages entre l’homme et les machines, entre les machines et l’homme, et entre la machine et la machine sont appelés à jouer un rôle sans cesse croissant ». La seconde sonne l’alerte du danger qu’elles peuvent engendrer : « pour qui n’en a pas conscience, transférer sa responsabilité à la machine... C’est lancer sa responsabilité au vent et la voir revenir portée par la tempête ». »[170]
Il faut signaler que peu après que Wiener se soit posé ces questions en termes philosophiques, d'autres intellectuels américains se les posent sans état d'âme, en termes strictement techniques. Ainsi en 1955, les informaticiens John McCarthy et Claude Shannon lèvent les fonds pour organiser une rencontre sur « l'intelligence artificielle » (c'est la première fois que cette expression est utilisée). La rencontre a lieu l'année suivante et est connue sous le nom « Atelier de Dartmouth ». C'est alors qu'est développé Logic Theorist, le tout premier programme d'intelligence artificielle.
Ego, « source vive du progrès »
En 1943, l'écrivaine américaine Ayn Rand publie La Source vive, une fiction dans laquelle elle plaide pour un individualisme radical, affirmant notamment que « l'ego de l'Homme est la source vive du progrès ». Et en 1957 - donc en pleine Guerre froide et alors que le collectivisme pratiqué en URSS est vivement critiqué dans son pays -, elle développe ses thèses dans son roman La Grève (qui devient rapidement un best seller) : l'ingéniosité de l’individu constitue « le moteur du progrès social »[171]. Prônant les valeurs du mérite, du self made man et de l'« égoïsme rationnel », son concept central, et considérant le chef d'entreprise comme « le surhomme des temps modernes »[réf. nécessaire], elle influence le libertarianisme puis le néolibéralisme.
Mais Rand est beaucoup plus radicale que les penseurs libéraux, qui ne remettent pas en cause les fonctions régaliennes de l'État, ne nient pas la nature sociale de l'homme, tiennent à différencier « individualisme » et « égoïsme »[172] et pour qui, selon l'expression de Ludwig von Mises, « l'individualisme est une philosophie de coopération sociale et d'intensification progressive du nœud social »[173]. Refusant toute forme de coercition, elle s'en remet exclusivement aux valeurs du moi et de la raison[n 11], ce qui incite l'économiste Claude Rochet à qualifier sa vision de « fascisme sans führer »[174] et le journaliste Martin Legros à y voir « un socle philosophique tout à fait cohérent au transhumanisme » :
« en vertu de la liberté absolue qu'il a sur lui-même, l'individu peut se transformer et même transformer sa propre condition. Il n'est pas tenu de préserver en lui cette "dignité" qui, pour les humanistes classiques, fondait la liberté et au nom de laquelle il était possible de limiter les usages de la liberté individuelle[175]. »
Le succès de La Grève est tel que le livre est parfois qualifié de « plus influent aux États-Unis après la Bible »[176]. Or pour certains psychologues, les engouements collectifs comme celui-ci constituent des phénomènes de compensation à la massification de la société. Le psychiatre suisse C.G. Jung voit derrière les idéologies et les doctrines dominantes un facteur pathologique, qu'il nomme « inflation du moi »[177]. Et sa conception de l'« individu » diffère radicalement de celle défendue aussi bien par Rand et que par les libéraux. Croire que l'individu est un être exclusivement rationnel, affirme t-il, c'est faire fausse route car il existe des façons d'aborder le monde qui sont irrationnelles, par exemple l'intuition, et qui sont tout autant dignes d'intérêt que la raison. Et il estime que quiconque identifie son psychisme à son seul moi surestime celui-ci et, ce faisant, n'est pas à même de repérer en lui, dans son inconscient, un certain nombre de complexes ; en conséquence de quoi, il projette ceux-ci à l'extérieur (sur des personnes, des objets, des idéaux...), ce qui l'expose ensuite - qu'il finisse ou non par se rendre compte qu'il a « pris ses désirs pour des réalités » - à toutes sortes de déconvenues[178].

Faisant du « processus d'individuation » le concept-clé de sa méthode, Jung estime qu'on n' est pas un individu de facto : on ne le devient qu'au fil d'un long et méticuleux travail d'introspection (lire supra), et certainement pas par le biais d'interventions effrénées sur le monde extérieur (le travail, le technique, l'innovation...) telles que les vantent les discours progressistes, qu'au passage il égratigne : « le progrès et l'évolution sont des idéaux qu'on ne saurait nier ; mais ils perdent leur valeur si l'homme ne parvient au stade nouveau qu'à l'état de fragment de soi même, ayant laissé dans l'ombre de l'inconscient tout ce qui constitue son arrière-plan et forme l'essentiel, l'ayant abandonné à l'état primitif, disons même de barbarie[150]. »
Selon lui, donc, le seul « progrès » qui vaille, la seule chose qui puisse permettre aux humains de dépasser le stade de la « barbarie », passe non pas par l'affirmation du moi, ni par son effacement, mais par son décentrement, c'est-à-dire la relativisation de son importance, ceci au prix d'une confrontation avec l'inconscient qui peut se révéler longue - s'étendant sur plusieurs années - et même pénible - car ponctuée d'errements - mais finalement salutaire, car authentiquement émancipatrice.
Dans les faits, les théories de l'inconscient (parmi lesquelles celles de Jung) vont connaître une réception beaucoup plus faible que les sciences cognitives et le comportementalisme, approches héritées du darwinisme social et de la philosophie utilitariste puis importées des États-Unis. Jung lui-même en exprime le regret lors d'un entretien donné en 1957 à un psychologue américain : « En Amérique, vous êtes très en avance en ce qui concerne la technique mais en psychologie, vous avez cinquante ans de retard. Simplement, vous n'avez pas compris. C'est un fait. »[180],[181]. Aux États-Unis puis en Europe, de nombreux psychologues comportementalistes se mettent au service des entreprises et des organismes publics afin d'aider les « individus » à s'adapter autant que possible aux cadences et aux méthodes exigées par le monde moderne et - in fine - se mettre au service du néolibéralisme[182].
Parmi les théoriciens du néolibéralisme les plus influents figurent les économistes Friedrich Hayek et Milton Friedman. Le premier est un fervent défenseur de l'individualisme[183], tout comme le second qui déclare : « le monde avance grâce à des individus qui poursuivent leur propre intérêt »[184]. Or, durant les années 1980, sous l’impulsion de Ronald Reagan, président des États-Unis, et de Margaret Thatcher, Première ministre britannique, et plus encore durant la décennie suivante, après la fin du communisme, le néolibéralisme ne rencontrera plus aucun adversaire idéologique et gagnera l'ensemble de la planète[185].
Mais peu avant, en 1979, l'Américain Christopher Lasch aura contesté les présupposés des néolibéraux, au motif que l'individualisme ne garantit nullement que les marchés s'effectuent de façon rationnelle, ainsi qu'ils le prétendent, mais qu'il constitue au contraire l'origine de la « société de consommation » et de tous les comportements irrationnels que celle-ci induit ; selon lui : la montée en puissance du narcissisme, la culture de l'instant, l'achat compulsif et la consommation ostentatoire[186]... lesquels, avancera t-il plus tard, constituent « l'exact contraire de ce que l'on entend en général par le mot "progrès" »[187].
Du « progrès » à la prospective
En 1957, Gaston Berger et André Gros fondent la revue Prospective et le centre du même nom. La prospective se présente comme une discipline visant à préparer le futur par une approche rationnelle (à la différence, par exemple, des auteurs de romans d'anticipation) et holistique. Par là-même, on entend œuvrer de façon à ne pas être surpris par les innovations techniques mais à anticiper leur émergence et à préconiser alors toutes sortes de mesures politiques et économiques, afin qu'il soit plus facile aux humains de s'y adapter.
Importée des États-Unis, l'expression « recherche et développement » se répand en Europe durant les années 1960 dans le monde du management. Elle signifie que le progrès technique n'est plus initié exclusivement par des ingénieurs financés par l'État mais également par des entreprises privées, afin de se montrer plus concurrentielles (lire infra la théorie de l'innovation par Schumpeter).
Progrès « déshumanisant »

En 1956, menant une réflexion de fond sur les concepts d'humanité et de progrès après Hiroshima et Auschwitz, le philosophe autrichien Günther Anders estime qu'en regard de ses réalisations techniques, l'être humain est « dépassé, « obsolescent »[188],[189].
Il développe le concept de « honte prométhéenne »[190], désignant par là le sentiment que l'homme éprouve lorsqu'il se compare à ses productions, ne supportant pas l'idée que, contrairement à elles, il ne relève pas du processus de fabrication rationalisé qui leur a donné naissance. L'homme moderne a honte de devoir son être à la nature et non à un processus technique, il a honte d'avoir évolué, progressé, « naturellement » « d'être devenu plutôt que d'avoir été fabriqué », résume Anders. Ainsi, selon lui, la mutation de l'humanité correspond à une volonté inconsciente de supprimer tout obstacle naturel par des moyens techniques, afin de mettre un terme à la honte de se savoir un « produit de la nature ».
L'analyse d'Anders passe relativement inaperçue (son livre ne sera traduit en français qu'en 2002[191]) mais selon le philosophe Hicham-Stéphane Afeissa, elle préfigure l'apparition de l'idéologie transhumaniste, à la fin du siècle : décrivant ce qu'il appelle « l'homme sans monde »[192], le philosophe met en garde contre la montée d'un « monde sans homme », sans humanité, dépourvu de sensibilité et de sens critique, à l'image du robot et du cyborg qui constituent ses nouveaux modèles[193].
Technique « désacralisante » mais « sacralisée »
Après la Seconde Guerre mondiale, plus particulièrement durant les années 1950, alors que les pays européens entrent dans une période de forte croissance économique, quelques intellectuels entendent démontrer les arrière-plans de la « société de consommation » et démystifier le progrès, affirmant d'une part qu'il constitue sans doute une garantie de confort matériel mais nullement une garantie de mieux-être ; d'autre part, qu'il ne profite qu'à quelques-uns et qu'il accentue même les inégalités sociales. Ils se demandent alors pourquoi de tels effets négatifs perdurent et que signifie au fond l'expression « on n'arrête pas le progrès » ?
Jacques Ellul est de ceux-là. Selon lui, le nœud du problème, c'est le « progrès technique », plus exactement le fait que « la technique » en soi (et non pas « les techniques ») est devenue au fil des générations l'objet d'une vénération inconsciente et collective. En 1954, La Technique ou l'Enjeu du siècle constitue l'un des premiers ouvrages fondateurs de la pensée technocritique[Sp 51]. L'auteur conçoit la technique comme un phénomène autonome (la marge de manœuvre des humains pour le contrôler est de plus en plus limitée[Sp 52]). À la différence de l'historien américain Lewis Mumford, qui s'inquiète des effets du machinisme sur la vie spirituelle et culturelle (Le Mythe de la machine, 1967), Ellul considère que la question du progrès technique dépasse largement celle des équipements matériels (les « technologies »), elle englobe également les moyens immatériels, tout ce par quoi les humains repoussent toujours plus les limites de la rationalisation. En un mot : les méthodes, au premier rang desquelles viennent la division rationnelle du travail, le management, le marketing, les relations publiques... tout ce qui concerne la recherche de l'efficacité maximale, dans n'importe quel contexte :
« La préoccupation de l'immense majorité des hommes de notre temps, c'est de rechercher en toutes choses la méthode absolument la plus efficace. »[Sp 53]
Conséquence ultime de son raisonnement, Ellul estime que la technique ne peut plus se définir comme « un ensemble de moyens permettant d'atteindre tel ou tel but », que ces moyens soient « matériels » ou « immatériels » : elle est devenue une fin en soi. Et il en va ainsi, explique t-il, parce que les humains sacrifient tout à l'autel de l'utilité et de la nécessité. La technique constitue un facteur qui détermine tous les autres, y compris le capitalisme : « Il est vain de déblatérer contre le capitalisme, dit-il, ce n'est pas lui qui crée ce monde, c'est la machine. »[Sp 54]. Or s'il en est ainsi, poursuit-il, c'est parce que la technique est sacralisée :
« Le sentiment du sacré et le sens du secret sont des éléments sans lesquels l'homme ne peut absolument pas vivre. Or l'invasion technique désacralise le monde[n 12] dans lequel l'homme est appelé à vivre. Pour la technique, il n'y pas de sacré, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de tabou. Et cela provient justement du (fait qu'elle est devenue un phénomène autonome). (...) La technique est désacralisante car elle montre, par l'évidence et non par la raison (...) que le mystère n'existe pas. (...) L'homme qui vit dans le milieu technique sait bien qu'il n'y a plus de spirituel nulle part. Et cependant, nous assistons à un étrange renversement ; l'homme ne pouvant vivre sans sacré, il reporte son sens du sacré sur cela même qui a (désacralisé la nature) : la technique. Dans le monde où nous sommes, c'est la technique qui est devenu le mystère essentiel[Sp 55]. »
Ellul reprendra cette analyse en détail plus tard dans deux ouvrages, Métamorphose du bourgeois (1967) et Les nouveaux possédés (1973), arguant - comme Schmitt et Löwith l'ont fait avant lui - que ce que l'on appelle « modernité », « bonheur », « progrès », « humanisme », « sécularisation »... sont des concepts apologétiques directement calqués de la culture chrétienne. Selon lui, l'idée de progrès est profondément religieuse.
« Progrès technique » versus « progrès social »


On a vu précédemment que, dans le cadre de l'économie capitaliste, l'accélération du progrès technique se manifeste par une tendance prononcée des entreprises à innover de façon incessante, ceci afin de rester compétitives sur le marché ; et que, pour rendre leurs produits et leurs services toujours plus attractifs, elles recourent à différentes techniques de communication de masse, principalement la publicité. On a vu également que - toujours en régime capitaliste - le moi tend à être constamment survalorisé : non seulement du côté du producteur (la figure du « patron » se mue ainsi peu à peu en celle de « l'entrepreneur », « celui qui entreprend ») mais aussi du côté du consommateur, pour qui tout équipement procurant du confort matériel (automobile, appareils électroménagers, téléphone, etc) tend à être assimilé à la fois au progrès technique et au progrès social.
Dès l'après-guerre, différents intellectuels s'efforcent d'analyser le sens de cet amalgame. En France, le philosophe Jean Baudrillard explique dans les années 1960 que la différence essentielle entre la réclame et la publicité, c'est que la première se limite à vanter les mérites de tel ou tel produit tandis que la seconde promeut tout un style de vie : elle élève l'acte de consommer à un signe de distinction sociale[194]. S'inscrivant dans le sillage des théories de Marx sur le « fétichisme de la marchandise », de Lukács sur la réification et de Debord sur La Société du spectacle, Baudrillard explique comment, alors que les États-Unis sont devenus la première puissance économique mondiale après 1945, l'American Way of Life tend à être érigé en modèle de vie exemplaire en Europe occidentale et que le paradigme de la croissance économique s'impose dans l'ensemble du monde.
Cette montée en puissance simultanée de l'homo œconomicus et de l'individualisme a des conséquences considérables sur l'évolution des rapports sociaux : elle mène à ce que, dans les années 1950, le philosophe Henri Lefebvre appelle la « société de consommation ». L'anthropologue français Louis Dumont en tire l'hypothèse que, bien qu'étant théoriquement fondées sur des principes égalitaristes, les sociétés occidentales en viennent à tolérer de plus en plus les inégalités sociales et même à leur trouver une légitimation. Dès 1950, dans un livre qui connait un vif succès dans son pays[195] mais qui ne sera traduit qu'une quinzaine d'années plus tard en France[196], le sociologue américain David Riesman estime quant à lui que ce phénomène ne se traduit pas seulement par un accroissement des inégalités entre nations (pays industrialisés et pays du Tiers Monde) et au sein d'un même pays ; il s'exprime également par une tendance prononcée, chez les couches sociales favorisées, la middle class, à une quête incessante de confort et par suite à un conformisme croissant à l'ordre économique existant, dont elle espère sans cesse qu'il lui procure ce confort. En 1967, dans son livre Métamorphose du bourgeois, Jacques Ellul considère lui aussi que l'idéologie du progrès technique est entièrement fondée sur ce qu'il appelle « l'idéologie du bonheur »[197].
Progrès « désenchanteur »
Commentant en 1969 les événements politiques de l'année précédente, au cours de laquelle la jeunesse des pays industrialisés a manifesté dans la rue son rejet des formes traditionnelles d'autorité (Dieu, les parents, les patrons, les intellectuels...), le sociologue Raymond Aron évoque, en pastichant le titre de Georges Sorel, les « désillusions du progrès » :
« Après un quart de siècle de croissance économique, la société moderne affronte de nouveaux assauts : les uns, disciples fidèles ou infidèles de Marx, dénoncent ses échecs relatifs ou partiels, les îlots de pauvreté au milieu de la richesse, l'inégalité excessive de la répartition des revenus ; les autres, dont l'inspiration remonte à Jean-Jacques Rousseau, voire aux romantiques, vitupèrent contre la barbarie de la "civilisation industrielle", la dévastation de la nature, la pollution de l'atmosphère, l'aliénation des individus manipulés par les moyens de communication, l'asservissement par une rationalité sans frein ni loi, l'accumulation des biens, la course à la puissance et à la richesse vaine. (...) Tout se passe comme si les désillusions du progrès, créées par la société moderne (...) étaient éprouvées par la jeune génération avec une telle intensité que l'insatisfaction endémique s'exprime en révolte[Sp 56]. »
Symbole de paix ?


La même année, cependant, le « progrès technique » présente une image enchanteresse car le monde entier a les yeux rivés sur les écrans de télévision : l'Américain Neil Armstrong marche sur la Lune. Sur une plaque commémorative fixée au pied de son vaisseau spatial sont écrits ces mots : « Nous sommes venus en paix pour toute l'Humanité ». Les grands médias, eux aussi, présentent l'événement comme un symbole de progrès et de paix dans le monde. D'autres astronautes, qui se rendent à leur tour sur la Lune, soulignent que, depuis là-bas, la Terre parait petite et fragile et que les frontières sont invisibles. Mais ils mettent au second plan le fait que leur pays est en guerre au Viêt Nam et que leurs voyages résultent de la volonté des États-Unis d'exercer une suprématie technologique, dans le cadre de la rivalité idéologique qui les oppose à l'Union soviétique[198].
Pour comprendre ce décalage entre les propos et les réalités, et sans remonter nécessairement à la célèbre citation de Clausewitz, dans les années 1820 (« la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens »), il faut revenir à l'origine de l'association « progrès » / « paix dans le monde », en 1948, quand a été signée la Déclaration universelle des droits de l'homme à l'ONU sous l'impulsion des Américains[199], trois ans après que ceux-ci ont lancé leurs bombes atomiques sur les villes d'Hiroshima et Nagasaki. Les États-Unis deviennent la première puissance économique mondiale parce qu'ils tirent un profit financier de l'aide qu'ils accordent aux pays d'Europe pour se remettre des dommages subis pendant la Seconde Guerre mondiale. « Paix » et « croissance économique » étant donc étroitement liées, on comprend le sens de la formule prononcée à la fin du siècle par Kofi Annan, secrétaire général des Nations unies : « Sans progrès, il n'y a pas de paix possible. Sans paix, il n'y a pas de progrès possible »[200].
Mais à la fin des années 1960 (précisément à l'époque où les Américains marchent sur la Lune), leurs entreprises multinationales impactent de plus en plus sur les décisions politiques à l'échelle planétaire[201]. Un nouveau type de guerre apparaît alors comme le nouvel aiguillon du « progrès », alias la croissance économique : la « guerre économique ». Le financier français Bernard Esambert forge ce concept pour désigner entre autres la concurrence exacerbée entre entreprises, qui se manifeste par des pratiques agressives (espionnage industriel, dumping…)[202].
Vingt ans plus tard, après la dislocation de l'URSS et la fin du communisme, l'idéologie néolibérale s'impose sur toute la planète. Esambert ainsi que Christian Harbulot (un ancien militant maoïste reconverti dans la stratégie d'entreprise et l'intelligence économique) popularisent l'expression « guerre économique »[203]. Les innovations technologiques étant devenues l'élément le plus déterminant de l'économie (lire plus haut les théories de Schumpeter), les entreprises se focalisent sur elles pour conquérir sans cesse de nouveaux marchés.
En 2002, l'économiste Christian Barrère résume ainsi cette analyse :
« toute institution est lieu de relations de pouvoir, le marché comme l’entreprise sont lieux de telles relations, donc de luttes. (...) Les désaccords marchands ne résultent pas de cas particuliers, de configurations « anormales » de monopole ou de pratiques « illégitimes » de collusion, sur le modèle des affrontements qui résulteraient d’abus de souveraineté. Ils sont le lot normal du fonctionnement marchand. »[204]
Cette critique du capitalisme se démarque sensiblement de celle des militants marxistes ou socialistes (selon qui les principaux responsables des crises économiques sont les patrons ou les actionnaires, censés ne pas être vertueux) : le système est intrinsèquement vicié. Dans ce contexte, en tout cas, la rhétorique progressiste, pacifiste, droit-de-l'hommiste, humaniste, républicaniste... est elle-même en crise. Selon l'écrivaine Evelyne Pieiller, elle ne relève plus que des « bons sentiments » et - à terme - tend à subvertir totalement l'idée de démocratie :
« Réduire l’idéal de progrès humain à un manuel actualisé de bonne conduite n’est pas seulement un exemple égayant de méthode Coué. C’est surtout une vision de l’homme passablement conservatrice : en assimilant le progrès à l’élimination du « négatif » intérieur – ce qui incline l’humain à la domination, à l’exclusion –, ce progressisme autoproclamé suppose que le « mal » relève avant tout de vilains penchants innés, qui s’inscriraient tout naturellement dans la société[205]. »
De fait, non seulement la guerre économique brise la paix sociale (le chômage de masse s'accentue, la précarité s'institutionnalise, les inégalités se creusent...) et génère une crise écologique majeure mais les conflits armés se multiplient sur la planète, avec leurs cortèges de violations des droits de l'homme. Malgré la création en 2002 de la Cour pénale internationale - juridiction chargée de juger les personnes accusées de génocide, de crime contre l’humanité et de crime de guerre -, la communauté internationale reste impuissante face à des exactions telles que les massacres de milliers de civils perpétrés par le régime syrien à partir de 2011, l'occupation de la Crimée par les soldats russes en 2014.
Progrès « accéléré »

En 1965, l'ingénieur américain Gordon Moore, co-fondateur de la société Intel, premier fabricant mondial de semi-conducteurs, assure que la puissance de calcul des ordinateurs doublera chaque année ; prédicat nommé par la suite « loi de Moore ».
L'année suivante, Jacques Ellul proclame : « chaque jour, mille nouveautés surgissent. Un monde technicisé se construit autour de nous à une vitesse croissante. Une organisation toujours plus rigoureuse, précise, contraignante, exacte, multiple, enserre dans un filet aux mailles toujours plus denses chaque homme à chaque instant de sa vie. Et nous n'y pouvons rien. Personne ne conduit et ne maîtrise cette prolifération. L'opération déclenchée il y a un siècle et demi se poursuit d'elle-même. Personne n'en est plus responsable. »[206].
Un peu plus tard, Bernard Charbonneau qualifie l'accélération du progrès technique de cercle vicieux : plus les innovations techniques peuplent la vie quotidienne et plus les individus se sentent dans l'obligation morale de s'y adapter, de suivre les modes, de ne s'enraciner nulle part. « Quand tout change de plus en plus vite, on habite un maelström »[207]. Par la suite, Pierre-André Taguieff reprendra cette idée à travers son concept de bougisme (lire infra).
Mais à l'opposé de cette approche fataliste, d'autres font l'apologie de l'accélération du progrès, en particulier, outre Atlantique dans les années 1970, les premiers théoriciens transhumanistes. C'est le cas notamment du roboticien canadien Hans Moravec à l'occasion d'une série d'articles où, s'appuyant sur la loi de Moore, il prédit l'essor exponentiel de « l'intelligence artificielle ». À la fin du siècle le futurologue américain Raymond Kurzweil pousse encore plus loin la réflexion[208], et au début du siècle suivant, il estimera que, face à cette accélération incessante des innovations techniques et à leurs interconnexions, l'humanité elle-même, telle qu'on se la figure aujourd'hui, est appelée à disparaître[209] (lire infra).
Progrès « contre-productif »
Au début des années 1970, le développement de l'électronique est tel que la capacité des ordinateurs augmente de façon exponentielle. En 1971, est commercialisé le tout premier microprocesseur de l'histoire , Intel 4004, dont la puissance de calcul excède 90 000 opérations par seconde.
Durant la décennie, toutefois Ivan Illich élabore le concept d’« effet de seuil » pour avancer l'idée de l'ambivalence du progrès technique. Prenant l'exemple de l'automobile, objet censé faire gagner du temps à ses utilisateurs, il estime que son développement s'opère au détriment de la vitesse de déplacement (le trop grand nombre de voitures provoque la prolifération des embouteillages), donc des usagers eux-mêmes ; surtout si l'on intègre le temps de travail qui leur est nécessaire pour gagner les sommes leur permettant d’acquérir les véhicules puis de les entretenir (carburant, parking, réparations, assurances, etc.)[210].
Illich n’applique pas seulement le concept d’« effet de seuil » aux objets matériels mais aussi aux services. Il élargit en effet son raisonnement à l’École (Une société sans école[211]) et à la santé (Némésis médicale[212]) pour décrire ce qu'il appelle « les effets contre-productifs » de l’institution scolaire et de l’entreprise médicale.
L'idée de contre-productivité du progrès technique sera par la suite reprise par d'autres intellectuels, notamment en 1988 par le journaliste français Noël Mamère, critiquant la société de l'information, dans une formule désormais célèbre : « trop d'informations tue l'information »[213].
Source de catastrophes
Avec le développement des centrales nucléaires émerge une prise de conscience des dangers qu'une exploitation irraisonnée des ressources de la Terre fait courir sur l'environnement, eu égard au caractère fini de notre planète. Elle donne lieu à l'apparition de différents courants dans le domaine de l'écologie qui vont de l'approche confiante, s'inscrivant encore dans l'idéal du progrès (notion de développement durable, susceptible de concilier environnement, aspects sociaux, et économie) à l'approche catastrophiste (notion d'effondrement ayant pour origine un rapport du Club de Rome publié en 1972[214]).

Mais les craintes d'un emballement du progrès technique ne se limitent pas aux considérations écologiques, elles portent également sur les répercussions sur le plan psychologique d'une évolution exponentielle des techniques, en particulier l'informatique. En 1970, dans son livre Le Choc du futur, le sociologue américain Alvin Toffler anticipe la société de l'information et livre un pronostic pessimiste : « le choc du futur est le stress et la désorientation provoqués chez les individus auxquels on fait vivre trop de changements dans un trop petit intervalle de temps »[215].
En 1977, Jacques Ellul estime que toutes les postures progressistes, non seulement celles émanant de la sphère technoscientifique mais aussi les discours qui vantent l'émancipation par des moyens techniques (qu'ils émanent du monde entrepreneurial et de la sphère politique ou au contraire de la génération post-68 et du mouvement écologiste), sont voués à l'échec, de nature incantatoires et déconnectés du réel. La raison en est selon lui que l'idéologie technicienne est désormais si prégnante que s'est érigé un système englobant, de nature totalitaire, le « système technicien », qui - insidieusement et apparemment sans douleur - façonne les mentalités : non seulement dans le monde du travail mais aussi celui de la vie privée et des loisirs :
« C'est maintenant la technique qui opère le choix ipso facto, sans rémission, sans discussion possible entre les moyens à utiliser… L'homme (ni le groupe) ne peut décider de suivre telle voie plutôt que la voie technique … ou bien il décide d'user du moyen traditionnel ou personnel … et alors ses moyens ne sont pas efficaces, ils seront étouffés ou éliminés, ou bien il décide d'accepter la nécessité technique, il vaincra … soumis de façon irrémédiable à l'esclavage technique. il n'y a donc absolument aucune liberté de choix[Sp 57]. »
En 1979, le philosophe allemand Hans Jonas se montre également très inquiet face à ce qu'il appelle le pouvoir de la technoscience mais il estime que celui-ci peut et doit être régulé par les humains au nom de principes éthiques qu'ils privilégieraient à tout autre principe, notamment celui des intérêts marchands[Sp 58]. Il anticipe ainsi la notion de « principe de précaution », qui se développera dans les années 1990.
Acclimatation aux risques
Durant les années 1980, le progrès technique est présenté comme une fatalité, un phénomène inéluctable. Ainsi, en 1986, le sociologue allemand Ulrich Beck affirme que, du fait que celui-ci n'a jamais été unanimement considéré comme une idéologie, nous vivons désormais sous sa coupe, dans « la société du risque »[Sp 59].
Ellul estime que « tout progrès se paie », ceci d'autant plus que « le progrès technique soulève à chaque étape plus de problèmes (et plus vastes) qu'il n'en résout ; les effets néfastes du progrès technique sont inséparables des effets favorables ; tout progrès technique comporte un grand nombre d'effets imprévisibles »[Sp 60]. Toutefois, il considère que malgré les innombrables et considérables risques, le discours colporté sur « les technologies » est « bluffant » et l'emporte sur la conscience ou l'intuition du danger.
Progrès « éclaté »
Dans les années 1990, le philosophe finlandais Georg Henrik von Wright estime que le mythe du progrès n'est mort qu'en apparence car il survit sous d'autres formes et d'autres mots : « Si le mythe est mort, il vit toujours dans des formes dérivées qui identifient le progrès soit à la croissance économique, soit à la démocratie formalisée. Ces restes pétrifiés d'une croyance originairement optimiste continuent d'exercer une forte influence comme forces de motivation. Ils motivent les actes et les décisions des technocrates d'un côté et des politocrates de l'autre »[Sp 61].
XXIe siècle
En ce début de siècle, les écarts de richesse entre les individus d'une même nation et entre les nations ne cessent de se creuser ; les droits de l'homme et la démocratie sont bafoués dans de nombreuses régions, notamment en Russie et en Chine ; et le réchauffement de la planète se confirme, tandis que des catastrophes écologiques se multiplient, la plus spectaculaire étant l'explosion de la centrale de Fukushima, au Japon, en 2011... Dans ce contexte, l'idée de progrès devient de plus en plus difficile à défendre et le mot tend à s'estomper.
Usure du mot en politique

Dans le milieu politique, le mot « progrès » est beaucoup moins usité que par le passé[216]. Toutefois lorsqu'il l'est, on en fait en général l'éloge. Ainsi en janvier 2012, au détour d'un échange avec des journalistes consacré aux présidentielles, Jean-Luc Mélenchon, président du Front de gauche, lâche : « Demain, nous vaincrons la mort. (...) Cette espérance humaine, dans la foi dans l'avenir, dans le progrès, aller au-delà de soi, voilà ce qui compte »[217]. Et en novembre 2013, lors du forum « Le progrès face aux idéologies du déclin » organisé par le Parti socialiste[218], Laurence Rossignol déclare : « Le progrès n'a pas de limites. Derrière, on passe les frontières et derrière les frontières on trouve un champ infini. Et le progrès, il est dans le fait de passer nos frontières et de passer nos limites »[219]. La « Fondation pour l'Innovation politique », un think tank qui se proclame « libéral, progressiste et européen », affirme : « Le progrès, c'est nous ! »[220].
Beaucoup plus rarement, le mot « progrès » est utilisé pour pourfendre cette fois l'idée qu'il véhicule et développer l'idée que « c'était mieux avant ». C'est le cas notamment de Patrick Buisson (ancien conseiller du Président de la République, Nicolas Sarkozy, puis de Nicolas Dupont-Aignan[221]), qui déclare en 2018 : « le progrès a vidé l'homme du sacré » et « détruit les grands récits qui donnaient du sens à la vie et à la souffrance humaine » (...) ; « il est clair aujourd'hui que la promesse fondatrice du progrès qui était le bonheur n’a pas été tenue. Jamais l’homme soi-disant émancipé et libéré n’aura été aussi dépendant » (...). « C'est au nom de la théodicée du progrès (...) que des millions de vies ont été immolées sur l'autel de cette croyance érigée en religion séculière par le stupide XIXe siècle »[222].
Signification et conséquences de l'usure du mot
Même si, au sein de la classe politique, le mot « progrès » est moins présent qu'auparavant, dans la grande majorité des cas, celle-ci promeut l'idée progressiste sous d'autres vocables et, selon l'essayiste Robin Rivaton, « ce retour de la notion de progrès (peut) s’interpréter dans une optique défensive comme une réaction au pessimisme ambiant », voire une sorte de déni de réalité[223]. La situation est en effet paradoxale : alors que la crise écologique s'accentue et que l'impact des réseaux informatiques sur la sphère politique elle-même se fait plus pressant[224],[n 13], cela ne modifie guère les modes de vie ni n'infléchit les programmes électoraux. Les théoriciens de la décroissance, qui prônent la simplicité volontaire, restent sans grande influence[225]. À l'inverse, la doctrine néo-libérale, dominante sur l'ensemble du globe depuis la fin de la Guerre froide, continue de prévaloir et, pour l'ensemble du personnel politique, la croissance économique demeure l'objectif premier.
Le contexte ne prêtant pas à l'optimisme, de nouveaux vocables apparaissent, jugés plus neutres, notamment « développement » et « innovation » (lire supra). Le mot « humanisme » lui-même perd de son aura tandis qu'émerge aux États-Unis une nouvelle idéologie, le transhumanisme, axée sur l'essor exponentiel des technologies. Les mots changent, donc, mais le rêve progressiste reste intact et vivace, ce qui rend sa critique d'autant plus problématique. D'autant qu'un élément brouille singulièrement la réflexion : la montée en puissance de l'intelligence artificielle (IA). Depuis son origine, en effet, l'idéologie du progrès se fonde sur l'idée que l'homme est capable de maîtriser de plus en plus la nature et sur la fierté qu'il éprouve de cette supériorité sur les autres espèces animales. Or voilà qu'avec l'IA, les spéculations prolifèrent - tant dans les récits ou films de science-fiction que dans les essais philosophiques - quant à savoir si les robots ou cyborgs pourront un jour accéder à la conscience, éprouver des émotions et finalement se substituer aux humains. C'est la prédiction faite par les théoriciens transhumanistes et le vœu des technophiles ; c'est en revanche la crainte des penseurs technocritiques, lesquels restent globalement minoritaires.
Voyons à présent l'inventaire des critiques formulées au XXIe siècle.
Réflexions contemporaines

On a vu précédemment que l'idée de progrès a émergé au début du XVIIe siècle et que c'est durant la seconde moitié du XVIIIe siècle, quand l'usage du mot s'est généralisé, qu'elle a commencé à être critiquée, mais toujours de façon assez marginale. Les effets pervers du « progrès technique » se multiplient par conséquent sans que, dans le même temps et les mêmes proportions, il soit fait état, par exemple, de progrès social, culturel ou spirituel.
Ce décalage s’accentue au XXIe siècle car "les technologies" occupent une place majeure dans la vie quotidienne et l’imaginaire collectif, qui confine parfois à l'addiction[n 14]. Globalement, malgré les problèmes tels que la raréfaction des ressources naturelles ou le réchauffement climatique, et malgré des initiatives populaires telles que la marche pour le climat, le débat politique reste centré sur la question du pouvoir d'achat et, ce faisant, la société de consommation ne cesse se renforcer : non seulement l’idéologie de progrès n’est critiquée que de façon marginale (lire infra) mais elle continue de se propager sous la forme de nouveaux vocables.
Nouveaux vocables
En France et dans les pays francophones, l'expression « le progrès » s'estompe au profit de nouveaux mots, en premier lieu « la croissance », « le développement » et « l'innovation », tandis que le phénomène internet est quasi unanimement qualifié de révolution : « la révolution numérique ».
« La croissance »
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les dirigeants des pays d'Europe se sont engagés dans d'importantes politiques de reconstruction : après les dommages subis, il fallait « remettre l'économie en marche » et l'objectif de croissance s'est mué rapidement en impératif (lire supra). Après le temps des privations, les populations ont pu d'autant plus s'adonner à la consommattion de biens matériels que celle-ci leur devenait financièrement accessible. Conçues puis perfectionnées pour la plupart aux USA, les nouvelles techniques de production autorisaient en effet une réduction sensible des coûts. Ainsi s'est amorcée une période de trois décennies d'expansion continue (qualifiée par la suite de « Trente glorieuses »), opérée non plus au nom de la reconstruction mais de la modernisation : être « progressiste » revenait à être « moderne », « vivre avec son temps » , ne pas le remettre en question[226]. Ainsi, « le progrès » est devenu un mode de vie axé sur une quête permanente de confort matériel (appareils électro-ménagers, automobile, télévision, supermarchés, centres commerciaux, etc) doublée d'une totale insouciance en regard des dommages écologiques et sociaux causés par cette explosion de la consommation[227].

Alors que, dès la fin de la Guerre, sous l'impulsion des États-Unis (et notamment d'un discours du président Truman en 1949), l'idée de progrès a déjà pris le sens de « développement économique » (lire ci-dessous), elle est désormais défendue de façon implicite par des millions de consommateurs, non plus par des discours idéologiques mais par leurs comportements. De même, au motif répété que « la croissance » est « créatrice d'emplois », elle est devenue le premier leitmotiv des politiciens, toutes sensibilités confondues[228]. Pour continuer d'être stimulée, cette « croissance » nécessite un dispositif de propagande continue et c'est la publicité qui assure ce rôle (lire infra) : on désigne par "productivisme" l'idée selon laquelle l'économie n'est pas guidée par la consommation (les besoins) mais où la publicité crée artificiellement des besoins (désirs) de sorte à stimuler indéfiniment la production, "coûte que coûte", quitte à générer des surplus, donc du gaspillage. Et c'est précisément en cela, en cette « fuite en avant », soutenait le philosophe Henri Lefebvre, que l'idéologie de la croissance constitue une variation de celle du progrès[229]. Ellul précisait que cette course au gaspillage était appelée à s'accroître du fait qu'en raison du « progrès technique », les coûts de production diminuent[230].
Aujourd'hui, le caractère idéologique du mot « croissance » est âprement discuté chez les économistes qui ne conçoivent pas « le progrès » comme une idéologie : certains affirment que « la croissance et le progrès social ne sont pas incompatibles »[231] ; d'autres se demandent si « le progrès technique est nécessairement source de croissance »[232] ; d'autres encore ne parviennent pas à se positionner[233].
« Le développement »
A la fin du XXe siècle, le mot « développement » s'est imposé dans le langage courant (lire supra) et a donné naissance à toutes sortes d'expressions : « recherche et développement », « développement économique et social », « développement personnel », « pays en développement », « environnement de développement »... et surtout « développement durable », qui connait un vif succès.
Analysant l'impact du mot « développement », l'universitaire suisse Gilbert Rist considère que, depuis la fin de la Première Guerre mondiale, « progrès » et « développement » participent d'une seule et même idéologie : l’évolutionnisme social[234]. Selon lui, le système des mandats établi en 1919 par la Société des Nations a rendu légitime l’intervention des nations industrialisées en Afrique et en Asie, au nom de « la civilisation », ce mot finissant par devenir à son tour synonyme de « progrès ».

« L’analyse étymologique et sémantique du terme complète ici son approche socio-historique. Rist montre ainsi qu’il porte nombre d’implicites et d’affects : son usage fait référence à une métaphore organiciste qui affecte au développement une directionnalité positive, une continuité et une irréversibilité. En appliquant les principes naturels de la croissance organique à des institutions sociales et à l’Histoire à travers le concept de développement, force est de constater que celui-ci bascule dans le champ du mythe et du religieux : on incante plus qu’on ne prouve et ne pratique le développement. Comment alors l’examiner, le critiquer voire le remettre en question, puisqu’il est porteur d’idéaux et d’imaginaires que nous partageons tous ? »[235]
Dans le contexte de la crise environnementale, l'expression « développement durable » (forgée en 1987 dans le Rapport Brundtland rédigé pour le compte de l'ONU) connaît un succès considérable[236], valorisée principalement par les chefs de gouvernements et les entrepreneurs. Elle résume une nouvelle conception de la croissance économique, pensée dans une perspective de long terme qui intègre les contraintes liées à l'environnement, elles-mêmes abordées en termes de risques.
Non seulement la thématique du progrès perdure à travers le concept de « développement » mais la majorité des réflexions ayant cours dans les milieux économiques et institutionnels portent sur cette question : autour de quel projet de société concilier « progrès » et « développement durable »[237],[238],[239] ?
Certains assimilent l'expression l'expression « développement durable » à un oxymore et l'apparentent à l'écoblanchiment : ils y voient davantage un moyen pour le milieu économique de tirer profit de la crise environnementale que de contribuer à résoudre celle-ci. Dès les années 1990, l'anthropologue américano-colombien Arturo Escobar inaugure le concept d'« après-développement » (encountering development)[240], qui se structurera par la suite dans un nouveau courant de pensée, celui de la décroissance (lire supra).
« L'innovation »
Dans le sillage des analyses de Schumpeter, dans la première moitié du XXe siècle (lire supra), le terme « innovation » tend à supplanter le terme « progrès » mais plusieurs intellectuels contestent la pertinence de ce rapprochement.
En 2000, le philosophe Jean-Michel Besnier estime que l'innovation est au progrès ce que le présentisme est au progressisme. Il écrit :
« Qu'en est-il au juste de cette "innovation" à quoi l'on incite tous azimuts dans le monde de l'entreprise ? A t-elle donc à voir avec l'idéologie du progrès dont on semblait deviner l'extinction prochaine ? Ce n'est pas sûr : elle témoigne bien davantage de ce souci du petit, si caractéristique du temps présent qui fuit comme la peste les "grands récits", c'est-à-dire les philosophies de l'histoire. Odyssée du médiocre dédiée au concours Lépine qui consacre l'invention du ruban adhésif prédécoupé ou du porte-clés sonore comme le triomphe de l'invention, là où l'on cherchait jadis à le surprendre dans l'utopie d'un Bacon ou les anticipations d'un Jules Verne : tel est notre présent. Innover n'est pas forcément progresser. Ce peut être tout au plus aménager le site d'une existence qui voudrait s'abstraire des vicissitudes du temps. De ce dernier point de vue, les technologies d'information et de communication, qu'on présente comme le foyer de toutes les promesses du XXIe siècle, seraient mal placées au palmarès des progrès, elles qui écrasent le temps et l'espace faute desquels la pensée anticipatrice s'abolit[241]. »
En 2014, l'historienne américaine Jill Lepore écrit :
« Là où le progrès recherche une amélioration de la condition humaine, l’innovation ne se contente que de créer de nouveaux produits et de les lancer sur le marché. C’est pourquoi, l’innovation, c’est le progrès dénué des valeurs des Lumières. Nous aurions donc renoncé aux valeurs héritées des Lumières. Mais, en contrepartie de ce renoncement, nos outils techniques deviendraient de plus en plus sophistiqués. La sophistication technique s’est donc substituée à la recherche de sens[242]. »
En 2017, Étienne Klein fait état d'études menées avec le sociologue Gérald Bronner portant sur le glissement de sens entre les mots « progrès » et « innovation » :
« Il semblerait qu’on demande à l’innovation le maintien du monde: cela revient à une réthorique autour de l’érosion du temps: le temps dégrade, l’innovation permet de conserver un statu quo. C’est une contradiction majeure avec la philosophie des Lumières qui, elle, suppose une idée de progrès, de changement, d’évolution, de futur possible et désirable. »[243],[244]
« La révolution numérique »
En France, la plus ancienne occurrence de l'expression « révolution numérique » remonte à 1993[245]. Elle désigne le bouleversement sociétal provoqué dans le monde entier par l'essor de l'informatique et d'Internet et qui se traduit par de nouvelles formes de communication entre les individus : courriels, messagerie instantanée, sites, blogs, réseaux sociaux...
En comparaison avec les termes « développement » et « innovation », l'expression « révolution numérique » est peu décryptée. D'une part elle est régulièrement utilisée dans un sens laudateur, même lorsqu'il est fait état des risques que « le numérique » fait craindre[246] ; d'autre part et surtout, il semble admis qu'elle ne désigne nullement une construction idéologique mais un fait, ou un ensemble de faits, à savoir la concrétisation des idéaux progressistes du XVIIIe siècle : "démocratisation du savoir" (les idées ne viennent plus d'une autorité supérieure, telle l'Église ou l'État, mais de partout)[247] ; gain maximal d'efficacité dans leur transmission (qui devient quasi instantanée entre les émetteurs et les récepteurs) ; décloisonnement des domaines ; dimension planétaire des échanges...

Pour répandue qu'elle soit, cette expression n'en est pas moins ambigüe car le mot « révolution », comme la formule « révolution industrielle », induit l'idée d'un projet exclusivement émancipateur[n 15]. Le journaliste Xavier de La Porte ironise sur le fait que les personnalités politiques ne cessent de l'utiliser[n 16].
Cette expression est très utilisée dans le milieu entrepreneurial, lui-même acquis à l'idéologie progressiste[248], ainsi que le révèlent par exemple en 2018 les « sept résolutions pour une révolution numérique » du Cigref (Club informatique des grandes entreprises françaises), qui se dit déterminé à « créer les conditions, jusqu’au plus haut niveau de l’État, d’une conviction, partagée par les dirigeants des entreprises et des administrations publiques, de l’impérieuse nécessité de la réussite du numérique comme condition de la croissance de l’économie et de la création d’emplois[249]. »
Très rares, en définitive, sont les remises en question de « la révolution numérique » et ceux qui s'y risquent avancent essentiellement des arguments d'ordre économique. Selon eux, « le numérique » ne bouleverse aucunement les grands indicateurs macroéconomiques[250]. « Un mouvement qui n'apporte pas un surcroît de bien-être et qui n'est pas source de croissance ne peut être qualifié de révolution[251]. »
Crise du progrès technique
Les principales objections formulées contre le « progrès technique », les plus répandues, concernent les dommages causés sur l'environnement et les interrogations relatives aux manipulations effectuées sur le corps humain, notamment les manipulations génétiques. La notion même de progrès technique est donc en crise.
Ancien membre du Comité consultatif national d'éthique, le généticien et essayiste Axel Kahn explique cette crise par « une immense naïveté » :
« La crise du progrès est venue de ce que le XXe siècle est à la fois une illustration du progrès et une négation du progrès. C’est évidemment le siècle de la médecine, de la diminution de la mortalité infantile, de l’augmentation de la longévité, de la conquête de la Lune, de la conquête de Mars, de la conquête du génome, etc… c’est-à-dire des choses extraordinaires ; et puis c’est aussi le siècle de deux ou trois génocides, des bombes atomiques, de Tchernobyl, de la pollution, de l’augmentation de la température (planétaire)… c’est-à-dire - de plus en plus - le siècle où on se rend compte qu’il y a une discordance entre la persistance de l’augmentation des connaissances et des techniques qui en découlent, d’une part, et le sentiment que tout cela doit suffire à assurer une meilleure condition, un meilleur bien-être, pour l’homme (…). D’où vient cette crise du progrès ? D’une immense naïveté. (…) Les progressistes ont élaboré différentes hypothèses pour expliquer pourquoi les progrès des connaissances et des techniques devaient imparablement aboutir à un progrès pour l’homme. Et quand on réfléchit d’un point de vue philosophique extrêmement rationnel, tous ces arguments sont d’une extraordinaire faiblesse. (…) Pour que l’homme de plus en plus puissant soit également capable d’utiliser cette puissance au bénéfice des hommes (…), il faudrait qu’il y ait un accroissement de la sagesse au prorata de l’accroissement de sa puissance. (…) On a deux registres : celui des techniques et des sciences, qui est incroyablement cumulatif avec un effet boule de neige et dont on doit maîtriser l’usage éventuellement au bénéfice des autres à l’aide d‘une sagesse qui, elle, ne connaît pas du tout une évolution ayant la même cinétique. »[Sp 62]
Selon Axel Kahn, donc, la crise du progrès repose en premier lieu sur un retard du questionnement éthique par rapport à l'innovation technique, autrement dit sur une « crise des valeurs » (lire infra). Sans nullement contredire ce type d'approche, d'autres estiment que les causes de la crise du « progrès technique » sont inhérentes au perfectionnement même des techniques. On peut globalement retenir quatre catégories d'analyse.
La propagande du progrès
.jpg.webp)
La planète est de plus en plus peuplée et ses habitants de plus en plus demandeurs de confort matériel, donc d'énergie. En 1972, le rapport Meadows alertait sur les risques que cette quête de confort faisait peser sur l'environnement, posant la question des potentiels « limites de la croissance » sur Terre. À la même époque s'est développé le mouvement écologiste et d'autres signaux d'alarme ont été tirés : Rachel Carson, Paul Ehrlich, Barry Commoner, James Lovelock, Bernard Charbonneau, et beaucoup d'autres, ont fortement insisté sur le fait que la planète est un abri vulnérable. Mais, en cette période des « Trente Glorieuses », leurs messages sont restés pratiquement inaudibles.
Aujourd'hui, même si la possibilité de catastrophe environnementale est largement considérée comme une réalité, peu d'humains se prononcent en faveur d'un modèle de décroissance, considérant qu'une croissance sur Terre reste possible. Plus nombreux en revanche sont ceux qui, adeptes du concept de développement durable (lire supra) estiment que les réponses aux problèmes causés par la technique (notamment l'exploitation des énergies fossiles) ne peuvent être résolus que par de nouveaux moyens techniques (le solaire, l'éolien, etc.).
Il y a « crise du progrès » non pas au sens où l'idéal progressiste s'essouffle mais au contraire au sens où — sous de nouveaux vocables — il s'emballe : « on n'arrête pas le progrès » car nul ne se sent plus capable de l'arrêter[252].
Tentant d'expliquer cette perte de contrôle, certains penseurs technocritiques estiment que si la quête de confort matériel l'emporte sur le souci de préserver l'équilibre écologique — et celui de cultiver une vie spirituelle — c'est d'abord en raison de la prégnance et de l'efficacité des techniques publicitaires. C'est en tout cas ainsi que, dès 1944, Georges Bernanos analysait le caractère obsessionnel de cette quête de confort matériel :

Ici :Times Square, New York
« la plupart des besoins, constamment provoqués, excités par cette forme abjecte de la Propagande qui s’appelle la Publicité, tournent à la manie, au vice. La satisfaction quotidienne de ces vices portera toujours le nom modeste de confort, mais le confort ne sera plus ce qu’il était jadis, un embellissement de la vie par le superflu, le superflu, devenant peu à peu l’indispensable (…). Comment voulez-vous qu’un homme formé, dès les premières heures de sa vie consciente, à ces innombrables servitudes, attache finalement grand prix à son indépendance spirituelle vis-à-vis d’un système précisément organisé non seulement pour lui donner ce confort au plus bas prix, mais encore pour l’améliorer sans cesse ? »[253]
Au début des années 1960, Jacques Ellul estimait que la difficulté de saisir la nature idéologique du « progrès » tient à ce que la plupart des humains sont déjà victimes non seulement des techniques de manipulation que sont la publicité et les relations publiques mais aussi des supports d'information, quand bien même ceux-ci sont animés par des gens consciencieux et vertueux : tous, en effet, tendent à présenter « le progrès » comme un fait, ce qui conduit à désamorcer tout esprit critique[254] au point qu'ils se retrouvent alors dans l'incapacité de « penser globalement » le progrès[255], c'est-à-dire à la fois comme un fait et comme une construction idéologique. Selon Ellul, donc, « on n'arrête pas le progrès » car il est considéré avant tout comme un fait inéluctable[256].
La réflexion sur la prégnance de la publicité sur les mentalités a joué un rôle important dans les années 1960 et 1970, quand sont apparues les premières critiques de la société de consommation (en France : Debord, Baudrillard, etc) mais elle s'est émoussée dès les années 1980, quand les dirigeants des nations industrialisées se sont officiellement alignés sur les thèses néo-libérales (idéologie de la croissance) — notamment sous l'impulsion du président américain Ronald Reagan et de la Première Ministre britannique Margaret Thatcher — et surtout dans les années 1990, après l'écroulement du bloc des régimes communistes. Des mouvements critiques à l'égard de la publicité restent très minoritaires. Citons en France les cas de l'association Casseurs de pub et du collectif des Déboulonneurs.
Selon Mehdi Khamassi, chargé de recherche au CNRS, la publicité « pose la question de notre libre arbitre, de notre liberté de penser, quand notre environnement est en quelque sorte manipulé par des marques à gros budget publicitaire. Les publicités véhiculent des modes de vie, des valeurs. C’est particulièrement dangereux chez l’enfant, encore plus influençable car, pour lui, la dissociation entre la réalité et l’imaginaire est balbutiante[257] ».
Le dépassement de seuil
Dans le sillage de la pensée d'Ivan Illich, différents économistes[n 17] estiment qu'un paramètre n'est pas pris en compte dès lors que l'on aborde la question du progrès technique, celui de la contre-productivité. Dans les années 1970, Illich a développé le concept de seuil critique et avancé la thèse que, lorsqu'elles sont en situation de monopole, les grandes institutions industrielles s'érigent sans le savoir en obstacles à leur propre fonctionnement : la médecine nuit à la santé (tuant la maladie parfois au détriment de la santé du patient) ; le transport et la vitesse font perdre du temps ; l'école abêtit ; les communications deviennent si denses et si envahissantes que plus personne n'écoute ou ne se fait entendre, etc.[Sp 63] (lire supra).
Sur le plan philosophique, Olivier Rey reprend cette problématique. En 2014, il estime que
« dans la réalité, la taille n’est pas un paramètre que l’on pourrait fixer à volonté : chaque être vivant n’est viable qu’à l’échelle qui est la sienne. En deçà ou au-delà, il meurt, à moins qu’il ne parvienne à se métamorphoser. Il en va de même pour les sociétés et les cultures. La plupart des crises contemporaines (politiques, économiques, écologiques, culturelles) tiennent au dédain affiché par la modernité pour les questions de taille. Nous mesurons tout aujourd’hui, des volumes de transactions à la bourse aux taux de cholestérol, de la densité de l’air en particules fines au moral des ménages. Mais plus nos sociétés se livrent à cette frénésie de mesures, moins elles se révèlent aptes à respecter la mesure, au sens de juste mesure. Comme si les mesures n’étaient pas là pour nous aider à garder la mesure mais, au contraire, pour propager la folie des grandeurs[258]. »
La démocratisation des techniques

Les politiciens associent fréquemment la notion de progrès à celle de démocratie, afin de la connoter positivement[n 18]. Pourtant, la démocratisation de l'accès à des moyens techniques sophistiqués soulève aujourd'hui un certain nombre d'interrogations. Déjà, en 1987, Jacques Ellul écrivait :
« Nous vivons le phénomène de la démocratisation du mal. [...] Un nombre de plus en plus grand d'entre nous accède à la possession d'instruments qui peuvent nuire aux voisins. [...]) Des moyens qui, autrefois, étaient réservés à des puissants, des riches [...] et constituaient leur privilège sont maintenant à la portée de tous. [...] Cela nous paraît naturel, c'est une démocratisation du confort, du bien-être, une élévation du niveau de vie, et vu sous cet angle optimiste, c'est très bien. Mais c'est en même temps la démocratisation du mal que l'on peut se faire à soi-même et aux autres. [...] L'homme de notre société n'est assurément pas plus mauvais que celui des siècles passés mais [...] il a maintenant des moyens qui le rendent redoutable[259]. »
Interprétant les attentats du 11 septembre 2001 comme la démonstration de cette thèse, le politiste Patrick Chastenet entend décrire « la face sombre du progrès »[260].
En 2016, la journaliste anglaise Katharine Viner avance une thèse analogue. Elle souligne que les blogueurs et les utilisateurs des réseaux sociaux, à la différence des journalistes professionnels, ne sont soumis à aucune déontologie, en particulier ils n'ont pas l'obligation de vérifier les faits qu'ils annoncent : ils peuvent donc raconter n'importe quoi. Or, du fait que, dans les pays anglo-saxons, les gens s'informent davantage sur les blogs et les réseaux sociaux que via la presse traditionnelle, les contre-vérités sont susceptibles d'être crues de façon très importante, au point par exemple d'influer sur les résultats d'une élection nationale. Ainsi la journaliste explique-t-elle la victoire du Brexit et la montée du populisme dans son pays. Ce faisant, elle avance l'idée que les réseaux sociaux propulsent l'humanité dans une nouvelle période, caractérisée par la désinformation permanente : l'ère post-vérité[261].
L'accélération sans fin
La rapidité croissante avec laquelle se multiplient les innovations technologiques est telle que les produits techniques se retrouvent de plus en plus rapidement caducs. Dès la fin du XXe siècle, on l'a vu, plusieurs intellectuels s'en sont inquiétés.
Mais les commentaires prennent encore plus d'ampleur en 2005 quand, dans son ouvrage The Singularity Is Near (traduit deux ans plus tard sous le titre Humanité 2.0), l'ingénieur et futurologue américain Raymond Kurzweil affirme que le croisement des nanotechnologies, du génie génétique, de l'intelligence artificielle et des sciences cognitives (croisement appelé « NBIC ») permet d'envisager que l'humanité elle-même risque de se retrouver obsolète - et ceci plus rapidement que lui-même n'ose l'imaginer. Kurzweil tient pour hautement réaliste la formule « obsolescence de l'homme », qui n'avait qu'une portée philosophique lorsque Günther Anders l'a utilisé pour la première fois en 1956[262].
Selon lui, en effet, il est absolument certain, indiscutable, que les distinctions entre humain et machine, réel et réalité virtuelle, vont à court ou moyen terme totalement disparaître : la dimension biologique de l'humain et les réseaux électroniques s'interpénétreront au point de former un tout. Si bien, estime Kurzweil, qu'il ne sert plus à rien de s'interroger aujourd'hui sur « le progrès » - celui-ci étant inexorable - mais qu'il devient en revanche urgent de se questionner sur ce que sera un humain, plus exactement sur ce que l'on veut qu'il devienne ; notamment dans l'hypothèse où le téléchargement intégral d'un cerveau s'avèrerait possible :
« Télécharger un cerveau humain signifie scanner tous les détails essentiels et les installer ensuite sur un système de calcul suffisamment puissant. Ce processus permettrait de capturer l'intégralité de la personnalité d'une personne, sa mémoire, ses talents, son histoire. »
Par la suite, certains auteurs de science fiction avancent que les choses pourraient aller plus loin encore et qu'avec les développements de l'informatique quantique et du deep learning, un humain pourrait accéder à la fois à l'omniscience et à l'immortalité. Tel est notamment le message du film Transcendance, du réalisateur américain Wally Pfister, en 2014.
Ces positionnements participent de la montée en puissance des thèses transhumanistes et, plus largement, s'inscrivent dans le contexte de ce qu'on appelle « la crise des valeurs ».
Crise des valeurs
Selon le philosophe Michel Puech,
« la question du progrès (est devenue) : quel est notre système de valeurs ? Nous voulons progresser, nous voulons devenir ce que nous voulons être, collectivement et individuellement, mais savons-nous ce que nous voulons être ? Faut-il le déterminer collectivement, comme l'ont fait tous les groupes humains jusqu'ici, ou sommes-nous en train de passer à une civilisation globale ouverte qui autorisera des référentiels de valeurs individualisés, enfin véritablement éthiques ? Un progrès humain open source ?
La technoscience progresse parce qu'elle sait ce qu'elle veut : la puissance, par tous les moyens. Si nous n'avons pas d'autres référentiels de valeurs, alors nous ne pouvons progresser qu'en nous laissant mener par la technoscience, en nous y soumettant. Cette abondance de puissance est en train de nous étouffer – d'un étouffement qui est en réalité technocratique, une asphyxie par la soumission.
S'il nous prend l'envie de nous demander ce que nous voulons vraiment, où nous voulons aller, et si nous nous donnons les moyens de le déterminer autrement que par la soumission, nous pourrons parler d'un progrès humain qui serait émergent, assumé, nous pouvons desserrer le nœud coulant[Sp 64]. »
Deux questions majeures se posent alors : quelles sont les causes de cette crise des valeurs ? Et pourquoi, si les effets du progrès peuvent se montrer dévastateurs, tant sur le registre écologique que sur le registre psychosocial, les humains sont-ils incapables de se ressaisir ? Plusieurs penseurs apportent des éléments de réponses.
La liberté-prétexte
Dans les années 1970, Jacques Ellul estimait que la liberté, telle qu'elle a été célébrée par les tenants du libéralisme au XVIIIe siècle, n'est en réalité qu'un prétexte :
« L’homme n’est pas du tout passionné par la liberté, comme il le prétend. La liberté n’est pas un besoin inhérent à la personne. Beaucoup plus constants et profonds sont les besoins de sécurité, de conformité, d’adaptation, de bonheur, d’économie des efforts ; et l’homme est prêt à sacrifier sa liberté pour satisfaire ces besoins. [...] Certes, il ne peut pas supporter une oppression directe. [...] Être gouverné de façon autoritaire, être commandé, cela lui est intolérable non pas parce qu’il est un homme libre mais parce qu’il désire commander et exercer son autorité sur autrui. [...] L’homme a bien plus peur de la liberté qu’il ne la désire. »[263]
Aujourd'hui, certains estiment qu'il existe « une guerre larvée entre progrès et liberté »: « La liberté, la vraie, passe par une culture de la simplicité, de la frugalité, du minimalisme... et ce, quels que soient les progrès de la technique[264] » .
La valeur-travail remise en cause

Depuis qu'en 1939, l'économiste américain Joseph Schumpeter a expliqué comment le « progrès technique » provoque à la fois des suppressions et des créations d'emplois (lire supra), les débats se multiplient quant à la question de savoir s'il en crée plus qu'il n'en supprime. Mais au-delà de son caractère strictement économique, cette mutation a conduit Jacques Ellul à poser dans les années 1960 un problème d'ordre éthique : quelle valeur peut-on encore accorder au travail si l'évolution du « marché de l'emploi » ne résulte pas d'une réflexion préalable et concertée mais — précisément — du « progrès technique », c'est-à-dire d'un processus qui semble prendre les individus au dépourvu et les mettre devant le fait accompli[265] ? L'avènement de l'informatique, le développement de l'automation, le fait que des machines deviennent « intelligentes » et qu'on y recourt non plus seulement pour remplacrer les muscles des hommes mais leurs cervaux... tous ces événements alimentent sa réflexion[266].
Influencé par les positions de Max Weber sur les liens entre capitalisme et christianisme[267], Ellul développe son analyse sur une prise en considération du temps long. Il retient cinq phases :
1°) pour faire accepter la pénibilité du travail aux ouvriers et pour se donner bonne conscience, la bourgeoisie européenne du XVIIIe siècle justifie l’usure au travail par une interprétation moralisante de la Bible ; ce faisant, elle érige le travail en valeur, elle en fait une idéologie ;
2°) sur cette base, la bourgeoisie fonde une autre idéologie, "l’idéologie du bonheur" : plutôt que d'espérer le salut de leur âme dans un hypothétique au-delà, après leur mort, les humains doivent travailler d'arrache-pied pour accéder au bien-être matériel, dès leur vivant et dans un "ici-bas" bien réel ;
3°) c'est ainsi que la vie politique est peu à peu annexée par l'économie et que s'élabore le productivisme, idéologie de la croissance ;
4°) pour être toujours plus productifs, et décupler sans cesse leurs forces, les hommes inventent et multiplient les machines ;
5°) celles-ci devenant « intelligentes » avec l'informatique, le travail intellectuel — après le travail physique — n'est plus créateur de richesse et c'est en revanche la technique qui le devient. Or cela, les humains n'en prennent pas conscience.
Ellul estime en effet que, théoriquement, les humains pourraient profiter du fait que la technique leur libère du temps pour se défaire de l'idéologie du travail et se pencher par exemple sur des questions d'ordre spirituel mais, en réalité, il n'en est rien : engoncés dans une vision du monde étroitement matérialiste, ils continuent de faire du travail une valeur ; qui plus est, ils sacralisent la technique inconsciemment du fait qu'elle optimise sans cesse le travail et quand bien même elle les écarte progressivement de la chaîne de production. Les nuisances se multiplient alors sans que nul ne puisse y remédier : concurrence effrénée entre les entreprises, donc entre les individus, stress au travail, chômage de masse et précariat, catastrophe écologique, etc.
Bougisme
Se livrant en 2001 à une analyse détaillée de l'idée de progrès[268], Pierre-André Taguieff développe le concept de bougisme :
« Ce qui se dessine nettement, c'est le système de valeurs et de normes à travers lequel l'idéologie globaliste prend forme. Les nouvelles élites transnationales exigent des individus qu'ils "bougent", qu'ils suivent le mouvement globalisateur, qu'ils accélèrent leur propre mouvement, qu'ils vivent à "l'heure de la mondialisation". Les normes en sont simples, voire sommaires : consommer toujours plus, communiquer toujours plus rapidement, échanger d'une façon optimalement rentable. »[269]
Constatant lui aussi l'agitation de la plupart de ses contemporains, le sociologue allemand Hartmut Rosa propose dans les années 2010 une autre explication. Selon lui, s'ils se comportent ainsi, ce n'est pas sous la pression de telles ou telles « élites », comme l'affirme Taguieff, mais parce qu'ils ont intériorisé un certain nombre de contraintes sociales. Alors que les moyens de transports et de télécommunications, de plus en plus perfectionnés, leur permettent de gagner toujours plus de temps, ils sont soumis à un nombre croissant d'obligations diverses, notamment professionnelles, si bien qu'ils éprouvent de plus en plus le sentiment de manquer de temps[270]. C'est donc parce que l'augmentation des contraintes est supérieure à celle des avantages procurés par la technologie, affirme Rosa, qu'ils en viennent à s'exposer toujours plus au risque du stress et du burn out[271].
Certains militants technocritiques contestent la pertinence de cette analyse. S'inscrivant dans la pensée d'Ellul, ils entendent comme lui ne pas limiter « la technique » aux « techniques » ou aux « technologies ». Selon eux, « la technique » est un processus bien plus large, comprenant également des éléments immatériels, en premier lieu l'organisation du travail. C'est pourquoi ils estiment que la situation décrite par Hartmut Rosa n'est en rien paradoxale : disposer de moyens permettant de gagner du temps et souffrir de manquer de temps sont les deux faces d'un même assujettissement à l'idéologie technicienne. Le progrès technique est un processus autonome[272], d'une part parce que les humains attendent de lui qu'il leur procure toujours plus de confort, d'autre part parce qu'ils placent cette quête de confort au sommet de leurs priorités :
« On n’arrête pas le progrès pour la raison que l’on est devenu incapable de le penser, à force de le sacraliser. La quête frénétique du confort moderne se paie au prix fort du refoulement du bon sens. »[273]
Considérant leurs désirs de confort pour des besoins, et les désirs étant par définition insatiables, les humains non seulement « n'arrêtent pas le progrès » mais sont contraints de s'adapter toujours plus à lui[n 19], courir après lui, à son rythme à lui, ceci dans le monde du travail comme dans celui des loisirs (notamment le secteur des jeux vidéo, dont le rythme d'évolution est exponentiel[274]).
« Solutionnisme technologique »
En 2013, l'écrivain américain Evgeny Morozov développe la notion de « solutionnisme technologique » pour expliquer que chaque problème humain (politique, social, sociétal) est systématiquement transformé en question technique, puis adressé par les acteurs du numérique privés ou les États avec des solutions numériques traitant les effets des problèmes sans jamais analyser leurs causes[275]. Selon lui, « ce qui pose problème n’est pas les solutions proposées, mais plutôt la définition même de la question : le solutionniste possède un marteau (le Web, Internet, de puissants ordinateurs…) et tout ressemble à un clou »[276].
L'essayiste Hubert Guillaud - selon qui le «progrès n’a pas encore tout à fait disparu »[277] et qui consacre deux articles à Morozov[278] - conclut de l'analyse de ce dernier que le solutionnisme contribue à bouleverser les raisonnements des politiciens au point que, en s'y conformant eux-mêmes, ils se positionnent de plus en plus par rapport aux effets d'un problème et ne sont plus capables d'en analyser les causes :
« L’innovation technologique ne garantit pas l’innovation politique. Parfois, elle pourrait même y faire obstacle. La glorification de « l’efficacité » par la Silicon Valley remet en question la manière même dont on fait politique. (...) Comme le dit Giorgio Agamben, la relation traditionnelle entre les causes et les effets est désormais inversée, de sorte qu’au lieu de gouverner par les causes, les gouvernements essayent de contrôler les effets. »[279]
Fin de la théodicée
Analysant les raisons qui ont conduit à l'émergence de l'idée de progrès et celles qui sont la cause de son déclin, le philosophe Michel Lacroix situe le point de rupture au début du XXe siècle. Il estime en effet que depuis les fondements de la religion juive (Ve siècle av. J.-C.) jusqu'à Marx et Darwin (XIXe siècle), les conceptions du progrès ont en commun une même dialectique de la transformation du mal en bien (théodicée) mais que ce paradigme prend fin aux lendemains de la Première Guerre mondiale. Selon lui, quatre facteurs étroitement corrélés constituent la cause de cette rupture[280] :
- l'effondrement de l'idée de totalité : les conceptions du monde holistes et les grands récits s'effacent au profit de prises de position spécifiques et parcellaires, indépendantes les unes des autres et considérées comme aussi pertinentes les unes que les autres (« tout se vaut ») ;
- une nouvelle façon de vivre le mal : les tueries en masse, par leur ampleur même, et les génocides, par leur cruauté extrême, constituent des « impensés », des « scandales absolus, impossibles à maîtriser par la dialectique » du bien et du mal ;
- la naissance d'une « mystique du mal » : celui-ci n'est plus vécu comme un tremplin possible vers le bien, il est devenu en quelque sorte autonome, aussi digne que le bien d'un point de vue ontologique ;
- un doute fondamental quant à l'efficacité de toute action de bienfaisance ou de bienveillance.
Position de l'Église

Au XXe siècle, l'Église catholique s'est plusieurs fois trouvée contrainte de prendre position sur le progrès scientifique et le progrès technique, Essentiellement pour condamner ouvertement l'esprit matérialiste et la quête croissante de confort matériel, qui en sont d'après elle les conséquences, au détriment des valeurs spirituelles. En 1967, le pape Paul VI a mis l'humanité en garde dans son encyclique Populorum Progressio, se référant alors non pas tant aux Évangiles qu'à un « humanisme nouveau », qu'il appelait de ses vœux[Sp 65], sur le modèle de l'« humanisme intégral » proposé en 1936 par le philosophe Jacques Maritain, précisant que l'être humain est « capable d’être lui-même l’agent responsable de son mieux-être matériel, de son progrès moral, et de son épanouissement spirituel »[n 20].
En 2014, le pape François qualifie Internet de « don de Dieu » au motif qu'il « peut offrir plus de possibilités de rencontre et de solidarité entre tous »[281]. L'année suivante, toutefois, dans l'encyclique Laudato si', il nuance son propos. Il regrette notamment que « la croissance de ces deux derniers siècles n’a pas signifié sous tous ses aspects un vrai progrès intégral ni une amélioration de la qualité de vie » ; il invite à « chercher d’autres façons de comprendre l’économie et le progrès » ; il fustige « le mythe moderne du progrès matériel sans limite » ; il reconnaît que « nous ne pouvons pas ne pas valoriser ni apprécier le progrès technique » ; il souligne néanmoins que « l’immense progrès technologique n’a pas été accompagné d’un développement de l’être humain en responsabilité, en valeurs, en conscience » ; il souhaite que l'on oriente la technique pour « la mettre au service d’un autre type de progrès, plus sain, plus humain, plus social, plus intégral » ; il avertit qu'« on ne doit pas chercher à ce que le progrès technologique remplace de plus en plus le travail humain » ; il souligne que les processus biologiques « ont un rythme lent qui n’est pas comparable à la rapidité qu’imposent les progrès technologiques actuels » ; pour finir, il appelle tout simplement à « d'autres formes de progrès et de développement », à « convertir le modèle de développement global » et à « redéfinir le progrès ».
Un mythe mortifère
Différents auteurs (citons von Wright en 1993, Sale en 1999, Gray en 2013, Bouveresse et Vignaux en 2017 ; voir la bibliographie) associent l'idée de progrès à un mythe qui se substituerait à tous les mythes du passé — y compris le mythe chrétien — mais qui ne serait pas assumé comme tel par "l'homme moderne" car il constituerait pour lui un moyen de se glorifier lui-même sans s'en donner l'air, un moyen d'enjoliver son existence d'innombrables fictions, détours et aveuglements, afin de ne pas reconnaître qu'il est un animal[282].
Conformisme des sociologues
Le sociologue Julien Mattern fait remarquer que la majorité de ses confrères peuvent tout à la fois dénoncer le caractère idéologique de la notion de progrès et s'y conformer. Il souligne cette contradiction dès les fondements de sa discipline (Max Weber et Emile Durkheim) puis, plus tard, chez Georges Friedmann. Et il l'explique par le fait d'un conformisme à la philosophie de l'histoire ; laquelle, selon lui englobe l'idéologie du progrès[283].
Marginalité et hétérogénéité de la critique
Dans un climat dominé par une relative indifférence à la notion de progrès (celle-ci ne fait plus vraiment débat, notamment sur le terrain de la politique), on observe deux positions extrêmes : les convaincus ("geeks", technophiles, transhumanistes...) et les opposants déclarés (technophobes et néo-luddites). La critique argumentée reste donc assez minoritaire. Et encore y retrouve t-on à nouveau — mais de façon plus nuancée — les deux tendances : un courant "partisan", "optimiste" et favorable à l'idée de progrès ou ne la remettant pas fondamentalement en question ; et un autre, qui s'efforce d'élaborer une expertise du concept, convoquant à la fois l'économie, la sociologie et — plus rarement — l'anthropologie : c'est le camp de la "technocritique".
Entre ces deux pôles, certains philosophes tentent d'adopter une position médiane, refusant d'associer systématiquement le progrès à une idéologie et estimant qu'il est possible de l'aborder également de façon pragmatique en le considérant comme un processus « humain » et « subtil ».
Les partisans
En France, le philosophe Michel Serres fait partie de ceux qui affichent le plus sa confiance dans le progrès. Il construit celle-ci sur la nécessité de rester toujours optimiste :
« Ça ne sert à rien de dire "c'est épouvantable" ; tandis que si vous êtes un peu optimiste, vous aidez quand même, un peu, les générations futures à survivre. »[284]
Le psychologue cognitiviste canadien Steven Pinker, connu pour son plaidoyer en faveur de la psychologie évolutionniste et auteur en 2018 du livre Enlightenment Now, estime que la raison, la science et l’humanisme, combinés, ont permis des avancées considérables sur toute la planète dans à peu près toutes les dimensions de la condition humaine[285].
En France, le journaliste Pierre-Antoine Delhommais, connu pour s'afficher « 100% progressiste »[286], passe en revue les avancées que l'humanité a connues depuis plusieurs siècles, de l'élimination de la variole à la réduction de la mortalité infantile et de l'hygiène à l'alphabétisation et, au motif que « non, ce n'était pas mieux avant », il fustige toutes celles et tous ceux qui s'exposent à critiquer l'idée de progrès[287].
Le « progrès humain »
Inspiré par les écrits de Gilbert Simondon, le philosophe belge Pascal Chabot estime que tout en pointant le caractère idéologique de la notion de progrès, il est possible de l'aborder de façon pragmatique. Il différencie « le progrès utile », au fondement de l’avancée des sciences et des techniques et se développant par capitalisation (« technocapitalisme ») et « le progrès subtil », qui est selon lui « le progrès humain par excellence » car « il faut toujours réapprendre à vivre, réinterpréter les valeurs, réinterroger le sens »[288] :
« La question n’est pas de savoir s’il faut être technophile ou technophobe. Cette alternative est un piège. Reformuler en termes de progrès utile et de progrès subtil, avec chacun leurs logiques et leurs modes de développement, l’alternative se mue en une interrogation sur les modes de relation. Il ne peut en effet s’agir de devoir choisir l’un plutôt que l’autre, ou l’un au lieu de l’autre. L’utile et le subtil constituent deux dimensions humaines fondamentales, comme l’esprit de géométrie et l’esprit de finesse de Pascal ou l’intelligence et l’intuition de Bergson. Le progrès s’alimente à ces deux sources. Plutôt que de les opposer, il s’agit de se demander comment les mettre en relation. »[289]
La technocritique

Stimulés par des auteurs tels que Mumford, Ellul ou Illich, certains courants militants estiment que le progrès ne peut pas être autre chose qu'une idéologie : qu'ils le veuillent ou non, le sachent ou non, et surtout s'ils ne le savent pas, les humains en ont fait un idéal-type, une catégorie inconsciemment mais constamment sur-évaluée. Raison pour laquelle ils affirment que le progrès technique se développe de façon totalement autonome[290] et que cela conduit l'humanité à sa perte. Ils analysent et dénoncent l'inaction des pouvoirs publics ainsi que le désengagement des intellectuels (lire supra) et des milieux confessionnels (lire supra), voire le désintérêt de la majorité des militants politiques, notamment les anticapitalistes et les écologistes[291].
Il faut distinguer dans cette mouvance d'une part les groupements qui focalisent leur action sur telle ou telle technique (le nucléaire, les OGM, le contrôle des individus à distance, du type géolocalisation ou télésurveillance, l'usage des pesticides...) ; d'autre part ceux qui considèrent la technique dans sa globalité. C'est le cas en France du collectif Pièces et Main d'oeuvre, apparu en 2000 ; également celui de l'association Technologos, née en 2012, dont les membres, pour la plupart d'inspiration ellulienne, tiennent à ce que la technique ne soit pas réduite aux « machines » (ordinateurs et TICE, réseau internet, équipements divers...) mais qu'elle intègre également l'immatériel, les procédures telles que l'organisation rationnelle du travail, « recherche et développement », la communication et les relations publiques, la publicité et le marketing[292]. Se basant sur le livre L'Illusion politique (1965), la plupart d'entre eux estiment que la technique a échappé au contrôle des gouvernants et qu'il revient essentiellement aux individus eux-mêmes de « désacraliser la technique ».
En 2014, l'historien François Jarrige décrit et analyse le mouvement technocritique depuis son émergence jusqu'à nos jours[293].
Grandes interrogations
Les premiers véritables signaux d'alarme concernant « le progrès » datent des risques d'effondrement formulés dans le rapport Meadows, en 1972. Depuis, de multiples scandales alimentent un débat sur la question des risques sanitaires, tels celui de l'amiante (France, années 1970), celui de la vache folle (Royaume Uni, à partir de 1986), celui du sang contaminé (France, années 1980-90) ou celui du Mediator (France, années 2010). Mais le poids des lobbies industriels est tel que rien ne vient remettre en cause « le progrès » dans son ensemble : il est globalement considéré que l'on évolue dans la société du risque (Beck, 1986) et que, pour limiter les risques, il faut — dans chaque situation — appliquer le principe de précaution (formule adoptée lors de la Déclaration de Rio, en 1992).
En 2005, le géographe et biologiste américain Jared Diamond contribue à accélèrer le débat avec son célèbre essai Effondrement. Et en 2018, il retient quatre facteurs particulièrement problématiques : l'utilisation de l’arme nucléaire, le changement climatique, l'épuisement des ressources naturelles et les conséquences des inégalités sociales[294]. On en recensera ici une dizaine, étroitement liés.
Réchauffement climatique

Le réchauffement climatique est le phénomène d'augmentation des températures moyennes océaniques et de l'air, induit par la quantité de chaleur piégée à la surface terrestre, mesurée depuis plusieurs décennies, du fait des émissions de gaz à effet de serre (CO2, etc). Observé au début du XXe siècle, il n'inquiète et mobilise les pouvoirs publics que depuis les années 1980. C'est ainsi qu'en 1988, l'ONU a créé un organisme, le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), afin de synthétiser les études scientifiques sur le sujet puis d'émettre des diagnostics et des préconisations.
Selon le rapport du GIEC en 2001, la cause la plus probable de ce réchauffement dans la seconde moitié du XXe siècle serait le « forçage anthropique », c’est-à-dire l’augmentation dans l’atmosphère des gaz à effet de serre résultant de l’activité humaine. Le degré de certitude augmente dans les rapports entre 2007 et 2014, qui qualifient de très probable, puis d’extrêmement probable le fait que le réchauffement climatique est dû à l’activité humaine[296],[297].
En 2018, un rapport spécial du GIEC est consacré aux conséquences d’un réchauffement planétaire de 1,5 °C. Selon ses projections, la température de surface du globe pourrait croître de 1,1 à 6,4 °C supplémentaires au cours du XXIe siècle[298]. « Nous sommes face à un risque de voir le sud de l’Europe basculer dans une désertification d’ici à la fin du siècle » affirme Pierre Cannet, de l’ONG WWF[299].
Bien que les rapports du GIEC soient sans cesse plus alarmants, il existe dans différents pays toute une mouvance qui en conteste le bien fondé : le climatoscepticisme. Mais plutôt que d'opposer frontalement les tenants des conclusions du GIEC et leurs opposants, l'économiste Thomas Porcher et l'environnementaliste Henri Landes estiment que les humains sont « tous climato-sceptiques (...), tous conscients d'être responsables du réchauffement climatique (...) tout en continuant à subventionner les énergies fossiles, à promouvoir des traités de libre-échange sans clause sur le climat et à utiliser les indicateurs de mesure qui comptabilisent uniquement la production marchande[300].» Et se référant aux rapports du GIEC, le journaliste Pierre de La Coste fait remarquer que c'est la communauté scientifique, hier massivement favorable à la thèse du Progrès, qui est aujourd’hui majoritairement pessimiste quant à l’avenir de la planète[301].
Érosion de la biodiversité

Depuis le Sommet de la Terre de 1992, il est établi que la biodiversité est gravement menacée par les activités humaines et s’appauvrit d'année en année à un rythme sans précédent[302]. Depuis son apparition il y a environ 100 000 ans, l'Homme a eu un impact croissant sur son environnement jusqu'à en devenir le principal facteur de changement[303]. Avec la révolution industrielle, le rapport de domination de l'homme sur la nature est devenu si considérable que certains scientifiques soutiennent que ce fait marque l'entrée dans une nouvelle époque géologique, l'anthropocène[304]. La disparition des espèces est le signe le plus visible de cette érosion de la biodiversité.
Cinq causes majeures sont identifiées : la première est la destruction des habitats, suivie par la surexploitation (chasse, pêche), les espèces envahissantes, le changement climatique et la pollution[305],[306].
Tous les dix ans depuis 1972 et à l'initiative de l'ONU, les gouvernants de la planète se réunissent au Sommet de la Terre pour tenter de stopper ou au moins ralentir la catastrophe. Et depuis 1995, se tiennent annuellement des conférences (dites « conférences des parties ») où les États présents signent des conventions dans le but de réduire collectivement les émissions de gaz à effet de serre. Les résultats, dans l'ensemble, restent très en dessous des objectifs fixés.
La critique de la destruction de la biodiversité, et surtout de la relative inefficacité des pouvoirs publics pour l'endiguer, s'exprime essentiellement sous la forme de pétitions en ligne. Disposant des moyens offerts par internet, celles-ci sont de plus en plus massives. Ainsi, celle signée en 2017 par plus de 15 000 scientifiques : « Il sera bientôt trop tard »[307]. Dans les milieux technocritiques, on estime toutefois que ce type de réactions se limite à la déploration et l'incantation, par absence d'identification de l'idéologie technicienne, et qu'il est paradoxal que ce soient des scientifiques qui portent la dénonciation alors qu'ils endossent une responsabilité majeure dans la catastrophe[308].
Catastrophe environnementale
Les politiques énergétiques, l'utilisation des produits chimiques dans l'industrie et l'agriculture, la gestion des multiples déchets (en particulier ceux qui sont extrêmement et durablement toxiques, tels les déchets nucléaires), le réchauffement climatique lié aux émissions de gaz à effet de serre, la pollution atmosphérique, le devenir des océans, souvent qualifiés de « septième continent » du fait qu'ils sont remplis de matières plastiques, tous ces problèmes ont commencé à préoccuper les politiciens et les populations à partir des années 1970, quand s'est déclaré la crise écologique résultant du développement de la société industrielle, alias « société de consommation ». Alors s'est développée l'écologie politique.
Pour parer aux catastrophes, les gouvernements mènent des politiques qui varient d'un pays à l'autre. Certains pays, par exemple, ont renoncé à utiliser l'énergie nucléaire. Sans entrer dans le détail, on peut dire que la tendance générale est de maintenir le système capitaliste et de poursuivre des politiques de développement afin d'assurer toujours la croissance économique. Les débats portent alors sur l'évaluation des risques en termes sanitaires et environnementaux, en regard des intérêts économiques ; plus exactement sur un arbitrage entre les avantages et les inconvénients associés à la production. Deux principes sont alors retenus : le « développement durable », concept par lequel on entend garantir le maintien de la croissance, au motif qu'elle est créatrice d'emplois, tout en prenant des précautions pour sauvegarder l'équilibre écologique, en vertu du « principe de précaution ».
Bien que le terme « progrès », on l'a dit, soit de moins en moins utilisé, les dispositions prises par les gouvernements peuvent cependant être qualifiées de progressistes dans la mesure où c'est l'expression qui la remplace — l'innovation technologique — qui est systématiquement promue au rang d'objectif. On peut donc dire qu'au XXIe siècle se poursuit l'opposition qui s'était amorcée au XIXe siècle entre les défenseurs du progrès et ceux qui, au contraire, l'identifient à une idéologie mortifère.
On ne retiendra ici que deux exemples caractéristiques du fait que cet affrontement ne cesse de perdurer : l'usage du nucléaire et celui des produits chimiques.
Nucléaire

Aucune autre forme de production d'énergie ne soulève autant de discussions que le nucléaire. Selon trois historiens spécialistes des questions énergétiques, « avec lui, ce sont les cycles écologiques qui peuvent se trouver contaminés sans que l'on puisse agir sur cette contamination. Même si la probabilité de l'accident est très réduite, le nucléaire introduit dans l'histoire humaine la notion de risque majeur. Ce n'est plus seulement une population statistique définissable qui est concernée mais, potentiellement, l'espèce elle-même »[309].
Depuis l’ouverture des premières centrales nucléaires, dans les années 1950, on ne recense que deux accidents majeurs : à Tchernobyl (en 1986 en Ukraine) et à Fukushima (au Japon en 2011). Les zones touchées sont devenues impraticables pour plusieurs décennies et il est difficile d’évaluer avec certitude les dommages pour les décennies à venir. Ces événements suscitent donc de vives réactions et interrogent : en quoi l’usage du nucléaire relève t-il d’un quelconque progrès ?
Créée en février 2018, l’association française Progrès nucléaire apporte une réponse. S’assignant l’objectif de « promouvoir le progrès pour l’humanité et pour la nature », ses membres se proclament « scientifiques, pragmatiques, éco-modernistes et (politiquement) indépendants »[310]. Ils estiment que « les énergies renouvelables sont propres mais peu efficientes tandis qu’à l’inverse, l’énergie nucléaire est efficiente ». Reconnaissant toutefois que « (actuellement) des dangers persistent », ils affirment qu’il existe une solution radicale à tous les problèmes : les réacteurs à sels fondus. L’association adresse aux pouvoirs publics une pétition appelant à investir dans cette nouvelle technologie[311].
Outre le fait que celle-ci est débattue dans les milieux scientifiques, les militants anti-nucléaire considèrent que, quand bien même elle se substituerait avec succès aux systèmes actuels, cela ne changerait rien au fait que tous les déchets accumulés au fil des dernières décennies seront radioactifs pendant plusieurs siècles. Ils estiment qu'aucun argument exclusivement technique ne peut occulter cette réalité et qu'à l'inverse, tout argument technique continue de s'apparenter à l'utopie progressiste[réf. nécessaire].
Produits chimiques

De plus en plus répandus dans l'industrie et l'agriculture depuis la Seconde Guerre mondiale, les produits chimiques constituent avec le nucléaire la menace la plus importante en matière de pollution, qu'il s'agisse de pollution de l'air, de l'eau, des sols ou des sous-sols.
Conscients du problème, la quasi-totalité des leaders politiques, qui restent affiliés au système capitaliste et à la doctrine de la croissance économique, estiment qu'il existe au moins deux solutions pour enrayer le processus : la recherche de sources d'énergie les moins polluantes possibles et l'utilisation de matériaux recyclables (c'est-à-dire, une fois usés, pouvant être réinvestis dans le cycle de la production)
Intelligence artificielle
Alors que l'idéologie du progrès s'est construite sur l'idée que l'homme est capable de maîtriser de plus en plus la nature, l'intelligence artificielle (IA) suscite une question : les robots pourront-ils accéder un jour à la conscience, éprouver des émotions et finalement se substituer aux humains ? Cette question est un facteur de division au sein des hautes sphères de la technoscience : Elon Musk, Stephen Hawking et Bill Gates[312], par exemple, s'en inquiètent tandis que Mark Zuckerberg se félicite des avancées dans le secteur[313].
Si l'on ne peut plus opposer frontalement les technophobes aux technophiles, comme par le passé, les humeurs et les affects - en l'occurrence l'enthousiasme et la crainte, l'optimisme et le pessimisme - semblent orienter le débat sur l'IA jusque dans la sphère technocritique ; le premier camp se développant essentiellement aux États-Unis, le second surtout en Europe, singulièrement en France[314].
En France, l'essayiste Éric Sadin affirme que « les prouesses de l'intelligence artificielle masquent son pouvoir d'emprise sociale »[315]. Selon lui, la capacité de l'IA à « décrypter le réel mieux que n'importe quel esprit humain troublé par sa subjectivité le rend en effet plus que convaincant, irrésistible. Mieux : ses analyses, constamment améliorées grâce aux logiciels de machine learning permettant aux dispositifs d'auto-apprendre en permanence, lui confèrent une fiabilité, une « autorité » inédite dans l'histoire des techniques »[315].
Manipulations génétiques
À la suite du développement exponentiel du génie génétique, une nouvelle discipline est apparue dans les années 1960, la bioéthique, qui vise à sensibiliser les chercheurs, mais aussi les politiciens et le grand public, à la nécessité d'introduire systématiquement une dimension éthique dès la phase des recherches (principe de précaution). À terme, les craintes les plus importantes portent sur les techniques de clonage reproductif, permettant de reproduire artificiellement un être vivant.
Clonage reproductif
Comparable à une gémellité retardée, le clonage reproductif consiste à créer un être à partir de la totalité du matériel génétique déjà existant. Un clone est donc un être vivant génétiquement identique à un autre, dit « donneur », mais créé en laboratoire de façon artificielle, à partir de l’information génétique contenue dans l’ADN du noyau des cellules du donneur.
Rappelons brièvement l'histoire du processus. En 1979, le biologiste américain Landrum Shettles entreprend la première tentative de cloner un humain et différentes expérimentations se sont poursuivies ensuite sur des animaux. Ainsi, en 1984, un mouton est cloné par la technique dite « de division de cellules indifférenciées », laquelle est de nouveau testée ensuite sur différents animaux. En 1990, les Américains mettent en place le projet « Génome Humain », dans le but de déchiffrer le patrimoine génétique humain. Et quatre ans plus tard, dix-sept embryons humains non viables sont clonés et cultivés jusqu'à un stade assez avancé. En 1997, pour la première fois, deux biologistes britanniques réussissent le transfert de noyau de cellule adulte chez un mammifère, mettant ainsi au monde la brebis Dolly. C'est seulement après cet événement que les pouvoirs publics entreprennent de légiférer.
En novembre 1997, l'UNESCO publie la Déclaration Universelle sur le Génome Humain et les Droits de l'Homme[316] qui stipule que « le clonage humain est une offense à la dignité humaine ». Mais ce texte n'est qu'une déclaration de principe : elle laisse chaque État légiférer sur le sujet. Adoptée en décembre 2000, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne interdit en revanche le clonage reproductif des êtres humains[317] et en 2005, l'Assemblée générale des Nations unies interdit le clonage, même à des fins thérapeutiques[318].
En 2008, toutefois, les responsables d'une firme américaine affirment avoir créé cinq embryons humains en utilisant des cellules de la peau de deux individus adultes. Après vérification, la firme n'a pu confirmer que ces embryons étaient des clones des deux hommes que dans trois des cinq cas et ceux-ci ont été détruits au terme du processus de vérification. Mais les recherches se poursuivent[319].
Démocratie menacée par les GAFA
Depuis les années 1970 (notamment depuis les révélations concernant l'implication de la CIA dans le renversement du président Allende au Chili en 1973[320]), on sait comment les intérêts économiques nationaux, via les grandes entreprises privées, modèlent la vie politique au point de menacer les fondements de la démocratie et des droits de l'homme. Mais depuis l’avènement de l'économie numérique et de la « société de l'information », la situation est devenue plus complexe : l'idée se répand en effet que la vie politique n'est plus seulement façonnée par des accords entre les États et les lobbies privés mais que la marge de manœuvre des politiciens est de plus en plus déterminée par les « GAFA », ou « Géants du web »[321].
Cyberguerre et la post-vérité
En mai 2017, une cyberattaque d’ampleur internationale a touché à la fois des entreprises et des organisations publiques. Elle a révélé à quel point les humains sont vulnérables au réseau internet.
Des alternatives au progrès ?
La majorité des critiques expriment l'idée que le progrès technique, pour être devenu une idéologie dominante ne profitant qu'à quelques-uns et sur le court terme, est à présent un processus incontrôlable et donc dangereux pour l'ensemble de l'humanité.
On peut retenir essentiellement quatre types de critiques (dont certaines sont conciliables entre elles) assorties plus ou moins de propositions concrètes.
Liberté mais « non-puissance »
Au XXe siècle, Jacques Ellul ne s'est pas posé exclusivement en penseur technocritique, toute une partie de son œuvre a traité de questions éthiques en proportion, précisément, de la poussée exponentielle du progrès technique. Il s'est régulièrement efforcé d'argumenter autour d'une idée : « Ce n'est pas la technique qui nous asservit mais le sacré transféré à la technique, qui nous empêche d'avoir une fonction critique et de la faire servir au développement humain »[322]. Ce faisant, Ellul se basait sur deux postulats, voici le premier :
« On proclame que l’homme moderne n’est plus religieux mais on se garde bien de dire ce qu'est la religion, et de même le sacré ou le mythe… et si parfois on s'y hasarde, c'est toujours une définition ad hoc, faite après coup, dans un but de légitimation. Il y a là une complète obéissance à des présupposés non critiqués, (formulés) sans discernement[323]. »
Le second postulat est que le « présupposé non critiqué » de « l'homme moderne » est par excellence la technique ; ceci parce qu'elle est pour lui source de confort matériel et que c'est ce confort qu'il privilégie par-dessus tout, y compris la liberté et à commencer par elle (voir supra). Ellul invite ses lecteurs à penser la quête de liberté comme l'antithèse de l'autonomie du progrès technique et il fonde sa propre conception sur trois principes : la contemplation, la non puissance et la référence à une entité transcendant la raison.
« Le plus haut point de rupture envers cette société technicienne, l’attitude vraiment révolutionnaire, serait l’attitude de contemplation au lieu de l’agitation frénétique[324]. »
« Le choix de la non puissance, et celui-là seul, nous situe dans une échelle de valeurs où la Technique n'a plus rien à faire. [...] La non-puissance n'est pas l'impuissance. [...] L'impuissance, c'est ne pas pouvoir à cause des circonstances de fait, à cause des limitations de notre nature, à cause de notre condition…. [...] La non-puissance, c'est pouvoir et ne pas vouloir le faire. C'est choisir de ne pas faire. Choisir de ne pas exercer de domination, d'efficacité, choisir de ne pas se lancer dans la réussite[325]. »
Un certain nombre d'esprits technocritiques reprennent aujourd'hui l'argumentaire ellulien[réf. nécessaire].
Effondrement
Pour certains, le « progrès technique » est un processus qui est allé trop loin pour qu'il soit possible de le réguler.
Le biologiste Jacques Testart ne remet pas en question l'idée que le progrès constitue une "marche en avant". Mais il précise que c'est une avance "dans le mur", d'autant que la plupart des "progrès" menés au XXe siècle ont au XXIe siècle des effets non seulement désatreux (en termes écologiques, politiques et éthiques) mais irréversibles. Sans sombrer dans l'angoisse, il importe selon lui de s'y préparer avec lucidité[326].
Notes et références
Notes
- Dans un article du New Yorker du 23 juin 2014, Jill Lepore, professeure d’histoire à l'Université de Harvard, conteste l'équivalence "progrès"-"innovation", au motif qu'avec la seconde, les humains auraient explicitement renoncé à tout projet d'améliorer la condition humaine.
- Au XXe siècle, les sociologues Max Weber et Norbert Elias ont défini l'État comme une organisation contrôlant l'emploi de la force militaire de façon exclusive et légale, sur un territoire spécifique.
- Le mot "catholique" vient du grec katholikos (καθολικός), signifiant "universel".
- Pour les premiers chrétiens les notions de progrès scientifique et progrès technique sont proprement impensables.
- Cette position est toutefois contestée en 2011 par Pascale-Marie Milan, dans une recension de l'ouvrage de Rouvillois sur le site Liens socio.
- L'adjectif « catholique » vient du grec καθολικός (katholikos), qui signifie « universel ».
- Rappelons seulement ici qu'en 1825, la première ligne ferroviaire est ouverte au public en Angleterre :.
- Le Prix Nobel d'Économie est créé en 1969.
- Dans ce passage, toutes les majuscules sont dans le texte.
- Norbert Wiener, Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine, 1948 ; et The Human Use of Human Beings, 1950 ; traduit en français en 1952 aux éditions des Deux rives sous le titre Cybernétique et société ; réédité depuis.
- Pendant une vingtaine d'années, Rand entretient une liaison avec le psychothérapeute cognitiviste, Nathaniel Branden.
- Pour évacuer toute ambiguïté, c'est à la nature qu'Ellul se réfère ici, et non au monde dans son intégralité ; d'autant plus que l'univers des villes est un milieu déjà grandement technicisé.
- En 2016, par exemple, l'État russe a pu influer sur les résultats de l'élection présidentielle américaine par voie de piratage.
- On l'observe notamment dans le rapport aux écrans : Addictions : mise en garde institutionnelle contre les écrans et les jeux vidéo, Le Monde, 24 juin 2015
- On retrouve la même ambiguité dans l'expression « intelligence artificielle », elle aussi très usitée, qui laisse entendre qu'un robot pourrait avoir des capacités intellectuelles équivalentes ou comparables à celles d'un humain.
- « Si tous ces gens acceptent de parler de “révolution numérique”, c’est parce que quand vous accolez “numérique” à “révolution”, vous éteignez l’idée même de révolution. Faisons un exercice de méditation collective... Fermez les yeux... Je vous dis doucement à l’oreille “révolution numérique”. Vous voyez quoi ?... Des câbles, des ordinateurs, des écrans, des serveurs. Si vous voyez des humains, vous voyez des types barbus derrière un clavier en train d’aligner du code. Franchement, vous arrivez à voir là le ferment d’une révolution ? ». Voir Hé, les politiques, arrêtez de parler de "révolution numérique" !, Xavier de La Porte, France Culture, 19 janvier 2017.
- Citons Pierre-Yves Gomez, directeur de l'Institut français de gouvernement des entreprises, dans "A la source de la contre-productivité", Le Monde, 16 janvier 2012
- Cf par exemple le « Centre démocratie et progrès », dans les années 1970 ; ou, plus récemment en Espagne, le parti « Union, progrès et démocratie ».
- "S'adapter à la révolution numérique" est désormais une formule récurrente, comme le prouve la consultation des moteurs de recherche.
- J. Ellul a critiqué cette position de l'Église comme étant ambigüe dans Fausse présence au monde moderne (éd. Tribune libre protestante, 1963), mais sa position a été considérée comme pamphlétaire et intransigeante par Roger Mehl dans son compte rendu, Revue d'histoire et de philosophie religieuses, 1965, 45-2, p. 306-307
Sources primaires
- Robert Redeker, Le progrès ou l’opium de l’histoire, Pleins feux, coll. Étude(s), 2004
- En 1930, Georges Duhamel écrit : "L'idée d'une civilisation universelle, supposant un progrès en même temps spirituel et temporel, était (...) à l'apogée de sa fortune quand elle fut assaillie par la guerre". - Scènes de la vie future, Paris, Mercure de France, p. 11
- Rabelais, Le Tiers Livre, XXV, éd. Screech, p. 185
- Montaigne, Essais, éd. P. Villey, Paris, PUF, 2e édition, 1965, II 12, p. 497.
- Georges Sorel, Les illusions du progrès, Paris, Marcel Rivière, 1908. Réed. L'Âge d'Homme, 2005
- Robert Bouchez et Claire Laurent, "L'homme et l'invention", in Jean Poirier (dir.), Histoire des mœurs, tome 3 La pléiade, 1990. Cité dans Jean-Marc Tonizzo, L'homme et l'invention, La mécanique universelle, 2001
- Pascal Picq, L'homme ne descend pas du singe, il a des ancêtres communs avec lui, c'est très différent. Entretien avec Anne Chemin, Le Monde, 13 décembre 2012
- Hésiode, Les Travaux et les Jours, traduction : Paul Mazon, Les Belles Lettres
- Jacques Ellul, La technique ou l'enjeu du siècle, 1954; réed. Economica, 2008, p.25
- Thomas d'Aquin, Somme contre les Gentils, vers 1260
- Roger Bacon, Opus tertium, chap. II. Opus minus, édi. Brewer p. 322. S. C. Easton, Roger Bacon and his Search of a Universal Science, Oxford, 1952, 126-143.
- Mathias Roriczer, Von der Fialen Gerechtigkeit (Comment construire correctement des pinacles et des tours)
- Francis Bacon, The Two Books of Francis Bacon of the profiscience and Advancement of Learning divine and Human, to the King, 1605 ; traduit en latin en 1623 dans une version amendée pour le continent : De dignitate et augmentis scientiarum). Première traduction en français, 1624. Titre anglais par la suite abrégé : The Advancement of Learning. Dernière traduction en français : Du progrès et de la promotion des savoirs, Gallimard, 1991. Autre traduction : Du progrès et de l'accroissement des sciences.
- « The end of our foundation is the knowledge of causes, and secret motions of things; and the enlarging of the bounds of human empire, to the effecting of all things possible. » Francis Bacon, La Nouvelle Atlantide (1627) in Œuvres de François Bacon, vol. XI, Paris, 1840, traduction d'Antoine de La Salle, p. 449.
- René Descartes, Les Principes de la philosophie, 1644 (en latin), 4e partie, 6203, in Descartes, Œuvres, Adam et Tannery, Paris, 1897-1913, t.IX, p. 321
- Pascal, "Fragment d'un Traité du vide", 1647, in Pascal, Pensées et opuscules, Paris, Hachette, 1968, p.80
- TurgotPlan des deux Discours sur l'histoire universelle (introduction). Ce texte ne sera publié qu'en 1844.
- Auguste Comte, Plan des travaux scientifiques nécessaires pour réorganiser la société, 1822
- Auguste Comte, Cours de philosophie positive, 1830-1842
- Auguste Comte, Discours sur l'esprit positif, 1844.
- Pierre-Joseph Proudhon, Philosophie du progrès. Programme, 1853. Réed. Elibron Classics, 2002
- Rodolphe Töpffer, Du progrès dans ses rapports avec le petit bourgeois, 1835, 1853. Réed. Le temps qu’il fait, 2001
- « Leçons de M. Michelet », in Des Jésuites, par MM. Michelet et Quinet, Liège, 1843.
- Gustave Flaubert, lettre à Louise Collet, 26 mai 1853, in Flaubert, Correspondance, vol II, Paris, Gallimard, bibliothèque de la Pléiade, 1980, p.334.
- Eugène Huzar, La Fin du monde par la science, Dentu, 1855. Réed. Ère, 2008
- Herbert Spencer, « Progress : its Law and Cause », 1857. Trad. fr. in Essais de morale, de science et d'esthétique Vol.1 : Essais sur le progrès, Germer Baillière, 1877. 2e éd. Paris, Félix Alcan, 1886
- « [Leifchild, J. R.] 1859. [Review of] On the origin of species. Athenaeum no. 1673 (19 November): 659-660. », sur darwin-online.org.uk (consulté le ).
- « Article 1, 1. de la Convention de 1928 concernant les Expositions internationales », Bureau international des Expositions
- Ludovic Carrau, "La philosophie de l’histoire et la loi du progrès d’après de récens travaux". Revue des Deux Mondes T. 11, 1875
- Friedrich Nietzsche, Par delà le bien et le mal, 1886. § 252 et 253.
- L'Antéchrist. Trad. Jean-Jacques Pauvert, 1967, p.79
- Retranscription en ligne
- Jules Delvaille, Essai sur l’histoire de l’idée de progrès jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, 1910; Réed. Hachette/BNF, 2013
- Oswald Spengler, Der Untergang des Abendlandes. Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte, 1918-1922. Trad. fr. Le déclin de l’Occident. Esquisse d'une morphologie de l'histoire universelle, Gallimard 1948 ; réed. 2002
- Carl Schmitt, Politische Theologie. Vier Kapitel zur Lehre von der Souveränität, 1922. Trad. fr. Théologie politique, Gallimard, 1988
- Karl Löwith, Meaning of History, 1949. Trad. fr. Histoire et Salut. Les présupposés théologiques de la philosophie de l’histoire, Gallimard, 2002
- Georges Duhamel, Scènes de la vie future, 1930. Dernière édition : Les mille et une nuits, 2003
- Gina Lombroso, La Rançon du machinisme, Payot, 1931
- Robert Aron et Arnaud Dandieu, Le cancer américain, 1931. Dernière édition : L'Âge d'homme, 2008.
- Ostwald Spengler, L'homme et la technique, 1931
- Nicolas Berdiaev, De la destination de l'homme. Essai d’éthique paradoxale. édition originale : 1931. Dernière édition en français : L'Âge d'homme, 2010
- Nicolas Berdiaev, L'Homme et la Machine, 1933 (traduit en français la même année).
- Georges Duhamel, « La querelle du machinisme », article publié en 1933 dans La Revue de Paris. Accessible en ligne.
- Lewis Mumford, Technique et civilisation, 1934
- Simone Weil, Réflexions sur les causes de la liberté et de l’oppression sociale, 1934. Dernière édition : Folio, coll. « Essais », 1998
- Bernard Charbonneau, 1936. In Jacques Ellul et Bernard Charbonneau, Nous sommes révolutionnaires malgré nous, Le Seuil 2014.
- Friedrich Georg Jünger, La perfection de la technique
- Georges Friedmann, Problèmes humains du machinisme industriel, Gallimard, 1946
- Georges Bernanos, La France contre les robots, 1947. Réed. Castor Astral, 2017
- Alfred Sauvy, « Théorie générale de la population », 1952-1954, TI, p. 193 et suiv.
- Jacques Ellul, La technique ou l'enjeu du siècle, 1954. Rééd. Economica, 2008
- Ibid. p. 2.
- Ibid. p. 18-19
- Ibid. p. 3 - Lorsqu'on recontextualise la phrase dans son contexte, « machine » est ici à remplacer par « technique ».
- Ibid. p.130-132.
- Raymond Aron, Les désillusions du progrès : Essai sur la dialectique de la modernité, 1969 (réed. Gallimard/poche, 2010)
- Jacques Ellul, Le Système technicien, Calmann-Lévy, 1977, p. 245
- Hans Jonas, Le Principe responsabilité, 1979
- Ulrich Beck, Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne, Suhrkamp, 1986. Trad. fr. La Société du risque. Sur la voie d'une autre modernité, Aubier, 2001,
- Jacques Ellul, Le bluff technologique, Pluriel, 1988, p. 96-156
- Georg Henrik von Wright, Myten om framsteget, 1993. Trad. fr. Le mythe du progrès, L'arche, 2000, p. 68-69
- Axel Kahn, Rencontres "Les idées mènent le monde", 3ème édition : "Le progrès"; Pau, 18-20 novembre 2016. Extrait vidéo sur YouTube, 11’35" à 14’45"
- Ivan Illich, Némésis médicale, Seuil, 1975
- Michel Puech, Progrès scientifique, progrès technique, progrès humain : démêler l'écheveau pour respirer un peu, Nonfiction.fr, 24 janvier 2013
- Paul VI, Populorum Progressio, 26 mars 1967, lettre encyclique, article 20
Références
- Mircea Eliade, Le Mythe de l'éternel retour, 1949 (traduit du roumain en français).
- Hegel et la divinisation de l'État, Damien Theillier, Le Québecquois libre, 15 avril 2012
- Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Introduction à la philosophie de l'histoire, Livre de poche, 2011
- L'humanisme a été le premier facteur de laïcisation des sociétés occidentales, Jean-Pierre Bernajuzan, Textchroniqu, 24 février 2017
- Comme en 1919, la science est placée au cœur du projet de refondation de l’État-civilisation chinois, Stéphanie Balme, Le Monde, 4 mai 1919
- Carl Schmitt, Politische Theologie, 1922. Trad. fr. Théologie politique
- Albert Dauzat, Nouveau dictionnaire étymologique, Paris, Larousse.
- Jean Borella, « L’idée de progrès », 1971
- Auguste Comte, Système de politique positive, rédigé entre 1851 et 1854
- Grand Dictionnaire universel du XiXe siècle, Paris, 1866-1876, 17 vol. article "Progrès", partie encyclopédique
- Georges Sorel, Les illusions du progrès, 1908 ; rééd. L'Âge d'homme, 2005
- Bernard Charbonneau, « Le progrès contre l'homme », conférence donnée le 15 janvier 1936, in Bernard Charbonneau et Jacques Ellul, Nous sommes révolutionnaires malgré nous, Seuil, 2014, p.89
- Jean Larmat, L'idée de progrès, 1981
- Citons, entre autres : En danger de progrès, de François de Closets (1970) et Mythe ou crise de l'idée de progrès ? , de André Tosel (1984)
- « Transhumanisme : du progrès de l’inhumanité », Pièces et main d'œuvre, mai 2015
- CD Echaudemaison, Dictionnaire d'économie et de Sciences sociales, Nathan Paris, 1993
- Raymond Aron, Les Désillusions du progrès, Calmann-Lévy, 1969. Réed. Gallimard, 1996
- CFDT, Les dégâts du progrès. Les travailleurs face au changement technique, 1977, Seuil, Paris; François de Closets, En danger de progrès, Denoël, 1978
- Cité dans Jacques Ellul, Le Système technicien, p. 316.
- Norbert Elias, Du temps, Fayard, 1996, p.50. Édition originale : Über die Zeit, Francfort, Suhrkamp, 1984
- Nathalie Heinich, La sociologie de Norbert Elias, La Découverte, coll. "Repères", 1997, pp. 66-68.
- Pièces et main d’œuvre, Progrès technoscientifique et regrès social et humain, 2014
- Yuval Noah Harari, Sapiens : Une brève histoire de l'humanité, Albin Michel, 2015, p. 55. Édition originale en hébreu, 2011
- "Le long chemin de l'évolution", in Atlas de l'origine de l'homme, Comprendre les sciences, décembre 2017, p. 6-10
- Atlas de l'origine de l'homme, Comprendre les sciences, décembre 2017. p. 26
- « Les premiers « hommes modernes » », sur www.college-de-france.fr (consulté le )
- Homo sapiens, homme moderne, hominides.com
- Jean-Paul Demoule, La Révolution néolithique, Le Pommier, 2017
- Jean-Paul Demoule, Les dix millénaires oubliés qui ont fait l'histoire. Quand on inventa l'agriculture, la guerre et les chefs, Fayard, 2017, p.25
- Ibid. p.26
- Jacques Le Goff, "Progresso/reazione", Enciclopedia Einaudi, Turin, 1977-1982
- La Théogonie, p. 66.
- Suzanne Said, "Le Prométhée enchaîné, un hymne au progrès ?" L'information grammaticale, no 23, 1984, p. 33-37
- Sylvie Mullie-Chatard, De Prométhée au mythe du progrès. Mythologie de l'idéal progressiste, L'Harmattan, 2005
- Jean-François Dortier, « Y a-t-il eu un miracle grec ? »,
- Gingras, Keating et Limoges 1998, p. 78
- Antoinette Novara cité par Jules Wankenne, op. cit. p.380
- Antoinette Novara, Les Idées romaines sur le progrès d’après les écrivains de la République : essai sur le sens latin du progrès, 2 vol., Paris, Les Belles Lettres, 1983
- C. G. Jung, Réponse à Job (en), édition originale 1952; trad. fr. Buchet Chastel, 2009
- Mathilde Herrero, Histoire de l’idée de progrès de l’Antiquité au XVIIe siècle, Nonfiction.fr, 24 janvier 2013.
- Michel Lacroix, "L'idée de progrès et la dialectique du mal et du bien", in Jean-Michel Besnier et Dominique Bourg (dir.), Peut-on encore croire au progrès ?, PUF, 2000, p.56
- Jean-Claude Guillebaud, "L'Évangile est une précieuse dissidence", entretien avec Jacques de Guillebon et Christophe Geffroy, E.S.M., 2008
- Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 6, verset 26. Traduction d'après la Bible Louis Segond
- Evangile de Jean, 13, 34-35
- Évangile de Luc, 22, 19
- Jacques Le Goff, Le Moyen Âge est une époque pleine de rires ! Le Point, 1er avril 2014
- Emmanuèle Baumgartner et Laurence Harf-Lancner (dir.), Progrès, réaction, décadence dans l'Occident médiéval, Droz, 2003, p.7
- Ibid. p. 8 et 9
- Jean-Paul Trudel, Saint Augustin, humaniste : étude sur la place de Saint Augustin dans l'histoire de la culture classique, Éditions du bien public, , 171 p.
- Charles Béné, Érasme et saint Augustin ou Influence de saint Augustin sur l’humanisme d’Érasme, Droz, , 474 p. (ISBN 978-2-600-03025-0, lire en ligne)
- Augustin d'Hippone, La Cité de Dieu, VII, 7
- Julija Vidović, L’homme dans le dessein de Dieu selon saint Augustin d’Hippone, academia.edu, 2008
- Brève histoire de l'idée de progrès, Alain de Benoist, Blogéléments, 23 janvier 2013
- Mathilde Herrero, Histoire de l’idée de progrès de l’Antiquité au XVIIe siècle, Nonfiction.fr, 24 janvier 2013
- (en) Marjorie Reeves et Warwick Gould, Joachim of Fiore and the Myth of the Eternal Evangel in the Nineteenth Century, Oxford, 1987 ; p. 320-321 [lire en ligne]
- Mircea Eliade, Le Mythe de l'éternel retour, chapitre IV, Gallimard, Paris, 1949
- Ernst Jünger, Le mur du temps, 1959. Trad. fr. Gallimard, Paris, 1963.
- Robert Redeker (entretien avec Galaad Wilgos), Le progrès est un échec politique, écologique et anthropologique, Le Comptoir, 28 janvier 2016
- (en) Toby Huff, Intellectual Curiosity and the Scientific Revolution : A Global Perspective, Cambridge, Cambridge University Press, (ISBN 978-0-521-17052-9), p. 146-150.
- Emmanuèle Baumgartner et Laurence Harf-Lancner (dir.), op. cit. p. 19
- Olga Hazan, Le mythe du progrès artistique: étude critique d'un concept fondateur du discours sur l'art depuis la Renaissance, Presses de l’Université de Montréal, 1999
- Jacques Maritain, Principes d’une politique humaniste, Paul Hartmann, 1945 ; Réedition in Œuvres complètes, tome VIII, Fribourg, éditions universitaires et Paris, éd. Saint-Paul, 1991, p. 227.
- Louis Lachance, L'humanisme politique de Saint Thomas d'Aquin : individu & État, Saint Maixant, Quentin Moreau, (1re éd. 1965), 536 p. (ISBN 978-2-930788-00-5)
- Fernand Braudel, La dynamique du capitalisme, Paris, Flammarion, (1re éd. 1985), 112 p. (ISBN 978-2-08-130795-7)
- Robert Black, École et société à Florence aux XIVe et XVe siècles, Annales. Histoire, Sciences sociales, 2004/4
- Gérard Buis, "Progrès et perspective" in L'idée de progrès, Vrin, 1981
- Olga Hazan, "De la notion de progrès artistique dans la représentation de l'espace", Bulletin des médiévistes québécois, décembre 1995, p. 22-34
- Patrick Boucheron, Conjurer la peur : Essai sur la force politique des images, Sienne, 1338, Points, 2015
- Paul F. Grendler, Printing and censorship, Cambridge University Press, 1988
- Edgar Zilsel, The Genesis of the Concept of Scientific Progress, Journal of the History of Ideas, 1945, 6, p. 325.
- Émile-Guillaume Léonard, Histoire générale du protestantisme, volume I : La Réformation, Paris, PUF, 1961, chap. VII : « Calvin, fondateur d'une civilisation », p. 258-309
- Le Tiers Livre, p. 127.
- Jean Larmat, "L'idée de progrès dans les Essais de Montaigne", in L'idée de progrès, Paris, Vrin, 1982, p. 1-15
- D'Alembert, Discours préliminaire, p. XXIV.
- Angoulvent 1992, p. 35.
- Mairet 2000, p. 12.
- Strauss 1950, p. 429.
- Spinoza, précurseur des Lumières ?, Cafés-philo de Chevilly-Larue et L'Haÿ-les-Roses, 16 mai 2016
- Frédéric Rouvillois, L'invention du progrès 1680-1730, Kimé, 1996 (rééd. CNRS Éditions, 2010)
- Fontenelle, Digression sur les anciens et les modernes, 1688. In Fontenelle, Rêveries diverses. Opuscules littéraires et philosophiques, Paris Desjonquières, 1994, p.43
- Op. cit, p.47
- Frédéric Rouvillois, L'invention du progrès 1680-1730, Kimé, 1996 (édition augmentée : CNRS, 2010. p. 166)
- voir Ulrich Ricken, « Le champ lexical Science-Littérature en français et en allemand » in Dix-huitième siècle, 1978, No. 10, p. 33
- XVIIe siècle. Le Grand Siècle des Sciences, herodote.net, 4 septembre 2017
- Pascal Duris, Les savants du XVIIe siècle, pas si modernes..., Pour la science, 28 juin 2017
- Quelles valeurs pour le progrès ? Débat organisé par le Collège des Bernardines, 27 mars 2018
- Discours préliminaire, p. xxiv.
- Voltaire, Les Cabales. Œuvre Pacifique, 1772. Kessinger Publishing, 2009
- Emmanuel Kant, Qu’est-ce que les Lumières ?, Paris, Flammarion, Collection GF, 2006, pp. 41-44
- Alexis Philonenko, "L’idée de progrès chez Kant", Revue de métaphysique et de morale, 79e année, no 4 (octobre-décembre 1974), p. 433-456. Article repris in Études kantiennes, Vrin, 1982, p. 52-75
- Michel Lacroix, « L'idée de progrès et la dialectique du mal et du bien », in Jean-Michel Besnier et Dominique Bourg (dir.), Peut-on encore croire au progrès ?, PUF, 2000, p.54
- Robert Mauzi, L'idée de bonheur dans la littérature et la pensée françaises au XVIIIe siècle, Paris, A. Michel, (réimpr. 1965, 1969, 1979) (1re éd. A. Colin 1960), 725 p. (ISBN 2-226-06872-4)
- Guilhem Farrugia et Michel Delon (dir.), Le bonheur au XVIIIe siècle, La Licorne, 2015
- Denis Diderot, Essai sur la vie de Sénèque le philosophe, sur ses écrits et sur les règnes de Claude et de Néron, 1778.
- Denis Diderot, Mémoires pour Catherine II. Texte présenté par Paul Vernière, Paris, Garnier, 1966
- Saint-Just, Œuvres complètes, Gallimard, coll. « Folio histoire », 2004, p. 673
- Jacques Ellul, Métamorphose du bourgeois, 1967. Rééd. La table ronde, coll. "La petite Vermillon", 1998
- Jacques Ellul, « L'idéologie du travail », consulté le 30 mai 2020.
- Vocabulaire technique et critique de la philosophie - A. Lalande - Ed. PUF
- Robert Badinter, « La Déclaration de 1789 est une rupture éclatante », Le Monde, 26 novembre 2009 (propos recueillis par Laurent Greilsamer)
- « Les valeurs de l’éthique contemporaine », Bernard Cretin, Institut d'éthique contemporaine, 26 mars 2013
- Immanuel Wallerstein, L’Universalisme européen. De la colonisation au droit d’ingérence, Paris, Demopolis, 2008
- Sylvain Menant, Voltaire-Rousseau : deux conceptions modernes de l’égalité, Académie des Sciences morales et politiques, 8 novembtre 2010
- John Locke, Traité du gouvernement civil, 1690
- De l'esprit des lois, Tome I, Livre xi, chap. iv.
- Blaise Bachofen, Jean-Jacques Rousseau, ou la mauvaise conscience de la modernité, Huffington Post, 10 février 2012
- Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité, p. 288-289.
- Jean Starobinski, texte d'introduction au second Discours sur l'origine et le fondement des inégalités parmi les hommes., pp. LVII-VVIII. Repris dans Starobinski, Jean-Jacques Rousseau, La transparence et l'obstacle, Gallimard, 1971, puis coll. "Tel", 1976, p. 344
- Et les Lumières furent : l’idée de progrès dans la France du XVIIIe siècle, Hugo Borgogno, Nonfiction.fr, 24 janvier 2013
- Condorcet : la condamnation au progrès et la liberté, Nonfiction.fr, 24 janvier 2013
- Le Chapelier, Le Moniteur universel, t. 8, p. 661, cité par Pierre Rosanvallon, L'État en France de 1789 à nos jours, source.
- Jacques Ellul, Exégèse des nouveaux lieux communs, 1966. Réed. La Table ronde, coll. La Petite Vermillon, 2004, p.126
- Michel Lacroix, "L'idée de progrès et la dialectique du mal et du bien", op. cit. p. 55
- Patrice Delpin, « Justifications de la colonisation », sur clio-texte.clionautes.org,
- Michael Ruse, article "Évolution", in Monique Canto-Sperber (dir.), Dictionnaire d'éthique et de philosophie morale, PUF, 1996, p. 547
- Raquel Capurro, Le positivisme est un culte des morts, Epel Eds, 2001
- Sarane Alexandrian, Le socialisme romantique, Paris, Seuil, 1980, p. 262.
- Anne Rasmussen, "La gauche et le progrès", in Histoire des gauches en France, vol. 1. L'héritage du XIXe siècle, La Découverte, 2005
- Extraits commentés de “De l’idée de progrès” in Philosophie du progrès, Irène Pereira, IRESMO, 25 septembre 2011
- Ernest Renan, L’Avenir de la science. Pensées de 1848, 1890. Flammarion, 2014
- Jean-Baptiste Fressoz, L'Apocalypse joyeuse. Une histoire du risque technologique, Seuil, , p. 17
- L'avenir de la science, p. xviii.
- Correspondance Ernest Renan - Marcellin Berthelot, 1847-1892, Calmann-Lévy, 1898
- Paul Mouy, L'idée de progrès dans la philosophie de Renouvier, Vrin, 1927
- Charles Renouvier, Philosophie analytique de l'histoire, 1896
- Anne Rasmussen, « Critique du progrès, « crise de la science » : débats et représentations du tournant du siècle », Mil neuf cent, Revue d'histoire intellectuelle, no 14, , p. 93 (Citation de Charles Renouvier, Derniers entretiens, 1904) (lire en ligne)
- Karl Marx, Les révolutions de 1848 et le prolétariat, 1856
- Karl Marx, Grundrisse, 1857
- Karl Marx, Le Capital, 1863. Livre premier, chap. XV, sous-chapitre X, éditions sociales (trad. Joseph Roy), p. 360-361.
- Henry de Dorlodot, L'origine de l'homme : Le Darwinisme au point de vue de l'orthodoxie catholique, Éditions Mardaga, coll. « Cosmologiques », , 204 p. (ISBN 978-2-8047-0009-6, lire en ligne), p. 32
- Christian Laval et Pierre Dardot, La nouvelle raison du monde. Essai sur la société néolibérale
- John Kells Ingram, A History of Political Economy, Adam & Charles Black, London 1888; Macmillan, New York 1894; McMaster University Archive for the History of Economic Thought, Dodo Press, 2008
- Jacques Ellul, Présence au monde moderne, 1948. Réédition dans « Le défi et le nouveau », La table ronde, 2007, p.39
- Antoine Augustin Cournot, Considérations sur la marche des idées et des événements dans les temps modernes
- William Morris, L' Âge de l'ersatz et autres textes contre la civilisation moderne, Encyclopédie des nuisances, 1999
- Jean-Paul Dekiss, Jules Verne. Le rêve du progrès, Gallimard, 2004
- Anthony Grégoire, Jules Verne contre le progrès, Carfree, 13 août 2015
- Remy de Gourmont, Promenades littéraires. Mercure de France, 1906
- Sociologie critique et critique de la sociologie, Genève, Droz, 1976, 230 p., p. 82
- Du progrès technique au contre-progrès, Encyclopedia Universalis
- René Guénon, La Crise du monde moderne, chapitre 7 ("Une civilisation matérielle"), 1927.
- E. d'Hooghvorst, Le Fil de Pénélope, tome I, Paris, Éditions La Table d'Émeraude, , 385 p. (ISBN 978-2-903965-41-9), p. 97.
- Propos cité par Caterina Zanzi, « La machine dans la philosophie de Bergson », in Annales bergsonniennes, VI, PUF, 2014, page 292. Texte accessible en ligne
- Elkorg projects
- Jean-Pierre Tuquoi, "Ellul et Charbonneau : C’est l’idéologie du progrès qui nous tue", Reporterre, 21 avril 2014
- Kévin Boucaud-Victoire, George Orwell : écrivain des gens ordinaires, Editions Première Partie, 2018. Extrait : George Orwell : un socialisme sans le Progrès, Le Comptoir, 11 avril 2018
- Stefan Zweig, Le Monde d'hier. Souvenirs d'un Européen, 1942, publication posthume 1944 ; traduction nouvelle de Serge Niémetz, éditions Belfond 1993
- Présentation de l'ouvrage par Robert Steuckers, accessible en ligne.
- Siegfried Giedion, Mechanization takes command, 1948. Tr. fr. La Mécanisation au pouvoir, Denoël, 1948. Réed. 1983
- Carl Gustav Jung et Charles Kerényi, Introduction à l'essence de la mythologie, Petite Bibliothèque Payot, 1974. P. 136
- Véronique Liard, « C.G. Jung et le malaise social dans le monde occidental », revue Sociétés, 2003/4 (n° 82)
- Carl Gustav Jung, Présent et avenir, Buchet Chastel, 1962 ; pp. 58-59 Texte original : Gegenwart und Zukunft, Rascher, Zurich, 1957
- Carl Gustav Jung, Dialectique du moi et de l'inconscient, Folio, 1986
- Joseph Schumpeter, Business Cycles: a Theoretical, Historical and Statistical Analysis of the Capitalist Process, 1939. Trad. fr. Les cycles des affaires (
- Jacques Ellul, « L'économie, maîtresse ou servante de l'homme », in Pour une économie à la taille de l'homme, L. Maire et alii, éd. Roulet, Genève, 1947, p. 44-45
- Alfred Sauvy, La machine et le chômage : les progrès techniques et l'emploi, Paris : Dunod/Bordas, 1980
- Jean-Pierre Léac, « Innovation et progrès. Le progrès est mort, vive l’innovation ! » Les Cahiers de l'innovation, 31 mai 2016
- Ouvaton, Le « Point IV » du Président Truman : l’invention du développement ou l’intégration des " Sud " au mythe occidental de la croissance, 29 janvier 2007
- René Courtin, "Un retour à l'économie non monétaire : le macro-marginalisme d'Alfred Sauvy", Revue d'Économie Politique, mai-juin 1954
- Jean Fourastié, Le Grand Espoir du XXe siècle. Progrès technique, progrès économique, progrès social, PUF 1949 ; Machinisme et Bien-être, Éditions de Minuit 1951.
- (en) Eliot Roy Weintraub (en), How Economics Became a Mathematical Science, Duke University Press, .
- Christian Comeliau, La Croissance ou le Progrès ? Croissance, décroissance, développement durable, Le Seuil, 2006
- Bernard Charbonneau, Le Changement, Le pas de côté, 2013, pp. 46-47
- Christian Chavagneux, Le progrès technique est-il toujours source de croissance ? Alternatives économiques, 3 avril 2018
- Céline Lafontaine, L'Empire cybernétique. Des machines à penser à la pensée machine, Seuil, 2004
- Ellul Jacques, « Wiener (Norbert) - Cybernétique et société. Traduit de l'anglais », Revue française de science politique, vol. 5, no 1, (lire en ligne, consulté le )
- Cybernétique, la science des systèmes, Syti.net, 1999
- Imane Sefiane, L’apologie de l’ère informationnelle. Étude généalogique des principes essentiels d’une philosophie idéaliste de l’information pour le progrès humain, Thèse en sciences de l’information et de la communication, Université Paris Ouest Nanterre La Défense, 2012
- Imane Sefiane, La « société de l’information » : entre résurgence et oubli d’un concept cybernétique, Études de communication, Université Lille-3, 2015
- Imane Sefiane, op. cit.
- « Ayn Rand et le moteur du progrès social », sur abebooks.fr
- Vladimir Vodarevski, Libéralisme et individualisme, Contrepoints, 22 mai 2014
- Ludwig von Mises, L'Action humaine, 1949
- Claude Rochet, « Ayn Rand, la haine froide ou le fascisme sans führer », sur claude-rochet.fr,
- Martin Legros, « Liberté, inégalité, immortalité. Le monde que vous prépare la Silicon Valley », Philosophie Magazine, n°83, octobre 2014, p.45
- (en) « Ayn Rand (1905-1982) », sur iep.utm.edu
- C.G. Jung, « Réflexions théoriques sur la nature du psychisme », in Les Racines de la conscience, Buchet-Chastel, 1971. p. 548. Texte original : 1946
- C.G. Jung, Dialectique du moi et de l'inconscient, Folio, 1986
- Carl Jung on the Labyrinth as a Primordial Imagen, Carl Jung Depth Psychology site, 18 avril 2018
- Richard I. Evans, Entretien avec C.G. Jung, Petite Bibliothèque Payot, 1970, p.97
- Jung on film : The Richard Evans Interviews (1957)
- Paul Mengal, "Néolibéralisme et psychologie behavioriste", Raisons politiques, 2007/1 (n° 25), pp.15-30.
- Friedrich Hayek, Vrai et faux individualisme, 1945
- (en) Milton Friedman, Capitalism and freedom, Chicago, The University Chicago press, , 202 p., p. Introduction
- Le néolibéralisme, modèle économique dominant, Hugues Puel, Revue d'éthique et de théologie morale, 2005/1, no 233, p. 29-51
- Christopher Lasch, The Culture of narcissism – American Life in An Age of Diminishing Expectations, 1979. Trad. fr. La Culture du narcissisme. La vie américaine à un âge de déclin des espérances, Climats, 2000
- Christopher Lasch, The True and Only Paradise, 1991). Trad. fr. Le Seul et Vrai Paradis : Une histoire de l'idéologie du progrès et de ses critiques, Champs/Flammarion, 2002
- Günther Anders, Die Antiquiertheit des Menschen 1. Über die Seele im Zeitalter der zweiten industriellen Revolution, C. H. Beck, Munich.
- Philippe Gruca, « Günther Anders », in Cédric Biagini, David Murray et Pierre Thiessen, dir., Aux origines de la décroissance : Cinquante penseurs, L'Échappée - Le Pas de côté - Écosociété, 2017, p. 16
- « Qu’est-ce que la honte prométhéenne ? », sur anthropotechnie.com,
- Günther Anders, L'obsolescence de l'homme. Sur l'âme à l'époque de la deuxième révolution industrielle, tome 1, éditions Ivrea et Encyclopédie des Nuisances, Paris, 2002
- Günther Anders, L'homme sans monde, Écrits sur l'art et la littérature Fairo, 2015
- Hicham-Stéphane Afeissa, Günther Anders, le penseur visionnaire de l'après-Hiroshima, Slate, 9 juillet 2015
- Jean Baudrillard, Le Système des objets : la consommation des signes, Gallimard, 1968
- David Riesman, The Lonely Crowd, Yale University Press, 1950
- David Riesman, La foule solitaire, 1964
- Jacques Ellul, Métamorphose du bourgeois, 1967. Éditions La Table ronde, 1998
- Eugene Cernan et Don Davis, J'ai été le dernier homme sur la Lune, Altipresse, 2010
- 70 ans de progrès pour les Droits de l’Homme, Humanrights
- Citation souvent reprise en ligne mais non référencée.
- Claude Julien, L'Empire américain, Grasset, 1968
- Bernard Esambert, Revue « Les informations », 1971
- Bernard Esambert, La guerre économique mondiale, Orban, 1991 ; Christian Harbulot, La machine de guerre économique, Economica, 1992
- Christian Barrère, La rivalité, le pouvoir, et les discours de la paix et de la guerre, Revue de Philosophie Economique, n°5, 2002/1, pp.39-66
- Evelyne Pieiller, "Une si gentille subversion", in Le progrès en procès, Le Monde diplomatique / Manière de voir, octobre-novembre 2018, p.65
- Jacques Ellul, Exégèse des nouveaux lieux communs, 1966, éd. La Table Ronde, coll. « La petite vermillon », 2004, p. 173
- Bernard Charbonneau , Le changement (ouvrage posthume), Le Pas de côté, 2013
- Raymond Kurzweil, The Age of Spiritual Machines : when Computers Exceed Human Intelligence, Viking / Penguin Books, 1999
- Raymond Kurzweil, The Singularity is Near : When Humans Transcend Biology, New York, Penguin, 2005. Trad. fr. Humanité 2.0. La Bible du changement, Paris, M21, 2007
- Énergie et équité, Le Seuil 1975. Réédition Arthaud, 2018
- Une société sans école, Le Seuil, 1971. Réédition Points Essais, 2015
- Némésis médicale, Le Seuil 1975
- Noël Mamère, La Dictature de l'Audimat, La Découverte, 1988
- (en) « The Limits to Growth », sur Club de Rome (consulté le ).
- Alvin Toffler, Future Shock, 1970. Trad. fr. Denoël, Le Choc du futur, 1971. Réédition, Folio Essais, 1987
- Sylvain Besson, « La mort du progrès nous laisse vides et angoissés », Le Temps, (lire en ligne, consulté le ).
- Émission "Des paroles et des actes", France 2 , 12 janvier 2012, 28e minute
- « Le progrès face aux idéologies du déclin », Clip de promotion, Dailymotion, 2013
- Déclaration de Laurence Rossignol secrétaire nationale du PS chargée de l'environnement et du développement durable, Centre des Nouvelles industries et Technologies, 23 novembre 2013. Cité par Olivier Rey, Leurre et malheur du transhumanisme, Desclée de Brouwer, 2018, p. 165.
- « Le progrès, c’est nous ! », sur fondapol.org
- Christine Ducros, « Dans l'ombre de Dupont-Aignan, un trio de conseillers », sur lefigaro.fr, (consulté le ).
- Eugénie Bastié et Éléonore de Noüel, « Patrick Buisson et Pierre-Antoine Delhommais : «Était-ce mieux avant ?» », sur lefigaro.fr/vox,
- Robin Rivaton, Progrès, le retour, L'Opinion, 6 janvier 2014
- Vera Bonda, « Les réseaux sociaux : quel impact sur la politique ? », sur prezi.com, (consulté le )
- La décroissance, une idée qui chemine sous la récession, Eric Dupin, Le Monde diplomatique, août 2009
- Collectif Pièces et main d'œuvre, Il faut vivre contre son temps, éd. Service Compris, 2014
- Henri Lefebvre, La Vie quotidienne dans le monde moderne, Gallimard, 1968. Réed. 2018
- Progrès, croissance et bien-être : quelle idéologie pour quelle humanité ?, AMAP Les Courgettes, février 2015
- Henri Lefebvre, « Les idéologies de la croissance », in L'Homme et la société, 1973, n°27, pp. 3-17
- Jacques Ellul, Le bluff technologique, 1988. Réed. Hachette, 2004
- Croissance et progrès social ne sont pas incompatibles, Finyear, 12 mai 2011
- Le progrès technique est-il toujours source de croissance ?, Christian Chavagneux, Alternatives économiques, 3 avril 2018
- Christian Comeliau, La croissance ou le progrès ? Croissance, décroissance, développement durable, Le Seuil, 2006
- Gilbert Rist, Le Développement : Histoire d'une croyance occidentale, Presses de Sciences Po, coll. « Références », Paris, 1996, 4e éd. revue et augmentée, 2013
- Vincent Enjalbert, recension de la quatrième édition du livre de Gilbert Rist, Lectures, 19 juin 2013
- Alain Micoud, Le succès social du « développement durable », Responsabilité et environnement, no 48, octobre 2007
- Charte de progrès et de développement durable établie entre Électricité de France et les Organisations professionnelles représentatives des entreprises prestataires du parc nugléaire, janvier 2004
- Comment concilier progrès de l’humanité et développement durable ?, L'expérience maçonnique en société
- Développement durable avec ou sans progrès ?, Yvette Veyret, La revue du projet, PCF, janvier 2013
- Arturo Escobar, Encountering Development: The Making and Unmaking of the Third World, Princeton University Press, 1995
- Jean-Michel Besnier, "Conclusion", in Jean-Michel Besnier et Dominique Bourg (dir.), Peut-on encore croire au progrès ?, PUF, 2000, pp.252-253
- Innovation et progrès : est-ce la même chose ? Guillaume Villon de Benveniste, The Innovation and Startegy Blog, 9 juillet 2014
- Hervé Kabla, Progrès et innovation: quels liens ? Kablages, 14 septembre 2017
- Propos d'Etienne Klein tenus lors d'une conférence organisée par le Collège des Bernardins, Paris, le 23 janvier 2018 et intitulée « On n’arrête pas le progrès ! » Vraiment ? - Vidéo, entre 10’35" et 15’05".
- Numéro spécial de la revue Sciences et avenir n°95, 1er décembre 1993
- Lire par exemple "La révolution numérique est une opportunité", Anna-Christina Chaves, Le Monde, 17 janvier 2017
- La démocratisation des savoirs, Mireille Delmas-Marty et Françoise Massit-Folléa, Rue Descartes, 2007/1, n° 55, pp. 59-69
- Entreprise et progrès : des patrons de bonne volonté, Stratégies, 4 avril 2006
- 2018 : Sept résolutions pour une révolution numérique !, Cigref, 2 janvier 2018
- Jobic de Calan et Jérôme Cauchard, Remède contre l'hystérie numérique, Robert Laffont, 2019
- Et si la révolution numérique n'existait pas ? Paul Sugy, Le Figaro, 26 mars 2019
- On n’arrête pas le progrès ! Vraiment ? The Conversation, 9 avril 2018
- Georges Bernanos, « Révolution de la liberté », décembre 1944. in La France contre les robots (1947). Réed. Le Castrol Astral, 2017, pp. 173-174
- Jacques Ellul, Propagandes, 1962. Rééd. Economica 2008, p.160
- Jacques Ellul, À temps et à contretemps, Entretiens avec Madeleine Garrigou-Lagrange, Le Centurion, 1981, p.176
- Jacques Ellul, « Et d'abord, c'est un fait ! » in Exégèse des nouveaux lieux communs, 1966 ; réédition : La Table ronde, 2004, pp. 200-203
- Les panneaux publicitaires numériques envahissent l’espace public... et nos esprits, Alexandre-Reza Kokabi, Reporterre, 28 mars 2019 /
- Olivier Rey, Une question de taille, Stock, coll. « Les essais », 2014
- Jacques Ellul, Ce que je crois, Grasset, 1987, pp.85-86
- Patrick Chastenet, Pour une approche ellulienne des événements du 11 septembre, Cahiers Jacques-Ellul no 1, 2003, p. 7-30
- Katharine Viner, « Comment le numérique a ébranlé notre rapport à la vérité », Courrier international, 9 septembre 2016.
- Günther Anders, Die Antiquiertheit des Menschen. Über die Seele im Zeitalter der zweiten industriellen Revolution, C. H. Beck, Munich. Trad. fr. L'Obsolescence de l'homme, tome 1, éditions Ivrea et éditions de l'Encyclopédie des Nuisances, Paris, 2002
- Jacques Ellul, Éthique de la liberté, tome 1, Labor et Fides, 1973, p. 36
- Progrès et Liberté : Mise en perspective dans notre techno-société d’aujourd’hui, management-post-moderne.fr, 5 octobre 2018
- Jacques Ellul, Métamorphose du bourgeois, 1967. Réédition : La Table ronde, 1998
- "Les possibilités techniques et le travail", Foi et Vie, juillet 1980 ; réédition in Pour qui, pour qui travaillons-nous ? La Table ronde, 2013, pp. 85-112.
- Jacques Ellul, « Max Weber, l’éthique protestante et l’esprit du capitalisme », Bulletin SEDEIS, n° 905, 20 décembre 1964. Réédition : Cahiers Jacques-Ellul, n°2, mars 2004.
- Pierre-André Taguieff, Du progrès. Biographie d’une utopie moderne, Paris, EJL, « Librio », 2001
- Pierre-André Taguieff, Résister au bougisme, Fayard / Mille et une Nuits, 2001
- Hartmut Rosa : « Plus on économise le temps, plus on a la sensation d’en manquer », interview de Anne-Sophie Novel, Le Monde, 25 mars 2016
- Hartmut Rosa, Accélération. Une critique sociale du temps, La Découverte, coll. « Théorie critique », 2010,
- "Contrôlons-nous la technique ou en sommes-nous les esclaves ?" et "La question de l’autonomie de la technique", journée thématique et assises nationales de Technologos, 2013
- Joël Decarsin, Le problème n’est pas le capitalisme, mais l’empire de la technique, Reporterre, 30 septembre 2013
- Eva Bahbouche, L'évolution hallucinante des jeux vidéo de 1952 à 2016, Gentside, 21 mai 2016
- Evgeny Morozov, To save Everything, Click Here. Technology, Solutionism, and the Urge to Fix Problems that Don't Exist, New York, PublicAffairs. Trad. fr. Pour tout résoudre, cliquez ici. L'aberration du solutionnisme technologique, FYP éditions, 2014
- Contre le « solutionnisme » numérique, David Larousserie, Le Monde Science et techno, 6 octobre 2014
- Hubert Guillaud, Le progrès n’a pas encore tout à fait disparu ! Internetactu, 10 décembre 2017
- Hubert Guillaud, La technologie est-elle toujours la solution ? 1 : Le biais de l’internet-centrisme ; 2 : Le risque du solutionnisme, internetactu.net, 27 et 28 mars 2013
- Le progrès est-il un programme politique ?, Hubert Guillaud (propos recueillis par Aurélien Berthier), Agir par la culture, 14 avril 2015
- Michel Lacroix, "L'idée de progrès et la dialectique du mal et du bien", in Jean-Michel Besnier et Dominique Bourg (dir.), Peut-on encore croire au progrès ?, PUF, 2000, p. 59 et seq
- Pour le pape François, Internet est un « don de Dieu », Le Monde, 23 janvier 2014
- John Gray, Le silence des animaux. Du progrès et autres mythes modernes, Les Belles Lettres, 2018. Edition originale, 2013
- Julien Mattern, "Le mythe du progrès en sociologie", Rencontres "Les idées mènent le monde", 3e édition : "Le progrès"; Pau, 18-20 novembre 2016
- Comment redonner du souffle à l'idéal de progrès ? France Inter, 22 janvier 2018
- Denis Meuret, Le progrès a encore un avenir, nonfiction.fr, 6 octobre 2018
- Eugénie Bastié et Eléonore de Noüel, Patrick Buisson et Pierre-Antoine Delhommais : « Était-ce mieux avant ? », Le Figaro, 25 octobre 2018
- Pierre-Antoine Delhommais et Marion Cocquet, Au bon vieux temps, Éditions de l'Observatoire, 2018
- Pascal Chabot, Après le progrès, P.U.F., 2008
- Pascal Chabot, "Progrès utile et progrès subtil", Le Philosophoire 2011/2, n° 36, pp. 53-64
- "La question de l’autonomie de la technique", assises nationales de Technologos, 6-7 septembre 2013
- Mathieu Amiech et Julien Mattern, Le cauchemar de Don Quichotte, Retraites, productivisme et impuissance populaire, Climats, Collection Sisyphe, Castelnau-le-Lez, 2004. Réed. 2013
- "Qui sommes-nous ?", site internet de Technologos, septembre 2012
- François Jarrige, Technocritiques. Du refus des machines à la contestation des technosciences, La Découverte, 2014.
- Frédéric Joignot, « « Quatre dangers menacent l’existence humaine » (Entretien avec Jared Diamond) », sur lemonde.fr,
- (en) « Snow and Ice on Kilimanjaro », sur https://earthobservatory.nasa.gov/, .
- Rapport du GIEC : « L’influence humaine sur le système climatique est sans équivoque », beurk.com, 1er octobre 2013
- Climat : Cinq rapports du GIEC, cinq chiffres alarmants, Alexandre Pouchard, Le Monde, 4 novembre 2014
- Rapport spécial du GIEC sur les conséquences d’un réchauffement planétaire de 1,5 °C, Johan Lorck, Global-climat, 11 octobre 2018
- Le rapport glaçant du Giec, Aude Massiot, Libération, 7 octobre 2018
- Thomas Porcher et Henri Landes, Le déni climatique, Max Milo, 2015. Recension
- Pierre de La Coste, Apocalypse du progrès, Les ouvrages perspectives libres, 2014
- Secrétariat de la convention sur la diversité biologique (SCDB), 2010. 3e édition des Perspectives mondiales de la diversité biologique. Montréal, 94 pages
- Linda R. Berg, Peter H. Raven, David M. Hassenzahl, Environnement, De Boeck Supérieur, 2009, p. 2-3, (ISBN 2804158918).
- Robert Barbault, Écologie générale, 6e éd., Dunod, 2008, p. 268-269.
- Georgina Mace (coord.), Hillary Masundire (coord.), Jonathan Baillie (coord.), « Biodiversity ». Dans : Évaluation des écosystèmes pour le millénaire, Ecosystems and Human Well-being: Current State and Trends, PNUE, 2005, p. 77-122 [lire en ligne].
- Neville Ash (coord.), Asghar Fazel (coord.), « La biodiversité », p. 166-169. Dans : PNUE, Global Environment Outlook (GEO-4, Avenir de l'environnement mondial), 2007, p. 157-192.
- « [Tribune] Le cri d’alarme de quinze mille scientifiques sur l’état de la planète », sur lemonde.fr,
- Joël Decarsin, « Aujourd’hui, il est trop tard », sur sciences-critiques.fr,
- Jean-Claude Debeir, Jean-Paul Deléage et Daniel Hémery, Les servitudes de la puissance, Flammarion, coll. nouvelle bibliothèque scientifique, 1986, p. 284
- « Nous connaître - Nos valeurs, nos missions », sur progresnucleaire.org
- Lettre ouverte : “Investissons dans les réacteurs à sels fondus”, Le Monde de l'Énergie, 4 octobre 2018
- Jean-Philippe Louis, Intelligence artificielle : pourquoi Musk, Hawking et Gates s'inquiètent ? Les Échos, 30 janvier 2015
- Christophe Bys, Zuckerberg contre Musk : leur clash sur l'intelligence artificielle, L'Usine digitale, 26 juillet 2017
- Un monde sans humains, documentaire de Philippe Borel, 2012. Résumé : Université d'Orléans, 2014
- Claire Chartier, La face (très) noire de l'intelligence artificielle, L'Express, 25 octobre 2018
- Contenu de la Déclaration
- Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, article 3, 2
- Texte de la déclaration
- Hervé Ratel, Le clonage humain devient réalité, Sciences et Avenir, 25 juillet 2014
- John Dinges, Les Années Condor, comment Pinochet et ses alliés ont propagé le terrorisme sur trois continents, La Découverte, 2005.
- Florian Delorme, « L’hyperpuissance des GAFA menace-t-elle la démocratie ? », sur franceculture.fr,
- Jacques Ellul, Les nouveaux possédés, 1973. Rééed. Mille et une nuits/Fayard, 2003, p. 316
- Op. cit. p.73
- Jacques Ellul, Autopsie de la révolution, 1969. Réed. La Table ronde, 2008 , p.96
- Jacques Ellul, Théologie et technique. Pour une éthique de la non-puissance, Labor et Fides, 2014 (ouvrage posthume), pp. 314-315
- Jacques Testart, « De Gauche », petit lexique à usage pédagogique, scientifique et politique Sous la direction d’Alain Caillé et Roger Sue, Fayard, 2009, pp. 262-267. Texte en ligne.
Bibliographie
Répertoire exhaustif, classement par ordre inversement chronologique de la première édition.
- Sont ici privilégiés les ouvrages et les articles dont le titre contient le mot « progrès ».
- Les essais rédigés en langues étrangères (principalement l'anglais et l'allemand) ne sont mentionnés que s'ils ont ensuite été traduits en français.
XXIe siècle
- Gilles McMillan, Mauvaise foi. Essai sur la religion du progrès, Montréal, Somme toute, 2018
- John Gray, Le silence des animaux. Du progrès et autres mythes modernes, Les Belles Lettres, 2018 (édition originale : 2013)
- Stefan Dehnert, Vincent Charlet et Thierry Germain, L’Industrie du futur : progrès technique, progrès social ? Regards franco-allemands, Presses des Mines, 2017.
- Etienne Klein, Sauvons le progrès, Éditions de l'Aube, 2017
- Georges Vignaux, Le mythe du progrès: Discours, techniques, idéologies, 2017
- Jacques Bouveresse, Le mythe moderne du progrès. La critique de Karl Kraus, de Robert Musil, de George Orwell, de Ludwig Wittgenstein et de Georg Henrik von Wright, Agone, 2017
- Miki Kasongo, Le non-progrès de l'Afrique. Etude d'une responsabilité partagée, L'Harmattan, 2016
- Robert Redeker, Le Progrès ? Point final, Ovadia, 2015
- Pierre de La Coste, Apocalypse du progrès, Les ouvrages perspectives libres, 2014
- Collectif, L'idéologie du progrès dans la tourmente du postmodernisme (actes de colloque), Académie Royale de Belgique, 2012
- Jean Druon, Un siècle de progrès sans merci. Histoire, physique et XXe siècle, Jean Druon L'échappée, 2009
- Kirkpatrick Sale, Le mythe du progrès, Non Fides, 2008
- Pascal Chabot, Après le progrès, P.U.F. 2008
- Audrey Reynier, Innovation et progrès technique, Bréal, 2008
- Ronald Wright, Brève histoire du progrès, éditions Hurtubise, HMH, 2006
- Ronald Wright, La Fin du progrès ?, Editions Naïve, février 2006
- Jean-Paul Besset, Comment ne plus être progressiste ...: ... sans devenir réactionnaire, Fayard, 2005
- Sylvie Mullie-Chatard, De Prométhée au mythe du progrès: mythologie de l'idéal progressiste, L'Harmattan, 2005
- Pierre-André Taguieff, Le Sens du progrès. Une approche historique et philosophique, Flammarion, « Champs », 2004
- Robert Redeker, Le progrès ou l’opium de l’histoire, Pleins feux, coll. Étude(s), 2004
- Michel Claessens, Le progrès au XXIe siècle, L'Harmattan, 2003
- Emmanuelle Baumgartner et Laurence Harf-Lancner, Progrès, réaction, décadence dans l'Occident médiéval, Droz, 2003,
lire en particulier la préface de Laurence Harf-Lancner, p. 7-22 : « L'idée de progrès dans l'occident médiéval : un paradoxe ? » - Alain Touraine, Barbarie et progrès, Alice, 2002
- Guy Sorman, Le progrès et ses ennemis, Fayard, 2001
- Pierre-André Taguieff, Du progrès. Biographie d’une utopie moderne, EJL, « Librio », 2001

- p. 9-10
- p. 89
- p. 9
- p.44
- p.131
- p. 45
- p. 47
- Descartes, Le principe de la philosophie, 1644. Cité p. 47
- Leibniz, Principes de la nature et de la grâce fondés en raison, §18, éd. André Robinet, Paris, PUF, 1954, p. 65. Cité p. 57
- p. 66-66
- Herbert Spencer, Social Statics, Londres, John Chapman, 1851, p. 65. Cité p. 79
- p. 79
- p. 82
- Dominique Bourg, Jean-Michel Besnier (dir.), Peut-on encore croire au progrès ? Garnier-Flammarion, 2000
XXe siècle
- Daniel Boy, Le Progrès en procès, Presses de la Renaissance, 1999
- Olga Hazan, Le mythe du progrès artistique: étude critique d'un concept fondateur du discours sur l'art depuis la Renaissance, Presses de l’Université de Montréal, 1999
- Teodor Shanin, L’idée de progrès, 1997
- Dominique Lecourt, L'avenir du progrès. Entretien avec Philippe Petit, Textuel, 1997
- Dominique Bourg, Nature et technique. Essai sur l'idée de progrès, Hatier, 1997
- Sylvie Lelièpvre-Botton, L'Essor technologique et l'idée de progrès, Ellipses, 1997
- Gilbert Rist, Le Développement : Histoire d'une croyance occidentale, Presses de Sciences Po, coll. « Références », Paris, 1996 (ISBN 2-7246-0694-9), 4e éd. revue et augmentée, 2015 (ISBN 978-2-7246-1279-0)
- Anne Rasmussen, « Critique du progrès, “crise de la science” : débats et représentations du tournant du siècle », in « Progrès et décadence », no 1900, Revue d’histoire intellectuelle, 14, p. 89-113
- Frédéric Rouvillois, L'invention du progrès 1680-1730, Kimé, 1996 (édition augmentée : CNRS, 2010)
- Étienne Barilier, Contre le nouvel obscurantisme. Éloge du progrès, Genève et Lausanne, Éditions Zoé/l’Hebdo, 1995
- Georg Henrik von Wright, Myten om framsteget, 1993. (trad. fr. Le mythe du progrès, L'arche, 2000)
- David Noble, Progress Without People, Between The Lines, Toronto (Canada), 1993 (trad. fr. Le Progrès sans le peuple. Ce que les nouvelles technologies font au travail, Agone, 1995)
- Robert Bonnaud, Les alternances du progrès, Kimé, 1992
- Christopher Lasch, The True and Only Paradise, 1991 (trad. fr. Le Seul et vrai Paradis. Une histoire de l'idéologie du progrès et de ses critiques, Champs/Flammarion, 2002)
- Jacques Ellul, Le bluff technologique, 1988 (réed. Hachette, 2012)
- Henri Agel, Progrès ou déclin du mal dans le monde actuel ?, Dervy, 1985
- André Tosel, « Mythe ou crise de l'idée de progrès ? » Praxis, Éditions sociales, 1984
- Eugen Drewermann, Der tödliche Fortschritt, Gebundenes Buch, 1983 (trad. fr. Le progrès meurtrier. La destruction de la nature et de l'être humain à la lumière de l'héritage du christianisme, Stock, 1993)
- Antoinette Novara, Les Idées romaines sur le progrès d’après les écrivains de la République : essai sur le sens latin du progrès, 2 vol., Paris, Les Belles Lettres, 1983
- Leo Strauss, « Progrès ou Retour ? La crise contemporaine dans la civilisation occidentale », Modern Judaism, 1, 1981, p. 17-45
- Jean Larmat, L'idée de progrès, Vrin, 1981
- François de Closets, En danger de progrès, 1970 (édition révisée et augmentée, 1972)
- Raymond Aron, Les Désillusions du progrès : Essai sur la dialectique de la modernité, 1969 (réed. Gallimard/poche, 2010)
- Pierre Piganiol, Maîtriser le progrès. Inventaire de l'avenir, Robert Laffont, 1968
- Radovan Richta, « Révolution scientifique et technique et transformations sociales », L'Homme et la société no 3, 1967, p. 83-103
- Hannah Arendt, Condition de l'homme moderne, 1958
- Jacques Ellul, La technique ou l'enjeu du siècle, 1952 (réed. Economica, 2008)
- Jean Fourastié, Le Grand Espoir du XXe siècle. Progrès technique, progrès économique, progrès social, Paris, PUF, 1949 ; 2e éd. revue, 1950.
- John Burdon Sanderson Haldane, « Influence du progrès technique sur le progrès moral », in : Progrès technique et progrès moral, Rencontres internationales de Genève, septembre 1947, Paris, Oreste Zeluck, 1948
- Collectif, Progrès technique et progrès moral, Paris, Oreste Zeluck éditeur, 1946
- Charles Léopold Mayer, L'homme ne vaut que par le progrès, Éditions de la Maison française, 1945
- Georges Friedmann, La Crise du progrès : Esquisse d'une histoire des idées (1895-1935), Gallimard, 1936
- René Hubert, « Essai sur l'histoire d'idée de progrès », Revue d'histoire de la philosophie, 1934
- Henry Ford, Le Progrès, trad. fr. A. Foerster, Paris, Payot, 1930
- Eugène Dupréel, Deux essais sur le progrès, éd. Lamertin, Bruxelles, 1928
- Jules Sageret, La Guerre et le Progrès, Paris, Payot, 1917
- Adolphe Ferrière, La Loi du progrès en biologie et en sociologie et la question de l’organisme social, Paris, A. Kundig, 1915.
- Louis Weber, « Le Rythme du progrès ». Étude sociologique, Paris, Félix Alcan, 1913, p. 22-24.
- Jules Delvaille, Essai sur l’histoire de l’idée de progrès jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, thèse déposée à la Faculté de Lettres de Paris,
Félix Alcan, 1910 (réed. Slatkine, 1969 ; Georg Olms, 1977; Skatline reprints, 2012 ; Hachette/BNF, 2013) - Georges Sorel, Les illusions du progrès, 1908 (réed. L'Âge d'homme, 2005)
XIXe siècle
- Ferdinand Brunetière, La Formation de l'Idée de Progrès au XVIIIe siècle, Études Critiques. Paris, Hachette, p. 183–250.
- Romolo Federici, Les Lois du progrès déduites des phénomènes naturels, tr. fr. [anonyme], Paris, Germer Baillière, vol. I (première partie), 1888 ; Paris, Félix Alcan, vol. II (seconde partie), 1891
- Jean Félix Nourrisson, Tableau des progrès de la pensée humaine depuis Thalès jusqu’à Hegel, 6e éd., Paris, Perrin, 1886
- Louis Cortambert, La religion du progrès, New York, Marcil, 1875
- Ludovic Carrau, « La Philosophie de l’histoire et la loi du progrès », in Revue des Deux Mondes T. 11, 1875
- Antoine Augustin Cournot, Considérations sur la marche des idées et des événements dans les temps modernes, 1872
- Henri de Ferron, Théorie du progrès, Paris, Rennes : A. Leroy, 1867
- Edmond About, Le Progrès, Paris, Hachette, 1864
- Herbert Spencer, « Progress : its Law and Cause », 1857. Trad. fr. in Essais de morale, de science et d'esthétique Vol.1 : Essais sur le progrès, Germer Baillière, 1877
- Étienne Vacherot, « La doctrine de progrès », Revue de Paris, XXXIII, 1856
- Charles Baudelaire, Où est, je vous prie, la garantie du progrès?, 1855
- Pierre-Joseph Proudhon, Philosophie du progrès. Programme, Lebègue, 1853 (réed. Rivière & Cie, 1946 ; Elibron Classics, 2002 ; Nabu Press, 2010)
- Pierre Leroux, Doctrine de la perfectibilité et du progrès continu, Nêtré, 1851
- Rodolphe Töpffer, Du progrès dans ses rapports avec le petit bourgeois, 1835
XVIIIe siècle
- Nicolas de Condorcet, Esquisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit humain, 1793 (réed. Garnier-Flammarion, 1998)
- Alexandre Savérien, Histoire des progrès de l’esprit humain dans les sciences exactes et les arts qui en dépendent, 1766 (rééd. Lacombe, 1775)
- Charles-Augustin Vandermonde, Essai sur la manière de perfectionner l’espèce humaine, Paris, Vincent, 1756 (réed. Classiques Garnier, 2015)
- Pierre-Louis Moreau de Maupertuis, Lettre sur le progrès des sciences, 1752
- Turgot, Tableau philosophique des progrès successifs de l’ésprit humain (discours prononcé en latin le 11 décembre 1750 dans les écoles de la Sorbonne) ;
« Recherches sur les causes des progrès et de la décadence des sciences et des arts ou réflexions sur l’histoire des progrès de l’esprit humain » (1748)
XVIIe siècle
- Francis Bacon, The Two Books of Francis Bacon of the profiscience and Advancement of Learning divine and Human, to the King, 1605 ; traduit en latin en 1623 dans une version amendée pour le continent : De dignitate et augmentis scientiarum). Première traduction en français, 1624. Titre anglais par la suite abrégé : The Advancement of Learning. Dernière traduction en français : Du progrès et de la promotion des savoirs, Gallimard, 1991
Voir aussi
- Tous les articles commençant par progrès
- Toutes les pages avec « progrès » dans le titre
Articles connexes
Notions associées
A
B
C
- Changement
- Conception du monde
- Conformisme
- Connaissance
- Connaissance technique
- Conscience collective
- Conscience historique
- Criticisme
- Critique de l'humanisme
- Croissance économique
- Croyance
D
- Darwinisme
- Darwinisme social
- Déchristianisation (société)
- Découverte scientifique
- Démocratie
- Démocratie représentative
- Développement

- Développement durable
- Développement économique et social
- Droits de l'homme
E
- Empirisme
- Époque moderne
- Ère industrielle
- Ère progressiste
- Eschatologie
- Esprit critique
- Eudémonisme
- Évolutionnisme (anthropologie)
- Évolutionnisme social
F
G
H
- Histoire de l'Humanité
- Histoire du monde occidental
- Histoire des idées
- Histoire des sciences
- Histoire des techniques
- Historicisme
- Humanisme
- Hygiénisme
I
- Idéologie
- Indicateur de progrès véritable
- Industrialisation
- Innovation
- Innovation en Europe à la Belle Époque
- Invention

- Invention (technique)
J
L
- Laïcisation

- Liberté d'opinion
- Libre arbitre
- Libre examen
- Loi de Moore
- Loi des trois états
- Lumières (philosophie)
M
- Maîtres et possesseurs de la nature (Descartes)
- Marche du Progrès
- Miracle grec
- Modernisation
- Modernité
N
- Néopathie
- Neuf Clés de la modernité (livre)
O
P
- Perfectionnisme (philosophie)
- Philosophie de l'histoire
- Philosophie de la technique
- Philosophie moderne
- Philosophie politique
- Populorum Progressio
- Processus d'amélioration continue
- Progrès accéléré
- Progrès médical
- Progrès scientifique
- Progrès social
- Progrès spirituel
- Progrès technique
- Progression

- Progressisme
- Prospective
- Providence
Q
R
- Rationalisation
- Rationalisme
- Recherche et développement
- Réformisme
- Religion naturelle
- Renaissance
- Révolution
- Révolution copernicienne
- Révolution industrielle
- Révolution numérique
S
- Saint-simonisme
- Savoir
- Scientisme
- Sécularisation
- Sens (métaphysique)
- Siècle des Lumières
- Singularité technologique
- Société post-industrielle
- Summum bonum
T
U
V
Notions opposées
A
C
- Cage de fer
- Catastrophe environnementale
- Catastrophisme
- Chute (Bible)
- Collapsologie
- Comité liquidant et détournant les ordinateurs
- La Complainte du progrès (chanson)
D
- Décadence
- Déclin de civilisation
- Le Déclin de l'Occident (livre)
- Dépendance à Internet
- Désenchantement du monde
- Destin
E
- Écologie sociale
- Effondrement (essai)
- Effondrement écologique
- Ère post-vérité
- Éternel retour (concept antique)
- Extinction de l'humanité
F
H
I
L
M
N
P
R
T
V
Liens externes
Histoire
- Origine et usages du mot « progrès », Littré
- Le progrès selon les stoïciens, Persée
- Francis Bacon et son rôle dans le progrès des sciences, Encyclopédie de l'Agora, avril 2012
- Brève histoire de l'idée de progrès, Alain de Benoist, Blogéléments, 23 janvier 2013
Dossier établi par le site Nonfiction (2013)
- Introduction : L' irréligion du progrès, Frédéric Ménager-Aranyi
- 1 : Histoire de l’idée de progrès de l’Antiquité au XVIIe siècle, Mathilde Herrero
- 2 : Condorcet : la condamnation au progrès et la liberté, Catherine Kintzler
- 3 : Et les Lumières furent : l’idée de progrès dans la France du XVIIIe siècle, Hugo Borgogno
- 4 : Entretien avec David Muhlmann : « Les marxistes et le progrès », Frédéric Ménager-Aranyi
- 5 : Progrès scientifique, progrès technique, progrès humain : démêler l'écheveau pour respirer un peu, Michel Puech
Débats organisés par le Collège des Bernardins, Paris, (2018)
- Inroduction : « On n’arrête pas le progrès ! » Vraiment ? (23 janvier)
- 1 : L’éducation, clé du progrès humain ? (30 janvier)
- 2 : Qui gouverne le progrès ? (6 février)
- 3 : Un monde à plusieurs vitesses ? (13 février)
- 4 : L’intelligence peut-elle devenir artificielle ? (13 mars)
- 5 : Quelles valeurs pour le progrès ? (27 mars)
Autres débats (par ordre inversement chronologique)
- L'idée du progrès est au cœur de nos systèmes financiers, Cécile Philippe, Le Point, 23 mars 2019
- Le progrès en procès, Le monde diplomatique, Manière de voir, no 161, octobre-novembre 2018
- Il est urgent que la philosophie questionne l’innovation, Xavier Pavie, Catherine Vincent, Le Monde, 31 août 2018
- Est-ce la fin du progrès ?, La tête au carré, France Inter, 15 septembre 2016
- Comment arrêter le progrès (à propos du livre de François Jarrige, « Technocritiques »), La Vie des Idées, 5 février 2016
- Le progrès est-il un programme politique ?, Hubert Guillaud (propos recueillis par Aurélien Berthier), Agir par la culture, 14 avril 2015
- Penser le Progrès au XXIe siècle (cycle de cinq conférences), Fédération française de l’Ordre Maçonnique Mixte International, Paris, 12 avril 2014
- Progrès utile et progrès subtil, Pascal Chabot, Le Philosophoire 2011/2 (n° 36), pp. 53-64
Citations
- Portail de la philosophie
- Portail de l’histoire



.jpg.webp)





.jpg.webp)





.jpg.webp)










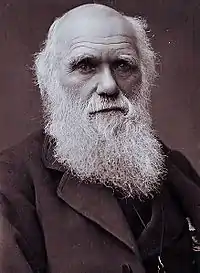













_by_Erling_Mandelmann_-_2.jpg.webp)
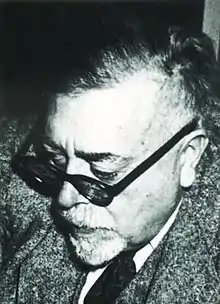

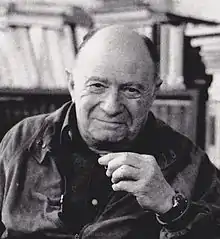
.jpg.webp)
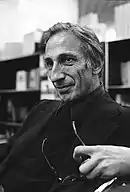






.jpg.webp)
.jpg.webp)
.jpg.webp)

.jpg.webp)

