Philosophie politique
La philosophie politique est une branche de la philosophie qui étudie les questions relatives au pouvoir politique, à l'État, au gouvernement, à la loi, à la politique, à la paix, à la justice et au bien commun entre autres. Elle est considérée comme une des branches de la philosophie pratique à côté de la philosophie du droit et de la philosophie morale.
En tant que recherche philosophique, elle se distingue de celles menées par les sciences humaines et sociales (sociologie, histoire, psychologie, psychologie politique, science politique) en ce que, à la différence de celles-ci qui s'attachent à ce qui existe historiquement et particulièrement, elle est fondée sur la recherche d'un universel, guidée par la question du juste, du meilleur et du légitime[1]. Cette recherche aboutirait-elle à l'impossibilité de son achèvement que cela ne changerait pas la nature de la recherche.
De nos jours, la science politique est devenue inséparable de la philosophie politique.
Définition
Selon Leo Strauss, toute tentative de définir la philosophie politique suppose de contourner deux erreurs[2] :
- La première consiste à ne considérer la philosophie politique que comme une dépendance subalterne de la philosophie dans son ensemble. Cette généralisation abusive pose des problèmes, dans la mesure où elle fait l'économie des divergences profondes entre l'histoire de la philosophie politique, et celle de la philosophie[3].
- La seconde consiste à n'y voir qu'un simple prolongement de l'analyse politique. En effet, si la philosophie politique ressort de la pensée politique, toute pensée politique n'est pas une philosophie politique : « un penseur politique qui ne serait pas un philosophe s'intéresserait ou s'attacherait avant tout à un ordre ou à une législation politique spécifique ; le philosophe politique s'intéresse et s'attache avant tout à la vérité »[4],[3]. Parce que son objet est fortement enraciné dans la réalité humaine, « par un rapport à la fois nécessaire, indépassable, et indéfiniment problématique avec les expériences et les opinions effectivement présentes dans la vie réelle de la cité » la philosophie politique se caractérise par une tension constante entre la théorie et la pratique : tout en assumant une portée universelle, elle se doit de faire la part de l'existant[3].
Historique
Antiquité
Socrate est généralement tenu pour le fondateur de la philosophie politique, mais c’est Aristote qui emploie expressément ces mots[5]. Il semble en effet avoir été le premier à formuler une critique globale et absolue d'un système politique existant[6], bien qu'un discours relevant de la science politique se retrouve également chez son contemporain Thucydide, et qu'une philosophie politique se trouve à l'état fragmentaire dans ce qu'il reste de l'œuvre d'Héraclite.
Le débat initial qui fonde la philosophie politique comme un domaine essentiel de la philosophie se trouve dans le dialogue Le Phédon de Platon, lorsque Socrate indique que dans sa jeunesse, il a été conduit à abandonner les sciences de la nature pour s'intéresser aux opinions de la Cité. Ce qu'il est convenu d'appeler, avec Socrate sa « seconde navigation », signe le point de départ de la Philosophie comme « Philosophie Politique ». Ce point de départ est déjà porteur d'une ambiguïté, qui se trouve au début des œuvres d'Aristote, la Métaphysique et la Politique. Chacune est dite science première. La première des tâches de la philosophie politique va être ainsi de justifier son primat sur les choses qui sont au-delà de la Nature (méta ta phusikè). Pour Aristote, l'homme est un animal politique[7],[8] ; il écrit dans Politique :
« La cité est au nombre des réalités qui existent naturellement, et (...) l'homme est par nature un animal politique. Et celui qui est sans cité, naturellement et non par suite des circonstances, est ou un être dégradé ou au-dessus de l'humanité. Il est comparable à l'homme à qui Homère reproche d’être : Sans famille, sans loi, sans foyer, car, en même temps que naturellement apatride, il est aussi avide de guerre et on peut le comparer à une pièce isolée au jeu de dames. »
— Aristote, Politique, I, II, 1253 a 1-7.
Moyen Âge
Dans le contexte de renouveau intellectuel du XIIe siècle, la philosophie politique connut, après plusieurs siècles de silence, une renaissance avec le Policraticus de Jean de Salisbury (1159). Il s'agit d'un vaste traité en huit livres, d'inspiration platonisante et augustinienne. Jean de Salisbury ignorait en effet la Politique d'Aristote. Il propose dans ce traité un idéal de cité terrestre orientée à des fins spirituelles, où le roi exerce son pouvoir en étroite collaboration avec l'Église et en se défiant de ses conseillers laïcs[9].
C'est seulement au Moyen Âge, lors de la réception des textes et des commentaires de la pensée d'Aristote, que l'on en viendra à parler de philosophie première ou de science des premiers principes à propos des textes d'Aristote dans lesquels le Stagirite analyse la polysémie des sens de l'Être et la question de l'ousia (de l'essence). Ce qu'on va appeler Métaphysique (en grec : méta ta phusikè, « ce qui est au-delà de la nature ») sera dès lors curieusement détaché des études politiques, en contradiction avec le propos même d'Aristote, au début de ses ouvrages politiques, dans lesquels il dit que la philosophie première est la philosophie politique.
Pour Thomas d'Aquin, dans le commentaire qu'il fait de l'épître de Paul aux Romains, « le pouvoir des princes, en tant qu'il est précisément un pouvoir, vient de Dieu ». Dans le Commentaire des Sentences, il écrit que « le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel viennent l'un et l'autre du pouvoir divin ». Saint Bonaventure, quant à lui, conciliait l'origine divine de l'autorité et le système électif ; il soulignait les dangers du système héréditaire et insistait sur l'idée que généralement les chefs élus sont les meilleurs. Cependant, il considérait que cette élection n'était qu'une simple désignation et qu'il appartenait à Dieu, c'est-à-dire au pouvoir spirituel représentant Dieu, de conférer le pouvoir au chef ainsi désigné[10].
Époque moderne
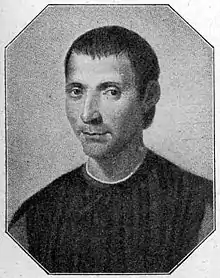
Sans perdre des yeux cette difficulté native de la distinction entre la philosophie première d'Aristote et la philosophie politique, celle-ci connut aux XVIIe et XVIIIe siècles un tournant radical avec l'apparition des théories du contrat social, développées par Thomas Hobbes (Léviathan, 1651), John Locke (Traité du gouvernement civil, 1690), Jean-Jacques Rousseau (Du contrat social, 1762) et Emmanuel Kant. Ces théoriciens recherchaient un fondement du pouvoir moins discutable que le droit divin (théorisé par saint Bonaventure) et moins arbitraire que la force (théorisée par Machiavel). Leurs théories reposaient sur l'hypothèse d'un état de nature, état fictif des hommes n'ayant entre eux d'autre lien que leur qualité commune d'être des êtres humains, chacun étant libre et égal à tous[11].
Giulia Sissa estime que, dans la transition d’une théorie de l’animal politique, naturellement enclin à la sociabilité (Aristote), à une vision mécaniste de la nature humaine (Hobbes), le fondement anthropologique du politique se trouve repensé[12].
Époque contemporaine
La philosophie politique est aujourd'hui encore en grande partie tournée vers l'examen et la discussion des théories du contrat social élaborées aux XVIIe et XVIIIe siècles.
L'une des œuvres actuellement les plus commentées de la philosophie politique contemporaine se situe explicitement dans cette perspective dite « contractualiste »: il s'agit de la Théorie de la justice de John Rawls (1971). D'autres voies ont néanmoins été ouvertes avec, en France, des travaux comme ceux de Michel Foucault, de Cornelius Castoriadis, de Claude Lefort, de Jacques Rancière, de Jean-Pierre Dupuy ou d'Yves Michaud. Là encore, c'est parfois à partir de la redécouverte et de la discussion d'auteurs classiques que se sont dessinées des perspectives nouvelles - comme le montrent par exemple les analyses de Claude Lefort sur l'œuvre de Nicolas Machiavel, auteur du Prince (1512).
Doctrines
Thèmes
- Citoyenneté
- l'État
- la loi naturelle
- le droit et la justice
- le droit naturel
- le pouvoir et l'autorité
- les libertés politiques
- les lois
- les théories du contrat social
- souveraineté
- théories sociologiques du comportement politique
Auteurs majeurs en philosophie politique
Article détaillé : Bibliographie de philosophie juridique et politique.
Moyen Âge
- Al-Farabi
- Dante Alighieri
- Eusèbe de Césarée
- Maïmonide
- Marsile de Padoue
- Saint Augustin
- Thomas d'Aquin
- Ptolémée de Lucques
- Jean de Salisbury
- Brunetto Latini
- Gilles de Rome
- Bonvesin della Riva
- Guido Faba
- Orfino de Lodi
- Giovanni da Vignano
- Geremia da Montagnone
- Filippo Ceffi
- Al Mawardi
- Muhammad al Ghazali
- Ibn Taymiyya
XVe siècle
XVIe siècle
XVIIe siècle
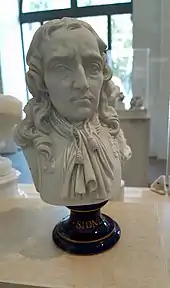
- Algernon Sydney
- Baruch Spinoza
- Duddley Digges
- Gerard Winstanley
- Henry Parker
- Hugo Grotius
- James Harrington
- John Hayward
- John Hall
- John Locke
- John Maxwell (en)
- Petrus Cunaeus
- Philip Hunton
- Robert Filmer
- Samuel von Pufendorf
- Thomas Hobbes
XVIIIe siècle
- Anacharsis Cloots
- Antoine Destutt de Tracy
- Cesare Beccaria
- Claude-Henri de Rouvroy de Saint-Simon
- David Hume
- Edmund Burke
- Emmanuel Kant
- Étienne Bonnot de Condillac
- François Quesnay
- Gabriel Bonnot de Mably
- Germaine de Staël
- Jean-Jacques Rousseau
- Johann Georg Schlosser
- Joseph von Sonnenfels
- Louis de Bonald
- Montesquieu
- Nicolas de Condorcet
- Paul Thiry d'Holbach
- Pietro Verri
- Thomas Paine
- Voltaire
- Wilhelm von Humboldt
- William Godwin
- William Paley
XIXe siècle
- Alexis de Tocqueville
- Antonio Labriola
- Antoine Blanc de Saint-Bonnet
- Auguste Comte
- Benjamin Constant
- Charles Fourier
- Élisée Reclus
- Étienne Cabet
- Félicité Robert de Lamennais
- Franz Mehring
- Georg Wilhelm Friedrich Hegel
- Henry David Thoreau
- Henry Sidgwick
- Jeremy Bentham
- Johann Gottlieb Fichte
- John Stuart Mill
- Joseph Dietzgen
- Joseph de Maistre
- Juan Donoso Cortés
- Karl Marx
- Leonard Trelawny Hobhouse
- Louise Michel
- Max Stirner
- Mikhaïl Bakounine
- Moritz Rittinghausen
- Robert Owen
- Philippe Buchez
- Pierre Joseph Proudhon
- Pierre Kropotkine
- Vincent Bacallar
- Voline
- William Thompson
Période contemporaine
- Alain Badiou
- Albert Camus
- Alexandre Kojève
- Alfred Schütz
- Amartya Sen
- Anselm Jappe
- Anton Pannekoek
- Antonio Gramsci
- Ayn Rand
- Carl Schmitt
- Carlos Astrada
- Chantal Mouffe
- Charles Taylor
- Claude Lefort
- Cornelius Castoriadis
- Daniel Bensaïd
- Daniel Guérin
- Eduard Bernstein
- Eric Voegelin
- Félix Guattari
- Franz Neumann
- Georg Lukács
- Gilles Deleuze
- Giorgio Agamben
- Gustave Thibon
- Guy Debord
- Hannah Arendt
- Hans Blumenberg
- Hans Jonas
- Hélène Landemore
- Henri Temple
- Herbert Marcuse
- Isaiah Berlin
- Ivan Illich
- Jacob Taubes
- Jacques Derrida
- Jacques Ellul
- Jacques Rancière
- Jean-Paul Sartre
- John Dewey
- John Rawls
- Jürgen Habermas
- Karl Popper
- Leo Strauss
- Louis Althusser
- Marcel Gauchet
- Martha Nussbaum
- Maurice Merleau-Ponty
- Max Horkheimer
- Michel Foucault
- Michael Walzer
- Marcel de Corte
- Michel Onfray
- Pierre Manent
- Raymond Aron
- Robert Nozick
- Rosa Luxemburg
- Slavoj Žižek
- Theodor W. Adorno
- Toni Negri
- Walter Benjamin
Notes et références
- La question de la légitimité illustre bien cette différence : chez le sociologue Max Weber, ce mot désigne les moyens par lesquels une personne ou une entité prend aux yeux des hommes le caractère de légitimité, alors que chez les philosophes, la légitimité est elle-même comme vérité l'objet de la recherche, par exemple par le biais de la notion centrale dans les publications de la période moderne de droit naturel par opposition au droit positif (positif, c'est-à-dire existant historiquement).
- Philippe Raynaud 2006, p. 560
- Philippe Raynaud 2006, p. 561
- Leo Strauss 1959, p. 12
- Aristote, Politique, Livre III, chap. XII, 1282 b 23.
- Philippe Raynaud 2006, p. 562.
- 1253 a.
- Pierre Pellegrin 2014, p. 2325
- Jacques Verger, La Renaissance du XIIe siècle, Cerf, 1996, p. 116-117
- E. Cattin, L. Jaffro, E. Petit, Figures du théologico-politique, Librairie philosophique J. Vrin, 1999
- Maryvonne Longeart, Les théories du contrat social : Hobbes, Locke, Rousseau
- Giulia Sissa, « De l’animal politique à la nature humaine : Aristote et Hobbes sur la colère », Anthropologie et Sociétés, vol. 32, no 3, , p. 15-38 (DOI 10.7202/029714ar, lire en ligne)
Voir aussi
Bibliographie
- Pierre Pellegrin (dir.) (trad. du grec ancien), Les Politiques : Aristote, Œuvres complètes, Paris, Éditions Flammarion, , 2923 p. (ISBN 978-2-08-127316-0).

- Luc Brisson (dir.) et Jean-François Pradeau (trad. Jean-François Pradeau), Le Politique : Platon, Œuvres complètes, Éditions Flammarion, (1re éd. 2006), 2204 p. (ISBN 978-2-08-121810-9).

- Olivier Nay, Histoire des idées politiques, Armand Colin,
- Eric Zernik, La pensée politique, Ellipses,
- Leo Strauss, What is political philosophy ? and other studies, University of Chicago Press,
- Philippe Raynaud, Dictionnaire de philosophie politique, PUF,
- Luc Ferry, Philosophie politique, 1984-85 (en 3 volumes dont le troisième en collaboration avec Alain Renaut).
Wikisource
Articles connexes
- Politique
- Philosophie
- État
- Philosophie du droit
- Philosophie morale
- Philosophie sociale
- Psychologie politique
- Science politique
- Théologie politique
- Théories du fascisme
- Conservatisme one-nation
- Portail de la philosophie
- Portail de la politique