Crise du 6 février 1934
La date du fait référence à une manifestation antiparlementaire organisée à Paris devant la Chambre des députés par des groupes de droite, des associations d'anciens combattants et des ligues d’extrême droite pour protester contre le limogeage du préfet de police Jean Chiappe à la suite de l'affaire Stavisky.

La manifestation tourne à l'émeute sur la place de la Concorde, faisant au minimum 15 morts (dont 14 parmi les manifestants), 31 voire 37 morts si l'on compte les décès ultérieurs[n 1] et plus de 2 000 blessés, ce qui en fait la fusillade des forces de l'ordre la plus sanglante de la Troisième République, outrepassant la fusillade de Fourmies en 1891[4]. De nouvelles manifestations violentes — avec de nouvelles victimes du côté des manifestants — se produisent les 7, 9 et 12 février[n 2].
La crise provoque dès le lendemain la chute du second gouvernement Daladier et exerce une influence profonde et durable sur la vie politique française.
La République en crise
Le contexte économique et politique
Au début de l'année 1934, le monde subit les conséquences de la crise économique issue du krach de 1929 et la montée des extrémismes.
En Italie et en URSS, Mussolini et Staline consolident leurs pouvoirs personnels. En Allemagne, Hitler, nommé chancelier le , obtient les pleins pouvoirs le de la même année.
La France est touchée à partir de 1931 par la Grande Dépression, née en 1929 aux États-Unis. La crise économique et sociale frappe particulièrement les classes moyennes, soutien traditionnel de la République, le chômage passant de 273 000 personnes en 1932 à 340 000 en 1934[6]. Or, le pouvoir se révèle incapable d'apporter des solutions et son budget devient fortement déficitaire. Les gouvernements se succèdent (six gouvernements de à ), constitués des mêmes hommes de la majorité, tour à tour institués puis discrédités.
L'antiparlementarisme est aussi alimenté par une succession de scandales politico-financiers : l'affaire Hanau (Marthe Hanau a utilisé ses appuis politiques pour attirer, grâce à son journal La Gazette du franc, les économies des petits épargnants), l'affaire Oustric (la faillite frauduleuse du banquier Oustric précipite en 1930 la chute du gouvernement d'André Tardieu, dont le garde des Sceaux est mêlé à l'affaire), et enfin, cause directe des événements du 6 février, l'affaire Stavisky.
L'affaire Stavisky et ses conséquences


Ce nouveau scandale, impliquant le Crédit municipal de Bayonne, éclate en . Apparaît alors le personnage d'Alexandre Stavisky, escroc lié à plusieurs parlementaires radicaux, dont un ministre du gouvernement de Camille Chautemps. La presse révèle ensuite qu'Alexandre Stavisky a bénéficié de dix-neuf remises de son procès, alors que le Parquet est dirigé par le beau-frère de Camille Chautemps. Le , Alexandre Stavisky est retrouvé mort. Selon la version policière, il se serait suicidé, ce qui suscite l’incrédulité. Pour la droite, il a été assassiné sur l'ordre de Chautemps, afin d’éviter des révélations. Quand, le 12 janvier, le député Jean Ybarnegaray demande devant la Chambre une commission d'enquête, le président du Conseil refuse : « Laissons la justice faire son travail. »[7]. Chautemps commet là une erreur psychologique qui alimente le discours de l'Action française.
Dès le , L'Action française incite les parisiens à huer les députés en criant « à bas les voleurs ! »[8]. Le soir du , le mouvement monarchiste manifeste[9]. Son numéro du 9 janvier proclame : « Aujourd'hui, jour de rentrée du Parlement, à l'heure de sortie de vos ateliers et de vos bureaux, nous vous engageons à venir en foule autour du Palais-Bourbon et aux cris de « À bas les voleurs ! À bas les assassins ! » exiger la justice et l'honneur. »[10]. 2 000 membres et sympathisants répondent à l'appel le premier soir. Le 11 janvier, l'arrestation de M. Aymard, rédacteur au journal Liberté, et de M. Dubarry, directeur de Volonté, jette 4 800 manifestants sur le pavé, où l'Action française est rejointe par les Jeunesses patriotes[11]. La pluie rebute les protestataires le 12 janvier, mais les démonstrations reprennent, aussi nombreuses, les 19 et 20 janvier. Les étudiants de l'Action française et les Camelots du roi scandent : « À bas Chautemps ! À bas les voleurs ! Stavisky au Panthéon ! ». Un nouveau débat sur l'affaire Stavisky le 23 janvier aboutit à un vote de confiance de la Chambre, majoritairement à gauche, en faveur du Président du Conseil Camille Chautemps (367 voix contre 201)[12]. La Ligue des Contribuables descend à son tour dans la rue, mais à un autre point de rendez-vous que celui de l'Action française. Le 27 janvier, la manifestation se grossit de communistes, qui se réclament des soviets et chantent l'Internationale[13]. Le garde des Sceaux, Eugène Raynaldy, étant mouillé à son tour, se retire et le président du Conseil jette l'éponge le 28 janvier. La démission du cabinet Chautemps apaise les revendications. En trois semaines, il y a eu près de 2 000 arrestations et plusieurs centaines d'agents des forces de l'ordre ont été blessés. Maurice Pujo, de l'Action française, explique plus tard à la commission d'enquête : « On me dira qu'il est scandaleux d'arracher des bancs, de déraciner des arbres, de jeter sur la voie publique des grilles d'arbres. Il est certain que nous avons cherché le désordre dans la rue. Les manifestations n'ont pas d'autre but. »[14].
Changement de cabinet
Le président de la République Albert Lebrun appelle le radical Édouard Daladier à constituer un nouveau gouvernement. Celui-ci reprend huit membres du précédent cabinet, y ajoute deux républicains de gauche (François Piétri et Gustave Doussain), un républicain du centre (Jean Fabry), et Eugène Frot, homme nouveau et membre d'une loge maçonnique. La formation du cabinet est achevée le 30 janvier.
Tandis que la droite tente d’utiliser l’affaire Stavisky pour remplacer la majorité issue des élections de 1932, remportées par le Cartel des gauches, l’extrême-droite frappe plus fort : antisémitisme, xénophobie (Alexandre Stavisky est un Juif ukrainien naturalisé), hostilité à la franc-maçonnerie (dont Chautemps fait lui aussi partie), antiparlementarisme. Selon l'historien Serge Berstein, l'affaire Stavisky n'est exceptionnelle ni par sa gravité ni par les personnalités mises en cause, mais par la volonté de la droite de faire chuter un gouvernement de gauche sur ce thème, profitant du fait que les radicaux n'ont pas la majorité absolue à la Chambre des députés et forment donc des gouvernements fragiles. Du point de vue de la droite, cet énième scandale est la goutte d'eau qui fait déborder le vase des compromissions.
Le déclenchement de la crise du 6 février
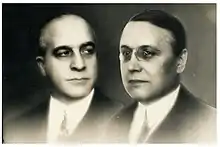
.jpg.webp)
(Le Populaire, organe du Parti socialiste (SFIO), no 4017, 6 février 1934.).
Le , Paris apprend que son préfet de police, Jean Chiappe, est muté au Maroc : Édouard Daladier applique une série de mutations-promotions-sanctions pour éloigner les hommes éclaboussés par l'affaire Stavisky. Or le préfet de police est haï de la gauche, dont il entrave sans violence les manifestations depuis 7 ans, mais très aimé de la droite et de l'extrême-droite, pour lesquelles il manifeste une grande indulgence[16]. Les journaux de gauche l'accusent depuis plusieurs semaines d'être impliqué dans l’affaire Stavisky, mais la droite dénonce le résultat d’un marchandage avec les députés de la SFIO : départ de Chiappe contre soutien au nouveau gouvernement. Les ministres Piétri, Doussain et Fabry démissionnent le , imités le lendemain par Édouard Renard, préfet de la Seine[15]. Le bruit court que le général Maxime Weygand, en conflit avec le président du Conseil, sera le prochain sur la liste des mutations. Le nouveau préfet de police est Adrien Bonnefoy-Sibour, auparavant préfet de Seine-et-Oise (à Versailles) et qui n'a pas d'expérience particulière de la capitale.
Aussitôt des appels à manifester sont placardés partout dans Paris : rendez-vous le 6 février (jour où le nouveau gouvernement doit être présenté à la Chambre) sur la place de la Concorde, à des horaires variables selon l'origine de la protestation. Les Jeunesses patriotes craignent une épuration anticléricale et antipatriotique : « Demain, cédant à la pression de l'Allemagne, un des organisateurs de la victoire sera mis dans l'obligation de partir : le général Weygand. Une formidable hécatombe se prépare dans l'armée, dans la magistrature, à tous les degrés de l'administration vont être frappés ceux qui ont donné des preuves de leur indépendance et de leur patriotisme. Le régime des fiches va renaître ! Le délit d'opinion est rétabli. »[17]. Les Phalanges universitaires interprètent la mutation du préfet de police comme le signal d'une révolution d'extrême-gauche : « Au moment où les révolutionnaires communistes décident de « tenter le coup », on leur prépare des complaisances policières. [...] Gouvernement de voleurs, de traîtres ! »[18]. Le Front universitaire appelle à un rassemblement indépendant des affinités politiques : « Étudiants, en dehors et au-dessus des partis, indépendants de toutes les organisations de droite ou de gauche, nous venons faire appel à ceux de nos camarades qui se sont toujours refusés, comme nous-mêmes à faire de la politique. La France est en péril. Demain, les organisations révolutionnaires essaieront de s'emparer du pouvoir et livreront sans défense notre pays à l'envahisseur. Il n'est pas nécessaire d'être inscrit à un groupe pour se révolter devant les effroyables scandales qui condamnent aujourd'hui le système de ceux qui en vivent. Pour l'honneur de notre génération, les étudiants doivent se dresser et prendre la tête du grand mouvement national qui se dessine. »[19].
La plupart des journaux de Paris s'indignent : la Liberté, L'Ami du peuple, L'Intransigeant, L'Écho de Paris, le Petit Parisien prennent fait et cause pour Jean Chiappe et publient des appels à manifester le 6 février à des endroits divers. L'Ami du Peuple, relayant l'appel de Solidarité Française, écrit : « Il faut que le gouvernement se rende compte que le peuple est réveillé et qu'il avance, décidé à en finir avec les internationaux révolutionnaires et les politiciens pourris. »[14].
Le gouvernement Daladier pense avoir affaire à une simple manœuvre politique qu'une démonstration de la force publique suffira à calmer. Les partis de gauche accréditent, après le 6 février, la crainte d'un complot destiné à renverser la République, en lien avec le renforcement du fascisme en Allemagne et en Autriche. Cette thèse est contestée par M. Noedts, commissaire à la Direction des renseignements généraux, et par M. Perrier, directeur à la préfecture de police, lors de leur interrogatoire par la commission d'enquête parlementaire[20]. Marcel Déat, député ayant été exclu de la SFIO en raison de ses dérives autoritaires, écrit en 1934 : « Le 6 février, place de la Concorde, il y avait des réactionnaires, des fascistes, des petites troupes organisées et courageuses, oui ; mais il y avait aussi une foule énorme de braves gens qui n'avaient pas d'opinion politique mais qui, en revanche, avaient des sujets de mécontentement et de colère. Il y avait même des radicaux et des socialistes et s'ils manifestaient c'était contre les saligauds qui déshonorent la République. »[21]
Dans l'atmosphère surchauffée des premiers jours de février, les journaux parlent d'un recours à l'armée pour contrer la manifestation prévue. L'Action française et l'Écho de Paris évoquent, photographies à l'appui, des mitrailleuses transportées vers le palais Bourbon. Celles-ci font en fait partie d'un cortège de troupes venu rendre des honneurs militaires au général Lefèvre enterré ce jour-là. Le Jour et la Liberté annoncent un rassemblement de tanks dans les casernes de la rive gauche. La Fédération des contribuables s'en plaint dans une lettre ouverte au président de la République[22].
Le soir du 6 février 1934
Les différentes manifestations
Le 6 février, plusieurs manifestations ont lieu simultanément. Les ligues d’extrême-droite, qui jouent un rôle très important dans l'entre-deux-guerres, notamment lorsque la gauche est au pouvoir, ce qui est le cas depuis les élections législatives de 1932, forment plusieurs cortèges.
Parmi les principales ligues présentes le 6 février, la plus ancienne est l’Action française. Fondée en 1898/1899 par Maurice Pujo, Henri Vaugeois et Charles Maurras (60 000 membres revendiqués), elle a pour but de renverser « la gueuse » (la République) afin de restaurer la monarchie. Elle s’appuie sur les Camelots du roi, qui, malgré des effectifs assez limités, sont très actifs dans la rue. De fondation plus récente (1924), les Jeunesses patriotes, qui revendiquent l’héritage de la Ligue des patriotes, comptent 90 000 membres dont 1 500 font partie des « groupes mobiles ». Créées par Pierre Taittinger, député de Paris, elles entretiennent des rapports étroits avec des hommes politiques de droite, et comptent dans leurs rangs plusieurs conseillers municipaux de la capitale. Quant à la Solidarité française, fondée en 1933 par le richissime parfumeur antisémite François Coty, elle est dépourvue d’objectif politique précis et ses effectifs sont moins élevés.
- Enfin, bien que ses effectifs soient insignifiants, le francisme de Marcel Bucard.
- Les Croix-de-feu, créées en 1927 sous la forme d’une association d’anciens combattants, ont élargi leur recrutement à d’autres catégories, notamment les femmes et les non-combattants, sous l’impulsion de leur chef, le colonel de la Rocque. Les Croix-de-feu s'inspirent de l'esprit « anciens combattants » au sens de la fraternité vécue dans les tranchées, quelles que soient les opinions ou origines sociales ou religieuses. Ce mouvement est le premier en nombre d’adhérents, parmi les ligues ou organisations d'anciens combattants.
- La Fédération des contribuables, dont les dirigeants ont des objectifs politiques proches de ceux des ligues, appelle à manifester dès le mois de janvier.
En plus des manifestants de janvier, les très puissantes associations d’anciens combattants appellent aussi à la mobilisation le 6 février. La plus importante d’entre elles, l'Union nationale des combattants (UNC), dont les idées sont proches de la droite et qui est présidée par un conseiller municipal de Paris, compte pas moins de 900 000 membres. Mais l'Association républicaine des anciens combattants (ARAC), satellite du Parti communiste français, appelle également ses troupes à défiler le 6 février, bien que sur un mot d'ordre radicalement contraire, puisqu'elle réclame l'« arrestation immédiate de Chiappe ! »[23]
La marche
Les ligues de droite et d’anciens combattants, de droite comme de gauche[24], appellent donc à manifester le jour même de l'investiture de Daladier, à Paris, place de la Concorde, en face de la Chambre des députés (le palais Bourbon). Au total 30 000 à 50 000 manifestants, dont une bonne majorité d'anciens combattants et quelques milliers d'émeutiers[25]. Tous se mobilisent sur le thème : « À bas les voleurs ! »[n 3].
Les ligueurs d'extrême-droite sont au premier rang de cette manifestation antiparlementaire[27],[28]. La journée débute par des réunions place de la Concorde[29], où toutes les ligues sont présentes.
À l'hôtel de ville, un gouvernement provisoire potentiel est en place[30],[31], composé d'un certain nombre de conseillers municipaux dont beaucoup sont en même temps députés de Paris[30],[31],[32]. Les Jeunesses patriotes sont placées sur l'ancienne place de Grève lui faisant face[33] pour attendre l'heure de l'avènement de ce nouveau gouvernement, selon la tradition, au balcon de l'hôtel de ville. Des camelots, Maxime Real del Sarte et Binet-Valmer y sont envoyés en tant qu'agents de liaison[34], l'Action française, pour sa part, ayant donné comme rendez-vous à ses ligueurs et camelots le croisement du boulevard Saint-Germain et du boulevard Raspail[35]. « Ces voies larges, de plain-pied avec le Palais-Bourbon, avaient facilité nos manœuvres ; elles étaient difficiles à barrer et constituaient le meilleur accès vers la Chambre » dira, plus tard, Maurice Pujo[35].
La Chambre des députés est l'objectif à atteindre[33]. Tandis que Binet-Valmer reste à l'hôtel de ville pour la liaison, Real del Sarte, les Jeunesses patriotes et certains conseillers municipaux, lassés d'attendre, rejoignent les troupes monarchistes aux côtés de la Solidarité française dans le but d'escorter « les élus du peuple de Paris jusqu'à la Chambre »[33] et de prendre le palais Bourbon[32].
Puis les manifestants se dispersent. L'objectif n'est pas atteint.
L'émeute
Le colonel de la Rocque, toujours avec ses Croix-de-feu, gagne l'esplanade des Invalides mais refuse le coup de force. À son appel, les Croix-de-feu se dispersent rapidement. Bien que proches du palais Bourbon, siège de la Chambre des députés, ils se refusent à occuper celui-ci. Leur dispersion rend alors vaine toute possibilité de renverser le régime par la force.
À la suite de la dispersion, des manifestants se rendent place de la Concorde, suivis de près par la Solidarité française, l'Union nationale des combattants et l'ARAC[36]. C'est alors que la manifestation dégénère en combat de rue[31], notamment au pont de Solférino. Alors que dans l'après-midi, des manifestants avaient déjà manifesté par le feu[37], plus tard, en début de soirée, des autobus sont incendiés[38].
Des milliers de militants, dont certains sont armés, tentent de marcher sur le palais Bourbon. L'émeute est extrêmement violente, à coups de boulets de charbon, de débris de fonte, de lames gilette fichées au bout d'un bâton, de billes d'acier qui font chanceler les chevaux de gardes mobiles désarçonnés, mais aussi de balles[39] de revolver[40]. Les forces de l'ordre sont harcelées puis, selon les conclusions rendues par la commission d'enquête parlementaire (voir ci-dessous), subissent des tirs et ouvrent le feu à leur tour à au moins trois reprises au cours de la soirée. Les affrontements se prolongent pendant la nuit[41].
Morts et blessés
_bless%C3%A9_6_f%C3%A9vrier_1934.jpg.webp)


Un bilan détaillé des morts et blessés a rapidement été établi et publié par le président de la commission d'enquête parlementaire sur le 6 février[42].
Parmi la population, manifestants ou badauds, on relève 14 morts et 657 blessés, mais 2 d'entre eux décèdent plusieurs mois plus tard des suites de leurs blessures. 14 tués et 62 blessés l'ont été par balle : des munitions de pistolet de 7,65 mm mortelles jusqu'à 400 m[n 4].
L'Action française, qui compte en tout 20 manifestants tués (dont cinq ont succombé à leurs blessures après le 7 février)[44], déplore 4 morts parmi ses membres (Alphonse Aufschneider, Cambo Costa, Jules Lecomte et Georges Roubaudi), 16 blessés par balle parmi ses membres et 10 parmi ses sympathisants. La ligue des Jeunesses patriotes pleure deux morts (Jean-Éloi Fabre et Raymond Rossignol), de même que la Solidarité française (Gratien Cheynier Le Jouhan de Noblens et Galli Mezziane), qui compte 26 blessés, dont 2 par balle. L'Union nationale des anciens combattants a certifié lors de l'enquête n'avoir eu aucun mort dans ses rangs, mais 53 blessés par coups de matraque, coups de sabre et coups de crosse de revolver. Le président de cette association, Georges Delbecq, fut lui-même blessé à la tête. Les Croix-de-feu, qui n'ont perdu aucun homme, ont subi 2 blessures par balle après la dislocation du cortège et 120 blessés par coups de sabre, de matraque et de crosse de revolver (répartis sur les journées du 5 et du 6 février). Le Parti communiste signale 2 blessés par balle parmi ses membres, 1 parmi ses sympathisants. Au moins 4 des 20 manifestants tués recensés par l'Action française n'appartenaient à aucune association politique[44].
Dans le service d'ordre, on dénombre 1 mort, le garde républicain Marcel Flandre, qui succombe à ses blessures quelques jours plus tard et sera décoré de la Médaille Militaire à titre posthume, et 1664 blessés. 969 d'entre eux sont des gardiens de la paix, 695 sont des militaires : 14 sapeurs pompiers de Paris et 681 gendarmes (225 gardes mobiles, 271 gardes républicains et 185 gendarmes départementaux). D'après le général Bourret (La Tragédie de l'armée française), l'attribution de la Médaille militaire au garde républicain « Landre » (sic), a été annulée par le maréchal Pétain, nouvellement nommé ministre de la Guerre et la décoration ôtée du cercueil devant la famille à la chapelle du Val de Grâce. La presque totalité des blessures ont été occasionnées par des jets de projectiles (pierres, moellons, arceaux de fonte brisés, morceaux de vitres et de bitume). Quelques blessures sont le fait de coups de bâton ou de matraque. Certains manifestants ayant utilisé des lames de rasoir fixées au bout de cannes pour trancher les jarrets des chevaux[n 5], et ainsi couper l'élan des charges de cavalerie, les agents qui ont tenté de les leur arracher ont subi quelques coupures. On ne compte que 3 blessures par balle (et 2 probables).
Polémiques et commission d'enquête parlementaire
De nombreuses questions se posent à la suite de l'émeute : y a-t-il eu complot ? Qui des forces de l'ordre ou des manifestants a tiré en premier ? Les sommations légales ont-elles été faites par les forces de l'ordre ? Quelles armes ont été utilisées ?
Une commission d'enquête parlementaire, présidée par le député et ancien Garde des Sceaux Laurent Bonnevay[46] et composée de quarante-quatre députés est formée à partir du 24 février 1934 (le même jour se réunit une deuxième commission d'enquête sur l'affaire Stavisky elle-même). Censée avoir achevé ses travaux pour Pâques (le 1er avril) elle ne rend ses conclusions qu'en juillet, alors que trois députés se sont retirés en juin et treize autres le 4 juillet car ils refusaient de s'associer à ses conclusions (en fait c'est la totalité des députés du centre et de droite qui a démissionné)[47]. Le rapport fait 3 000 pages[48].
Dans ces conditions, les conclusions de la commission établissent – ou du moins elles affirment – que[47] :
- « ceux qui ont cherché à fausser le libre jeu de nos institutions démocratiques (...) ont mis en danger la République »
- Il n'y a en revanche pas eu de complot interne au gouvernement, mais cette conclusion n'étonne pas outre mesure car tous les membres de l'opposition - dont certains ont soupçonné notamment le ministre de l'intérieur Eugène Frot - ont démissionné de la commission.
- Ce sont les manifestants qui ont tiré les premiers. Mais cette version est contredite par de très nombreux témoignages et il est quasiment impossible de prouver qui - parmi les manifestants, des provocateurs éventuels ou certains membres isolés des forces de l'ordre - a tiré en premier. De plus, les nombreux pétards et amorces utilisés par les manifestants ont certainement contribué à créer ou à augmenter la confusion au sujet de l'emploi d’armes à feu.
- Les sommations légales – à la voix puis au clairon – ont été faites (mais étaient-elles audibles dans le tumulte ?). Certains témoins affirment toutefois que des policiers et/ou des gendarmes isolés ont tiré sans ordre – soit pour se défendre soit sous l'effet de la panique. Quelques officiers de la garde mobile ont déclaré à la commission avoir ordonné à leurs hommes de tirer en l'air à titre d'avertissement.
Par ailleurs, les nombreux témoignages attestant de la présence et de l'utilisation – par les forces de l'ordre ou même par l'armée – d'armes automatiques (fusils-mitrailleurs et mitrailleuses) sont invalidés par la commission d'enquête, ce que le nombre et le type des blessures relevées semble effectivement confirmer (la commission indique que les photos d'armes de ce type, prises lors d'une cérémonie commémorative quelques jours auparavant, ont pu induire la presse en erreur).
La portée du 6 février
Démission de Daladier et formation d'un gouvernement d'Union nationale

Dans la nuit, Daladier prend les premières mesures pour obtenir le rétablissement de l’ordre public (il envisage notamment d'instaurer l'état de siège). Mais le lendemain, ses consignes sont peu suivies par la justice et la police. De plus, il enregistre la défection de la plupart de ses ministres et de son parti. Il se résout finalement à démissionner. C’est la première fois qu’un gouvernement doit démissionner sous la pression de la rue.
La crise se résout finalement avec la formation d’un nouveau gouvernement sous la présidence de l'ancien président de la République (1924-1931) Gaston Doumergue, rappelé par Albert Lebrun, ce dont les ligues semblent se contenter. Qualifié de gouvernement d’« union nationale », il regroupe surtout les principales figures de la droite parlementaire (André Tardieu, Louis Barthou, Louis Marin), même si plusieurs radicaux ou le novice Pétain (ministre de la Guerre, c’est sa première expérience ministérielle) en font également partie.
Ce nouveau gouvernement, sans être issu de la manifestation du 6 février, semble témoigner d'une volonté de transformer la IIIe République conformément au projet développé par André Tardieu au sein du cabinet. Pourtant, la présidence du Conseil n'est pas confiée au « mirobolant » Tardieu mais à Doumergue, le « vieux sage de Tournefeuille [qui] représente, à première vue, tout le contraire de Tardieu, l'expérience face à l'audace, le conservatisme face à la modernité », observe l'historien Jean Garrigues. Dans la perspective d'un recours à une personnalité perçue comme « l'homme providentiel », « commence alors une séquence symbolique dont l'aboutissement » sera le vote des pleins pouvoirs constituants à Philippe Pétain le [49].
Vers l'union de la gauche
La gauche interprète les événements du 6 février comme la preuve d’un danger fasciste en France[50]. Les communistes contre-manifestent seuls le 9 février, place de la République. Le 12 février, la CGT (proche des socialistes) et la CGTU (proche des communistes) décident d’une journée de grève générale et la SFIO et le Parti communiste appellent à une manifestation parisienne qui n’a pas vocation à être commune mais voit pourtant les deux cortèges se mêler à l’initiative de la base. Cette journée marque donc un premier et timide rapprochement entre socialistes et communistes.
Ce rapprochement est ensuite poursuivi avec la création le 5 mars du Comité de vigilance des intellectuels antifascistes, qui rassemble notamment des intellectuels communistes et socialistes. En juin, le dirigeant du PCF Maurice Thorez propose une unité d’action avec la SFIO ; celle-ci « accepte l’offre d’action commune contre le fascisme et la guerre » et le pacte d’unité est signé le 27 juillet. Le 31, les deux partis commémorent ensemble l'anniversaire de l’assassinat de Jean Jaurès. Le 4 octobre, peu avant le congrès du Parti radical, Maurice Thorez, Renaud Jean et d'autres représentants du PCF appellent à la « création d’un large front populaire », qui aboutit en 1936 au gouvernement de Front populaire, composé de radicaux et de socialistes avec le soutien communiste[51].
D'autre part les événements du 6 février 1934 accélèrent la sortie de l'hebdomadaire catholique Sept qui veut que se crée entre les deux blocs, le « national » et le « populaire », une voie chrétienne, « au-dessus des partis et sans compromissions »[52]. Dans les premières pages du no 1 de l'hebdomadaire paraît un dessin ironique antifasciste[53]. Cet hebdomadaire catholique publie une interview de Léon Blum[54].
La radicalisation de la droite
Les méthodes violentes des ligues, leur allure paramilitaire, le culte du chef, font qu’elles sont souvent assimilées au nazisme ou au fascisme, notamment par Zeev Sternhell. Mais au-delà des apparences et de leur volonté de voir le régime parlementaire céder la place à un régime fort, certains historiens (Serge Berstein, René Rémond, Michel Winock) estiment qu'il est difficile de distinguer chez elles un réel projet nazi ou fasciste. Qualifiant leur approche de « thèse immunitaire au fascisme », Michel Dobry juge qu'elle relève d'une vision téléologique[56]. De son côté, Brian Jenkins pense qu'il est vain de chercher une essence nazie en France et préfère établir des comparaisons, qui aboutissent selon lui à une nette convergence entre un fascisme à l'italienne et une bonne partie des ligues d'extrême droite, notamment l'Action française. D'autre part, l'idée même d’un complot semble exclue par l’absence de concertation et le manque d’objectifs précis des ligues.
Après le 6 février, la droite parlementaire commence à durcir son discours et à se rapprocher de l'extrême droite. Plusieurs de ses leaders perdent confiance dans les institutions parlementaires. Cette droitisation s'accélère après 1936, avec le Front populaire et la guerre d'Espagne.
Pour certaines ligues d'extrême droite, le 6 février représente une occasion manquée de renverser le régime. La déception qu’elle suscite conduit à la radicalisation de certains[évasif] qui se tournent alors vers le fascisme ou le nazisme[réf. souhaitée].
L'Ordre nouveau participe aux activités du Club de février créées aux lendemains de la manifestation antigouvernementale du 6 février. Ce club était formé de Robert Aron et Daniel-Rops (Ordre nouveau), Jacques Arthuys et Jean Cagnat (Action publique), Christian Pineau et Charles Riandey (Nouvelles Équipes), Pierre Andreu et Jean Le Marchand (Front national-syndicaliste), Jean Amos et Pierre Winter (Prélude)[57].
Les leçons du maintien de l'ordre
Le nombre élevé de victimes aggrave de manière irréversible la crise politique et marquera durablement les esprits. L'agressivité de certains manifestants et la volonté plus ou moins avérée de certains de faire tomber le gouvernement sont bien entendu en cause mais il apparaît que non seulement la situation a été mal anticipée (et notamment le nombre de manifestants et donc l’effectif du service d’ordre nécessaire) mais de plus qu'elle a été très mal gérée par les autorités et notamment par un préfet de police nouvellement nommé et donc manquant d'expérience[n 6] : les différents corps de forces de l'ordre[n 7], mélangés, mal équipés[n 8] et en nombre insuffisant se retrouvent acculés devant le palais Bourbon sans possibilité de recul[n 9] et finissent par ouvrir le feu. On relève encore de nombreux morts au cours des manifestations suivantes – tant avant qu'après la guerre – mais la leçon sera retenue par les responsables de l'ordre qui font du « zéro-mort » la règle d'or en matière de maintien de l'ordre - notamment en Mai 68[61].
Au cours des mois qui suivent, différentes mesures seront prises, toutes plus ou moins directement inspirées par les événements du 6 février :
- Le renforcement de la Sûreté générale qui devient la direction générale de la Sûreté nationale par décret du 28 avril 1934 (sans changement au niveau de la préfecture de police)[62].
- Le rétablissement de l’article 10 du code d’instruction criminelle le 25 mars 1935[63]. Cet article, qui avait été abrogé par la loi sur les garanties des libertés individuelles le 7 février 1933, conférait aux préfets de département et au préfet de police de Paris le droit de décerner des mandats d’amener et de dépôt susceptibles d’être utilisés, entre autres, pour procéder à des arrestations temporaires en cas de troubles – constatés ou même anticipés – de l’ordre public.
- Le décret-loi du 23 octobre 1935 qui soumet toute manifestation sur la voie publique à la déclaration préalable aux autorités municipales ou préfectorales, cette même déclaration devant être déposée trois jours à l’avance avec mention des buts, lieux, dates heures et itinéraires projetés.
- La circulaire Panganon (du nom du ministre de l’intérieur) du 27 octobre 1935 requérant que les préfets prennent des arrêtés d’interdiction pour les réunions de nature « à faire prévoir des incidents et à faire redouter des troubles »[64].
Enfin, la loi du 10 janvier 1936 renforce le pouvoir de dissolution d’association et vise notamment les associations et groupements qui provoqueraient des manifestations de rue armées, ainsi que les formations paramilitaires ou les groupes ayant pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire national ou d’attenter par la force à la forme républicaine du gouvernement[65].
Elle sera utilisée dès février 1936 pour dissoudre la Ligue d'Action française, la Fédération nationale des Camelots du roi et la Fédération nationale des étudiants d'Action française puis en juin 1936 pour dissoudre quatre autres ligues qui venaient pourtant de se transformer en mouvements politiques pour tenter d’échapper à la loi[66].
La réponse des ligues à ces mesures est soit de se transformer en partis politiques, soit d’entrer dans la clandestinité comme l'Organisation secrète d'action révolutionnaire nationale (OSARN), plus connue sous le sobriquet de la « Cagoule[66]. »
Fin mai 1983, lorsque des affrontements éclatent entre des policiers et des étudiants hostiles à la réforme de l'enseignement supérieur sur le pont Alexandre-III, à quelques centaines de mètres du palais de l'Élysée, le président Mitterrand convoque son ministre de l'Intérieur, Gaston Defferre et le secrétaire d'État Joseph Franceschi pour les morigéner. Il leur dit : « Chacun sait depuis le 6 février 1934 que l'on ne doit jamais laisser les manifestants pénétrer dans le périmètre Palais-Bourbon, Élysée, place Beauvau[67]. » Le choc constitué par la manifestation du 6 février 1934 s'est donc perpétué dans les consciences des hommes politiques français jusqu'au moins les années 1980.
Voir aussi
Rapports des commissions d'enquêtes parlementaires
- Jules Chamvoux, Rapport fait au nom de la commission d'enquête chargée de rechercher les causes et les origines des événements du 6 février 1934 et jours suivants, ainsi que toutes les responsabilités encourues : la nature des blessures des chevaux de la garde républicaine de Paris, Paris, Imprimerie de la Chambre des députés, , 8 p. (lire en ligne).
- Paul Perrin et Jean de Tinguy du Pouët, Rapport fait au nom de la commission d'enquête chargée de rechercher les causes et les origines des événements du 6 février 1934 et jours suivants, ainsi que toutes les responsabilités encourues : la manifestation des conseillers municipaux de Paris le 6 février 1934, Paris, Imprimerie de la Chambre des députés, , 63 p. (lire en ligne).
- Pierre Appell, Rapport fait au nom de la commission d'enquête chargée de rechercher les causes et les origines des événements du 6 février 1934 et jours suivants, ainsi que toutes les responsabilités encourues : la soirée du 6 février 1934 à la Concorde, Paris, Imprimerie de la Chambre des députés, , 63 p. (lire en ligne).
- Jean-Baptiste Amat, Rapport fait au nom de la commission d'enquête chargée de rechercher les causes et les origines des événements du 6 février 1934 et jours suivants, ainsi que toutes les responsabilités encourues : les manifestations sur la voie publique en janvier 1934 et jusqu'au 6 février, Paris, Imprimerie de la Chambre des députés, , 26 p. (lire en ligne).
- Louis Gardiol, Jean-Baptiste Amat et Ernest de Framond de La Framondie, Rapport fait au nom de la commission d'enquête chargée de rechercher les causes et les origines des événements du 6 février 1934 et jours suivants, ainsi que toutes les responsabilités encourues : les victimes des journées du 6 au 12 février 1934, Paris, Imprimerie de la Chambre des députés, , 19 p. (lire en ligne).
- Camille Catalan, Rapport fait au nom de la commission d'enquête chargée de rechercher les causes et les origines des événements du 6 février 1934 et jours suivants, ainsi que toutes les responsabilités encourues : préparation de la manifestation, Paris, Imprimerie de la Chambre des députés, , 162 p. (lire en ligne).
- Maurice Dormann et Lucien Salette, Rapport fait au nom de la commission d'enquête chargée de rechercher les causes et les origines des événements du 6 février 1934 et jours suivants, ainsi que toutes les responsabilités encourues : la participation des associations d'anciens combattants à la manifestation, Paris, Imprimerie de la Chambre des députés, , 176 p. (lire en ligne).
- Jean Piot et Jean de Nadaillac, Rapport fait au nom de la commission d'enquête chargée de rechercher les causes et les origines des événements du 6 février 1934 et jours suivants, ainsi que toutes les responsabilités encourues : les décisions du gouvernement au lendemain du 6 février 1934 et la journée du 7 sur la voie publique, Paris, Imprimerie de la Chambre des députés, , 42 p. (lire en ligne).
- Ernest de Framond de La Framondie, Rapport fait au nom de la commission d'enquête chargée de rechercher les causes et les origines des événements du 6 février 1934 et jours suivants, ainsi que toutes les responsabilités encourues : la journée communiste du 9 février et les incidents communistes du 12 en banlieue, Paris, Imprimerie de la Chambre des députés, , 48 p. (lire en ligne).
- Pétrus Faure, Rapport fait au nom de la commission d'enquête chargée de rechercher les causes et les origines des événements du 6 février 1934 et jours suivants, ainsi que toutes les responsabilités encourues : les manifestations du 12 février 1934, la grève générale, Paris, Imprimerie de la Chambre des députés, , 90 p. (lire en ligne).
- Marc Rucart, Rapport général fait au nom de la Commission d'enquête chargée de rechercher les causes et les origines des événements du 6 février 1934 et jours suivants ainsi que toutes les responsabilités encourues, t. 1, Paris, Imprimerie de la Chambre des députés, , VIII-1134 p. (lire en ligne), chap. 3383.
- Marc Rucart, Rapport général fait au nom de la Commission d'enquête chargée de rechercher les causes et les origines des événements du 6 février 1934 et jours suivants ainsi que toutes les responsabilités encourues, t. 2, Paris, Imprimerie de la Chambre des députés, , XI-1139 à 2445 p. (lire en ligne), chap. 3383.
- Marc Rucart, Rapport général fait au nom de la Commission d'enquête chargée de rechercher les causes et les origines des événements du 6 février 1934 et jours suivants ainsi que toutes les responsabilités encourues, t. 3, Paris, Imprimerie de la Chambre des députés, , VIII-2451 à 2873 p. (lire en ligne), chap. 3383.
- Charles Serre, Rapport fait au nom de la Commission chargée d'enquêter sur les évènements survenus en France de 1933 à 1945, t. 1, Paris, Imprimerie de l'Assemblée nationale, , 286 p. (présentation en ligne, lire en ligne).
Témoignages contemporains
- Jean Bayern, De la boue au sang. Le six février, Paris, Albert Messein, 1934, 54 p.
- Marc Bernard, Les journées ouvrières des 9 et 12 février 1934, Paris, Bernard Grasset, 1934, 126 p.
- Laurent Bonnevay, Les journées sanglantes de février 1934, Paris, Flammarion, 1935, 249 p.
- Marc Chalouveine, Historique du 6 février 1934, Paris, Eugène Figuière, 1935, 127 p.
- Gaston Chérau, Concorde ! le 6 février 1934, Paris, Denoël et Steele, 1934, 277 p.
- Fédération républicaine et sociale du Massif central, La sanglante journée du mardi 6 février 1934. Récits de témoins, Clermont-Ferrand, Imprimerie moderne, s.d., 16 p.
- Philippe Henriot, Le 6 février, Paris, Flammarion, 1934, 247 p.
- Georges Imann, La Journée du 6 février, Grasset, coll. « Les grandes heures », 1934, 122 p.
- Georges Suarez, La grande peur du 6 février au Palais-Bourbon, Paris, Bernard Grasset, 1934, 128 p.
Études historiques
- Mathias Bernard, « Droites et gauches face aux barricades de février 1934 », dans Alain Corbin et Jean-Marie Mayeur (dir.), La barricade : actes du colloque organisé les 17, 18 et 19 mai 1995 par le Centre de recherche en Histoire du XIXe siècle et la société d'histoire de la révolution, de 1848 et des révolutions du XIXe siècle, Paris, Publications de la Sorbonne, coll. « Histoire de la France aux XIXe-XXe siècles », , 522 p. (ISBN 2-85944-318-5, lire en ligne), p. 469-482.
- Mathias Bernard, « L'antiparlementarisme de droite dans la France des années 1930 », Parlement(s) : revue d'histoire politique, Paris, L'Harmattan, no HS 9, , p. 99-111 (lire en ligne).
- Mathias Bernard, « Les violences du vues par les droites françaises », dans Philippe Bourdin, Mathias Bernard et Jean-Claude Caron (dir.), La voix & le geste : une approche culturelle de la violence socio-politique, Clermont-Ferrand, Presses universitaires Blaise Pascal, coll. « Histoires croisées », , 381 p. (ISBN 2-84516-276-6), p. 231-244.
- Serge Berstein (choix de textes réunis et présentés par), Le 6 février 1934, Paris, Gallimard, Julliard, coll. « Archives » (no 59), , 257 p. (ISBN 2-07-029319-X, présentation en ligne).
- Serge Berstein, « L'affrontement simulé des années 1930 », Vingtième Siècle : Revue d'histoire, no 5 « Les guerres franco-francaises », , p. 39-54 (lire en ligne).
- Emmanuel Blanchard, « Le 6 février 1934, une crise policière ? », Vingtième Siècle : Revue d'histoire, Paris, Presses de Sciences Po (PFNSP), no 128 « Dossier : Polices et événements politiques au XXe siècle », , p. 15-28 (lire en ligne).
- Georges Carrot, Le Maintien de l'ordre en France au XXe siècle, Paris, Éditions Henry Veyrier, coll. « Kronos » (no 6), , 431 p. (ISBN 2-85199-535-9).
- Christian Chevandier, Policiers dans la ville : une histoire des gardiens de la paix, Paris, Gallimard, coll. « Folio, Histoire » (no 198), , 1004 p. (ISBN 978-2-07-043969-0).
- Michel Dobry, « Février 1934 et la découverte de l'« allergie » de la société française à la Révolution fasciste », Revue française de sociologie, Paris, Éditions du CNRS, no XXX-3-4, , p. 511-533 (lire en ligne).
- Michel Dobry (dir.), Le Mythe de l'allergie française au fascisme, Paris, Albin Michel, coll. « Bibliothèque Albin Michel : Idées », 2003, (ISBN 2226137181).
- Jean-Étienne Dubois, « La rue parisienne à la reconquête de la souveraineté nationale ? Cortèges, violences et politique à Paris en janvier et », dans Jean-Claude Caron (dir.), Paris, l'insurrection capitale, Ceyzérieu, Champ Vallon, coll. « Époques », , 263 p. (ISBN 978-2-87673-997-0), p. 227-236.
- Yann Galera, La Garde républicaine mobile à l'épreuve du 6 février 1934, Maisons-Alfort, Service historique de la Gendarmerie nationale, coll. « Études », , 189 p. (ISBN 978-2-11-092357-8).
- (en) Brian Jenkins, « Plots and Rumors : Conspiracy Theories and the Six Février 1934 », French Historical Studies, vol. 34, no 4, , p. 649-678 (DOI 10.1215/00161071-1422874).
- Brian Jenkins et Chris Millington, Le Fascisme français : Le 6 février 1934 et le déclin de la République, Paris, éditions Critiques, , 368 p. (ISBN 979-10-97331-22-1, présentation en ligne). Traduction de (en) Brian Jenkins et Chris Millington, France and Fascism : February 1934 and the Dynamics of Political Crisis, Milton Park, Abingdon, Oxon (GB), Routledge, coll. « Routledge studies in fascism and the far right », , 201 p. (ISBN 978-1-138-86033-9 et 1138860336, présentation en ligne).
- (en) Chris Millington, « February 6, 1934 : The Veterans' Riot », French Historical Studies, vol. 33, no 4, , p. 545-572 (DOI 10.1215/00161071-2010-010).
- Pierre Pellissier, 6 février 1934. La République en flammes, Paris, Perrin, coll. « Une journée dans l'histoire », , 355 p. (ISBN 978-2-262-01523-7).
- Jean Philippet, Le temps des ligues : Pierre Taittinger et les jeunesses patriotes (1919-1944), vol. 1 à 8, Paris, Institut d'études politiques de Paris, , 2680 p. (présentation en ligne)Thèse de doctorat d'histoire sous la direction de Raoul Girardet.
- Antoine Prost, « Les manifestations du 12 février 1934 en province », Le Mouvement social, no 54, , p. 7-27 (lire en ligne).
- Robert Soucy, Fascismes français ? 1933-1939, Paris, Autrement, coll. « Mémoires/Histoire », 2004, (ISBN 2-7467-0452-8).
- Danielle Tartakowsky, Les manifestations de rue en France, 1918-1968, Paris, Publications de la Sorbonne, coll. « Histoire de la France au XIXe-XXe siècle » (no 42), , 869 p. (ISBN 2-85944-307-X, présentation en ligne).
- Danielle Tartakowsky, Les droites et la rue : histoire d'une ambivalence, de 1880 à nos jours, Paris, La Découverte, coll. « Cahiers libres », , 221 p. (ISBN 978-2-7071-7817-6, présentation en ligne).
- Michel Winock, La fièvre hexagonale : les grandes crises politiques de 1871 à 1968, Paris, Éditions du Seuil, coll. « Points. Histoire » (no H97), (1re éd. 1986, Calmann-Lévy), 475 p. (ISBN 978-2-7578-1538-0, présentation en ligne), [présentation en ligne].
Articles connexes
- Lucien Rottée
- Forces occultes (1943), film antimaçonnique et antiparlementariste qui figure la manifestation vue depuis le palais Bourbon
Liens externes
Notes et références
Notes
- Le bilan total en nombre de victimes dans la période allant du 6 au 12 février dépasse largement la trentaine, selon Georges Carrot : 37 morts en comptant les décès ultérieurs, une centaine de blessés avec des séquelles graves et près de deux mille blessés avec des blessures moindres[1]. À la suite de Pierre Pellissier[2], Emmanuel Blanchard évoque 31 morts en moins d'une semaine[3].
- La manifestation du 7 impliqua certains des acteurs (de droite) de la soirée du 6 mais également des communistes, plus un nombre important d’éléments incontrôlés de la population parisienne ou banlieusarde. Il y eut au moins 4 morts. Celle du 9 fut surtout une manifestation communiste et causa 4 nouvelles victimes (plus 4 autres qui décéderont ultérieurement des suites de leurs blessures). Celles du 12 rassemblèrent socialistes et communistes et, si la manifestation principale à la Nation ne fut pas violente il y eut deux victimes en banlieue et une à Marseille[5].
- Ils se conforment pour certains au mot d’ordre lancé par L’Action française dans un tract distribué le 6 février : « Ce soir, à l’heure de la sortie des ateliers et des bureaux, ils [les Français] se rassembleront devant la Chambre, au cri de « À bas les voleurs ! » pour signifier au Ministère et à ses soutiens parlementaires qu’ils en ont assez de ce régime abject. »[26]. L'Humanité, de son côté, a également appelé à manifester contre le « régime du profit et du scandale ».
- L'inventaire des munitions dépensées établi à la fin de la manifestation fait état de 197 cartouches tirées pour la garde républicaine mobile, 53 pour la garde républicaine de Paris, 168 pour la gendarmerie départementale et 121 pour les gardiens de la paix. Toutes les balles retrouvées dans les corps des victimes sont de calibre 7,65 mm (qui est commun à l'ensemble des forces de l'ordre) sauf une balle de calibre 8 mm. De nombreux journaux de l'époque font état de tirs de fusil-mitrailleurs, de mitrailleuses ou même d'emploi de chars mais ces affirmations ne sont ni confirmées ni corroborées par le nombre ou le type de blessure des victimes[43].
- L'usage des rasoirs « pour couper les jarrets des chevaux » sera abondamment rapporté et marque les esprits mais si, sur 305 chevaux engagés (dont seulement 25 à la Concorde), 120 ont été blessés plus ou moins gravement dont cinq ont dû être énucléés à la suite de jets de projectiles, sept chevaux ont reçu des coupures et aucun cheval n'a eu de jarrets tranchés. Trois chevaux doivent être abattus à la suite de fractures occasionnées par des chutes ou des coups reçus[45].
- De plus, son principal adjoint, Paul Guichard, qui est directeur de la police municipale vient d'être hospitalisé pour une appendicite.
- La presse de l'époque parle surtout de la garde républicaine mobile (la Gendarmerie mobile actuelle) mais celle-ci représente moins du tiers des effectifs déployés et moins d'un huitième du nombre des blessés. De plus, les témoignages ainsi que les inventaires des munitions dépensées semblent montrer que l'ensemble des forces de l'ordre (gardes mobiles mais aussi gendarmes départementaux, gardes républicains de Paris et policiers) a ouvert le feu[58].
- Les forces de l'ordre sont très mal équipées (pas de boucliers, pas de lacrymogènes, pas de fourgons-pompes, quelques lances à incendie mises en œuvre par les pompiers). De plus, conformément aux consignes de la préfecture de police alors en vigueur, les pelotons de garde républicaine mobile réquisitionnés pour la manifestation reçoivent l'ordre de laisser leurs mousquetons dans leurs cantonnements et ne conservent donc que leurs pistolets. Cette disposition sera abandonnée lors des manifestations suivantes les 7 et 9 février mais on constate alors qu'au moins deux des quatre personnes décédées le 7 ont subi des fractures du crâne résultant probablement de coups de crosse[59].
- De nombreux responsables, dont le commissaire Rottée rapportent à la commission qu'ils avaient reçu l'ordre de « défendre coûte que coûte et sans reculer d'une semelle la tête de pont »[60].
Références
- Carrot 1990, p. 96-98.
- Pellissier 2000, p. 320-321.
- Blanchard 2015, p. 15-16.
- Blanchard 2015, p. 15.
- Carrot 1990, p. 94-96.
- Ariane Chebel d'Appollonia, L'extrême-droite en France : de Maurras à Le Pen, Bruxelles, Éditions Complexe, coll. « Questions au XXe siècle » (no 3), , 519 p. (ISBN 978-2-87027-764-5, notice BnF no FRBNF37162798), p. 102.
- Philippe Henriot, Le 6 février, Flammarion, , 247 p., p. 70.
- Dubois 2014, p. n. 648.
- Philippe Henriot, Le 6 février, Flammarion, , 247 p., p. 107.
- Laurent Bonnevay, Les Journées sanglantes de février 1934, Flammarion, , 249 p., p. 34.
- Laurent Bonnevay, Les Journées sanglantes de février 1934, Flammarion, , 249 p., p. 38.
- Laurent Bonnevay, Les journées sanglantes de février 1934, Flammarion, , 249 p., p. 39.
- Laurent Bonnevay, Les Journées sanglantes de février 1934, Flammarion, , 249 p., p. 51.
- Laurent Bonnevay, Les Journées sanglantes de février 1934, Flammarion, , 249 p., p. 53.
- Philippet 2000, p. 1406.
- « Chiappe, Jean (1878-1940) », dans Gisèle et Serge Berstein, Dictionnaire historique de la France contemporaine : 1870-1945, éditions Complexe, 1995 (ISBN 2870275498), p. 146-147.
- Philippe Henriot, Le 6 février, Flammarion, , 247 p., p. 129.
- Philippe Henriot, Le 6 février, Flammarion, , 247 p., p. 131.
- Philippe Henriot, Le 6 février, Flammarion, , 247 p., p. 132.
- Philippe Henriot, Le 6 février, Flammarion, , 247 p., p. 122.
- Philippe Henriot, Le 6 février, Flammarion, , 247 p., p. 125.
- Laurent Bonnevay, Les Journées sanglantes de février 1934, Flammarion, , 249 p., p. 81.
- Blanchard 2015, p. 21.
- Jean-Pierre Rioux, Au bonheur la France, Paris, CNRS Éditions, coll. « Biblis » (no 143), , 449 p. (ISBN 978-2-271-09003-4), p. 165.
- Blanchard 2015, p. 24, n. 2.
- Cité dans les publications de l'Université de Bourgogne.
- Bernard 1997, p. 469-482.
- Bernard 2005, p. 231-244.
- Berstein 1985, p. 48.
- Yvan Combeau, Paris et les élections municipales sous la Troisième République : la scène capitale dans la vie politique française, éditions L'Harmattan, 1998, p. 367-369.
- Évelyne Cohen, Paris dans l'imaginaire national dans l'entre-deux-guerres, Publications de la Sorbonne, 1999, 396 pages, p. 55 et suiv.
- Gisèle Berstein, Serge Berstein, La Troisième République, MA éditions, 1987, 356 pages, p. 295.
- Tartakowsky 1997, p. 281-284.
- Compte-rendu de l'enquête parlementaire sur les manifestations du 6 février 1934.
- Robert Havard de La Montagne, Histoire de l'Action française, Amiot-Dumont, Paris, 1950, p. [réf. incomplète].
- Danielle Tartakowsky, op. cit.
- Eugen Weber, L'Action française, éd. Fayard, 1985, p. 373.
- Eugen Weber, L'Action française, éd. Fayard, 1985, p. 372.
- On relève quelques blessures par balles parmi les forces de l'ordre mais la grande majorité des blessures est causée par des lancers de projectiles ou des coups — voir ci-dessous paragraphe Morts et blessés.
- Maurice Chavardès, Le 6 février 1934 : la République en danger, Calmann-Lévy, , p. 211.
- Chevandier 2012, p. 690-696. Voir également Carrot 1990, p. 83 ; 88 ; 90.
- Laurent Bonnevay, Les Journées sanglantes de février 1934, Flammarion, , 249 p..
- Galera 2003, p. 73-74 pour l'inventaire des cartouches tirées et Galera 2003, p. 78 et suivantes pour les rumeurs d'emploi d'autres armes.
- « Les victimes du 6 février », L'Action française, 6 février 1935, p. 1.
- Pellissier 2000, p. 282.
- Il fut l'auteur de l'ouvrage : Les journées sanglantes de février 1934 en 1935 - voir bibliographie.
- Pellissier 2000, p. 275-285.
- Blanchard 2015, p. 16, n. 7.
- Jean Garrigues, Les hommes providentiels : histoire d'une fascination française, Paris, Éditions du Seuil, , 459 p. (ISBN 978-2-02-097457-8, présentation en ligne).
- Michel Winock, Le Siècle des intellectuels, Paris, Seuil, 1999, p. 282.
- Jean Vigreux, « 24 octobre 1934 : la naissance du Front populaire à Nantes », L'Humanité, (lire en ligne, consulté le ).
- Magali Della Sudda, « La suppression de l'hebdomadaire dominicain Sept », Vingtième Siècle : Revue d'histoire, vol. 104, no 4, , p. 32 (lire en ligne).
- Sept 3 mars 1934, p. 3.
- Magali Della Sudda, article cité, p. 30.
- Histoire des droites en France, tome 2) : Cultures.
- Dobry 1989, p. 518.
- Jean-Louis Loubet del Bayle, Les Non-conformistes des années 1930. Une tentative de renouvellement de la pensée politique française, Paris, Seuil, 1969 (nouvelle éd. Points Histoire, 2001), p. 125-126.
- Galera 2003, p. 73-74 et Annexe IV.
- Carrot 1990, p. 94.
- Carrot 1990, p. 83.
- Voir notamment : Maurice Grimaud - En mai, fais ce qu'il te plaît, Stock, 1977, p. 180.
- Carrot 1990, p. 102.
- Carrot 1990, p. 103-105.
- Carrot 1990, p. 108-109.
- Carrot 1990, p. 109-112.
- Carrot 1990, p. 112.
- Pierre Favier, La décennie Mitterrand, vol. 2 : Les épreuves (1984-1988), Paris, Éditions Points, coll. « Points » (no P51), (1re éd. 1991), 962 p. (ISBN 978-2-7578-5799-1, OCLC 941084320).
- Portail de l’entre-deux-guerres
- Portail de la politique française
