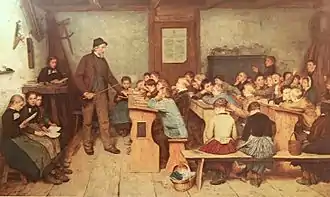
La composition est, avec l'analyse de document(s) et la réalisation d'un croquis ou d'un schéma, un des exercices prévus lors de l'épreuve écrite d'histoire et de géographie du bac général français. Traditionnellement, les correcteurs attribuent à cet exercice la majorité des points.
Après l'apprentissage et surtout la compréhension du cours, le meilleur moyen pour réussir l'épreuve de la composition est de s’entraîner régulièrement.
Articles connexes : Application de la méthode avec un sujet de seconde et avec un sujet de première.
Méthodes connexes : de la prise de notes, de l'analyse de doc et du croquis.
- décrire et mettre en récit une situation historique ou géographique ;
- rédiger un texte construit et argumenté en utilisant le vocabulaire historique et géographique spécifique ;
- utiliser un ordinateur pour rédiger un texte.
Définition
Article détaillé : Composition.
Le candidat traite un sujet parmi deux proposés à son choix dans la même discipline.
En histoire comme en géographie, il doit montrer qu’il sait analyser le sujet et qu’il maîtrise les connaissances nécessaires. Pour traiter le sujet choisi, il produit une réponse organisée et pertinente, comportant une introduction, plusieurs paragraphes et une conclusion.
Il peut y intégrer une (ou des) production(s) graphique(s).
Le libellé du sujet peut prendre des formes diverses : reprise partielle ou totale d'un intitulé du programme, question ou affirmation ; il peut être bref ou plus détaillé ; la problématique peut être explicite ou non.
Le candidat traite un sujet parmi deux qui sont proposés à son choix dans la même discipline. En histoire comme en géographie, il doit montrer qu’il maîtrise les connaissances du programme. Pour traiter le sujet choisi, il produit une réponse organisée et pertinente, comportant une introduction, plusieurs paragraphes et une conclusion. La formulation du sujet peut prendre des formes diverses : reprise (partielle ou totale) d'un intitulé du programme, question ou affirmation, problématique explicite ou non ; elle peut être brève ou plus détaillée.
La composition n’est pas un exercice de récitation : l'élève doit prouver qu’il sait organiser ses connaissances en une réponse structurée et logique.
Préparation au brouillon
Le principal danger est le hors-sujet, il ne faut donc surtout pas se lancer tout de suite dans la rédaction sur la copie, mais d’abord travailler au brouillon.
Analyser le sujet
L’analyse du sujet suit trois étapes qui fournissent à l'élève les éléments essentiels pour son introduction[6].
- Quels sont les mots les plus importants (notions, mots de liaison) ? Il faut définir ces notions.
- Quelles sont les limites chronologiques (quand) et spatiales (où) ? Parfois il faut justifier ce choix.
- Quelle est la problématique (question du sujet) ? Elle peut être fournie directement par l'intitulé du sujet (c'est le cas le plus courant en seconde et même en première).
Faire un plan détaillé
Pour un sujet, il y a souvent plusieurs plans possibles, avec deux ou trois parties équilibrées (elles doivent faire très approximativement la même taille). Chaque partie correspond à une grande idée, divisée en deux ou trois sous-parties qui correspondent chacune à des couples argument et exemple(-s).
En histoire, les plans sont souvent soit chronologiques (dans lequel les sous-parties peuvent être thématiques), soit thématiques (dans lequel les sous-parties peuvent être chronologiques). En géographie les plans sont souvent spatiaux (les parties correspondent à des territoires), multi-scalaires (chaque partie correspond à une échelle) ou thématiques.
Rédaction au brouillon
Préparer l’introduction
La première chose que lit le prof... À soigner au brouillon, avec trois éléments obligatoires :
- une entrée en matière présentant le sujet, définissant les mots-clés, situant spatialement et chronologiquement, donnant le contexte, avec parfois une citation (si elle est pertinente) ;
- l'énoncé de la problématique ;
- l'annonce du plan.
L'élève doit fournir une introduction substantielle (plus d'une demi-page).
Préparer la conclusion
Le bouquet final du feu d'artifice, à faire aussi au brouillon, avec deux éléments :
- un bilan-synthèse de l'argumentation, donnant une réponse à la problématique ;
- une ouverture, mettant en perspective le sujet.
- expliquer pourquoi cette ouverture est intéressante
La conclusion doit faire très approximativement la même taille que l'introduction.
Rédiger l'argumentation
L'élève doit suivre son plan détaillé :
- la structure doit être visible, il faut sauter deux ou trois lignes entre les parties, sauter une ligne pour chaque sous-partie et aller à la ligne (avec un retrait) pour chaque argument ;
- chaque partie et chaque sous-partie doit être introduite par la présentation du thème (surtout pas de titre) et terminée chacune par une phrase de transition annonçant la suivante ;
- le texte doit être précis, chaque argument doit être accompagné par son exemple (fait, date, nom, localisation...) ;
- l'histoire s'écrit au présent ou parfois au passé, jamais au futur ;
- l'élève doit éviter de donner son point de vue (première personne du singulier à proscrire : de la modestie !)[7], il doit être le plus objectif possible, relativiser et être critique.
Plus de conseils :
- Méthode de la composition en première appliquée à un sujet (page de la Wikiversité).
- Composition (article de Wikipédia).
- « La composition (niveau exigible en première) »


Notation
→ Consignes de correction du bac
Article détaillé sur Wikipédia : Notation d'une composition.
L'échelle des notes de 0 à 20 est utilisée dans toute sa plénitude au-delà des seuils usuels de 8, 10 et 12. Les bonnes copies font l’objet d'une notation élevée afin que chaque candidat tire l'avantage légitime qu’il peut escompter de sa prestation.
L'intitulé de l'épreuve précise qu'« à titre indicatif, la première partie peut compter pour 12 points et la deuxième pour 8 points ». Il est cependant rappelé que « l'évaluation de la copie du candidat est globale », ce qui permet d'envisager une répartition des points différente en fonction de la prestation du candidat.
La note peut prendre en compte des éléments de valorisation. Par « valorisation », on entend la reconnaissance de contenus et de qualités qui ne sont pas attendus d'un candidat au baccalauréat. En conséquence, ces éléments ne sont pas nécessaires pour obtenir la note maximale. Leur prise en compte permet de compenser des faiblesses éventuelles. Elle entraîne l'attribution de points supplémentaires par rapport à la note globale attribuée à la copie.
- Composition
Parmi les capacités et méthodes du programmes (BO n° 8 du 21 février 2013), on attend en particulier la maîtrise des capacités suivantes :
- mettre en relation des faits de localisations spatiales différentes ;
- décrire une situation géographique ;
- confronter des situations géographiques ;
- rédiger un texte construit et argumenté en utilisant le vocabulaire géographique spécifique.
Dans une courte introduction, dont la forme est laissée à la liberté du candidat, le candidat présente le sujet et le fil conducteur de son devoir.
Il organise librement les différents paragraphes qu’il développe. Tous les questionnements sont acceptables dès lors qu’ils s'inscrivent dans l'esprit du libellé ; on évalue la cohérence interne et la pertinence du devoir par rapport au sujet.
Dans une brève conclusion, le candidat fait le bilan de sa réflexion.
Notes et références
- ↑ [pdf] « Capacités et méthodes du programme en classe de seconde générale et technologique », sur http://media.education.gouv.fr/, arrêté du 8 avril 2010, publié au JORF du 25 avril 2010.
- ↑ « Capacités et méthodes du programme en classe de première des séries générales », sur http://www.education.gouv.fr/, arrêté du 21 juillet 2010 publié au JORF du 28 août 2010.
- ↑ « Capacités et méthodes du programme en classe de terminale de la série scientifique », sur http://www.education.gouv.fr/, arrêté du 7 janvier 2013 publié au JORF du 23 janvier 2013.
- ↑ « Note de service n° 2013-177 du 13 novembre 2013 sur l'épreuve au bac », sur http://www.education.gouv.fr/, publiée au BOÉN n° 43 du 21 novembre 2013.
- ↑ Note de service no 2010-267 du 23 décembre 2010 définissant l'épreuve obligatoire d'histoire-géographie applicable à compter de la session 2012 des épreuves anticipées de l'examen en série S, publiée au BOÉN no 5 du 3 février 2011.
- ↑ « La composition, alias dissertation, argumentation, art de convaincre (niveau exigible en seconde) »


- ↑ Dans le secondaire français, l'avis de l'élève est méprisé ; il ne pourra s'engager philosophiquement, politiquement et religieusement qu'au sein de l'enseignement supérieur.