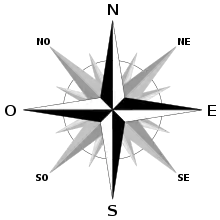Clairvaux-d'Aveyron
Clairvaux-d'Aveyron est une commune française située dans le département de l'Aveyron en région Occitanie. Son nom occitan est Claravals.
Pour les articles homonymes, voir Clairvaux (homonymie).
Ne doit pas être confondu avec Clairvaux ou Clairvaux-les-Lacs.
Pour l’article ayant un titre homophone, voir Clervaux.
| Clairvaux-d'Aveyron | |
 Porte d'entrée principale des anciennes fortifications de Clairvaux, surmontée d'une tour à mâchicoulis (XIVe siècle) | |
| Administration | |
|---|---|
| Pays | |
| Région | Occitanie |
| Département | Aveyron |
| Arrondissement | Rodez |
| Intercommunalité | Communauté de communes Conques-Marcillac |
| Maire Mandat |
Jean-Marie Lacombe 2020-2026 |
| Code postal | 12330 |
| Code commune | 12066 |
| Démographie | |
| Gentilé | Clairvallois |
| Population municipale |
1 147 hab. (2018 |
| Densité | 46 hab./km2 |
| Géographie | |
| Coordonnées | 44° 25′ 42″ nord, 2° 24′ 41″ est |
| Altitude | Min. 319 m Max. 734 m |
| Superficie | 25,14 km2 |
| Élections | |
| Départementales | Canton du Vallon |
| Législatives | Première circonscription |
| Localisation | |
Géographie
Localisation
Site

Située à l'extrémité Sud du canton de Marcillac-Vallon, la commune de Clairvaux-d'Aveyron s'étend sur 2514 hectares. L'INSEE l'inclut dans l'aire urbaine de Rodez.
C'est au fond de la vallée de l'Ady que se situent les villages de Clairvaux et de Bruéjouls qui regroupent l'essentiel de la population. À l'Est, sur une hauteur en bordure du Causse comtal, le petit village de Panat est groupé au pied de son château. À l'Ouest, la chapelle Notre-Dame du Buenne, à 736 mètres d'altitude, constitue le point culminant de la commune et du canton. Au Sud, le territoire communal s'étend jusqu'à la vallée de l'Aveyron.
La commune de Clairvaux-d'Aveyron fait partie de la zone de production des vins AOC de Marcillac. Les vignes de "mansois", nom local du fer servadou, sont plantées en terrasses sur les coteaux qui jouissent de la meilleure exposition.
site Internet; http://www.mairiedeclairvauxdaveyron.fr
Histoire
Le village de Clairvaux s'est développé autour d'un monastère dont la fondation est relatée par le cartulaire de l'abbaye de Conques[1].
En 1060, un prince anglais, nommé Alboin (connu en anglais sous le nom de Ælfwine Haroldsson), fils présumé du roi Harold II d'Angleterre, traverse le Rouergue à l'occasion d'un pèlerinage vers les lieux saints. Dans la vallée de l'Ady, il est ému par les ruines d'un monastère détruit par les Arabes au VIIIe siècle. Il se recueille longuement et décide de recréer un monastère dédié à saint Pierre. Il réussit à obtenir l'adhésion de l'évêque de Rodez et des seigneurs rivaux de Panat et Cassagnes qui abandonnent tous leurs droits seigneuriaux aux religieux. Alboin choisit de confier le monastère à l'abbaye Saint-Pierre de Brantôme en Périgord, qui l'avait accueilli au cours de son pèlerinage.
En 1062, le monastère est cédé à l'abbaye de Conques, plus proche. Au XIVe siècle, il ne s'agit plus que d'un prieuré auquel est désormais rattaché le prieuré voisin de Bruéjouls. Toutefois, témoignant de l'importance passée du monastère, le prieur de Clairvaux a droit au port de la crosse et de la mître. Il bénéficie également d'un rang de préséance élevé aux États du Rouergue. Le titulaire du bénéfice ecclésiastique constitué par le prieuré de Clairvaux est également seigneur du bourg.
Peu de noms des titulaires du prieuré nous sont parvenus. On relève néanmoins celui de l'abbé Pierre Tournier[2] (prieur de 1672 à 1741), issu d'une famille de parlementaires toulousains, lui-même conseiller clerc au Parlement de Toulouse et titulaire d'autres bénéfices ecclésiastiques (chantre de l'église Saint-Géraud d'Aurillac, prieur de Sieurac dans le Tarn).
La présence du monastère, puis du prieuré, a favorisé le développement du bourg de Clairvaux qui bénéficie d'une charte d'affranchissement en 1390. Celle-ci l'autorise à se doter d'une administration municipale. Les consuls engagent alors la fortification du village qui est cependant envahi par les Anglais durant la Guerre de Cent Ans.
Différentes enquêtes conduites aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles évoquent toutes Clairvaux comme un bourg prospère d'une relative importance. Le patrimoine bâti du vieux village en témoigne encore aujourd'hui.
Politique et administration
Liste des maires
À la création du département de l'Aveyron en 1790, Clairvaux devient chef-lieu de canton, mais ne le reste que jusqu'au début du XIXe siècle.
En 1860, Clairvaux absorbe les communes de Bruéjouls, Panat, Ruffepeyre et Balsac (qui redevient une commune autonome en 1866).
Un décret du 26 février 1958 change officiellement le nom de la commune en Clairvaux-d'Aveyron[3].
La commune fait aujourd'hui partie du canton de Marcillac-Vallon, de l'arrondissement de Rodez et de la 1re circonscription législative de l'Aveyron (Rodez - Nord Aveyron). Elle est membre de la communauté de communes Causse et vallon de Marcillac.
Démographie
La commune de Clairvaux-d'Aveyron a compté jusqu'à 2 500 habitants dans les années 1850. La population a ensuite fortement décru jusqu'au milieu des années 1960.
L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'Insee. Le recensement repose désormais sur une collecte d'information annuelle, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[6]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2007[7].
En 2018, la commune comptait 1 147 habitants[Note 1], en diminution de 0,78 % par rapport à 2013 (Aveyron : +0,55 %, France hors Mayotte : +1,78 %).
Économie
Outre la viticulture, liée à l'AOC Marcillac, les activités agricoles touchent également à l'élevage bovin, ovin ou avicole.
Depuis les années 1970, un établissement et service d'aide par le travail (ESAT) est installé dans le village de Clairvaux. Il accueille plus de 70 travailleurs handicapés. Ses activités se répartissent en trois pôles : tôlerie, câblage et conditionnement.
Une maison de retraite de près de 80 lits est installée dans les bâtiments de l'ancien couvent Saint-Joseph-de-Clairvaux, bâtis au XIXe siècle et rénovés au début des années 1990. Elle emploie 35 personnes.
Des commerces de proximité (cafés, restaurants, boulangerie, épicerie, dépôt de presse, bureau de tabac, salon de coiffure, cave a vins ) et des artisans de différents corps de métiers complètent le paysage économique de la commune.
Culture locale et patrimoine
Patrimoine religieux
- Église de l'Assomption de Bruéjouls.
- Église Saint-Julien de Panat.
- Chapelle Notre-Dame de Buenne.
- Chapelle Saint-Joseph du couvent des Sœurs de Saint-Joseph de Clairvaux.
Église paroissiale Saint-Blaise de Clairvaux-d'Aveyron
Édifice roman construit au XIe siècle pour servir d'église au monastère fondé en 1060, il a été partiellement rebâti au XVIIIe siècle, à la suite de l'effondrement du clocher, en réutilisant les matériaux d'origine qui ont été remarquablement appareillés.
Lors de sa reconstruction, l'église est réduite de trois travées et perd son transept. Elle se compose désormais d'une nef centrale voûtée d'arêtes d'une hauteur de 12 m et de deux bas-côtés voûtés en plein cintre. Le chœur et les absidioles sont voûtés en cul de four. La nef est séparée des bas-côtés par des arcades en plein cintre ou en anse de panier qui reposent sur des piliers carrés garni de demi-colonnes. Les chapiteaux, sculptés dans le grès rouge, sont décorés de figures humaines, de feuilles d'acanthe, d'aigles, etc. Ils rappellent ainsi fortement ceux de l'abbatiale Sainte-Foy de Conques qui a vraisemblablement servi de modèle. Il en est de même pour la corniche à décor de billettes que l'on trouve dans le chœur de l'église.
L'édifice renferme deux retables ![]() Inscrit MH (1989)[10] en bois doré du XVIIe siècle placés dans les absidioles : l'un représente une mise au tombeau, l'autre une vierge à l'enfant, entourée de médaillons représentant les mystères du Rosaire.
Inscrit MH (1989)[10] en bois doré du XVIIe siècle placés dans les absidioles : l'un représente une mise au tombeau, l'autre une vierge à l'enfant, entourée de médaillons représentant les mystères du Rosaire.

Façade. 
Nef centrale. 
Bas-côté. 
Chapiteau aux aigles. 
Fonts baptismaux. 
Retable.
Vestiges des fortifications du village de Clairvaux
De l'enceinte construite au XIVe siècle, il reste la porte d'entrée principale, surmontée d'une tour à mâchicoulis, ainsi que deux portes secondaires.
À l'intérieur du vieux village, les ruelles étriquées sont bordées d'anciennes demeures comportant des éléments architecturaux intéressants : des encorbellements, des pigeonniers, des tourelles d'escalier ainsi que des fenêtres à meneaux.

Façades rouges
des maisons.
Passage couvert. 
Maisons à encorbellements.  Fontaine sur la place principale.
Fontaine sur la place principale.
Petite place.
Village de Bruéjouls
- Église de l'Assomption de Bruéjouls.


Village de vignerons où l'on trouve de jolies maisons de grès rouge, typiques du Vallon de Marcillac.
L'église gothique, remaniée au XIXe siècle, renferme un très belle croix processionnelle en argent du XVIe siècle ![]() Classé MH (1938)[11]
Classé MH (1938)[11]
En 2000, pour rendre hommage aux vignerons du Vallon qui le portaient quotidiennement sur eux, le foyer rural de Bruéjouls a fait réaliser le plus grand "tassou" (taste-vin) du monde. Il est exposé sur la place de l'église.
Château de Panat

Berceau de la famille du même nom, le château de Panat voit son existence attestée dès le XIe siècle. Il est alors le siège d'une des principales baronnies du Rouergue médiéval et le chef-lieu d'un petit pays : le Panadès. La famille de Panat étend son influence jusqu'à Marcillac et Salles-Comtaux. Mais en 1238, le comte de Rodez contraint le vicomte de Panat de lui céder ses fiefs du Vallon contre notamment les châteaux de Coupiac et Peyrebrune. C'est désormais dans cette partie du Rouergue que se concentrent l'essentiel des intérêts des Panat, dont le souvenir est perpétué par le nom de la commune de Villefranche-de-Panat.
Tout au long du Moyen Âge, la seigneurie de Panat se voit partagée entre différents coseigneurs, jusqu'à ce qu'elle soit rachetée dans son intégralité par Charles de Buscaylet en 1617. Celui-ci devient alors seigneur de Panat, Bruéjouls et Capdenaguet. Par mariage, le château passe ensuite à une branche de la famille provençale d'Adhémar. Cette branche rouergate prend dès lors le nom d'Adhémar de Panat.
C'est de cette époque que date l'essentiel du château actuel, composé d'un corps de logis rectangulaire flanqué d'une tour ronde et auquel est adossée l'église paroissiale dédiée à saint Julien. Cet édifice religieux, aujourd'hui en ruine, était orné de fresques murales. Découvertes pendant la seconde Guerre Mondiale, elles n'ont pas pu faire l'objet de mesures de conservation et il n'en reste aujourd'hui plus de traces. Le château est resté la propriété de la famille d'Adhémar de Panat jusqu'au milieu des années 1990. Fortement délabré, le bâtiment fait depuis l'objet d'une importante campagne de restauration.
Au pied du château, le petit village de Panat est constitué de belles maisons anciennes construites en calcaire. Une église de style néo-roman a été construite à l'extérieur du village à la fin du XIXe siècle sous la direction de l'architecte Henri Pons. Elle renfermait une statue miraculeuse de Sainte-Anne en bois doré qui date du XVe siècle. (La statue se trouve maintenant dans l'église de Nuces.)

Vue Sud-Est. 
Façade Est. 
Décor de gouttière.
Personnalités liées à la commune
- François-Louis d'Adhémar, vicomte de Panat[13]. Né au château de Panat en 1715, il accomplit une brillante carrière dans l'armée royale. Il est fait commandeur de l'ordre de Saint-Louis par le roi en 1779, nommé maréchal de camp en 1780. En 1789, la noblesse de la sénéchaussée de Rodez le désigne comme son représentant aux États généraux convoqués par Louis XVI. Après les premiers événements révolutionnaires, il quitte la France pour Coblence et devient commandant dans l'armée des émigrés. Il meurt en avril 1792, à Limbourg.
Voir aussi
Bibliographie
![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.
: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.
 Gustave Desjardins (Éditeur scientifique), Cartulaire de l'abbaye de Conques en Rouergue, Paris, A. Picard, , 518 p., in-8 (notice BnF no FRBNF34114898) - Cartulaire de l'abbaye de Conques en Rouergue sur Gallica
Gustave Desjardins (Éditeur scientifique), Cartulaire de l'abbaye de Conques en Rouergue, Paris, A. Picard, , 518 p., in-8 (notice BnF no FRBNF34114898) - Cartulaire de l'abbaye de Conques en Rouergue sur Gallica Charles Joseph Eugène Marquis de Boisgelin, Les Adhémar : généalogie. Première partie, Draguignan, Impr. de C. et A. Latil, , 336 p., 28 cm (notice BnF no FRBNF34209592) - Les Adhémar : généalogie. sur Gallica
Charles Joseph Eugène Marquis de Boisgelin, Les Adhémar : généalogie. Première partie, Draguignan, Impr. de C. et A. Latil, , 336 p., 28 cm (notice BnF no FRBNF34209592) - Les Adhémar : généalogie. sur Gallica- (oc + fr) Christian-Pierre Bedel (préf. José Monestier), Marcilhac : Balsac, Claravals, Moret, Muret, Nòuviala, Prunas, Salas-Comtals, Sent-Cristòfa, Valadin / Christian-Pierre Bedel e los estatjants del canton de Marcilhac, Rodez, Mission départementale de la culture, coll. « Al canton », , 392 p., ill., couv. ill. ; 28 cm (ISBN 2-907279-52-1, ISSN 1151-8375, notice BnF no FRBNF38803935)
Articles connexes
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :
- Ressource relative aux organisations :
- « Photographies de l'église Saint-Blaise, du bourg de Clairvaux et du château de Panat », base Mémoire, ministère français de la Culture
- Site de la mairie
- « Famille d'Adhémar de Panat », sur roglo.eu (consulté le )
- Visite virtuelle du Village de Clairvaux
- Visite virtuelle du Village de Bruéjouls
- Office de tourisme Conques-Marcillac
Notes et références
Notes
- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2021, millésimée 2018, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2020, date de référence statistique : 1er janvier 2018.
Références
- Gustave Desjardins (Éditeur scientifique), Cartulaire de l'abbaye de Conques en Rouergue, Paris, A. Picard, , 518 p., in-8 (notice BnF no FRBNF34114898), p. 16 à 21 - Cartulaire de l'abbaye de Conques en Rouergue sur Gallica
- « ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA HAUTE GARONNE, FONDS TOURNIER VAILLAC »
- [PDF]Le décret du 26 février 1958 portant changement du nom de la commune, publié au Journal officiel du 1er mars 1958
- « Résultats des élections municipales 2020 - Maire sortant », sur le site du Télégramme de Brest (consulté le )
- « Répertoire national des élus (RNE) - version du 24 juillet 2020 », sur le portail des données publiques de l'État (consulté le )
- L'organisation du recensement, sur insee.fr.
- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.
- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.
- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018.
- Notice no PA12000006, base Mérimée, ministère français de la Culture
- Notice no PM12000069, base Palissy, ministère français de la Culture
- Notice no PA00093996, base Mérimée, ministère français de la Culture
- Charles Joseph Eugène Marquis de Boisgelin, Les Adhémar : généalogie. Première partie, Draguignan, Impr. de C. et A. Latil, , 336 p., 28 cm (notice BnF no FRBNF34209592), p. 78 - Les Adhémar : généalogie. sur Gallica
- Portail des communes de France
- Portail du Massif central
- Portail de l’Aveyron et du Rouergue